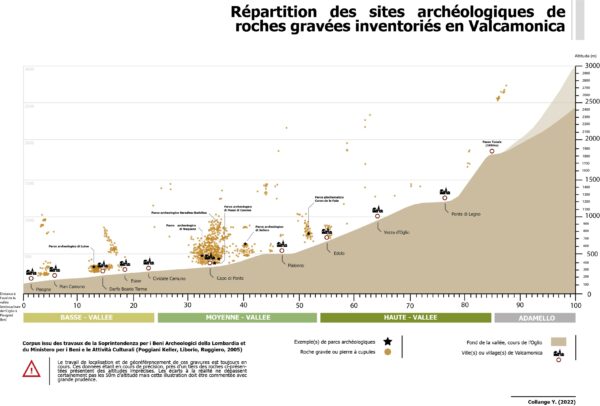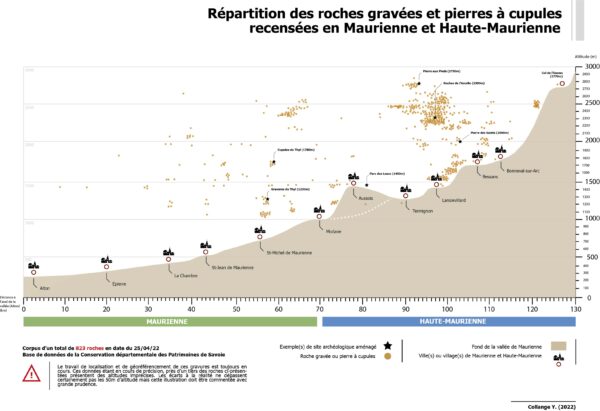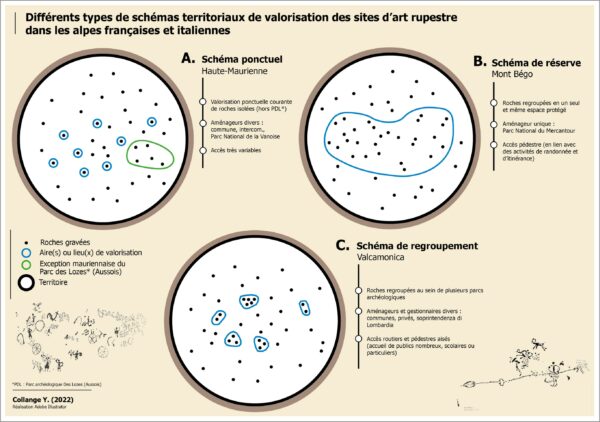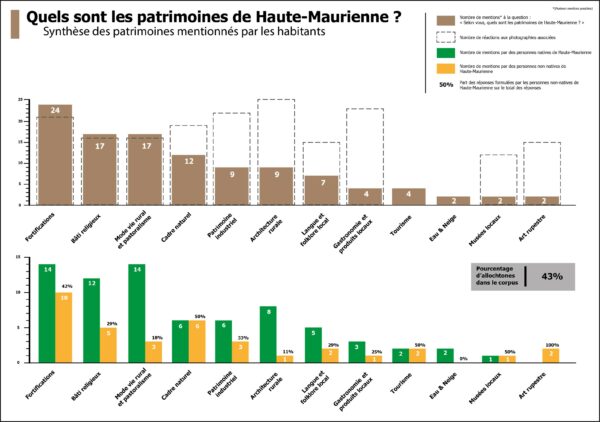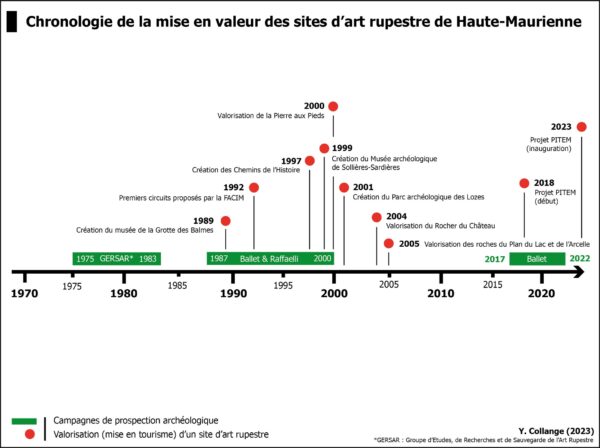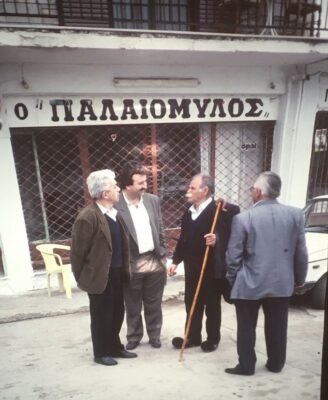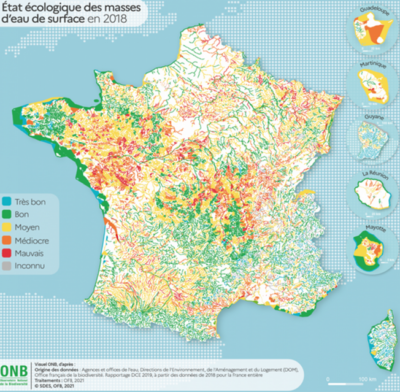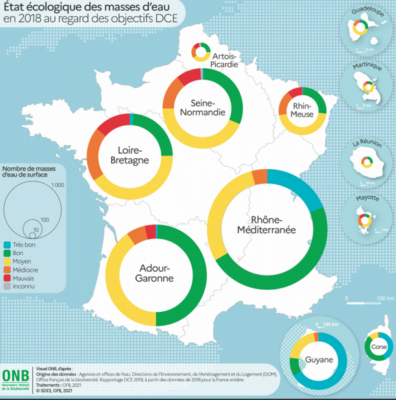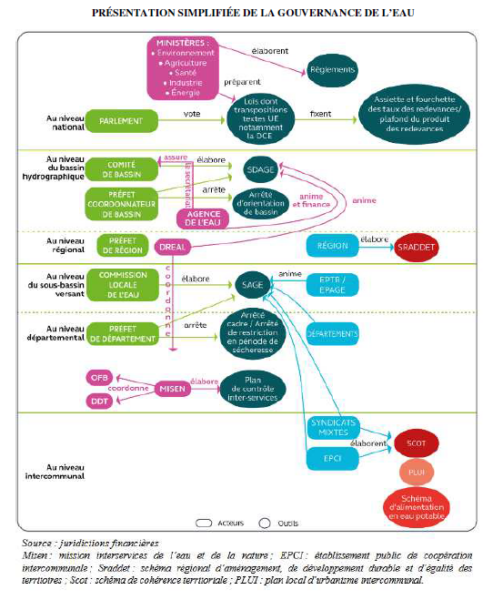Vous pouvez lire le billet sur le blog La Minute pour plus d'informations sur les RSS !
Canaux
4016 éléments (14 non lus) dans 54 canaux
 Dans la presse
(2 non lus)
Dans la presse
(2 non lus)
-
 Cybergeo
Cybergeo
-
 Revue Internationale de Géomatique (RIG)
Revue Internationale de Géomatique (RIG)
-
 SIGMAG & SIGTV.FR - Un autre regard sur la géomatique
(2 non lus)
SIGMAG & SIGTV.FR - Un autre regard sur la géomatique
(2 non lus) -
 Mappemonde
Mappemonde
-
Imagerie Géospatiale
-
 Toute l’actualité des Geoservices de l'IGN
Toute l’actualité des Geoservices de l'IGN
-
arcOrama, un blog sur les SIG, ceux d ESRI en particulier
-
 arcOpole - Actualités du Programme
arcOpole - Actualités du Programme
-
Géoclip, le générateur d'observatoires cartographiques
-
 Blog GEOCONCEPT FR
Blog GEOCONCEPT FR
 Toile géomatique francophone
(12 non lus)
Toile géomatique francophone
(12 non lus)
-
Géoblogs (GeoRezo.net)
-
 Conseil national de l'information géolocalisée
Conseil national de l'information géolocalisée
-
 Geotribu
(1 non lus)
Geotribu
(1 non lus) -
 Les cafés géographiques
(1 non lus)
Les cafés géographiques
(1 non lus) -
 UrbaLine (le blog d'Aline sur l'urba, la géomatique, et l'habitat)
UrbaLine (le blog d'Aline sur l'urba, la géomatique, et l'habitat)
-
 Icem7
Icem7
-
 Séries temporelles (CESBIO)
(2 non lus)
Séries temporelles (CESBIO)
(2 non lus) -
 Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)
Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)
-
 Cartes et figures du monde
Cartes et figures du monde
-
 SIGEA: actualités des SIG pour l'enseignement agricole
SIGEA: actualités des SIG pour l'enseignement agricole
-
 Data and GIS tips
Data and GIS tips
-
 Neogeo Technologies
(1 non lus)
Neogeo Technologies
(1 non lus) -
 ReLucBlog
ReLucBlog
-
 L'Atelier de Cartographie
L'Atelier de Cartographie
-
My Geomatic
-
 archeomatic (le blog d'un archéologue à l’INRAP)
archeomatic (le blog d'un archéologue à l’INRAP)
-
 Cartographies numériques
(4 non lus)
Cartographies numériques
(4 non lus) -
 Veille cartographie
Veille cartographie
-
Makina Corpus (1 non lus)
-
 Oslandia
(2 non lus)
Oslandia
(2 non lus) -
 Camptocamp
Camptocamp
-
 Carnet (neo)cartographique
Carnet (neo)cartographique
-
 Le blog de Geomatys
Le blog de Geomatys
-
 GEOMATIQUE
GEOMATIQUE
-
 Geomatick
Geomatick
-
 CartONG (actualités)
CartONG (actualités)
Les cafés géographiques (1 non lus)
-
 21:35
21:35 Café géo de Saint-Brieuc, 17 octobre 2024 : D’une frontière à l’autre : Etats-Unis et Mexique face à l’immigration clandestine, avec Thomas Cattin
sur Les cafés géographiquesCafé géographique
Amphithéâtre du Lycée Renan
2, Boulevard Hérault – 22000 – Saint-Brieuc
Horaires : 18h à 20h
Entrée libre et gratuite, sans réservation
Accès aux personnes à mobilité réduite
Contact : cafegeo.saintbrieuc@gmail.comLes « Cafés Géographiques » proposent une conférence-débat :
Jeudi 17 octobre 2024
« D’une frontière à l’autre : Etats-Unis et Mexique face à l’immigration clandestine »
avec Thomas CATTINMoins connue que sa jumelle au nord, la frontière sud du Mexique est devenue la principale zone de transit de migrants sans-papiers voyageant vers le nord. Alors que la question de l’immigration cristallise le débat politique aux Etats-Unis, l’administration américaine a fait pression pour que le gouvernement mexicain renforce ses contrôles à sa frontière avec le Guatemala. C’est sur cette frontière stratégique, et plus particulièrement dans la petite ville de Tapachula, que se concentre dès lors un important dispositif policier, militaire et administratif visant à immobiliser les migrants. Le quotidien de Tapachula, surnommée la « ville prison » est bouleversé par la présence de plusieurs milliers « d’étrangers » en attente de visas. Thomas Cattin, doctorant à l’Institut Français de Géopolitique, se propose de montrer les bouleversements générés dans l’espace urbain par ces milliers de migrants.
Thomas Cattin est doctorant à l’Institut Français de Géopolitique. Ses pays d’étude sont le Mexique et les Etats-Unis. Il a publié un ouvrage « Le mur de la discorde » édition Le Grand Continent, 2019.
AFFICHE Café Géo Saint-Brieuc 17 octobre 2024
-
 12:13
12:13 Café géo de Paris, 15 octobre 2024 : Les Etats-Unis et le Monde, avec Philippe Etienne
sur Les cafés géographiquesUn ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis rend compte de l’ampleur des défis auxquels fait face aujourd’hui la première puissance mondiale.
Café de Flore (75006), dans la salle du premier étage, mardi 15 octobre 2024, de 19h à 21h.
Philippe Etienne, ambassadeur de France aux Etats-Unis de 2019 à 2023, a accepté l’invitation des Cafés Géo pour éclairer l’assistance sur les grandes questions géopolitiques de la puissance américaine, sans oublier d’évoquer les fractures de la situation intérieure des Etats-Unis.
Moins de quatre ans après l’assaut sur le Capitole, l’élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024 opposera l’ancien Président Donald Trump et l’actuelle Vice-Présidente Kamala Harris. Deux Amérique continuent de s’affronter dans un contexte international incertain marqué par de nombreux conflits de toute nature. L’hégémonie américaine est menacée à la fois par le spectre de la désunion à l’intérieur et par la remise en cause de l’ordre mondial né en 1945.
Philippe Etienne a été ambassadeur en Roumanie, auprès de l’UE (13 ans au total à Bruxelles), en Allemagne et en dernier lieu aux Etats-Unis (2019 2023).
Il a été conseiller diplomatique d’Emmanuel Macron entre 2017 et 2019.
Il est Président de la Mission pour le 80ème anniversaire de la Libération de la France.Le Café abordera la problématique suivante : l’Europe semble dépassée par l’accumulation des crises et par la compétition entre Washington et Pékin. Comment nos démocraties peuvent- elles défendre leurs intérêts, leur souveraineté et leurs valeurs dans un monde autant déstructuré et violent ?
-
 11:44
11:44 Café géo de Chambéry-Annecy, 10 octobre 2024 : Pourquoi et comment protéger les glaciers et les écosystèmes qui leur succèdent ?
sur Les cafés géographiquesavec Jean-Baptiste Bosson, glaciologue et géomorphologue
10 octobre 2024, 18h, Café Terra Natura, 68 avenue des Neigeos, Seynod
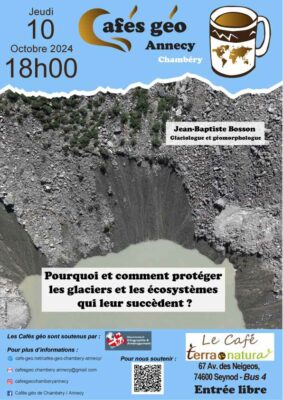 Les glaciers sont de passionnants témoins de l’histoire de la Terre. Sources de terreur puis d’émerveillement, d’aventure et de connaissance, ils permettent de mieux comprendre l’évolution du climat et ses enjeux à l’Anthropocène. Basée sur des résultats récemment obtenus dans les Alpes et dans le monde, cette présentation explore l’évolution fascinante et inquiétante des glaciers sur Terre et met en lumière l’importance de protéger ces géants et les écosystèmes qui leur succèdent.
Les glaciers sont de passionnants témoins de l’histoire de la Terre. Sources de terreur puis d’émerveillement, d’aventure et de connaissance, ils permettent de mieux comprendre l’évolution du climat et ses enjeux à l’Anthropocène. Basée sur des résultats récemment obtenus dans les Alpes et dans le monde, cette présentation explore l’évolution fascinante et inquiétante des glaciers sur Terre et met en lumière l’importance de protéger ces géants et les écosystèmes qui leur succèdent. -
 20:09
20:09 Programme des Cafés géographiques de Paris : saison 2024-2025
sur Les cafés géographiquesMardi 24 septembre 2024, Café géo au Café de Flore : Les territoires de l’extrême droite en France et en Europe, avec Béatrice Giblin, géographe.
Mardi 15 octobre 2024, Café Géo au Café de Flore : Les Etats-Unis et le Monde, avec Philippe Etienne, diplomate.
Samedi 9 novembre 2024, Institut de Géographie : Hommage à Michel Sivignon, de 10h à 12h30.
Mardi 26 novembre 2024, Café Géo au Café de la Mairie (3ème arrondissement) : Qu’est devenue la Yougoslavie ?, avec Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin, journalistes.
Samedi 30 novembre 2024, Institut de Géographie ; Conférence sur Trieste et l’Istrie, avec Daniel Oster et Henry Jacolin, de 10h à 12h.
Mardi 17 décembre 2024, Café Géo au Café de Flore : Une histoire mondiale de l’humanité, avec Christian Grataloup, géographe.
Samedi 18 janvier 2025, Institut de Géographie, de 10h à 12h. ; Conférence sur le Cambodge, avec Michel Bruneau, géographe.
Mardi 28 janvier 2025, Café Géo, au Café de Flore : Vivre au bord de la mer, avec Annaig Oiry, géographe.
Mardi 11 février 2025, Café Géo, au Café de Flore : Géographie des pandémies contemporaines, avec Guillaume Lachenal, historien.
Mardi 25 mars 2025, Café Géo au Café de Flore : Nous aurons toujours besoin des forêts, avec Laurent Testot, journaliste.
Mardi 29 avril 2025, Café géo au Café de Flore :Littérature et géographie, avec Jean-Louis Tissier, géographe, et Emmanuelle Loyer, historienne
-
 20:28
20:28 Le prochain café de Chambéry
sur Les cafés géographiquesavec Alexandre Schon, professeur d’histoire-géographie
le 25 septembre 2024, 18h30, O’Cardinal’s, place Métropole, Chambéry
Alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024 se sont achevés, les impacts à l’échelle locale de ce méga-évènement de rayonnement mondial se révèlent progressivement. À Saint-Denis (93), ils tiennent notamment à un régime d’urbanisme dérogatoire qui a permis la construction accélérée d’équipements sans passer par les concertations citoyennes préalables. Les conséquences sont nombreuses tant en termes urbanistiques et d’accompagnement des processus de métropolisation que de bilan écologique et démocratique.
L’événement aura lieu le 25 septembre 2024 à 18h30 à O’Cardinal’s, place Métropole, Chambéry
-
 17:32
17:32 Hokkaid? : un Finistère presque oublié
sur Les cafés géographiquesCe dossier a été réalisé par Maryse Verfaillie à la suite du voyage qu’elle vient de faire au Japon, particulièrement dans l’île septentrionale d’Hokkaïdo.
? Consulter le dossier Hokkaid? : un Finistère presque oublié
-
 12:36
12:36 Sélection 2025 du Prix du Livre de géographie des Lycéens et Etudiants
sur Les cafés géographiques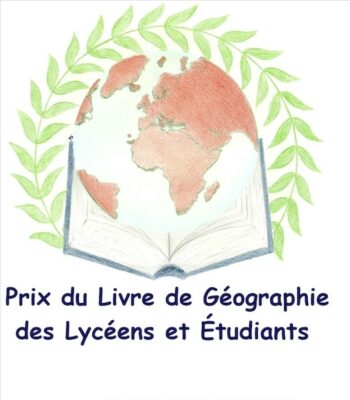
– Rémi Barbier et Sara Fernandez (dir), Idées reçues sur l’eau et sa gestion, Le Cavalier bleu
– Marie Bonte, Nuits de Beyrouth, ENS éditions
– Marc Brosseau, Tableau de la géographie littéraire, Puppa
– François-Michel Le Tourneau, Chercheurs d’or, CNRS éditions
– Sylvain Genevois, Matthieu Noucher et Xemartin Laborde, Le blanc des cartes, Autrement
-
 21:14
21:14 Café géo de Paris, 24 septembre 2024 : Les territoires de l’extrême droite en France et en Europe.
sur Les cafés géographiquesAvec Béatrice Giblin, géographe, géopolitologue
Café de Flore, 24 septembre 2024, 19-21h
Béatrice Giblin, géographe et géopolitologue française, professeur émérite des universités, est l’invitée des Cafés Géographiques pour parler de l’extrême droite de France et en Europe.
En 2012, dans un numéro de la revue Hérodote, elle présentait déjà une analyse géopolitique de l’extrême droite en Europe. En 2022, toujours dans la revue Hérodote, elle posait la question d’une nouvelle géopolitique électorale en France. Aujourd’hui, en 2024, à l’heure où l’extrême droite accroît son audience dans de nombreux pays européens, la lecture géopolitique et l’analyse spatiale s’avèrent des clés de lecture indispensables de ce phénomène.
Ainsi en France, les dernières élections ont montré un net renforcement du processus de diffusion géographique du vote de l’extrême droite. Si le cœur des métropoles et leurs banlieues restent des pôles de résistance à ce vote, l’espace périurbain a constitué le principal espace de progression du vote RN. A l’échelle européenne, Béatrice Giblin a publié dans le journal Le Monde en juin 2024 une série de cartes qui traduit les ressorts communs affectant les territoires les plus affectés par le vote croissant en faveur de l’extrême droite en Europe. Il y a là matière à mieux comprendre ce phénomène et à participer à la discussion collective pendant ce café géo.
Béatrice Giblin (géographe), Sylvie Gittus et Francesca Fattori (Cartographes) : Cartographie des territoires de l’extrême droite en Europe, Le Monde, 7 juin 2024 (édition abonnés)
-
 19:25
19:25 Mardi 24 septembre 2024, au Café de Flore, c’est la rentrée des Cafés Géo !
sur Les cafés géographiques
Cela fait 26 ans que l’aventure des Cafés Géographiques se poursuit et une quinzaine d’années qu’elle emprunte l’adresse parisienne du Café de Flore. Cette année encore, le mardi de 19h à 21h, la salle du premier étage du Flore permettra au public curieux et intéressé d’apprendre et/ou d’échanger à l’occasion de sujets variés grâce aux intervenants invités : géographes, historiens, diplomates, économistes, géopolitologues, journalistes… Cette saison 2024-2025 proposera des sujets d’actualité mais aussi d’autres sujets moins connus pour lesquels l’analyse spatiale et les outils de la géographie proposent des lectures pertinentes et … souvent stimulantes !
Programme des Cafés géographiques de Paris
Saison 2024-2025Mardi 24 septembre 2024 : Les territoires de l’extrême droite en France et en Europe (avec Béatrice Giblin, géographe)
Mardi 15 octobre 2024 : Les Etats-Unis et le Monde (avec Philippe Etienne, diplomate)
Mardi 19 novembre 2024 : Qu’est devenue la Yougoslavie (avec Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin, journalistes)
Mardi 17 décembre 2024 : Géohistoire de l’humanité (avec Christian Grataloup, géohistorien)
Mardi 28 janvier 2025 : Vivre au bord de la mer (avec Annaig Oiry, géographe)
Mardi 11 février 2025 : Géographie des pandémies contemporaines (avec Guillaume Lachenal, historien)
Mardi 25 mars 2025 : Nous aurons toujours besoin des forêts (avec Laurent Testot, journaliste)
Mardi 29 avril 2025 : Littérature et géographie (avec Emmanuelle Loyer, historienne, et Jean-Louis Tissier, géographe)
Le Café géo du mardi 24 septembre 2024, 19h à 21h
Les territoires de l’extrême droite en France et en Europe
(Avec Béatrice Giblin, géographe, géopolitologue)Béatrice Giblin, géographe et géopolitologue française, professeur émérite des universités, est l’invitée des Cafés Géographiques pour parler de l’extrême droite de France et en Europe.
En 2012, dans un numéro de la revue Hérodote, elle présentait déjà une analyse géopolitique de l’extrême droite en Europe. En 2022, toujours dans la revue Hérodote, elle posait la question d’une nouvelle géopolitique électorale en France. Aujourd’hui, en 2024, à l’heure où l’extrême droite accroît son audience dans de nombreux pays européens, la lecture géopolitique et l’analyse spatiale s’avèrent des clés de lecture indispensables de ce phénomène.
Ainsi en France, les dernières élections ont montré un net renforcement du processus de diffusion géographique du vote de l’extrême droite. Si le cœur des métropoles et leurs banlieues restent des pôles de résistance à ce vote, l’espace périurbain a constitué le principal espace de progression du vote RN. A l’échelle européenne, Béatrice Giblin a publié dans le journal Le Monde en juin 2024 une série de cartes qui traduit les ressorts communs affectant les territoires les plus affectés par le vote croissant en faveur de l’extrême droite en Europe. Il y a là matière à mieux comprendre ce phénomène et à participer à la discussion collective pendant ce café géo.
Daniel Oster, Paris, le 29 août 2024
-
 21:59
21:59 Michel Bruneau, un « géographe de transitions »
sur Les cafés géographiques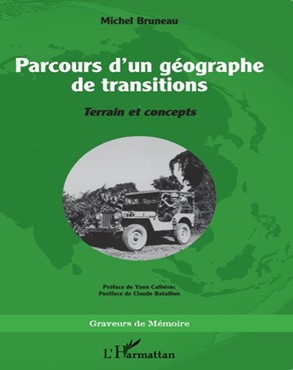
Michel BRUNEAU, Parcours d’un géographe de transitions. L’Harmattan, 2023
Ce « parcours » est le parcours d’une vie, d’une vie professionnelle de géographe bien sûr, mais aussi d’une vie personnelle où amitiés et rencontres intellectuelles jouent un grand rôle, dans le milieu universitaire français comme sur ses terrains d’études en Thaïlande ou en Asie Mineure. En utilisant le terme « transitions » pour qualifier une carrière de plus de 60 ans, Michel Bruneau se réfère à l’espace -passage de l’Asie du Sud-Est au terrain pontique de la Grèce au Caucase -, mais aussi à son évolution personnelle sur les plans méthodologique et épistémologique.
Le géographe est avant tout un homme de « terrain », terme qui définit à la fois un espace, des méthodes et le discours produit sur cet espace. Pour ce faire il collecte des données selon des moyens traditionnels (enquêtes, questionnaires…) mais aussi des techniques novatrices dans les années 1960/1970 (images de télédétection…) et utilise les travaux des autres sciences humaines (anthropologie, histoire…). Le choix des deux grands terrains d’études de Michel Bruneau, l’Asie du Sud-Est et le monde grec pontique, est en grande partie lié à son histoire familiale : un grand-père fonctionnaire en Indochine et un père élève de Pierre Gourou à Hanoï dans le premier cas, des vacances et l’étude du grec ancien au lycée dans le second cas. C’est ainsi que le jeune géographe a commencé sa carrière à l’université de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande dans le cadre du service civil de coopération afin d’y étudier « Les populations de riziculteurs des bassins et vallées ».
A travers les longues années passées en Thaïlande, nous pouvons suivre l’évolution intellectuelle de l’auteur mais aussi celle de la pensée géographique de l’époque.
Les premiers travaux de M. Bruneau se font dans le cadre de la géographie tropicale telle qu’elle a été définie par P. Gourou, une géographie classique post-vidalienne. Il recueille de nombreuses données qualitatives et quantitatives auprès des paysans dont il partage la vie, avec l’aide des étudiants locaux, notamment chez les Karen de la montagne et dans les villages du bassin de Chiang Mai. Ces travaux qui intègrent déjà les images de télédétection Landsat pour la cartographie et le traitement informatique des données chiffrées, sont la base de sa thèse préparée au Centre d’Etudes de Géographie tropicale (CEGET) de Bordeaux.
Au cours des années1970, un clivage divise les géographes selon des facteurs intellectuels et politiques. La géographie post-vidalienne de P. Gourou est vivement contestée par les tenants de la « géographie critique » qui utilise les concepts marxistes de mode de production. Ces derniers expliquent la différenciation des espaces ruraux thaïlandais par la pénétration du mode de production capitaliste sous la pression des impérialismes anglais et français. M. Bruneau, ancien soixante-huitard, sensible aux thèses marxistes d’analyse des sociétés et converti au catholicisme de Témoignage Chrétien, adopte l’approche de la géographie critique dans sa thèse, dirigée par Jean Delvert. La soutenance de celle-ci, en 1977, suscite de vives controverses. D’un côté, les géographes conservateurs – dont le directeur de thèse –, tenants de la géographie tropicale, s’étonnent de l’utilisation de concepts marxistes et refusent l’utilisation de l’histoire et des méthodes nouvelles. De l’autre côté, les « nouveaux » géographes, de gauche, tiers-mondistes, valorisent la problématique marxiste et dénoncent la filiation entre géographie coloniale et géographie tropicale. Sous la pression de J. Delvert, il n’y eut pas de compte rendu de la thèse de M. Bruneau dans les Annales de géographie.
Troisième étape dans son itinéraire intellectuel : l’abandon du schéma marxiste d’explication. La poursuite de ses recherches en Thaïlande l’amène à formuler des limites à la géographie critique. La lutte des classes des années 70 n’a pas débouché sur une réforme agraire. La forte croissance économique et industrielle capitaliste du pays a amené la création d’une nouvelle paysannerie aisée, intégrée dans une force de travail mondialisée. On peut parler de villageois urbanisés dont la cohésion est assurée par une forte identité culturelle.
Les derniers travaux de M. Bruneau sur son terrain asiatique sont marqués par la prédominance de la dimension géohistorique dont les maîtres sont F. Braudel puis C. Grataloup. Il a ainsi montré qu’en Asie de l’Est, deux modèles spatiaux ont été élaborés sur la longue durée, l’un polycentrique et hétérarchique (1), sur le modèle indien, qu’il appelle Etat-mandala, l’autre, de type hiérarchique autour d’une autorité centrale forte, sur le modèle chinois.
Le second grand terrain du géographe concerne les Grecs pontiques et l’amène à se déplacer de la Grèce à la Turquie et au Caucase russe et géorgien, mais aussi dans d’autres parties du monde (France, Amérique du Nord, Australie). Ces recherches ont été faites dans le cadre d’une nouvelle unité de recherche, « Territorialité et Identité dans le domaine européen » (TIDE). Le travail porte sur les diasporas et les communautés transnationales. En effet, le traité de Lausanne (1923) a contraint les Grecs d’Asie Mineure, du Pont et de Thrace orientale à quitter la nouvelle République turque pour l’Etat grec puis le reste du monde.
Bruneau s’engage dans ces recherches avec une nouvelle approche scientifique, celle de la géographie culturelle, telle qu’elle a été définie par Paul Claval. Les descendants des migrants pontiques ont gardé une forte mémoire du territoire d’origine de leurs ancêtres. La transmission de la mémoire des lieux d’origine, assurée par des associations culturelles, utilise une iconographie très riche et des voyages-pèlerinages. Monuments commémoratifs, images murales, toponymes évoquent aussi bien les mythes antiques que les violences turques plus récentes. On part à la découverte du village où vivaient les ancêtres ; même s’il est difficile de retrouver leurs maisons et si l’église a été transformée en mosquée, on reçoit un bon accueil des habitants actuels. La mémoire est aussi entretenue par les œuvres littéraires, comme les romans historiques de Christos Samouelidis ou les articles de Photis Kontoglou.
Le travail sur les migrations des Grecs pontiques a amené M. Bruneau à élaborer un nouveau concept, celui de « peuple-monde de la longue durée » (2). Un peuple-monde est une entité socio-politique et culturelle dont la dimension excède celle d’un seul Etat. Les enquêtes de terrain sont fondamentales dans ce nouveau champ de recherche, mais l’utilisation de données statistiques et la cartographie des paysages n’y ont pas leur place. De nombreuses références scientifiques ont guidé notre géographe, celles de F. Braudel et de de C. Grataloup déjà cités, mais aussi celles de P. Nora, de J. Gottman, d’A. Smith (l’approche mytho-symbolique de « peuple ») ou de J. Lacarrière (continuité de l’hellénisme de l’Antiquité à nos jours). Un peuple-monde a un Etat territorial et une diaspora mondiale.
Chez les Grecs, la continuité historique a été assurée par la langue, porteuse d’une culture, l’hellénisme. Une même langue parlée depuis l’Antiquité et une même spiritualité chrétienne depuis Byzance, l’orthodoxie. Un modèle spatial en cinq auréoles concentriques permet de comprendre la dimension spatiale de l’hellénisme, depuis l’espace égéen central jusqu’aux auréoles externes de la diaspora dans le Nouveau Monde et en Afrique.
A partir de ses analyses sur l’hellénisme, M. Bruneau a pu distinguer cinq autres peuples-monde de la longue durée : Indiens, Chinois, Juifs, Arméniens et Iraniens. La longévité de leur culture est exceptionnelle (même s’ils ont assimilé d’autres éléments culturels).
En conclusion, M. Bruneau reconnait qu’au cours de sa vie de chercheur-géographe, il a suivi deux approches différentes, celle d’une étude spatiale à différentes échelles (village, Etat, ensemble d’Etats) en Asie du Sud-est et celle des réseaux et des lieux à l’échelle mondiale pour la diaspora grecque. Mais au-delà de leurs différences, ces approches ont des caractères communs : immersion dans les cultures étudiées sur une longue période, approche interdisciplinaire, modélisation graphique, importance des relations amicales pour la compréhension du milieu…). Les inflexions de son itinéraire scientifique reflètent l’évolution des courants de la pensée géographique en un demi-siècle.
Notes :
(1) hétérarchique : relatif à un système d’organisation non hiérarchique qui est caractérisé par l’interrelation et la coopération entre les entités qui la composent.
(2) peuple-monde de la longue durée : concept élaboré par le géographe Michel Bruneau. Voir la synthèse : Michel Bruneau, Peuples-monde de la longue durée. Chinois, Indiens, Iraniens, Grecs, Juifs, Arméniens, CNRS Editions, 2022.
Michèle Vignaux, juillet 2024
-
 21:04
21:04 Géopolitique des céréales
sur Les cafés géographiques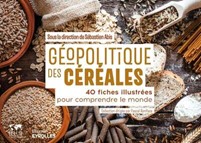
Géopolitique des céréales, sous la direction de Sébastien ABIS,
Editions EYROLLES, 2024Cet album, de taille modeste mais au contenu très dense, traite de ce qui constitue la moitié des calories consommées sur la planète, les céréales, cultivées, transformées, transportées, utilisées à des fins politiques. Sur les 40 fiches proposées, 20 sont consacrées au blé, à deux échelles, mondiale et française, 20 traitent des autres céréales et des produits alimentaires les plus populaires conçus à partir des céréales. Chaque thème est abordé par un texte de deux courtes pages, un « focus » qui en développe un aspect majeur ou peu connu et une illustration (carte, graphique ou schéma).
Les médias généralistes suscitent régulièrement les inquiétudes de leurs lecteurs en annonçant les pénuries futures de matières premières et de ressources énergétiques mais peu évoquent des pénuries possibles, voire probables, de produits alimentaires. Sur les 700 millions d’hectares cultivés dans le monde (à peu près la surface de l’Australie), la moitié est consacrée aux céréales. Or celles-ci constituent la moitié des calories consommées par la population mondiale. Trois fiches font de la « géopolitique-fiction » (2040, 2050, 2060). Elles présentent plutôt des scénarios catastrophes. Est-ce pour nous alerter ? En 2040 il faudra nourrir 9 milliards d’hommes alors que les incidents climatiques seront de plus en plus fréquents et que les superficies emblavées seront réduites par l’artificialisation des sols et le souci de conserver la biodiversité. A ces inquiétudes il faut ajouter la volonté de puissance de certains Etats qui peuvent utiliser l’« arme du blé ». La sécurité alimentaire se pose dans des termes difficiles.
Même si le blé n’a plus que le deuxième rang (après le maïs) dans la production céréalière, sa consommation est vitale pour une population mondiale dont l’urbanisation a changé les habitudes alimentaires. Partout sur la planète, on consomme du blé sous des formes différentes. Or si la Chine et l’Inde sont les premiers producteurs mondiaux, la Russie, troisième producteur, est, depuis cinq ans, le premier exportateur mondial (25% à 30%) et le changement climatique devrait lui permettre d’étendre largement ses terres cultivables (à contrario, les sécheresses vont affecter lourdement les « terres à blé » aux Etats-Unis, en Europe, en Australie…). Même si l’Union européenne reste le deuxième exportateur mondial – mais il n’y a pas de politique céréalière extérieure commune -, beaucoup de pays d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est sont et seront très dépendants de la Russie. Néanmoins la sécheresse récente dont a souffert récemment le sud du pays montre que son pouvoir sur la scène internationale n’est pas inébranlable. Par contre l’Ukraine a réussi à empêcher la catastrophe économique engendrée par l’invasion russe de février 2000. Les exportations de grains – dont une majorité de blé- qui n’atteignaient plus 500 000 tonnes en mars 2022, ont été de 7 millions de tonnes en avril 2024. Le conflit logistique a été gagné par les Ukrainiens grâce aux « nouvelles voies de solidarité » (terrestres et fluviales) et au corridor maritime de la mer Noire.
Au sein des pays de l’U.E., la France occupe une place privilégiée (5ème producteur et 5ème exportateur mondial). Le blé occupe 20% de la S.A.U. (2) et a des rendements élevés. Ces résultats sont remarquables pour un pays qui a connu le rationnement jusqu’en 1949. Mais le blé français (comme tous les blés européens) est dépendant des engrais riches en azote (150-200 kg/ha), nécessaires à une forte teneur en protéines. Or l’azote provient du gaz naturel fourni jusqu’alors par…la Russie. Il faut donc miser sur la recherche agronomique pour faire des progrès dans la génétique végétale et les engrais bas-carbone pour assurer notre sécurité alimentaire.

Depuis la fin du XXe siècle, le maïs est la céréale prédominante. Les Etats-Unis, la Chine, le Brésil et l’Argentine fournissent 70% de la récolte mondiale annuelle et 90% des exportations. L’U.E., première zone d’importation, se fournissait principalement en Ukraine qui connait une baisse drastique de ses exportations. Ce choix s’explique par le label « sans O.G.M. » du maïs ukrainien, à la différence des maïs produits sur le continent américain. L’expansion du maïs – qui occupe actuellement 1/8 des terres cultivées – suscite des controverses. Alors que des millions de personnes sont sous-alimentées et que la croissance démographique va se poursuivre jusqu’en 2050, est-il raisonnable de consacrer 60% de la première céréale mondiale à l’alimentation animale et un pourcentage non négligeable à la fabrication du bioéthanol et à divers usages industriels ?
Production asiatique par excellence, le riz réclame des conditions de culture très exigeantes, climatiques particulièrement, qui risquent d’être très impactées par le changement climatique. Or il est nécessaire d’accroître rapidement la production. La Chine, premier pays producteur, est aussi importatrice et en Inde, premier exportateur, 40% de la population souffre de malnutrition. Seulement 10% de la production sont commercés dans le monde. Pourtant c’est en Afrique subsaharienne, faible productrice, que la demande augmente le plus rapidement (la croissance de la demande est de 6% par an). Et la production africaine ne satisfait que 55 à 60% de la consommation. Entre 2023 et 2050, la population africaine doit doubler. Il est donc indispensable de revenir aux céréales traditionnelles, mils et sorgho.
Mils et sorgho sont des céréales à redécouvrir car elles ont des qualités nutritives et sont peu exigeantes en matière climatique et écologique. La F.A.O. (2) en fait la promotion sans rencontrer beaucoup de succès jusqu’alors.
Assurer la sécurité alimentaire de leur population dans les décennies à venir constitue donc un défi difficile à relever pour beaucoup d’Etats. Ils doivent non seulement faire aux risques naturels induits par le changement climatique mais aussi aux stratégies de puissance de quelques grands pays. Le conflit ukrainien en donne un exemple. On a déjà évoqué la dépendance de nombreux Etats à l’égard des blés russes. Il faut aussi souligner l’action de la Chine qui, bien qu’importatrice elle-même, utilise les besoins africains en riz pour accroître son influence. La deuxième puissance mondiale pratique une politique de stockage des céréales (blé, maïs, riz) à grande échelle. Elle détient plus de 50% des stocks mondiaux de céréales, ce qui lui permet de faire face à d’éventuelles mauvaises récoltes mais aussi lui donne du pouvoir sur les acheteurs.

Certains produits alimentaires fabriqués à partir de céréales contribuent au soft power des Etats dans lesquels ils ont été conçus, par leur notoriété mondiale. Ils sont porteurs d’une identité nationale, qu’il s’agisse de la tortilla mexicaine d’origine précolombienne, de la pasta italienne exportée dans le monde par les migrants italiens dès la fin du XIXe siècle et bien sûr de la baguette française de tradition (les normes de fabrication ont été fixées par décret) qui a été classée au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2022. Le sushi, produit culturel japonais largement diffusé depuis la fin du XXe siècle, était à l’origine une méthode de conservation du poisson. Aliment et boisson, la bière est le premier alcool au monde (180 milliards de litres sont consommés par an dans le monde. C’est un vrai produit de la mondialisation qui était déjà fabriqué dans l’Antiquité (Mésopotamie, Egypte…). Les grands producteurs de bière (Chine, Etats-Unis, Brésil, Mexique et Allemagne) utilisent du malt produit dans des malteries, secteur dans lequel la France est leader mondial (premier producteur et premier exportateur mondial depuis 1967) grâce à son haut niveau d’expertise. 1 pinte sur 5 bue dans le monde est faite avec du malt français ! la production française de bière (6ème rang mondial) est un secteur dynamique, créateur d’emplois qui font une large place aux cadres jeunes et féminins.
Nous pouvons clore cette présentation « en élevant le débat ». La culture des céréales a été génératrice de « grandes cultures » : les premières civilisations du Moyen Orient, il y a plus de 10 000 ans. Les croyances et rituels religieux leur ont accordé une grande place symbolique (par exemple, le pain dans le sacrement de l’Eucharistie).
L’étude des céréales nous a permis de traiter de géographie, de géopolitique, d’histoire, de gastronomie…et même de religion !
(1) A.U. : surface agricole utilisée. Elle comprend l’ensemble des terres arables, les pâturages et les cultures permanentes
(2) FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricultureMichèle Vignaux, juin 2024
(Ce compte rendu a pu bénéficier d’informations glanées dans le webinaire organisé par S. Abis et son équipe pour accompagner la sortie de l’ouvrage).
Les illustrations ont été reproduites avec l’aimable autorisation des Editions Eyrolles.
-
 10:57
10:57 Toujours plus vite et plus loin ? Mobilités et transports dans le monde
sur Les cafés géographiques
Xavier Bernier au Flore. Photo de Micheline Huvet-Martinet
En ce 30 avril, c’est un géographe « en mouvement », auteur d’un récent Atlas des mobilités et des transports (1), que les Cafés géo accueillent au Flore. Présenté par Gilles Fumey, Xavier Bernier est professeur de géographie à Sorbonne Université où il dirige le Master TLTE (transports). Notre invité qui a gardé de son expérience de montagnard dans les Alpes, le goût des cordages pour assurer sa progression, nous propose un Café collectif et participatif pour traiter des mobilités. Pas de micro pour pouvoir mieux bouger et des cordes pour symboliser les déplacements.
Pour sensibiliser le public aux différents plans de référence dans lesquels s’exerce une mobilité, il lui demande de « faire un freeze » (rester immobile un court instant). Pendant ce temps d’immobilité, le spectateur-cobaye s’est pourtant déplacé à la vitesse de 1100 km/h (vitesse de la rotation de la terre sur elle-même), de 107 000 km/h (vitesse de la rotation de la terre autour du soleil), de 300 000 km/s (vitesse de la lumière). Donc trois vitesses en même temps.
Pour aller d’un point A à un point B, des possibilités diverses s’offrent au voyageur : le « vol d’oiseau », le « chemin des écoliers » (qui suppose plusieurs arrêts en route), la « mobilité immobile » (comme dans 20 000 lieues sous les mers) …Plusieurs sentiments et sensations peuvent donc accompagner une même mobilité. Le choix du moyen de transport n’est pas non plus indifférent. La mobilité sera différemment ressentie selon que l’on opte pour la marche, l’hélicoptère ou le taxi.
Une mobilité déterminée par un objectif bien identifié peut donner lieu à un récit, qu’il soit oral, écrit ou validé par un selfie. « Faire un récit », c’est prouver qu’on est allé quelque part. « J’ai fait New York » : cette expression, incorrecte sur un plan linguistique mais fréquemment utilisée, « pose » son locuteur en tant que voyageur. Le récit permet de réinitialiser le projet de mobilité à plusieurs reprises.
On peut aussi faire le choix de l’aléatoire (ne pas décider d’une destination avant le départ). Prendre le premier bus qui passe ou se promener dans Paris « nez au vent » demandent un travail de réinitialisation permanente. On peut découvrir quelque chose qu’on n’attendait pas et faire ainsi preuve de sérendipité.
Mobilité et immobilité peuvent avoir aussi un sens politique (adhérer ou pas à certaines injonctions).
Pour comprendre les déterminants de tout déplacement, Xavier Bernier se réfère à la figure du triangle dont les trois points sont reliés. Un premier point correspond au support matériel, c’est-à-dire aux infrastructures nécessaires à toute mobilité (routières, ferroviaires, aéroportuaires…). Le deuxième dépend de choix politiques (limitation de vitesse, péages…). Dans certaines villes, on a tenté, à titre d’expérience, de supprimer tous les matériaux de signalisation, ce qui a amené…une diminution des accidents. Quant au troisième point, il concerne les usages. Cette notion se rapporte à la façon dont les voyageurs utilisent les infrastructures et valident ou pas la réglementation. Il semble qu’en France on donne la priorité aux infrastructures. C’est la dimension matérielle qui prime, ce que confirment les Atlas classiques montrant de nombreuses cartes d’infrastructures. Pourtant ce choix, fait le plus souvent par les dirigeants politiques, est-il toujours pertinent ? Il arrive que certaines gares, fleurons de la modernité, se transforment en « gares à betteraves » au bout de quelques années. En effet les usagers ne sont pas toujours d’accord avec les choix de leurs dirigeants. Les habitudes changent (on peut prendre l’exemple de tous ceux qui ont renoncé à l’avion pour des raisons écologiques).
En conclusion Xavier Bernier assure que c’est la liberté de circulation qui « fait société » car la mobilité, avec ses différents arrêts, met les hommes en relation les uns avec les autres.
Dialogue avec le public- Les mobilités virtuelles permettent-elles de « faire société » comme les mobilités réelles ?
Pendant le COVID, l’immobilité n’a été que relative. Le télétravail a rendu les individus plus mobiles. Ce sont les mobilités pendulaires qui ont diminué, mais l’indice de mobilité a augmenté. Les outils de télécommunication rapides favorisent les déplacements réels.
- Qu’en est-il des rapports entre mobilités et pouvoir ?
Les historiens nous apprennent que la Poste a été inventée par les Mongols et qu’en France c’est Henri IV qui a été le premier souverain à penser à un réseau postal. Le réseau postal est devenu un réseau de pouvoir.
A une autre échelle, on peut évoquer les actuels problèmes de l’autoroute A3. C’est la construction d’un parking voulu par un dirigeant politique, qui serait responsable des effondrements entrainant sa fermeture.
Bien sûr, les voies romaines ont joué un rôle majeur dans l’organisation du grand empire de l’Antiquité.
Récemment le gouvernement chinois a institué la gratuité du train Pékin-Lhassa pour favoriser l’usage du train par les voyageurs. C’est donc un choix politique.- Comment peut-on intégrer la question, centrale, du temps dans les mobilités ?
Autrefois on considérait le mouvement du « slow » comme un art de vivre. D’autres, au contraire, recherchent la vitesse qui peut être obtenue de différentes façons. En cas d’affluence sur une autoroute, il faut diminuer la vitesse pour fluidifier la circulation. Que choisir entre le train et l’avion pour les moyennes distances ? certes le train est moins rapide que l’avion mais il dessert le centre-ville. Et le TGV, s’il a une vitesse d’exploitation de 300km/h, peut dépasser les 500 km/h.
- L’informatique génère-t-elle les mêmes problématiques que les mobilités réelles ?
La digitalisation amène le déplacement du doigt sur un écran…On se déplace avec un portable à la main…En matière informatique, la mobilité est en fait visible (cf les balises, éléments de base du système de codage HTML).
- Ne faudrait-il pas remplacer le ministère des transports par un ministère des mobilités ?
Actuellement il existe une Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités au sein du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
1) Xavier BERNIER, Atlas des mobilités et des transports, Pratiques, flux et échanges, Paris, Autrement, 2023
Michèle Vignaux, mai 2024
-
 15:58
15:58 Etats et frontières en Asie centrale.Relier le Ferghana au reste de l’Ouzbékistan
sur Les cafés géographiques
1. Ouzbékistan. Sous le col de Kamchik, au nord
(cliché de Denis Wolff, 5 mai 2023)
(le même paysage en hiver, et en été)Au printemps 2023, parcourant l’Ouzbékistan entre Tachkent et la plaine du Ferghana[i], je traverse en voiture la chaîne du Qurama par le col de Kamchik[ii]. J’avoue être quelque peu surpris d’effectuer ce voyage sur une autoroute – ou au moins une route à deux fois deux voies – dans une région de haute montagne. Le col culmine à plus de 2200 mètres et les sommets, visibles au fond, encore enneigés au mois de mai (à environ la même latitude que Madrid), traduisent une altitude élevée. Si cette autoroute se révèle utile au vu de l’importance du trafic (outre les nombreux véhicules visibles sur la photographie, on note la présence d’un panneau publicitaire au-dessus du lacet), sa construction a dû coûter fort cher. Or l’Ouzbékistan n’est pas un pays riche. Son PIB (produit intérieur brut) par habitant est faible (bien qu’en croissance) : selon les sources, il se situe entre le 125ème et le 168ème rang mondial, sur environ 200 Etats (celui de la France est entre le 23ème et le 39ème rang mondial).

2. Ferghana et haute vallée du Syr-Daria (carte allemande, © Wikipédia en allemand)
Ferghana désigne une ville mais aussi la plaine qui s’étend entre les montagnes.
Chushand = Khodjent ou Khoudjand (ville tadjike) en allemand.Je me pose alors la question : pourquoi cette autoroute ? La réponse semble simple. Au sud du col de Kamchik, s’étend le Ferghana, arrosé par le Syr-Daria et ses affluents, ce qui a permis, à l’époque soviétique, la monoculture irriguée du coton (aujourd’hui les cultures sont plus variées). Cette plaine, peuplée (6,5 millions d’habitants), est vitale pour l’Ouzbékistan : sur moins de 5% de la superficie du pays, vivent presque 20 % de sa population (densité très forte), sans parler de son importance économique. Au nord du col, on atteint la capitale, Tachkent (2,6 millions d’habitants) et tout le reste de l’Ouzbékistan. Je suis sur la seule voie routière qui relie le Ferghana au reste du pays.
Pourquoi cette situation ?
Depuis la nuit des temps, si j’ose ainsi m’exprimer, la vallée du Syr-Daria est le débouché « naturel » du Ferghana vers l’ouest. La principale route de la soie suivait cet itinéraire, venant de Boukhara et Samarcande, traversant le Ferghana puis la chaîne élevée du Tian Shan avant de redescendre sur Kachgar (ou Kashi) au Xinjiang… A l’époque soviétique, pour aller du Ferghana à Tachkent, la voie ferrée et la route suivaient le même itinéraire par la vallée du Syr-Daria que l’on quittait peu avant Tachkent. On traversait certes la République socialiste soviétique du Tadjikistan, et notamment la ville de Léninabad (aujourd’hui Khodjent ou Khoudjand), mais cela ne posait alors aucun problème.
3. Carte politique. Confins de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Kirghizistan
(carte allemande, © Wikipédia en allemand)Mais l’URSS éclate en 1991 et toutes les Républiques socialistes soviétiques qui la composaient deviennent des Etats indépendants sans l’avoir ni demandé ni prévu. En Asie centrale, les relations deviennent rapidement très mauvaises entre les nouveaux Etats voisins : les frontières très sinueuses dessinées par le petit père des peuples (Staline) deviennent donc des barrières difficilement franchissables pour les hommes et les marchandises (en raison de la longueur et du coût des formalités), voire infranchissables. Cela est d’autant plus complexe qu’il y a beaucoup d’enclaves et d’exclaves, en raison partiellement du mélange des populations. D’ailleurs, les minorités nationales sont nombreuses : si, en Ouzbékistan, les Tadjiks ne représentent que 5 % de la population (et les Kirghizes sont peu nombreux), il y a environ 14 % d’Ouzbeks au Tadjikistan comme au Kirghizistan. Et le gouvernement ouzbek s’inquiète de leur sort… mais réprime lui-même ses minorités, tels les Karakalpaks… Les trois Etats promeuvent chacun le nationalisme, ce qui ne facilite pas non plus les rapports avec les voisins. Ils s’accusent mutuellement de pomper l’eau de l’Amou-Daria et du Syr-Daria au détriment des régions situées en aval… et de la mer d’Aral. Enfin, l’histoire de ces jeunes Etats est complexe : succession de régimes autoritaires (Ouzbékistan), parfois entrecoupés par des révolutions (en 2005 et 2010 au Kirghizistan), voire de guerres civiles (Tadjikistan de 1992 à 1997 avec une reprise entre 2010 et 2012).
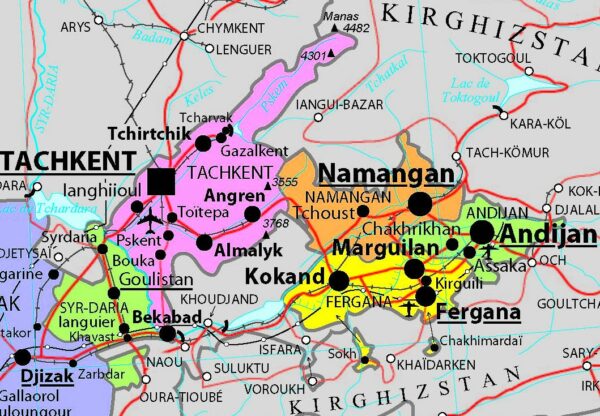
4. L’Est de l’Ouzbékistan (© Ministère des Affaires étrangères)
Routes = traits rouges. Voies ferrées = traits noirs (barrés si elles sont électrifiées)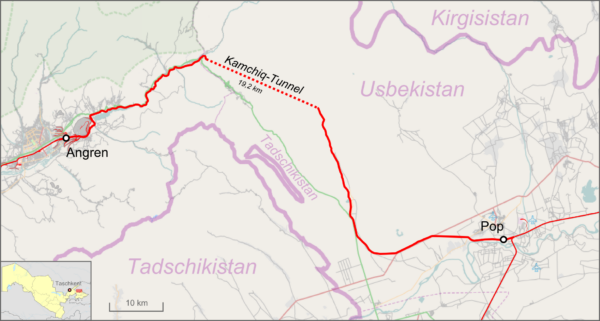
5. Tunnel du Kamchik (carte allemande, © Wikipédia en allemand)
Dans ces conditions, la plaine du Ferghana s’est trouvée isolée du reste de l’Ouzbékistan ; l’autoroute du col de Kamchik est le seul passage routier. Les autorités s’efforcent de le laisser ouvert autant que possible. Mais, en raison du climat continental, les hivers sont très froids, et l’autoroute est parfois coupée par des avalanches ou des glissements de terrain. C’est pourquoi, en 2013, la construction d’une liaison ferroviaire a été décidée. Quand on part de Tachkent, on utilise d’abord l’ancienne voie ferrée qui va jusqu’à Angren (cf. Carte 4). On a construit une nouvelle voie ferrée (non indiquée sur la Carte 4, voir Carte 5) de 120 kilomètres de long entre Angren et Pop (ou Pap, ville du Ferghana située entre Kokand et Namangam). On remonte d’abord la vallée de la rivière Angren, affluent du Syr-Daria, avant de traverser la chaîne du Qurama, à 1420 mètres d’altitude, par le tunnel de Kamchik de presque vingt kilomètres de long ; ce serait le plus long d’Asie centrale. On redescend ensuite dans le Ferghana. L’Ouzbékistan a financé la construction de la voie ferrée et la Chine celle du tunnel, bien plus coûteuse (tunnel creusé par un groupe chinois). L’inauguration de la ligne, en 2016, a d’ailleurs lieu en présence du président de l’Ouzbékistan, mais aussi de celui de la Chine. Ce pays est en effet favorable à l’ouverture de cette nouvelle route de la soie qui désenclave l’Asie centrale, sans parler de son intérêt pour les richesses de son sous-sol. Pour l’Ouzbékistan, cette voie ferrée assure une liaison permanente avec le Ferghana et lui permet d’économiser les millions de dollars de droits de transit qu’il versait auparavant au Tadjikistan.
En raison de l’érection d’une nouvelle frontière, particulièrement sinueuse et souvent étanche, l’axe de communication très ancien par la vallée du Syr-Daria a été fermé au profit d’un nouvel axe qui traverse une chaîne de montagnes, mais qui ne quitte pas l’Ouzbékistan.
Le cas de l’autoroute et du tunnel de Kamchik est spectaculaire mais non unique en Asie centrale. En effet, les Etats voisins de l’Ouzbékistan sont également confrontés à la sinuosité de frontières compliquées à traverser, voire étanches. Faute d’argent, ces nouvelles voies de communication sont en grande partie financées par des puissances voisines… naturellement peu désintéressées. Ainsi, au Tadjikistan, à 2700 mètres d’altitude, le tunnel d’Anzob, financé en grande partie par l’Iran, permet de relier la capitale Douchanbé à Khodjent (ou Khoudjand, au Nord) en toute saison sans quitter le pays. Et, pour désenclaver le Ferghana kirghize, on a construit une autoroute qui passe à plus de 3000 mètres d’altitude, entre la capitale, Bichkek et Och, au Ferghana kirghize. Et, bien plus près de chez nous, en Croatie, la construction du pont de Pelješac (2022), qui permet de relier Dubrovnik au reste de la Croatie sans passer par la Bosnie, relève de la même logique.Denis Wolff, février 2024
[i] Cette plaine du Ferghana est actuellement partagée entre trois Etats : le Tadjikistan, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan. Ce dernier en possède la plus grande part. Dans cet article, il ne sera question que du Ferghana ouzbek.
[ii] L’orthographe des noms ouzbeks est variable : le col de Kamchik s’écrit également Kamchiq ou Qamchiq, la plaine du Ferghana se note aussi Fergana…
-
 15:38
15:38 L’Urbex : une exploration géographique des lieux abandonnés
sur Les cafés géographiquesPar Aude Le Gallou
Maître assistante en géographie Université de GenèveL’intervention d’Aude Le Gallou dans le cadre d’un Café Géographique qui s’est tenu à Chambéry le 6 décembre 2023 portait sur une partie de ses travaux de thèse intitulée « Géographie des lieux abandonnés. De l’urbex au tourisme de l’abandon : perspectives croisées à partir de Berlin et Détroit » et soutenue en 2021 à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
L’introduction de ce Café Géographique chambérien prend la forme d’une question adressée au public : « L’urbex qu’est-ce que c’est ? »
Afin de répondre à cette question, Aude Le Gallou met en évidence plusieurs aspects de cette pratique : une exploration (souvent illégale) de lieux abandonnés, une pratique underground de plus en plus populaire ou encore, des règles… pas toujours respectées ! Par ailleurs l’intervenante souligne que l’exploration urbaine – car c’est bien la définition de l’urbex- est apparue dans les années 1990. Il s’agit de fait, selon elle, d’une pratique relativement jeune dont la popularisation est liée à l’essor d’internet. Au sujet des règles de cette pratique, Aude Le Gallou en rappelle quelques-unes : ne rien forcer pour entrer dans un lieu, ne pas altérer un lieu (on ne prend rien, à l’exception de photos), ou encore, ne pas divulguer la localisation précise d’un lieu visité (pour éviter tout vol et dégradation par des personnes malveillantes).
C’est à travers la pratique de l’urbex appréhendée d’un point de vue géographique qu’Aude Le Gallou se propose d’animer ce Café Géographique.Photo d’une ancienne usine en Allemagne, A. Le Gallou, 2023
1/ Les lieux abandonnés : des espaces marginauxEn préambule de cette première partie, Aude Le Gallou questionne la définition d’un lieu abandonné : « Qu’est-ce qu’un lieu abandonné ? » Le lieu abandonné peut présenter une « dimension variable allant de l’énorme usine abandonnée de Détroit à la petite maison individuelle délaissée d’Île de France ». Pour l’intervenante, il est également nécessaire de prendre en compte dans cet exercice de définition du lieu abandonné la question de la durée de l’abandon et par conséquent un état de dégradation variable. Aude Le Gallou propose de définir l’abandon par le croisement de cinq dimensions (voir figure ci-dessous) :
 La dimension fonctionnelle : absence d’usage, perte de son usage
La dimension fonctionnelle : absence d’usage, perte de son usage
 La dimension matérielle : l’absence d’entretien entraînant la dégradation du lieu
La dimension matérielle : l’absence d’entretien entraînant la dégradation du lieu
 La dimension économique : l’absence de valeur liée à des lieux qui ne produisent plus
La dimension économique : l’absence de valeur liée à des lieux qui ne produisent plus
 La dimension légale : le maintien malgré l’abandon du droit de propriété bien que les propriétaires ne s’acquittent plus de leur devoir (affaiblissement de la propriété)
La dimension légale : le maintien malgré l’abandon du droit de propriété bien que les propriétaires ne s’acquittent plus de leur devoir (affaiblissement de la propriété)
 La dimension symbolique : affaiblissement des formes d’attachement au lieu
La dimension symbolique : affaiblissement des formes d’attachement au lieuPour Aude Le Gallou, chacune de ces dimensions recouvre des degrés d’abandon variables (un lieu peut être plus ou moins dégradé sur le plan matériel, par exemple), et les nombreuses combinaisons possibles de ces cinq dimensions permettent de rendre compte de la grande diversité des situations d’abandon. Et d’ajouter que par l’abandon, « des lieux peuvent sortir des périmètres praticables et des espaces pratiqués, ils représentent alors une discontinuité, une exception dans les espaces où ils s’insèrent ».
Au-delà de ces 5 dimensions, l’intervenante met en évidence l’image des lieux abandonnés qui bien souvent sont « associés à des activités transgressives, comme les vols, les trafics en tout genre ou les graffitis qui témoignent de la place qu’occupent dans ces lieux des activités informelles à la visibilité moindre ». Elle rappelle par ailleurs que « bien souvent à l’échelle locale une friche est mal perçue, elle représente une nuisance pour un territoire ».
Les 5 dimensions de l’abandon, réalisation A. Le Gallou
2/ L’urbex, une valorisation des lieux abandonnésC’est ainsi qu’Aude Le Gallou s’est intéressée dans cette seconde partie à la manière dont l’urbex, en tant que pratique, investit les lieux abandonnés. Pour elle, l’urbex participe à une forme d’esthétisation de la ruine ou de la friche contemporaine, « une esthétique qui repose sur la matérialité du bâtiment, les trous, les manques, les jeux de lumière, le jeu entre la construction de l’Homme et la nature qui reprend ses droits ». Pour l’intervenante, à travers l’urbex, c’est bien « toute une iconographie de la ruine contemporaine qui se développe entraînant une valorisation esthétique mais également mémorielle ». « Certains urbexeurs entreprennent une démarche d’historien amateur en reconstituant l’histoire d’un lieu exploré, en allant aux archives ou en recueillant des témoignages ». Par conséquent, Aude Le Gallou souhaite faire ressortir que la pratique de l’urbex participe à un glissement de « l’abandon répulsif » vers « un abandon attractif » (voir figure ci-dessous). Cette transition prend la forme d’une triple revalorisation à laquelle participe l’exploration de lieux abandonnés :
– Valeur esthétique : circulation des représentations par les photographies des lieux abandonnés
– Valeur expérientielle : popularisation de la pratique et donc de l’intérêt pour les lieux abandonnés
– Valeur sociale : imaginaire du front pionnier à travers l’exploration, qui valorise les pratiquants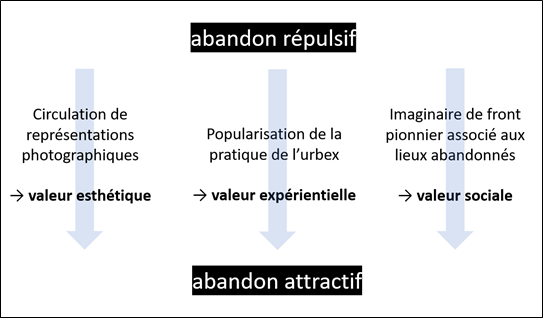
Figure A. Le Gallou
3/ L’urbex, une étape dans l’évolution des lieux abandonnés« Des lieux abandonnés peuvent après des temps de latence être rénovés ». Pour Aude Le Gallou, les friches peuvent avoir un potentiel de récupération élevé. Pour illustrer ses propos, l’intervenante met en évidence deux trajectoires fréquentes concernant des lieux abandonnés où l’exploration urbaine était pratiquée. Ainsi au terme de ce temps de latence, le lieu peut être démoli ou à l’inverse réhabilité. Ci-dessous, deux photographies prises par Aude Le Gallou, la première montre l’ancienne grande roue du Spreepark à Berlin, longtemps abandonnée et visitée par les urbexeurs et qui est aujourd’hui marquée par un projet de réhabilitation. Sur le second cliché apparaît le gazomètre de Charleroi avant que celui-ci ne soit démoli en 2023.

Photo de la grande roue du Spreepark à Berlin, A. Le Gallou, 2017

Photo du gazomètre de Charleroi – Belgique, A. Le Gallou, 2022
A l’instar de toutes actions de démolition ou de rénovation qui pourraient mettre fin à la pratique de l’urbex sur certains sites, Aude Le Gallou expose au public la dimension commerciale de l’urbex qui s’ancre dans cette évolution des lieux abandonnés. « L’urbex a pu inspirer une pratique commerciale qui est pourtant contraire à l’esprit même de l’urbex » : le tourisme de l’abandon. A partir de ses terrains de thèse en Allemagne et aux Etats-Unis, Aude Le Gallou met en évidence deux pratiques commerciales distinctes. La première est celle observée à Berlin où « une forme de tourisme de l’abandon a été légalisée, les entreprises passent des contrats avec des propriétaires qui eux reçoivent un pourcentage sur les visites ». Le second exemple développé est celui de Détroit où « la pratique commerciale est réalisée en toute illégalité ». Ces différents exemples montrent la manière dont l’urbex participe à une évolution de certains lieux abandonnés.
En conclusion de ce Café Géographique chambérien, Aude Le Gallou rappelle que « l’urbex permet de s’intéresser aux lieux abandonnés tout en étant une méthode pour étudier l’abandon et les questions liées à la mémoire et à la patrimonialisation des lieux ».
Par Yannis NACEF
Professeur agrégé de Géographie
Doctorant en Géographie – UMR 5204 EDYTEM – Université Savoie Mont Blanc – CNRS -
 16:15
16:15 Faire du tourisme avec du patrimoine. Le cas de l’art rupestre alpin
sur Les cafés géographiquesPar Yoann Collange
Doctorant en géographie – EDYTEM UMR 5204 – Université Savoie Mont BlancYoann Collange finalise actuellement une thèse à l’USMB au sein du laboratoire EDYTEM (Environnements, Dynamiques et Territoires de Montagne) intitulée « Ressource patrimoniale et transition touristique : la valorisation de l’art rupestre dans les alpes françaises et italiennes ». Cette intervention a eu lieu le 07 février 2024 à Chambéry dans le cadre d’un Café Géographie.
En guise d’introduction, Yoann Collange s’est intéressé aux visions « assez normées » de l’image de la montagne et du tourisme en montagne. Pour lui, « L’espace montagnard est de plus en plus codifié autour de la pratique sportive et des loisirs, une image en grande partie véhiculée par les médias ». Face à ce constat, l’intervenant propose de s’intéresser à la place du patrimoine au sein des territoires de montagne et plus particulièrement de l’art rupestre en tant que patrimoine. Pour ce dernier, plusieurs patrimoines peuvent être distingués en montagne, le patrimoine vernaculaire, le patrimoine militaire ou encore le patrimoine naturel (cette liste n’étant pas exhaustive). C’est ainsi que Yoann Collange amène progressivement son auditoire à s’interroger sur la place particulière de l’art rupestre en montagne en tant que patrimoine. L’art rupestre est selon lui un patrimoine universel, présent sur toute la planète, tout en prenant des formes diverses (en plein air, sous roche, etc.). A l’issu de cette introduction, Yoann Collange propose au public 3 questionnements qui vont articuler sa présentation autour de 3 terrains d’étude :
1/ Dans les Alpes, « faire du tourisme avec du patrimoine rupestre », qu’est-ce que cela signifie ?
2 /L’Art rupestre mauriennais est-il une ressource touristique active ? L’Art rupestre de Haute- Maurienne a-t-il valeur de patrimoine pour les habitants et les acteurs locaux ?
3/Comment expliquer le décalage entre la Haute-Maurienne, la Vallée des Merveilles et la Valle Camonica ?
1/ Etat des lieuxLa première partie de ce café géo s’intéresse à 3 sites étudiés par Yoann Collange dans son travail de thèse. Il s’intéresse tout d’abord au cas de la Valle Camonica dans la région de la Lombardie en Italie qui selon lui « représente une mine d’or pour la mise en tourisme de l’art rupestre accentuée depuis quelques années par une labélisation UNESCO ». En effet, l’intervenant présente les caractéristiques de ce territoire montagnard composé de 8 parcs archéologiques et dont la plus grande partie des sites archéologiques se localise dans les parties basses et moyennes de la vallée. La présentation des caractéristiques des sites archéologiques de la Valle Comonica amène Yoann Collange à proposer un schéma (qu’il déclinera pour les 2 autres terrains d’étude). C’est ainsi, que pour lui la Valle Camonica est marquée par la présence de regroupements de plusieurs roches au sein d’un même site (voir figure ci-dessous).
A l’inverse, la Vallée des Merveilles se localise dans le département des Alpes Maritimes en France et présente des caractéristiques et un schéma différent. Yoann Collange en profite pour rappeler la présence d’un peu plus de 200 000 dessins répertoriés dans cette vallée marquée par la Réserve Archéologique du Mont Bego. Cette dernière très haute en altitude se situe au sein du Parc National du Mercantour. Pour cette dernière, les roches se trouvent regroupées au sein d’un même espace protégé sur lequel s’exerce des contrôles et où sont réalisés des aménagements.
Le troisième site d’étude proposé au public dans le cadre de ce Café Géographique est celui de la Haute-Maurienne. La présence de roches gravées semble se concentrer au sein de la partie haute de la vallée de la Maurienne comme l’expose Yoann Collange. Ces roches sont présentes au sein de l’actuelle communauté de communes de Haute-Maurienne Vanoise et sont marquées par 6 sites de mise en valeur de l’art rupestre (Musée archéologique de Sollières-Sardières, Parc archéologique des Lozes, etc). Au sein de ce territoire, le schéma de répartition des sites archéologiques est de type ponctuel d’après Yoann Collange. Ces sites ne sont pas forcément connectés entre eux et présentent une moindre cohérence spatiale par rapport à la Valle Camonica ou à la Vallée des Merveilles (voir figure ci-dessous). Cela se traduit par une fréquentation touristique beaucoup plus faible.
Yoan Collange conclut cette première partie en soulignant l’existence au sein des 3 terrains d’étude de 3 modèles très singuliers où les modes de valorisation, les périodes de révélation des valeurs patrimoniales et les acteurs sont différents (voir figure ci-dessous).
2/ En Haute-Maurienne un patrimoine méconnuDans cette seconde partie consacrée principalement à l’art rupestre en Haute-Maurienne, Yoann Collange commence par poser la question de la visibilité de ces patrimoines. Une visibilité qui selon lui dépend de plusieurs paramètres comme : l’accessibilité aux sites d’art rupestre (qui en Haute-Maurienne présente des temps de marche et des dénivelés importants) ou l’exposition des roches gravées qui sont moins lisibles en pleine journée quand le soleil est au zénith. Cela amène Yoann Collange à questionner l’appropriation de ces patrimoines. Pour cela il présente au public une partie de sa méthodologie employée dans sa thèse. Cette dernière comprend une méthode de photo élicitation permettant d’analyser les discours des personnes rencontrées et d’identifier les valeurs que ces enquêtés accordent à l’art rupestre de leur territoire. A cela s’ajoute la présentation des résultats de 40 entretiens menés en Haute Maurienne. A la question quels sont les patrimoines de Haute-Maurienne ? sur 40 réponses, seulement à 2 reprises l’art rupestre a été mentionné, tandis que sur les 40 personnes interrogées, 21 connaissaient pourtant des sites d’art rupestre sur leur territoire (voir figure ci-dessous).
Pour compléter l’analyse de la visibilité de ces patrimoines, Yoann Collange propose au public de s’intéresser au discours des acteurs territoriaux : élus locaux, offices de tourisme, accompagnateurs en montagne… Selon lui, les visions de ces acteurs sur l’art rupestre sont partagées entre méconnaissance vis-à-vis de ces patrimoines et un attrait du public qui va plutôt vers des images d’Épinal de la Haute Maurienne. Il ressort de cette seconde partie présentée par Yoann Collange l’idée d’une valeur patrimoniale de l’art rupestre très hétérogène et dont l’offre touristique accorde que peu de place à ces patrimoines
3/ Les enseignements de l’approche comparativeDans cette troisième et dernière partie Yoann Collange a souhaité montrer au public les décalages temporels de l’intérêt scientifique pour l’art rupestre au sein des 3 sites étudiés. Il commence par indiquer qu’en Haute-Maurienne, l’activité scientifique autour de l’art rupestre est tardive, ce n’est qu’au milieu des années 1970 que des chercheurs s’y intéressent (1975 premier groupe de recherche bénévole GERSAR) (voir figure ci-dessous). Face à ce constat, l’intervenant met en regard la situation de la Valle Camonica dont l’activité scientifique autour de ces patrimoines débute au tout début du XXe siècle, ce qui permet selon lui « d’avoir aujourd’hui plus d’un siècle de travaux scientifiques sur ce territoire », et d’ajouter que « l’image territoriale est depuis longtemps liée à ces travaux archéologiques » dans la Valle Camonica. Une situation proche de celle de la Vallée des Merveilles qui, d’après Yoann Collange, connaît des premiers travaux sur l’art rupestre dès la fin du XIXe siècle. A cela s’ajoute les travaux du professeur Henry de Lhumley dans la seconde partie du XXe siècle qui a initié une politique de valorisation et de mise en tourisme de l’art rupestre.
Concernant les actions de valorisation de l’art rupestre en tant que patrimoine pour un territoire, Yoann Collange présente l’importance de l’alliance Parc National du Mercantour et accompagnateurs en montagne pour la Vallée des Merveilles ; tandis qu’il souligne l’alchimie entre gestionnaires des parcs archéologiques avec les pouvoirs publics dans la Valle Camonica. Ces associations participent selon lui à la forte visibilité de ces patrimoines dans l’offre touristique de ces territoires. Dans le cas de la Haute-Maurienne pour laquelle Yoann Collage a montré le décalage voire une certaine forme de « retard » dans la mise en tourisme de l’art rupestre, il souligne l’implication récente de certains accompagnateurs en montagne ou d’associations locales en faveur de la mise en valeur de ces patrimoines. Il rappelle pour cela la tenue en 2022 des « Visites nocturnes du parc archéologique des Lozes » (voir photos ci-dessous). Au terme de cette troisième partie, Yoann Collange rappelle que le poids de la sphère scientifique dans les politiques de mise en tourisme peut être déterminant. Et que le territoire de la Haute-Maurienne est marqué par la présence d’acteurs qui peuvent participer localement à faire de l’art rupestre des patrimoines pour le territoire pouvant de fait intégrer l’offre touristique de ce dernier.


Visite nocturne du Parc des Lozes, été 2022, photographies Y. Collange
En conclusion de ce Café Géographique consacré à l’art rupestre et aux dynamiques de patrimonialisation et de mise en tourisme, Yoann Collange souhaite insister sur le fait que l’art rupestre fait l’objet d’une mise en tourisme depuis longtemps dans la Valle Camonica et dans la Vallée des Merveilles. Tandis qu’en Haute-Maurienne, l’offre touristique liée à l’art rupestre demeure plus complexe et relève en grande partie de l’intérêt porté par les acteurs locaux et les pouvoirs publics envers ces patrimoines. Néanmoins, Yoann Collange souhaite terminer sa présentation sur une note positive en soulignant le fait qu’en Haute-Maurienne une tendance en faveur de ces patrimoines se dégage depuis quelques années.
Plusieurs questions ont été posées à l’intervenant, nous proposons ci-dessous d’en retranscrire quelques-unes :
Est-ce que l’art rupestre s’oppose à la pratique récréative en montagne ?
« Non, les roches gravées peuvent être le but ou un but à une excursion en montagne avec la pratique de la randonnée »Peut-on dire que l’art rupestre ne se suffit pas à lui-même ?
« En l’état actuel du tourisme dans la vallée, l’art rupestre a un intérêt à être mobilisé comme agrément de séjour ou d’offres récréatives. Mais avec un développement soutenu sur le long terme il pourrait composer une offre à part entière, comme autour du Mont Bégo ou en Valcamonica par exemple. »Existe-il localement des réticences à la mise en tourisme de l’art rupestre ?
« Non pas vraiment, je n’ai pas constaté de discours de réticence vis-à-vis de la mise en tourisme de l’art rupestre »Par Yannis NACEF
Professeur agrégé de Géographie
Doctorant en Géographie – UMR 5204 EDYTEM – Université Savoie Mont Blanc – CNRS -
 16:36
16:36 Articuler les mobilités durables à Montpellier ? Par Jean-Clément ULLÈS
sur Les cafés géographiquesLe 19 mars 2024, au cours de ce café géo, Jean-Clément Ullès a présenté des résultats issus de sa thèse de doctorat portant sur l’intermodalité au service de la durabilité du système de transport. L’intermodalité, notion technique du transport, a été définie comme une organisation des transports caractérisée par l’utilisation successive de deux ou plusieurs modes de transport. L’intermodalité est la pierre angulaire de la mobilité durable, c’est pourquoi elle fait l’objet d’une étude approfondie dans le cadre d’une thèse.
Qu’est-ce que l’intermodalité ?La première partie de la présentation a abordé le concept d’intermodalité, mettant en lumière les leviers des mobilités durables, notamment les nouvelles offres de transport et d’infrastructures (nouvelles pistes cyclables, nouvelles lignes de tramway…), les nouvelles pratiques modales telles que le vélo ou l’autopartage, ainsi que les nouveaux rythmes urbains liés au télétravail et à la densification urbaine. Le dernier levier envisage une nouvelle organisation de l’offre de transport via l’intermodalité. Cette organisation vise à réduire la dépendance à l’automobile du périurbain montpelliérain en offrant des possibilités performantes de se déplacer vers la ville-centre.
En théorie, l’intermodalité décuple l’accessibilité théorique des usagers en offrant la possibilité aux usagers de combiner différents modes de transports et leurs échelles de fonctionnement optimal. Néanmoins, en pratique, l’intermodalité implique une rupture de charge, nécessitant de la marche et un temps d’attente entre différents modes de transport. L’intermodalité doit faire face aux multiples discontinuités du système de transport afin de proposer aux usagers des déplacements avec le moins de ruptures possibles. Ces discontinuités peuvent prendre plusieurs formes : physique (changer de véhicule pour entrer dans un autre), institutionnelle (chaque autorité organisatrice organise son propre système de transport), billettique (les titres uniques sont encore rares ou trop restreints), tarifaire (absence d’abonnements multimodaux combinant plusieurs territoires) ou numérique (la profusion des applications téléphones de mobilité rend complexe la lisibilité de l’offre pour l’usager).

Le pôle d’échange multimodal de Baillargues : un modèle de rapprochement physique des modes. Crédit photo : Baptiste Baujard, 2024
1. L’intermodalité dans les mobilités locales : le cas montpelliérainLa deuxième partie s’est intéressée à l’intermodalité dans le contexte local de Montpellier, notamment à travers une enquête Cerema en 2014. Selon cette enquête, l’intermodalité ne représente que 3,5 % de l’ensemble des déplacements dans l’aire de mobilité de Montpellier, ce qui en fait une pratique faiblement mobilisée dans les mobilités locales. Les modes de transport utilisés dans les trajets intermodaux sont pour 80% des transports collectifs (bus, tramway, autocar et train). Par ailleurs, du point de vue des usagers, l’intermodalité est principalement effectuée par des étudiants et des élèves, à hauteur de 53 %, car ce sont des usagers captifs du système de transport et donc tributaires des pratiques intermodales.
2. Évaluation de l’accessibilité intermodale des transports collectifsEnfin, la troisième partie a évalué la performance de l’accessibilité intermodale des transports collectifs entre Montpellier et 692 communes du Gard et de l’Hérault. L’évaluation des chaînes intermodales met en lumière la faible coordination des horaires des véhicules avec des temps d’attente lors des correspondances souvent pénalisantes. Néanmoins, le rapprochement physique des modes de transport, mesuré par le temps de marche pour changer de véhicule, révèle de bons résultats du fait d’aménagements spécifiquement conçus pour minimiser les temps de marche : les pôles d’échanges multimodaux, nombreux en périphérie de Montpellier, et les gares multimodales. La comparaison des temps de parcours des chaînes intermodales par rapport à la voiture (dans une situation d’heure de pointe) met en exergue la très faible performance des transports collectifs (sauf pour le TER dont la vitesse commerciale concurrence directement la voiture). L’analyse a montré que malgré des efforts, l’offre de transport public reste globalement peu performante, avec des temps de parcours souvent doublés par rapport à la voiture.
ConclusionL’intermodalité est présentée comme un enjeu majeur pour la durabilité du système de transport, mais sa pratique reste peu mobilisée dans la région de Montpellier. Des efforts sont nécessaires pour améliorer la coordination des horaires, la billettique et l’offre de transport, notamment dans les zones périurbaines. L’enjeu de l’accessibilité des espaces périurbains est majeur pour réduire la dépendance à l’automobile des habitants en offrant une alternative intermodale efficace et construite pour les actifs quotidiens. Pour cela, puisque Montpellier ne possède pas d’étoile ferroviaire, une offre routière fondée sur des cars à haut niveau de service (CHNS) permettrait de concurrencer les déplacements en voiture et inviter au report modal.
Remarque et questions de l’audienceLors des séances de questions-réponses, plusieurs sujets ont été abordés. Les participants ont proposé des solutions claires pour améliorer l’intermodalité, mettant l’accent sur l’organisation des horaires de service de transport et la simplification de la billettique. La question du coût de mise en œuvre des trajets et de l’hybridation de la mobilité active (en particulier l’emport des vélos dans les trains et les cars) a également été soulevée, suscitant des discussions sur les investissements nécessaires et les obstacles à surmonter. De plus, des réflexions ont été menées sur les stratégies à adopter pour favoriser l’intermodalité chez les personnes âgées et dans les zones rurales. Pour finir, les défis liés à la concurrence entre les ouvrages autoroutiers et les transports publics ont été examinés, soulignant la nécessité d’un rééquilibrage des priorités en matière de planification des infrastructures de transport.
Compte rendu de Baptiste BAUJARD, mars 2024
-
 21:26
21:26 Le dessin du géographe n° 101. William Holmes et le Grand Canyon du Colorado
sur Les cafés géographiquesDans « les essentiels » de la Bibliothèque Nationale de France, se trouve un focus sur « L’Ouest, un mythe américain en image », par Jean-Louis Tissier et Jean-François Staszak, qui me permet d’introduire cette page. Commencé avec un portrait photographique de F.V. Hayden (un des 4 chefs d’expédition scientifique dans l’Ouest des Etats-Unis entre 1866 et 1879, avec C. L. King, G. M. Wheeler et J.W. Powell), il se termine par le formidable dessin suivant :
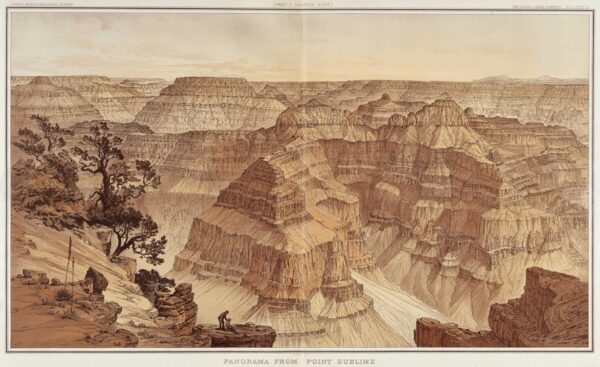
Fig.1 : Panorama du Grand canyon du Colorado depuis le Point Sublime, vers le sud, par William Holmes (1882), lithographie 50,5 x 84 cm (Source : BNF, Société de Géographie)
Cette image est certainement un des croquis panoramiques les plus connus de l’Ouest des États-Unis : le grand canyon du Colorado dessiné depuis le Point Sublime, du sommet du versant nord vers l’ouest. Le dessin original a dû être réalisé à la plume et au lavis d’encre sépia sur papier. Au vu des détails et des tracés de cet extraordinaire empilement de strates sédimentaires subhorizontales, on peut raisonnablement penser que le dessinateur William Holmes (1846-1933), qui fut le principal illustrateur de cette conquête scientifique de l’Ouest des États-Unis, a travaillé d’après une photographie pour produire une lithographie d’une telle précision picturale. Au droit du Point Sublime (2274 m), le Colorado coule à l’altitude de 774 m et c’est donc 1500 m de sédiments qui s’entassent depuis le précambrien dans une histoire géologique complexe.
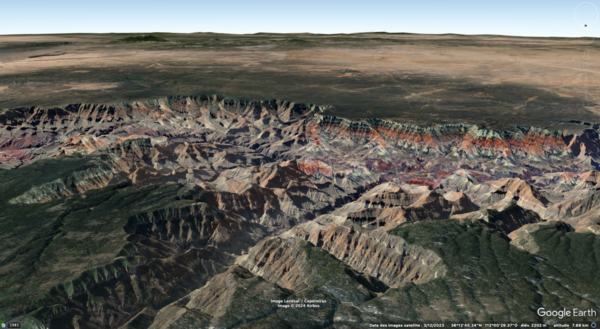
Fig.2 : Vue aérienne de la partie centrale du Grand canyon du Colorado, à la verticale du Point Sublime, vers le sud, correspondant à la partie dessinée sur la figure 1 (Source : Google Earth)
Jusqu’ici le « dessin du géographe » n’a publié aucun dessin d’un géographe d’origine américaine, et c’est une grave lacune, car l’exploration du double continent a produit au 19e siècle des images de grande qualité, en particulier de la part des géologues et géomorphologues qui se sont intéressés aux États-Unis. Les Montagnes Rocheuses, particulièrement riches en grands sites naturels, ont été parcourues pendant la seconde moitié du 19ème siècle par des scientifiques de renom (Hayden, Davis, Gilbert…) qui ont fait de très nombreuses observations originales et progresser à grands pas la science du relief du sol. Par exemple, la théorie du cycle d’érosion par le géographe William Davis : le premier dessin modélisateur d’un anticlinal de type jurassien soumis à l’érosion pourrait se trouver dans un article de The Geographical Journal publié par ce dernier en 1899 (Vol.14, No 5, p.492).

Fig.3 : Folded Strata, a Great Geological Arch, Colorado, par William Holmes (1874), aquarelle et crayon sur papier (Source : Smithsonian American Art Museum).
Le terme anglais « arch » ne se traduit pas ici par l’ « arche » française, mais par le « mont » anticlinal au sens « relief plissé » du terme. Curieusement, le catalogue en ligne du SAAM n’identifie pas la localisation géographique de ce mont, localisation qui permettrait d’en faire une analyse géomorphologique plus précise en s’aidant de la carte géologique.
Sur la fig.3 on reconnaîtra aisément, dans un relief plissé, un crêt encadrant une hémicombe peut-être à ‘occasion d’une cluse traversant un axe anticlinal. Mais le dessin ne permet pas de voir la topographie du thalweg ; par contre, il semble que l’érosion dégage dans la combe un mont dérivé dans une couche de roche plus dure.
W.H. Holmes, qui a commencé sa carrière de dessinateur scientifique en reproduisant des mollusques pour F.B. Meek, paléontologue de l’Institut Smithonian , a pratiqué ensuite le dessin et la peinture sur le terrain jusqu’à devenir un artiste reconnu, comme le montre l’aquarelle de la figure 3 prise sur le motif. Ce versant de son activité est mis en valeur par le SAAM sur son site internet : [https:]]
Le Grand canyon du Colorado a continué à attirer les scientifiques et les artistes. Parmi les peintres contemporains le dernier en date est peut-être David Hockney. En cherchant de nouveaux moyens perspectifs pour présenter des espaces de très grande taille, il a trouvé dans ce site un bon exemple pour illustrer sa méthode des paysages peints par panneaux multiples avec des points de vue différents. L’exposition « J’aime les Panoramas » réalisée au MUCEM de Marseille par Laurence Madeline et Jean-Roch Bouiller en 2015-2016 en présentait un résultat « flashant » pris du même point de vue que Holmes :
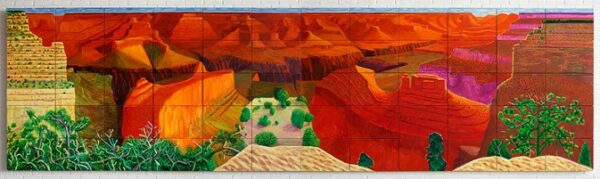
Fig.4 : David Hockney, A closer Grand Canyon, 1988, huile sur toile, 60 panneaux, 8,93 x 2,48m
Collection Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Denmark © David Hockney, Photo Richard SchmidtLe peintre anglais évoque à cette occasion une qualité commune au dessinateur et au géographe, l’observation : « Lorsqu’on est sur place, au bord du canyon, on regarde… : on se tient debout et on commence à contempler » (David Hockney, in Martin Gayford Conversations avec David Hockney, 2022, p.139).
Contemplation qui peut être alors à la source de la perception du Sublime, cette sensation nouvelle tirée de l’observation méditée de la nature à la fin du 18ème siècle par les poètes et les peintres, et qui a pu être partagée par les géographes sur le terrain de leurs propres recherches.
Pour aller plus loin : L’Ouest, un mythe américain en images, par Jean-Louis Tissier et Jean-François Staszak [expositions.bnf.fr]
Roland Courtot, avril 2024
-
 21:09
21:09 Hommage à Michel Sivignon, un grand géographe français
sur Les cafés géographiquesA peine arrivés à Paris au mitan des années quatre-vingt-dix, Michel Sivignon et son épouse Michèle (un seul prénom pour deux) sont invités au Café géo. Nous venons d’ouvrir la saison avec Yves Lacoste, Roger Brunet, Jean-Pierre Raison, Chantal Blanc-Pamard et Hervé Rakoto Ramiarantsoa et… très vite, Michel Sivignon nous parle de la Grèce, pays qu’il connaissait intimement pour y avoir fait sa thèse sur la Thessalie à la charnière des années 1960-1970, des Balkans, de l’Albanie… Dans les archives du Clermontois André Fel, nous retrouvons cette photo prise en Thessalie lors d’un voyage en 1992 : « Michel Sivignon, notre pâtre grec ».
Au Café géo, nous avons été d’emblée séduits par cette voix de basse, profonde. Michel parlait toujours posément, non sans une certaine solennité pour imprimer son récit, avec un geste de main droite qui est souvent celui des enseignants aimant montrer un lieu sur une carte. Michel était un sage qui faisait prendre de la hauteur à tous les débats. Sans avoir d’avis sur tout et renvoyant souvent aux collègues « qui en savent plus que moi », Michel avait toujours un point de vue en surplomb, sans négliger les détails « qui parlent ». Amoureux de la controverse et du débat, Michel semblait avoir élu la Grèce aussi pour son apport démocratique à la civilisation occidentale.
Les Cafés géo ont une dette incommensurable envers lui. Il est le premier universitaire qui a pris la mesure de ce qui s’y passait. Avec Michel, nous avions trouvé un ancêtre : le géographe allemand Friedrich Ratzel (1844-1904) réunissant ses étudiants à Leipzig au café (peut-être là où Bach jouait sa célèbre cantate ?) après les cours pour refaire le monde. Avec Pierre Gentelle notre autre mentor du CNRS, Michel avait aimé qu’on put lui offrir un espace où discuter librement, loin des chapelles et leurs querelles, des idées qui germaient dans les laboratoires de recherche et qu’il fallait tamiser par le débat démocratique. Michel a ouvert son carnet d’adresses à ses collègues, ses étudiants, ses amis, géographes ou non, pour les inviter au Café.

Au Café de Flore (Paris 6ème), Michel Sivignon (à droite) et Daniel Oster (à gauche) lors d’un café géo, le 11 décembre 2021 (photo de Jean-Pierre Némirowsky)
Hors de son travail universitaire, Michel cultivait de nombreuses passions qu’il aimait partager. Celle de l’étymologie et, surtout, du dessin, avec l’Aixois Roland Courtot qui vaut aux Cafés géo une rubrique étonnante, éclairante par son évidence à montrer ce qui se révèle aux géographes par le crayon et la gomme, puis l’aquarelle jusqu’à l’image satellitale : « Le dessin du géographe ». Déjà cent contributions d’amateurs sollicités entre les articles de Michel et Roland (près des deux tiers des articles à eux deux) constituent une mine dont on pense qu’elle fournira un jour le matériau d’une thèse. Des explorations en tous sens : la déesse grecque Eugée, la frontière du rio Grande, l’affichiste R. Broders, le dessin colonial du Maroc…
La deuxième passion partagée avec Michèle, était le symposion, mot grec qui fait référence aux nourritures et aux repas. Michel fut le premier à proposer en 1999 un « repas géo » dans un restaurant grec du XIVe arrondissement. On découvrit avec lui qu’une carte de restaurant vaut parfois carte de géographie. Que chaque mets, que l’ordonnancement des plats, que le boire, que les toasts et les gestes les plus banals et les moins évidents hors de leur culture font géographie. Grâce à cette aventure, un enseignement sur l’alimentation a germé à l’université où des jeunes et moins jeunes étudient pour comprendre quelle alimentation le changement climatique va faire naître. On peut entendre Michel et ses amis, chanter au cours du banquet qui a marqué les dix ans de l’association.
La troisième passion partagée, ce sont les voyages. Ceux qu’il a accompagnés ou, plus nombreux encore, initiés, notamment en Asie centrale avec un mémorable café géo nomade sur les routes même de la Soie. Ceux qu’il a suscités en Charolais d’où était originaire sa famille, en Grèce, dans le Pélion, à Argalasti où il avait pied depuis ses années de thèse. Nombreux sont ses amis, ses étudiants qui firent le pèlerinage au bord de la mer, non loin de Volos, et goûtèrent le spetzofai, la fasolada, le kefalotyri, le tiropsomo, sans oublier le célèbre thé des montagnes (tsai tou vounou). Michel savait partager la saveur d’un lieu qui infusait alors en ceux qui l’écoutaient.
Michel avait tant de talents qu’on ne fera pas injure à ceux qui l’ont connu de vouloir les évoquer tous. Il a donné à tous le modèle d’une vie lumineuse, exigeante, rayonnante jusque dans ses plus infimes attentions aux autres. Après plusieurs décennies à l’université, il s’est consacré pendant vingt-cinq ans au rayonnement des Cafés géo. Un maître de la transmission.
Michel, notre ami, tu seras toujours des nôtres, avec ta curiosité insatiable et ta bienveillance qui nous donnent du courage devant les défis qui nous attendent.
Gilles Fumey, Olivier Milhaud, Daniel Oster, avril 2024
-
 20:07
20:07 HUMAINS ET ANIMAUX, une géographie de relations
sur Les cafés géographiquesDe l’élevage aux productions industrielles, de l’abattage rituel au bien-être animal, des animaux de laboratoire aux antispécistes, de la zoophilie à l’extermination, les relations des humains avec les animaux nourrissent de nombreux débats parfois polémiques, souvent violents qui trouvent des réponses différentes en fonction des contextes et stimulent l’enquête géographique.

D. Oster et J. Estebanez (Photo M.Huvet-Martinet)
C’est devant un assez jeune public que nous avons accueilli Jean Estebanez (J.E) pour un café de géographie sociale et culturelle. Maître de Conférences à l’UPEC (Université Paris Est-Créteil), J.E est l’auteur d’une thèse sur « le zoo comme dispositif spatial » et a structuré son exposé autour des thèmes développés dans l’excellent dossier récemment publié à la documentation photographique*et qui fait le point sur la question.
La mise en relation des humains avec d’autres mondes et notamment le monde animal passe par différents moyens. S’il semble plus facile de communiquer avec les grands mammifères, il y a néanmoins de multiples possibilités de communiquer avec d’autres animaux (les insectes, par exemple), dès lors qu’on fait l’effort de s’intéresser à ce qui compte pour eux : on ne s’adresse pas avec un scarabée, pour qui les vibrations sont essentielles, comme à son chien. Il y a donc une grande diversité dans ces relations. Par ailleurs, si les humains n’ont jamais été seuls sur terre, mais ont vécu entourés de multiples espèces (comme en attestent les peintures rupestres préhistoriques), il apparait essentiel d’explorer ce que sont les relations interspécifiques.
Humains et animaux à l’âge de l’Anthropocène.
Si on considère que ce sont les humains qui sont devenus la puissance motrice de transformation des écosystèmes et au-delà, de la géologie, l’Anthropocène est devenu le terme qui désigne notre rapport au monde vivant, caractérisé par un effondrement rapide de la biodiversité. Ce sont ainsi les relations avec le monde animal qui perdent en diversité avec la disparition d’espèces. Les relations avec les animaux peuvent relever de la symbiose, de l’exploitation, de l’amour, de la destruction, de la prédation. Une même pratique, la chasse par exemple, se détermine très différemment suivant les espaces considérés.
La relation avec l’animal est socialement, anthropologiquement, historiquement située et donc extrêmement diversifiée.
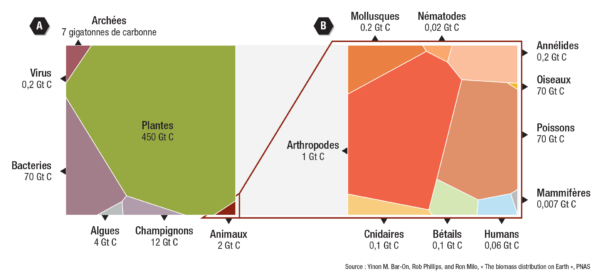
Diagramme de Voronoï représentant la composition de la biomasse. Source : Yimon Bar-On and Ron Mil, « the biomass distribution on Earth » PNAS, in J.Estebanez Doc.Photo 8149, CNRS Editions – Alexandre Nicolas
Des chercheurs américains ont cherché à évaluer la biomasse globale et sa répartition. Ils ont représenté graphiquement par un diagramme de Voronoï cette biomasse et les ordres de grandeurs des différentes espèces la composant. A gauche, la biomasse totale (A) ainsi que la répartition entre ses différents composants sont représentées par des surfaces de tailles proportionnelles (les formes n’ont pas de significations particulières). On prend alors conscience de la domination considérable des plantes terrestres pour 450 gigatonnes (GT), les animaux ne représentant que 2 GT de carbone. La répartition entre les catégories animales (B) à droite montre qu’elles sont principalement dominées par le groupe des arthropodes. La part des humains apparait fort modeste comparée à la biomasse globale et à celle des animaux même si leur impact est décisif sur la recomposition générale de la biomasse.
Les espaces et territoires des animaux.
Dans un monde structuré essentiellement par les hommes, les animaux se sont adaptés même dans des espaces qu’on pense totalement dominés par l’homme en zones urbaines.
L’exemple de Paris est significatif.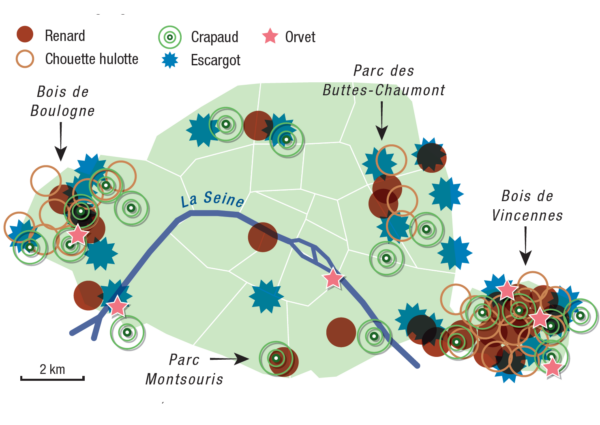
Paris, niche écologique ? Source Atlas de la nature de Paris, ed de la ville de Paris, 2020, in J. Estebanez Doc.Photo 8149, CNRS Editions – Alexandre Nicolas
La répartition géographique de quelques espèces à Paris met en évidence la grande diversité de la présence animale dans une métropole. Sa faune riche d’au moins 1618 espèces, si on y inclut les poissons et crustacés de la Seine. On est bien loin de l’idée reçue qu’il n’y aurait que des rats dans les égouts et des pigeons dans les rues. On remarque la présence animale importante dans les zones humides, le long de la petite ceinture mais aussi dans les bois de Vincennes et Boulogne. On repère également les espaces verts moins importants des Parcs Monceau, Montsouris, du Luxembourg, des Buttes-Chaumont qui accueillent chouettes, orvets, renards, escargots…
A l’échelle du foyer domestique, dont ne rend pas compte cet atlas, les animaux sont également présents en nombre. Il s’agit bien sûr d’animaux familiers (chiens, chats…) mais aussi d’acariens, et de très nombreuses espèces d’insectes.
La présence animale structurée dans des lieux spécifiques.
Les abattoirs apparaissent ainsi comme un lieu central de notre relation à l’animal mais progressivement invisibilisé, au fur et à mesure de l’industrialisation et des exigences hygiénistes de la mise à mort. Dans les pays riches, on assiste progressivement à sa sortie de l’espace public. Il existe pour autant de fortes variations qui démontrent que l’abattage ne relève pas seulement de considérations techniques mais aussi de rapports sociaux à la mort.
Par exemple, au Soudan, la mise à mort des animaux peut être effectuée devant les maisons et dans l’espace public, dans une atmosphère festive, sans que cela apparaisse comme une transgression de normes urbaines et morales.
Le zoo atteste d’un autre type de rapports avec les animaux. Lieux de spectacle vivant des animaux, ils attirent chaque année plus de 600 millions de visiteurs venus pour voir des animaux qualifiés de « sauvages » ou « exotiques ». Les animaux sont captifs et ont été très longtemps présentés dans des cages dont les barreaux étaient explicitement surdimensionnés ou ornés, pour affirmer un rapport de domination des humains sur les animaux. A compter du début du 20e siècle, les zoos ont progressivement été aménagés en suivant les principes de Carl Hagenbeck. Il propose de séparer les animaux des visiteurs par des fossés créant ainsi une sorte de continuité visuelle entre les uns et les autres, à l’aune d’une transformation de la relation homme/animal. Carl Hagenbeck crée ainsi une relation qui se veut apaisée entre ces animaux sauvages en « liberté », que le visiteur peut observer dans leur naturalité. Ce n’est plus l’enfermement qui est le thème central de la visite mais la continuité et la proximité. La plupart des zoos, notamment celui de Vincennes, ont appliqué ces principes.
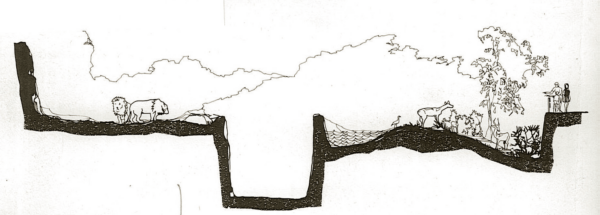
L’aménagement du zoo de Milwaukee (1961) suivant les principes de C.Hagenbeck utilise l’utilisation des fossés pour la composition du paysage photo David Hancocks, in J Estebanez, Doc photo 8149, CNRS Editions – Alexandre Nicolas.
Les parcs à Chiens qui se développent récemment posent le problème de la place des animaux domestiques en ville.
Les animaux ont toujours été présents dans les espaces urbains, notamment les animaux de traits (chevaux, bœufs, mulets, ânes…), pour le transport des personnes et des marchandises. Au début du XXème siècle, on pouvant ainsi compter de 80 000 à 100 000 chevaux à Paris. Il y a toujours eu de ce fait des équipements urbains adaptés à la présence animale (des écuries, des abreuvoirs…). La demande actuelle pour les parcs à chiens s’insère dans la problématique de la reconfiguration de la place des animaux en ville qui sont maintenant non plus d’abord des animaux de travail, mais des animaux familiers. Les parcs à chiens sont des équipements qui participent du réaménagement des espaces publics urbains, parfois dans un contexte de gentrification dans lesquels se transforment des quartiers populaires. La création de parcs à chiens, très développés aux Etats-Unis, souvent à la demande d’associations de résidents, témoigne de la requalification et des nouveaux usages légitimes des espaces publics qui émergent. Des parcs fréquentés par des SDF ou des dealers peuvent ainsi être progressivement transformés. La diversité des races de chiens qui fréquentent ces parcs participent d’ailleurs à des logiques de classement des classes sociales.
La chasse, une pratique controversée.
La chasse est singulière en ce qu’elle ne dissimule pas la violence vis-à-vis des animaux mais qu’elle la met en scène et la socialise. Si l’abattoir est un dispositif technique qui cherche à invisibiliser la mise à mort, la chasse en fait un élément central. Dans les différentes formes de chasse pratiquées, se mêlent connaissance, respect, violence, égards, ruse dans le rapport aux animaux et aux territoires. Les chasseurs valorisent d’ailleurs les animaux pour leur capacité à fuir, à ruser. Le chasseur reconnait l’intelligence de l’animal et l’admire même, ce qui ne l’empêche pas de le tuer. Ce rapport est diamétralement opposé à celui d’une forme de compassion protectrice à l’égard de l’animal, dans lequel il faudrait se mettre à sa place, qui structure les positions de certains défenseurs du droit des animaux.
Protéger les animaux : une relation morale.
La marchandisation des animaux, très ancienne, est un rapport crucial aux animaux et peut prendre de multiples formes. Elle apparait comme un type relationnel spécifique dont on peut tirer des ressources dont on tire profit. Certaines espèces peuvent ainsi menacées par les effets de la surchasse ou du braconnage par exemple pour fournir des trophées. La marchandisation peut se faire par la chasse, le braconnage mais aussi le tourisme de vision au cours des grands safaris dans les parcs africains. Le cas des rhinocéros dont la corne est parée de vertus diverses, notamment aphrodisiaques, et dont le prix dépasse celui de son poids en or, est intéressant. Le braconnage des rhinocéros a pris des proportions dramatiques en Afrique du sud, alors même que le rhinocéros participe d’une économie du tourisme de vision importante ; on le protège en pratiquant une technique préventive qui consiste à lui retirer sa corne en la sciant sous anesthésie.
Il existe dans le monde des aires protégées qui présentent une grande diversité de formes et qui apparaissent comme un outil majeur de préservation des populations animales (et végétales). En Afrique anglophone notamment, après avoir chassé intensivement les grands mammifères, les élites coloniales blanches ont mis en place des réserves cynégétiques où la chasse et le braconnage sont maintenant considérés comme une pratique autochtone à combattre.
Se mobiliser pour ou contre les animaux.
L’exemple des ours est significatif puisqu’il mobilise des manifestants dont les logiques s’opposent. Ces mobilisations renvoient à des places divergentes des humains par rapport aux animaux. Les manifestations anti-ours, généralement organisées par les éleveurs, s’organisent suite à l’attaque de troupeaux ou de bergeries par un ours. Les éleveurs défendent une morale de l’élevage et s’opposent à l’introduction (comme en 1996, dans les Pyrénées) et à la protection des ours, même si l’Etat les indemnise pour les brebis perdues. Pour eux, l’enjeu n’est pas seulement monétaire mais moral car il s’agit de prendre soin de ses animaux : il n’est pas question de les laisser attaquer par un ours. D’un autre côté, les militants animalistes pro-ours valorisent la figure de l’animal unique et irremplaçable qu’il faut protéger.
En ce qui concerne les souris de laboratoires reproduites en très grand nombre pour les besoins de la science, leur sacrifice fait l’objet de règles précises qui l’engagent dans un système de dons et contre-dons pour rendre sa mort acceptable. La mort de l’animal est justifiée par la production d’un bien plus grand qui est celui de la science. Elle fait l’objet de protocoles stricts avec des dispositifs techniques validés par des comités d’éthique pour donner « la bonne mise à mort » dans le cadre du laboratoire, montrant que tuer n’est pas rien et ne peut se faire que dans un cadre spécifique.
Le tabou de la zoophilie.
La zoophilie met en jeu une relation intime et charnelle par la sexualité avec des animaux. Elle est significative des relations morales aux animaux car elle est associée à la déviance, et donc, par opposition à la fabrique de la normalité. Elle tient une place importante dans beaucoup de mythologies, notamment grecque. On se souvient des épisodes relatant les multiples métamorphoses de Zeus en divers animaux pour séduire des mortelles. Dans ces récits mythiques, la zoophilie est fréquente mais peut parfois faire l’office de mise en garde contre des excès.
La zoophilie est également une pratique contemporaine : même si les sources, essentiellement psychiatriques, religieuses et judicaires sont très lacunaires, elle concernerait de 4 à 6% de la population nord-américaine. J.E développe le cas d’un scandale dans l’Etat de Washington, lié à la mort d’un homme, suite à des relations sexuelles avec un cheval, en 2005. On s’aperçoit à cette occasion avec horreur qu’il n’y a aucun interdit légal à la bestialité. L’Etat décide alors de légiférer par une loi anti-bestialité. L’argumentation déployée pour développer la loi s’avère complexe : s’il est considéré que l’animal ne peut consentir à l’acte sexuel et qu’il doit donc être protégé, il s’avère qu’il ne consent pas non plus à être engraissé, abattu ou tenu en laisse. L’enjeu relève plutôt de la façon dont sont définies la consommabilité alimentaire et la non-consommabilité sexuelle du fait d’un exceptionnalisme humain. Les législateurs soulèvent le problème de l’élevage qui pratique la stimulation sexuelle et l’insémination. Il s’agit alors d’exclure ses pratiques de la sexualité. La distinction se fait donc entre la zoophilie, définie comme une sexualité non reproductive, et donc immorale, et une pratique sexuelle (l’insémination) destinée à la reproduction, et donc légitime.
Les questions de la salle ont permis d’approfondir certains points.
- L’intérêt de la géographie pour ce sujet des relations humains/animaux est ancien. On trouve chez Elisée Reclus (1830-1905) des propos sur la participation des animaux aux labeurs humains. Dans les années 1920-1930 des tableaux détaillent la grande variété des animaux. Dans les années1950 et surtout 1960-70, des travaux importants, principalement chez les géographes anglophones, structurent et approfondissent ce champ de recherche. La dimension spatiale de l’approche donne son caractère géographique aux recherches, notamment au regard de l’anthropologie. Les progrès considérables de l’éthologie ont permis de faire progresser ce champ d’études.
- Les zoos bien que sous pression, demeurent des lieux très fréquentés (environ 600 millions de visiteurs/an) : c’est un espace sans équivalent car il présente des animaux vivants même s’ils sont dominés et enfermés. Les zoos ont actuellement un discours de légitimation en s’affirmant comme un lieu de protection d’espèces en voie de disparition, ce qui pose des questions car beaucoup d’espèces menacées ne sont pas présentées au public.
- Les nuisibles sont des animaux définis comme indésirables, dans un processus de construction sociale. Les espèces définies comme nuisibles sont également déterminées légalement, de façon variable suivant les époques, les lieux et en fonction des usages : les insectes, une des plaies d’Egypte, souvent combattus, peuvent aussi être élevés comme source de protéines du futur. Le pigeon pensé comme nuisible à Paris est positivement associé à l’image de la ville à Venise.
- Le trafic d’animaux est attesté au moins depuis l’Antiquité. Actuellement, c’est le deuxième trafic mondial après la drogue. Il participe à l’extinction de certaines espèces. C’est un marché très mondialisé avec une géographie des différents trafics. Le marché chinois est par exemple très demandeur en cornes de rhinocéros dont les braconniers d’Afrique du sud sont pourvoyeurs. L’interdiction en 1970 de fabriquer des objets en écailles de tortue génère aussi un trafic illicite important.
- Les interfaces entre les territoires des animaux sauvages et espaces urbains posent le problème de l’extension des aires urbaines qui se déploient vers les territoires d’animaux sauvages, comme à Los Angeles, avec le cas du puma. La ville est aussi une niche écologique qui a des propriétés qui conviennent à certains animaux, qui y trouvent de la nourriture et de la chaleur en hiver. Les pies, animaux forestiers, sont ainsi devenues totalement urbaines.
- La corrida est un véritable cérémonial, c’est exemple clair de la ritualisation de la mise à mort comme spectacle. La mort est l’aboutissement et le point d’orgue du combat de l’animal. L’idée de mettre en scène la mort est de moins en moins accepté, comme c’est également le cas dans le cadre de la chasse.
- Les cirques eux aussi, comme les zoos, sont sous pression et sont accusés d’exploiter illégitimement les animaux, présentés comme maltraités voire dénaturés dans le cadre de spectacles dégradants. Contrairement aux zoos, les spectacles d’animaux au cirque n’ont pas réussi à se (re)légitimer par le biais de la protection d’espèces en voie de disparition.
- Les animaux, auxiliaires de vie. Cette fonction atteste d’un nouveau rapport aux animaux familiers. Un procès en inutilité est fait par certains vis-à-vis de ces animaux auxquels trop de soins et d’attention seraient destinés. Les présenter comme des auxiliaires de santé, dont la compagnie a des effets bienfaisants y compris médicaux, est une façon de contrer ce discours. On voit ainsi des hôpitaux ou des Ephad accepter d’accueillir des animaux familiers. On peut aussi noter les cas d’utilisation d’animaux, comme les porcs, dans le cadre de greffes (reins).
*Jean Estebanez, Humains et animaux, documentation photographique 8149, ed. CNRS, 2022
Micheline Huvet-Martinet, relu par J.Estebanez, avril 2024
-
 13:12
13:12 Le Dessin du Géographe n°100. Une aventure graphique et numérisée au long cours
sur Les cafés géographiquesAu Festival international de Géographie 2020 de Saint-Dié-des-Vosges, le Dessin du Géographe présentait à la librairie Le Neuf une exposition-anniversaire de ses dix ans de parution sur le site internet de l’Association des « Cafés-géo » (cf. dessin n°83).

Exposition en 2020 des « dessins du géographe » au FIG de Saint-Dié (photo de Roland Courtot)
Début 2024 le dessin n°100 est atteint, Michel Sivignon prend sa retraite de la Rédaction de la page web, que deux nouveaux sont venus rejoindre depuis plusieurs années. Michel Sivignon a été « l’inventeur » de l’idée « dessin du géographe » et a entraîné Roland Courtot dans cette aventure graphique et numérisée au long cours. Simon Estrangin, aquarelliste et pédagogue du travail sur le motif, et Charles Le Cœur, géomorphologue des Massifs anciens et dessinateur de terrain, sont venus prêter main forte. Les collaborations des collègues et de quelques géographes étrangers n’ont pas manqué, mais jusqu’ici tout le champ du dessin géographique n’a pas été couvert et il reste certainement beaucoup à explorer. Essayons, dans le texte qui suit, de tirer quelques leçons de toutes ces images dessinées et parcourues, et des questions et réponses qu’elles peuvent (et doivent) poser et apporter.
Roland Courtot, Simon Estrangin, Charles Le Cœur, Michel Sivignon
Ce que le dessin peut apporter à la géographie (Simon Estrangin)
En 2010, dans leur intention initiale, R.Courtot et M.Sivignon, proposaient de créer une rubrique qui travaille à faire « sortir de l’oubli une pratique [le dessin] et à la raccrocher au devenir de la géographie ». Aujourd’hui, la rubrique compte cent numéros et couvre une variété incroyable de dessins (croquis de terrain, caricature, illustration de manuel…), d’époques (avec une attention particulière au dessin contemporain), d’espaces, de courants géographiques. Elle propose donc un vaste panorama. À la parcourir on se convainc que le dessin est bel et bien un outil qui présente encore de nos jours de nombreux intérêts. La liste ci-dessous tente de les répertorier en associant à chaque point un ou deux numéros de la rubrique à titre illustratif.
Un corpus à étudier
Pour étudier les représentations qui portent sur un territoire, sur des paysages.
n° 18 Gravures de Marc Théodore Bourrit, Roland Courtot
n° 97 Visions d’Orient, Michel SivignonPour étudier l’histoire de la discipline.
n° 19 : Un grand affichiste au service de la géographie, deux dessins de R.Broders, Roland Courtot, Michel Sivignon
n° 77 : Maroc Le dessin colonial de Théophile Jean Delaye, Michel Sivignon, Jean-François TroinLe dessin sur le terrain
Un outil qui accompagne les géographes dans leur (re)découverte d’un lieu et aiguillonne leur curiosité.
n° 45 Un pont sur la Neretva, Anne Cadoret
n° 89 Le dessin illustration du confinement, Martine TabeaudUne pratique qui aiguise les sens et élargit le champ de la perception.
n° 81 Les dessins en excursion géographique, Roland CourtotUn outil convivial qui crée un climat de confiance entre le dessinateur et ceux qu’il observe. Un moment d’échange.
n° 17 : Les femmes de Marrakech, Elise Olmedo
n°82 : Le dessinateur et le photographe : la photographie comme agression, Roland Courtot, Simon Estrangin et Michel SivignonLe dessin permet une prise de note efficace et favorise la mémorisation.
n° 25 : Une double-page du carnet de terrain d’Emmanuel de Martonne : la vallée d’Anies (Roumanie), Gaëlle Hallair
n° 62 : Croquis d’Albert Demangeon en Limousin (1906-1911), Denis WolffUn premier travail pour trouver et pointer ce qui est signifiant.
n° 90. Retour vers les montagnes d’Irlande du Nord : un changement de regard, Charles Le Cœur.Le dessin et la réflexion
Le dessin peut fertiliser la recherche en soutenant un effort d’imagination et de visualisation.
n° 91 Sous le pinceau de l’archéologue. Vues du passé de l’Amazonie, Stephen RostainLes géographes recueillent des dessins auprès des enquêtés pour étudier leurs représentations de l’espace.
n° 49 : Dessins pour interpréter les perceptions du rural par les citadins chinois d’aujourd’hui, Emmanuel Véron
n° 57 L’enfant et la guerre : Dessin d’enfants bosniens représentant les combats (1991-1995), Bénédicte TratnjekLe dessin peut encourager l’interdisciplinarité (botanique, entomologie, géologie…)
n° 71 Le trait et la lettre dans les carnets d’Afrique de Christian Seignobos, Michel Sivignon
n° 88 Dessin de géographe, dessin d’architecte : rencontres. Michel SivignonLe dessin peut accompagner des pensées relativement abstraites (proposer notamment des modèles)
n° 26 Jean Pierre Deffontaines: une modélisation paysagère depuis les fenêtres du TGV, Roland Courtot
n° 11 La « coupe-synthèse » de Yves Lacoste et Raymond Ghirardi, Michel Sivignon,Enseigner, communiquer, diffuser
Le dessin peut être une pratique pédagogique efficace.
n° 31 : Paysages de montagnes et de glaciers, Eduardo Martínez de Pison, Roland CourtotLe dessin implique des choix graphiques (il souligne, omet, ajoute, recompose, crée des modèles) qui permettent la diffusion d’un propos
n° 48 : Un bloc diagramme des falaises d’Ouessant, Julien Gayraud
n° 56 : Carnet de voyage dans les îles Gotô (juillet 2009), Philippe PelletierLe dessin peut s’appuyer sur l’émotion, l’humour, la narration (BD), et rendre un propos plus attractif et percutant.
n° 29 : Humour et Géographie sur le littoral alicantin, Gabino Ponce Herrero, Roland Courtot
n° 30 : Déforestation en Amazonie en bande dessinée, Hervé RégnaudExpérimenter ?
Le dessin est propice à des descriptions des lieux qui intègrent des thèmes peu abordés comme l’ambiance, la lumière, le fugitif.
n°86 : 100 ans de dessins de géographes dans les Écrins, Roland Courtot, Charles Le Coeur, Simon EstranginEnfin, ce panorama peut se compléter et se prolonger par la lecture d’articles consacrés au dessin et publiés dans les revues scientifiques ces dernières années.
Arango L., Guitard E., Lesourd C., et al. (2022), « Appréhender les relations à la nature en Afrique par le dessin sur le terrain » Sources. Materia & Fieldword in African Studies, n° 4, p. 381?408.
Herrmann, L. (2021). « Dessiner à l’Université. Esquisse d’un cheminement», Echogéo, 55.
Lascaux A.-A. et Rigaud A (2022)., « Dessiner son terrain pour le ressentir », EchoGéo, 62.
Roussel F. et Guitard E. (2021), L’usage du dessin dans l’enquête de terrain en sciences sociales, État des lieux et perspectives depuis la géographie et l’anthropologie, Carnets de Terrain
[https:]] .Dessin de terrain, de réflexion, d’enseignement, d’expérience sensible (Charles Le Cœur)
Dessiner c’est d’abord regarder pour comprendre un paysage ou un espace. Ensuite le crayon peut traduire l’observation sur le carnet de terrain. Il peut aussi reconstituer l’organisation des éléments qui se combinent dans cet espace. Une simple esquisse, un schéma grossier, ou bien une perspective élaborée sur le motif sont des outils de travail.
La question de l’échelle des objets devrait sans doute être mise en avant, puisque le dessin sélectionne les plans et choisi la dimension de la chose représentée. Entre la maison rurale et le paysage de campagne, entre la rue et le panorama de la ville, entre l’arbre et la forêt. Le dessin joue de ces rapports d’échelle en distinguant des plans. Le dessinateur choisit pour donner sens.
Et je me suis interrogé (en géographe physicien) sur les dynamiques associées à ces différentes échelles qui renvoient souvent à des durées très différentes et parfois à des processus différents. Entre le biotope de la prairie fleurie et la forme d’échelle moyenne résultant de la dénudation à long terme, il y a le versant qui conserve les marques (et les dépôts) des évolutions quaternaires et fin-quaternaires mais aussi les formes façonnées par des sociétés qui se sont succédé avec des pratiques différentes. Le dessin séquentiel peut faire apparaître ces éléments emboîtés et les replacer dans un ensemble paysagé plus synthétique.
Cela me pousse à différencier le dessin de paysage des croquis élémentaires qui sont des zooms sur des objets, ou encore des croquis-schémas, qui sont un autre outil pour penser la place des objets (sans nécessairement leur donner une forme précise). À ces schémas s’ajoutent les petits croquis pédagogiques, sortes de modèles synthétiques qui ont peuplé nos manuels de géographie ou les tableaux noirs de nos maîtres.
Enfin je m’interroge sur la place du dessin dans les œuvres de géographie où la photographie ou les diagrammes ont remplacé les rares dessins et schémas. Il est vrai que le concours d’agrégation est un exercice de discours pour lequel nombre de khâgneux ont été formés. Le dire plutôt que le voir. Ainsi, une partie de la géographie française, dans ses textes, s’est appuyée sur des travaux de seconde main. L’acquisition directe de données est parfois longue et périlleuse et il est plus simple d’intégrer dans son discours des éléments (souvent disparates) qui sont tirés des travaux d’autres disciplines pour en esquisser une synthèse territoriale.
Certes, l’observation directe demande du temps, et n’entre pas directement dans le discours. Mais le croquis peut être une étape dans la formulation des choses puisqu’il cherche à replacer des objets dans un espace avant de construire un lien conceptuel.
Les tentations anciennes de la géographie se nourrissaient de statistiques (souvent sans analyse critique des sources) et cherchaient à s’intégrer dans les systèmes des aménageurs. Les explorations plus récentes s’embarquent dans des modèles très abstraits qui ne peuvent se traduire par des croquis figuratifs. Je crois avoir écrit dans un petit texte dans Hérodote, pour dénoncer « les mots de la géographie » de Brunet, Ferras et Théry (1992), qu’il s’agissait d’une vision cubiste de l’espace niant l’échelle et la perspective. Les SIG ont pris le relai, c’est l’ordinateur et ses logiciels qui effectuent les opérations d’analyse des données qu’on leur a confiées.
Le dessin est un outil pour traquer l’hétérogénéité de nos espaces. Il nous demande de mettre les objets que nous voyons à leur place. Mais que peut faire le crayon pour évoquer les réseaux de valeurs invisibles ? Une géographie des flux financiers, une géographie des routes de dealers dans l’ombre, une géographie des intentions de vote, ou une géographie du genre ne s’inscrivent pas avec des traits sur le papier. Le dessin peut alors prendre une valeur de symbole. Comme les images des vieilles pages des bibles enluminées qui évoquent la sainteté, l’enfer ou les prières du jour. Les entêtes de chapitres dessinés par F. Kupka pour « l’Homme et la Terre » d’Elisée Reclus ont cette fonction. Mais la géographie peut-elle être une allégorie ?
Je m’interroge sur l’idée d’introduire le dessin dans les cursus de géographie, comme une géo-graphie d’apprentissage. C’est un rêve à contretemps de notre monde connecté et de ses écrans. Dans l’enseignement secondaire, la majorité des professeurs sont formés comme historiens et même s’ils sont familiers de la lecture d’image, ils sont souvent très loin du papier-crayon. Pour les cursus universitaires, ce sont les savoirs et la recherche intellectuelle à partir de modèles conceptuels qui sont mis en avant. Les « outils » qui étaient autrefois la cartographie et les statistiques ont été largement remplacés par la maîtrise des SIG, qui ont un tout autre intérêt. Si l’approche spatialisée a beaucoup gagné avec ces moyens techniques, les problématiques restent ancrées sur des constats visuels qui peuvent s’inscrire dans le dessin, souvent plus expressifs que la photographie.
Cette rubrique montre combien la pratique du dessin de géographe apporte une expérience sensible : le papier porte les liens entre l’observateur et son décor, c’est un média qui sert à l’appropriation du terrain et guide sa compréhension.
Formes et composition dans le dessin du géographe (Roland Courtot)
Ma participation au développement de la page web du « Dessin du Géographe », en compagnie de Michel Sivignon, a favorisé pour moi, avec beaucoup d’immodestie, des essais dans la géographie de l’art : création d’un carnet scientifique dans « hypothese.org », analyses du contenu géographique de tableaux de paysages sur le site des « cafés-géo ». Cette expérience rédactionnelle et la lecture de cet énorme corpus des pages web a mis en avant, sans d’ailleurs en résoudre les problèmes, quelques questions qui rapprochent le dessinateur géographe de l’art pictural en général : celles de la forme et de la composition d’une œuvre graphique.
Pour ce qui est des formes paysagères, le géographe dessinateur est évidemment l’héritier de l’histoire de l’art pour les questions de point de vue, de projection, de perspective. Son besoin de rester proche d’une vérité-terrain a pu l’empêcher de se libérer plus tôt que le peintre moderne ou contemporain des servitudes que la recherche picturale a cherché à surmonter depuis la Renaissance (cubisme, perspective inversée, etc…).Mais sur le terrain, le géographe a souvent procédé comme le peintre par itinéraires et cheminements qui lui ont fourni une quantité de points de vue à partir desquels il a pu construire ses propres modèles de dessins : croquis panoramique, perspective aérienne, bloc-diagramme, coupe…
Lorsque le peintre construit sa « présentation » d’un paysage terrestre ou marin, urbain ou rural, ou d’un événement historique dans son contexte environnemental, il compose son tableau en organisant à sa guise les objets, les personnages, les paysages réels ou inventés qui lui conviennent, dans sa recherche des émotions esthétiques qu’il veut communiquer. A partir de ses cheminements, le géographe peut, de la même façon, choisir les éléments signifiants du paysage et les organiser en un seul dessin de telle sorte qu’ils fassent « sens », que les relations entre les objets soient sensibles pour le « regardeur » : l’image paysagère peut alors être bien plus qu’un inventaire, et devenir une présentation des formes de l’espace géographique, donc d’un « système » spatialisé.
Ceci entraîne alors une question qui fait différence : celle de la légende. Le tableau du peintre n’a besoin que d’un titre sur un cartel, car sa capacité à produire des impressions esthétiques doit se suffire à elle-même. Tandis que, à l’inverse de la carte géographique qui possède une légende détaillée par laquelle tous les objets qui y sont représentés sont clairement définis, le dessin géographique de terrain n’a pas cette possibilité, où sinon d’une façon très restrictive. Les éléments paysagers que le géographe rencontre sous ses yeux et traduit sur le papier au bout de son crayon sont très (trop) nombreux pour permettre une identification nécessaire aux interprétations qui doivent suivre. Le dessin a besoin de mots : simples notations griffonnées à la hâte sur le carnet en forme de phylactères, ou plus longs commentaires. Dans sa réforme du « croquis de géographie régional » par la chorématique (qui n’est pas pris en compte dans cet article mais qui a eu par ailleurs d’heureuses conséquences sur la figuration des formes d’organisation de l’espace), Roger Brunet a en partie achoppé sur cet écueil : sa tentative de trouver les signes nécessaires à une taxonomie permettant de figurer ces logiques systémiques.
Roland Courtot, Simon Estrangin, Charles Le Cœur, avril 2024
-
 12:42
12:42 Que faire des mouches ?
sur Les cafés géographiques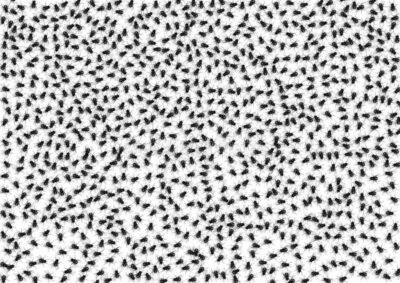 Le café géo consacré à nos relations avec les animaux, en présence du géographe et spécialiste Jean Estebanez le 26 mars 2024, a permis de montrer combien nos destins humains sont liés aux animaux. Y compris les plus petits comme les mouches qui altèrent la douceur de vivre à la campagne l’été. Faut-il déplorer qu’on ne vienne pas à bout de ces bestioles si fragiles ? Explications sur une lutte inégale des places hommes/animaux. (Gilles Fumey)
Le café géo consacré à nos relations avec les animaux, en présence du géographe et spécialiste Jean Estebanez le 26 mars 2024, a permis de montrer combien nos destins humains sont liés aux animaux. Y compris les plus petits comme les mouches qui altèrent la douceur de vivre à la campagne l’été. Faut-il déplorer qu’on ne vienne pas à bout de ces bestioles si fragiles ? Explications sur une lutte inégale des places hommes/animaux. (Gilles Fumey)Les citadins qui débarquent dans les campagnes l’été découvrent ces intruses dont ils ignorent l’existence en ville. Pauvres autochtones qui tapent, tempêtent, s’énervent. Sartre avait fait des mouches les déesses de la repentance dans une pièce de théâtre écrite sous l’Occupation en les chargeant de tous les péchés du monde. Salvador Dali les aimait pour confirmer sa méthode paranoïaque-critique. Cronenberg en a fait l’un des chefs d’œuvre du cinéma de science-fiction (La Mouche). Dans les tombes de l’Égypte antique, des pendentifs précieux en forme de mouche autour du cou des défunts rappellent que les mieux gradés de l’armée en étaient décorés, en hommage aux ennemis qu’ils avaient terrassés…
 Sur ce vitrail, entre les trois personnages dont saint Bernard (à droite), les mouches meurent sous le coup d’une excommunication alors qu’elles envahissent l’abbaye de Foigny lors de son inauguration le 11 juillet 1121 par le fougueux moine. Un épisode raconté sur un vitrail d’Altenberg (Allemagne) aujourd’hui à Shrewsbury (Grande-Bretagne). Pour François d’Assise, écologiste avant l’heure, les mouches (nécrophiles) représentaient le diable.
Sur ce vitrail, entre les trois personnages dont saint Bernard (à droite), les mouches meurent sous le coup d’une excommunication alors qu’elles envahissent l’abbaye de Foigny lors de son inauguration le 11 juillet 1121 par le fougueux moine. Un épisode raconté sur un vitrail d’Altenberg (Allemagne) aujourd’hui à Shrewsbury (Grande-Bretagne). Pour François d’Assise, écologiste avant l’heure, les mouches (nécrophiles) représentaient le diable.Pullulant dans les régions d’élevage où le bétail les nourrit, les mouches s’infiltrent partout. Jusque dans les conversations à table, vibrionnant sous la tonnelle, nous cherchant sur le transat et, parfois, dans les chambres à coucher où la nuit peut tourner à la bataille. Malgré la traque dont elles sont l’objet, elles reviennent, se posent n’importe où. Sur le web, les astuces pour s’en débarrasser fourmillent : insecticides au pyrèthre, rouleaux collants, buvards mortels, moustiquaires, plantes carnivores, pièges électriques, rien n’y fait, les mouches sont toujours là.
Et depuis longtemps. Les diptères apparaissent avant même le crétacé, il y a au moins 200 millions d’années, en coévolution avec les plantes à fleurs. Leur classement est interminable. Tout est bon pour les distinguer : saisons (mouches de mai), géographie (mouches d’Espagne), éthologie (mouche pisseuse, mouche à miel), couleur (mouche blanche), physiologie (mouche à scie), etc… Certaines espèces sont jugées utiles : elles pollinisent, elles attaquent d’autres insectes, elles servent de nourriture aux poissons, elles sont nécrophages… Ce qui fait problème ? Leur commensalité avec les humains : elles salissent les murs, elles transportent des bactéries, des microbes, des virus sur les aliments, elles sont associées à la souillure et la mort.
De la souillure à l’asticothérapie
Le choléra et le typhus voyagent avec elles, notamment pendant les guerres, les séismes. La maladie du sommeil, la maladie de Chagas et la leishmaniose transmises par la redoutable tsé-tsé qui tue cinquante mille personnes dans les pays du Sud chaque année. Sans compter les dégâts sur le bétail et les récoltes. Des millions d’euros sont dépensés par la communauté internationale pour en venir à bout. En vain, pour l’instant.
Pourtant, que seraient nos déchets organiques, nos égouts sans les mouches ? Certains asticots de laboratoire ne cicatrisent-ils pas les plaies, en se régalant de chairs mortes et de pus ? Certaines mouches prédatrices n’aident-elles pas à combattre des ravageurs comme les chenilles ou les pucerons ? Et les mouches n’aident-elles pas les médecins légistes à déterminer le moment d’un décès en fonction des pontes d’œufs et des larves ?
Faut-il aimer les mouches lorsqu’elles inspirent le généticien T.H. Morgan sur les drosophiles où il met en évidence pour la première fois les mutations génétiques sur des animaux ? Ou voir dans la peinture et le dessin des pionnières de l’art baroque, un art de l’illusion au moment où la science se met en quête de vérité ?
————-
Sur le sujet, écouter l’excellente conférence de Benedetta Papasogli (professeure à l’université LUMSA de Rome) au Collège de France dans un colloque consacré à Pascal : « Des créatures sans un cantique : cirons, mouches, fourmis chez Pascal ».
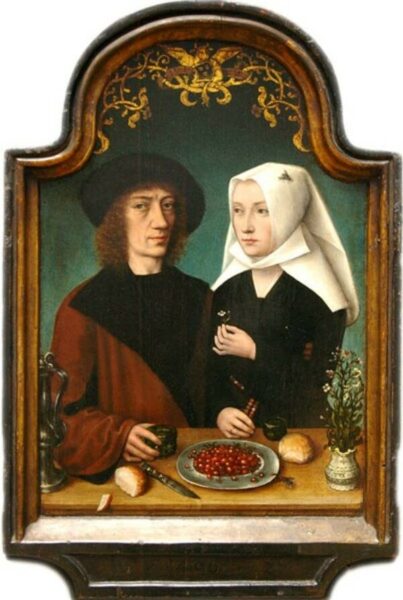
Maître de Francfort, Autoportrait de l’artiste et de sa femme, 1496. Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers
Maître de Francfort (autoportrait avec sa femme), XVe siècle. La taille de la mouche sur la coiffe donne l’impression qu’elle est posée sur le tableau. Un premier cas de mise en abyme
Gilles Fumey mars 2024
-
 18:15
18:15 Taïwan : une île en état d’alerte ?
sur Les cafés géographiquesL’agression de l’Ukraine par la Russie a ravivé les inquiétudes sur la sécurité de Taïwan.
La petite île doit-elle redouter une prochaine invasion de son grand voisin chinois ?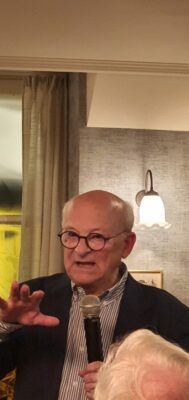
Jacques Gravereau (Photo de J.-P. Némirowsky)
Le Café de la Mairie était bondé pour écouter Jacques Gravereau nous parler de Taïwan, de sa société, de sa géographie particulière et surtout de ses relations avec la Chine. Grand expert des questions économiques et politiques liées à l’Asie, notre intervenant, président pendant 25 ans de l’Institut HEC-Eurasia, a une connaissance approfondie de la deuxième puissance mondiale dans laquelle il a fait 70 séjours. Et c’est sur un ton combinant humour et érudition qu’il analyse la situation d’une zone très sensible de notre monde.
Les médias occidentaux s’intéressent de plus en plus à la Chine à partir de 1989, année de Tiananmen et de la bifurcation majeure de la trajectoire économique chinoise. C’est ce que constate Jacques Gravereau qui a également pratiqué de près la diplomatie multilatérale en représentant longtemps la France au PECC (Pacific Economic Coperation Council) dont la France est membre eu égard à sa position dans le Pacifique grâce à la Nouvelle Calédonie et à la Polynésie. Dans cette enceinte, Chinois et Taïwanais (sous l’appellation de « Chinese Taipei ») discutent beaucoup ensemble – J. Gravereau reviendra à plusieurs reprises sur ce fait.
Que dire de la conjoncture actuelle ?
Xi Jinping a-t-il des velléités d’empire ? Depuis son arrivée au pouvoir il y a 11 ans, ses discours multiplient les appels à la « réunification » de la Chine avec Taïwan. Les manœuvres d’intimidation chinoises dans les eaux qui entourent l’île sont nombreuses, comme l’actualité récente ne cesse de l’illustrer, notamment par des incursions menaçantes répétées de chasseurs chinois à proximité immédiate de Taïwan. Le détroit de Taïwan est toutefois juridiquement constitué d’eaux internationales libres de navigation. Ce que les navires de la septième flotte américaine rappellent périodiquement en y passant intentionnellement.
Il est utile de rappeler brièvement l’histoire de Taïwan.
Ce sont d’abord des Aborigènes du Pacifique qui ont peuplé l’île. Puis des paysans chinois, originaires du Fujian voisin, s’y installent à partir du XVe siècle. Peu nombreux et « mal reçus » dans un premier temps, ils constituent un flux continu de migrants au XVIIIe siècle, alors que les Européens, Portugais puis Hollandais, s’intéressent aussi à la grande île. Les Aborigènes seront progressivement repoussés dans les montagnes. Lorsqu’à la fin du XIXe siècle, en 1885, Taïwan devient une province dépendant de l’empereur de Chine, 4 millions de Chinois parlant la langue du Fujian y vivent. Dix ans plus tard, le traité de Shimonoseki, qui met fin à la guerre sino-japonaise, donne au Japon la souveraineté sur Taïwan. Taïwan ne retournera à la Chine – alors dirigée par Tchang Kaï-chek – qu’au moment de la capitulation japonaise dans la guerre du Pacifique, en 1945.
En 1949 Tchang Kaï-chek, battu par les communistes sur le continent, installe à Taipei le gouvernement d’une « République de Chine ». De 1895 jusqu’à aujourd’hui, aucune autorité pékinoise, aucun soldat de Chine continentale, n’a mis les pieds sur le sol de Taïwan.
L’histoire racontée par Xi Jinping dit que Taïwan a de tout temps été une province chinoise inaliénable. Elle est instrumentalisée dans le droit fil d’une vision impériale ancienne. Un empire, en effet, n’a pas de frontières fixes, il a des « marches » bonnes à être vassalisées. Cela a toujours été, en Chine comme en Russie ou dans l’empire ottoman.
Depuis 1949, Taïwan et Chine ont connu deux évolutions différentes.
Taïwan est d’abord menée de main de fer par Tchang et son parti unique, le Kuomintang. Après la mort du leader autoritaire (1975), son fils entreprend la démocratisation du régime, ce qui est facilité par la conjoncture internationale. On vit alors la période de la mondialisation « heureuse » (boom économique du Japon, puis des « quatre petits dragons » asiatiques, dont Taïwan. Les progrès fulgurants favorisent l’éclosion de classes moyennes éduquées et entrepreneuriales, soucieuses de vivre selon des règles stables affranchies de l’arbitraire. A la fin des années 1980, l’éclosion du multipartisme, servie par la transparence des élections accouchent d’une démocratie authentique. Les Taïwanais ne sont pas prêts à régresser sur ce plan (la situation de Hong Kong leur sert de repoussoir absolu). A 80% il se revendiquent comme « Taïwanais » ; seulement 2% se définissent « Chinois ». D’accord pour avoir des relations avec les Chinois, mais uniquement sur le plan du business. Lors des dernières élections présidentielles de 2023, c’est le candidat non prochinois qui a été élu, mais personne ne s’aventurerait à prononcer le mot tabou d’ « indépendance ».
En Chine, Mao Zedong, arrivé au pouvoir en 1949, évoque à maintes reprises la « réunification de la province renégate » et envoie en 1955 et 1958 son armée bombarder les îles Kinmen et Matsu, tout proches du continent. Le mantra de la « réunification » est rabâché régulièrement par les successeurs de Mao, ce qui témoigne de la frustration des Chinois. Mais toute velléité d’attaque est obérée par les contraintes géographiques (éloignement des côtes, relief montagneux) et militaires (proximité de l’armée américaine).
Après Mao, Deng Xiaoping met la croissance économique au centre de sa politique et fait profil bas en matière internationale. C’est l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en novembre 2012 qui remet au centre du « rêve chinois » les ambitions internationales de l’« empire du milieu ». On proclame : « la mer de Chine est à nous » (jusqu’aux Philippines) et on bétonne les petits atolls pour en faire des pistes d’atterrissage.
La Chine fait des efforts considérables depuis quelques années pour se doter d’une imposante flotte de guerre. Elle a lancé en trois ans l’équivalent de toute la flotte de guerre française actuelle. Elle est encore en état d’infériorité sur les sous-marins et les porte-avions, mais ses ambitions sont grandes. De plus, la Chine est entourée d’une chaine d’iles (Japon, Philippines etc…) qui contraignent son déploiement dans les eaux profondes du Pacifique.
Actuellement la stratégie de Xi pour soumettre Taïwan déploie une panoplie impressionnante en « zones grises », faite de cyberattaques (5 millions par jour !), de désinformations systématiques, de menaces de rétorsions en tout genre, de fait accompli hors du droit international (en mer de Chine en particulier). Les gesticulations militaires chinoises sont amples et récurrentes, par des moyens ou aériens, tels des masses de chasseurs fonçant dans la zone d’identification aérienne de Taïwan, avant de faire subitement demi-tour). Quand les Américains se montrent trop empressés à l’égard de Taïwan, les menaces montent de plusieurs crans, et l’incertitude devient difficile à gérer. C’est le but.
Quels scénarios pour le futur ?
Trois scénarios sont envisageables.
Le « scénario vert » serait le statu quo avec la poursuite des échanges commerciaux. 40% des exportations taïwanaises partent en Chine et les Chinois ont besoin des entreprises taïwanaises implantées sur leur sol. Taïwan a sur son sol un joyau industriel unique : TSMC (Taïwan Semiconductor Manufacturing Company), qui contrôle actuellement 58% du marché mondial des semi-conducteurs de dernière génération.
Dans le cas d’un « scénario orange », les Chinois pourraient intensifier leurs intimidations, en ajoutant par exemple à leur panoplie actuelle des actions de quarantaine ou d’embargo maritime et aérien pour isoler Taïwan, qui dépend évidemment de ses échanges avec l’étranger.
Le « scénario rouge » aboutirait au lancement d’une attaque majeure sur l’ile, ce qui provoquerait un bain de sang. En effet, l’effet de surprise indispensable à une attaque amphibie est très hasardeux à cause du renseignement moderne et de l’importante flotte de missiles taïwanais. Néanmoins, si Taïwan est laissée à elle-même sans assistance extérieure, ses perspectives sont celles d’un champ de ruines. Mais le « coût d’acquisition » pour la Chine serait hors de sens. Tout dépendrait alors des Etats-Unis, présents dans quatorze bases autour de l’île (Guam, Okinawa, Japon, Philippines, Corée du Sud…). S’ils n’interviennent pas, ils perdent stratégiquement l’océan Pacifique et dynamitent l’ensemble de leurs systèmes d’alliances majeures en Asie et sans doute dans le monde. S’ils interviennent, ils subissent de lourdes pertes, mais tous les wargames indiquent que la Chine ne peut pas l’emporter.
La rationalité voudrait que Xi Jinping et les forces de rappel du Parti communiste chinois n’aillent pas jusque-là. Mais c’est une science inexacte !
Questions de la salle
A une question sur les relations entre Taïwan et Hong Kong, J. Gravereau confirme les liens étroits entre les deux territoires en matière de business, malgré la chape de plomb politique qui pèse sur la région administrative spéciale chinoise.
Une étudiante qui, pour ses travaux de recherche, a travaillé chez TSMC, précise que, depuis trois ans, aucun équipement de dernière génération n’a été vendu à la Chine et que beaucoup d’entreprises taïwanaises ont quitté le continent à cause de l’arbitraire chinois qui peut s’exercer sur n’importe quelle personne. Le climat des affaires n’est pas bon.
J. Gravereau n’est pas convaincu, comme le suggérait un auditeur, que l’« obsession chinoise » que subit Taïwan soit un voile pour masquer les actuels problèmes économiques chinois, car elle date de 1949.
Peut-on dire que le régime chinois « tangue » actuellement comme pourraient le faire soupçonner les purges anti-corruption et la « disparition » de certains ministres comme celui des Affaires étrangères et celui de la Défense ? On ne peut rien affirmer, ni sur la solidité du régime, ni sur celle de la base du pouvoir de Xi Jinping.
Une précision est donnée sur l’implication militaire des Etats-Unis : ils ne possèdent pas de base sur le territoire même de Taïwan mais lui vendent annuellement du matériel militaire d’une valeur de 500 millions $.
Note :
Jacques Gravereau vient de publier « Taïwan, une obsession chinoise » avec de nombreuses cartes en couleurs aux éditions Hémisphères, janvier 2024.
Michèle Vignaux, relu par Jacques Gravereau, mars 2024
-
 15:30
15:30 Le dessin du géographe n°99. Dessins pédagogiques de découverte du bocage (enfants de 3 à 9 ans)
sur Les cafés géographiquesCes dessins sont ceux d’enfants de 3 à 9 ans que j’ai amenés dans un petit bocage (vallée du Valbonnais, massif des Écrins, printemps 2022) avec l’intention de leur en faire découvrir la richesse. Ce ne sont pas des dessins de géographes, ni géographiques, mais le dessin ici est un moyen de découverte pédagogique du milieu. L’activité se déroulait dans le cadre d’une association qui propose des « ateliers nature » et les objectifs en termes de contenus ou de compétences étaient relativement peu formalisés, alors que l’aspect convivial et le plaisir simple d’être en extérieur étaient centraux.
Le bocage en question, où nous nous sommes rendus, est un endroit que les enfants connaissent mais qu’ils n’identifient pas comme tel. Je leur ai proposé successivement trois exercices : celui de dessiner un arbre ou arbuste, puis des plantes de la prairie, et enfin une vie ou une trace de vie animale (insecte, oiseau …). Une fois l’activité lancée j’ai incité individuellement ceux qui étaient les plus rapides à prêter attention à ce qui était en hauteur, à ce qui était au niveau du visage, ou à ce qui était au sol, avec l’idée qu’ils remarqueraient peut-être que des espèces différentes habitent ces étages des haies. Les consignes étaient des invitations et certains enfants se les sont réappropriés. Tel petit (3 ans) qui ne voulait pas dessiner a accepté de choisir un sujet que j’ai représenté pour qu’il le colorie (fig.1, rouge-gorge) ; tel enfant plus grand a préféré prendre des échantillons de feuilles pour les reproduire par frottage (fig.2, noisetier, cornouiller sanguin, érable…).
Finalement nous avons regroupé nos dessins pour échanger. Il en est ressorti l’idée de milieux riches, avec des habitats variés et de nombreuses espèces entretenant des relations entre elles.
Enfin, nous avons réfléchi sur l’origine d’un tel milieu, pour évoquer bien sûr la place de l’homme. Sans employer le terme il était question de co-suscitation des milieux (homme-nature).Le dessin a donc été un outil qui a servi d’abord de prétexte attrayant pour visiter le lieu et le parcourir (rando-croquis), ensuite pour y rester un long moment attentif et concentré. Puis a suivi un moment où exprimer de l’information et une sensibilité. Enfin, ce fut un temps de partage et de réflexion collective à partir des nombreuses observations.
Cette approche s’inscrit dans le vaste cadre de la pédagogie par le dehors. Elle est source de connaissances, mais nourrit aussi le lien affectif et sensible des enfants à leur environnement.


Fig.1 : Rouge-gorge Fig.2 : Feuilles diverses (cornouiller sanguin, pissenlit, noisetier…) 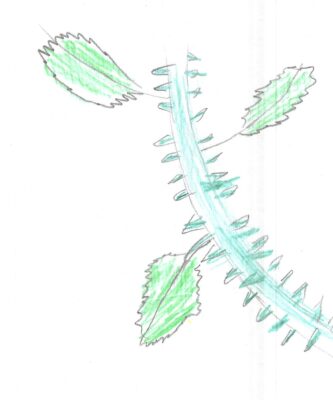
Fig 3 : Ronce 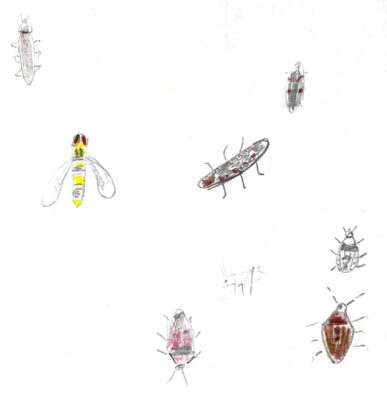
Fig 4 : Insectes variés (lacon souris, syrphe, larve de coccinelle etc.) 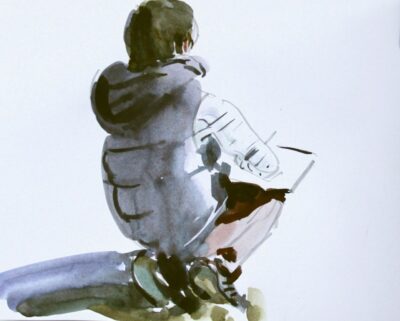
Fig 5 : J’ai dessiné un des enfants lors de cet exercice. Simon Estrangin, mars 2024
-
 16:43
16:43 La crise de l’eau en France
sur Les cafés géographiquesL’actualité de ces dernières années est marquée en France mais aussi partout dans le monde par la multiplication de crises de l’eau auxquelles nous étions peu habitués : sécheresses prolongées même dans des régions inhabituelles comme la Bretagne, inondations catastrophiques récurrentes (Pas de Calais, La Roya), pénuries d’eau potable généralisées à Mayotte, et surtout affrontements violents autour des ressources en eau et de projets hydrauliques (Sivens, Sainte-Soline). En général la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) qui visait à atteindre le bon état écologique des masses d’eau a échoué.
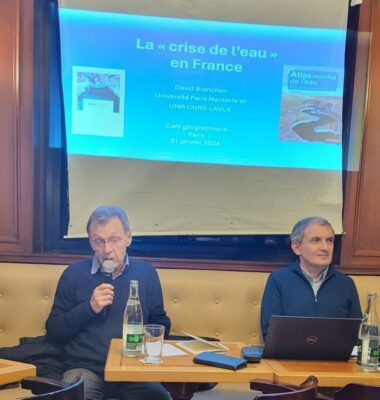
Daniel Oster présente David Blanchon (photo Micheline Huvet-Martinet)
Mardi 6 février devant un auditoire fourni, David Blanchon, géographe, Professeur à L’Université Paris-Nanterre, auteur d’ouvrages liés aux problèmes de l’eau * et grand connaisseur d’espaces comme les Etats-Unis, le Soudan et l’Afrique du Sud , est venu discuter de la crise, en fait des crises de l’eau, tout en s’interrogeant sur leur caractère conjoncturel ou structurel, mais surtout en cherchant à en comprendre la logique en introduisant des notions clés comme le nexus eau-énergie-alimentation et le cycle hydrosocial.
Qui aurait pu prédire ces crises ?
A priori tout le monde, à condition de s’y intéresser et de distinguer ce qui est neuf de ce qui est ancien : les climatologues et les hydrologues intéressés par le dérèglement climatique (qui aggrave la variabilité des pluies avec alternance année sèche/année humide), les urbanistes/aménageurs (bons connaisseurs de la vulnérabilité liée à l’arrachage des haies, l’artificialisation des sols qui renforce le ruissellement, les constructions en zones inondables qui aggravent les inondations…), les médecins qui peuvent estimer les effets de la pollution des eaux par l’usage des pesticides. Tous sont capables de prévoir les crises.
Ces crises de la variabilité de l’eau sont connues depuis longtemps tout comme les remèdes. Ainsi La Restauration des Terrains de Montagne, créée en 1882 existe toujours comme service de l’ONF, de même les Grands Lacs de Seine (1969). Elles sont anciennes, multifactorielles modifiées par le changement climatique qui accélère les difficultés d’alimentation en eau d’autant qu’on n’a pas vraiment d’idées sur l’évolution future des précipitations car les modèles ne convergent pas nécessairement. Il semblerait que d’ici 2050 la France connaisse une hausse du débit des cours d’eau en hiver particulièrement dans le bassin méditerranéen et une baisse significative en été à peu près partout sur le territoire sauf dans la Manche et un peu en Bretagne. Le débit du Rhône pourrait être divisé par deux ainsi que celui de l’Isère et des petits fleuves côtiers méditerranéen, engendrant un énorme souci d’approvisionnement en eau même si chaque bassin versant risque d’évoluer différemment.
De quoi cette crise est-elle le nom ? Analyse de la criseEtat de la situation. En France la crise est beaucoup moins dramatique que celle d’autres pays (Espagne, Ouest américain, pays sahéliens…). Les volumes d’eau disponibles demeurent importants : le territoire français métropolitain bénéficie en moyenne de 480 milliards de m3 de pluie/an auxquels s’ajoutent 11 milliards de m3 provenant des fleuves transfrontaliers (sans le Rhin). Même si une grande partie s’évapore, restent disponibles environ 2800 m3/habitant/an auxquels s’ajoutent aussi les stocks des eaux souterraines et des eaux stagnantes de surface (lacs, étangs, barrages). La pression sur le prélèvement des ressources est faible soit un peu moins de 1/6ème des précipitations tombées, alors que certains pays sont à 90%. La situation française de ce point de vue reste donc relativement confortable.
Il faut distinguer le prélèvement de la consommation car certaines activités prélèvent beaucoup sans forcément consommer car l’eau utilisée est rejetée et recyclée : ex : les centrales électriques prélèvent beaucoup mais consomment peu contrairement à l’agriculture qui est la première consommatrice avec 57% du total, devant l’eau potable (26%), le refroidissement des centrales électriques (12%) et les usages industriels (5%).
Principal problème en France : crise du nexus-eau-énergie-alimentation c’est-à-dire le lien (nexus) entre ces trois éléments qui sont intimement liés. Les actions menées dans un domaine peuvent avoir un impact sur l’un des autres secteurs ou les deux autres ce qui rend les actions difficiles. Ce concept introduit par l’université des Nations-Unies en 2013 permet d’insister sur la nécessité de penser les trois pôles dans le même volume.
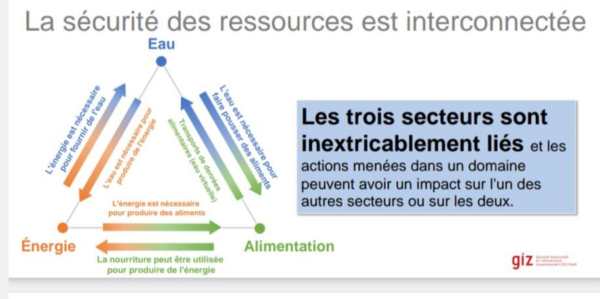
En France la consommation moyenne d’eau courante est d’une centaine de litres d’eau/jour/habitant, mais elle est de 4500 l pour notre consommation alimentaire. Une grande partie de la production électrique dépend des cours d’eau non seulement pour l’hydroélectricité mais aussi pour le refroidissement des centrales nucléaires. La moitié de l’eau prélevée en France l’est pour la production électrique.
En ce qui concerne le lien eau-alimentation le problème n’est pas seulement de la quantité mais aussi de la qualité. La Directive Cadre Européenne (DCE) de 2000 retranscrite dans le droit français en 2006 visait à atteindre le bon équilibre écologique des masses d’eau en 2015, mais l’échéance est constamment reportée et l’objectif ne sera probablement pas atteint en 2027. En effet, le bilan français est médiocre : 43% des masses d’eau de surface sont affectées par des pollutions diffuses, notamment nitrates et pesticides, 25,4% par des pollutions ponctuelles et 19,4% par des prélèvements d’eau excessifs. La situation est encore plus mauvaise ailleurs, notamment en Grèce et aux Pays-Bas.
C’est inutile de mettre en place une politique de l’eau stricte si par ailleurs on n’agit pas sur les deux autres pôles du nexus
Le modèle français de « gouvernance de l’eau » élaboré en 1964 et que beaucoup nous envient est en crise. Il a été élaboré par bassins hydrographiques en prenant les bassins versants comme base de gestion de l’eau. Ce modèle très articulé et décentralisé avec des agences de bassins, des comités locaux a été repris en 1992 par les Nations Unies. Maintenant on est arrivé au bout de ce modèle pas assez efficace pour résoudre les problèmes soulevés par la DCE concernant la qualité des masses d’eau. La hiérarchie administrative actuelle (communes, départements, régions) ne correspond plus aux bassins hydrographiques et il devient très compliqué pour les élus de se situer dans l’organigramme et de se retrouver parmi les compétences de chaque entité.
La crise du modèle des cycles et territoires hydro-sociauxLe cycle hydro-social considère que l’eau, en plus de sa nature physique, a aussi une réalité sociale. Le cycle hydro-social souligne les dimensions culturelles et historiques de l’eau. Actuellement, l’attachement, la connaissance qu’avaient les Français de l’eau a quasiment disparu car ils ne savent plus d’où vient l’eau qu’ils boivent ; ils n’ont aucune idée de la quantité qu’ils consomment. Selon D. Moose « la gestion de l’eau reflète les divisions majeures de la société, les rangs, les statuts et les positions dominantes et elle occupe une place centrale dans l’ordre symbolique ». IL existait des sociétés de gestion de l’eau dès le Moyen Âge. L’eau est le miroir d’une société mais ce miroir est maintenant cassé.
Que nous est-il permis d’espérer ?Pour ne pas rester négatif, il convient de souligner les progrès, notamment grâce aux stations d’épuration qui ont permis l’amélioration de la qualité des eaux. En 1992, la mise en place de politiques de l’eau permettait d’être assez optimiste mais maintenant, le dérèglement climatique remet en cause cette attitude et trois scénarios sont envisagés.
- Crash and burn : on continue comme d’habitude dans le vieux monde, c’est business as usual comme dans les années 1950 en maintenant les bassines, construisant des barrages, au mieux en changeant a minima les modes de gouvernance mais sans se préoccuper du nexus ni du cycle hydro-social. Dans ce cas le risque d’un effondrement est très probable vers 2050 si le changement climatique continue ou prend de l’ampleur. En Espagne ou dans l’Ouest américain, les barrages se vident déjà.
- scénario plus rose : celui d’une « nouvelle culture de l’eau » qui rencontrerait des oppositions et une certaine résistance car il suppose une remise en cause radicale du nexus énergie/ alimentation pour passer à une société de sobriété. Ceci conduit à une nouvelle vision de l’utilisation des cours d’eau, mais aussi à une révision des activités industrielles. Ce sont un peu les idées développées par le Parlement de Loire qui essaie de reconnecter les populations à la rivière en les sensibilisant à une nouvelle vision du fleuve.
- scénario médian du bumpy road. C’est un peu ce scenario qui est en cours actuellement en France. Bumpy car la route est cabossée avec une alternance de bonnes et de mauvaises années. C’est celui d’une transition lente et douloureuse qui agit sur la demande (avec un plan sobriété), met en place du techno-solutionnisme (dessalement, repoldérisation…) sans agir sur le nexus, en insistant sur les solutions fondées sur la nature. Le problème est celui de la variabilité climatique : un bon hiver peut être effacé par une succession d’années sèches. Il y a alors multiplication des crises conjoncturelles.
En conclusion, D. Blanchon se dit raisonnablement optimiste en observant la multiplication des initiatives locales. En effet, les acteurs locaux, notamment les agriculteurs, sont souvent beaucoup plus conscients des défis et des changements à mettre en place que les responsables au plus haut niveau de l’Etat qui bloquent sur le nexus.
Les nombreuses questions témoignant de l’intérêt de l’auditoire ont permis d’approfondir certains points.- La gouvernance de l’eau en France et la D.C.E. les technocrates européens ont assez peu d’influence sur la politique de l’eau dans les différents pays. La D.C.E s’est traduite dans le droit français par la loi de 2006 qui permet de fixer des objectifs et de faire un travail précis pour répertorier les disponibilités et la qualité des masses d’eau en faisant régulièrement des bilans. La D.C.E a un rôle incitatif et le fait de ne pas accomplir l’objectif est révélateur des difficultés. La gestion de l’eau est sous le contrôle de six principales agences de bassins avec des sous-bassins versants qui ont eux-mêmes des sous-sections constituées par commissions locales de l’eau rassemblant les différents acteurs concernés, lesquels élaborent des schémas directeurs. Bien sûr ce n’est pas forcement idéal car il peut y avoir des jeux de pouvoir et des rivalités mais cette gestion intégrée autour des bassins ne fonctionne pas si mal et a été adoptée par beaucoup d’autres pays. Ce modèle décentralisé est parfois contesté puisqu’il n’arrive pas à régler tous les problèmes en partie parce que le découpage des agences de bassins ne correspond pas aux limites administratives quand le bassin versant est sur deux régions et plusieurs départements. Finalement les agences de l’eau rajoutent une couche au millefeuille administratif français.
- Les bassines ont été élaborées depuis longtemps. Le problème n’est pas récent. Dans la région de Sainte-Soline le pompage des eaux sous-terraines remonte aux années 1980 créant déjà des conflits entre les agriculteurs irrigants et non irrigants car les rivières alimentant le marais poitevin s’assèchent sans qu’il soit possible d’identifier clairement les responsabilités. La création de bassines en surface a été considérée comme une solution pour résoudre les conflits antérieurs car elle a le mérite de mutualiser le pompage en identifiant clairement qui pompe, où et comment. Cette solution était considérée comme provisoire pour permettre progressivement de s’adapter aux nouvelles conditions : toute transition agricole nécessite la mise en place de nouvelles filières et est donc lente (10 à 15ans). C’est une aberration écologique de continuer à mettre en place des bassines sans considérer la nécessité de faire évoluer le nexus.
- Le rôle des régimes politiques dans la gestion de l’eau. L’histoire montre que les régimes autoritaires n’ont pas réussi : l’URSS comme la Chine ont eu des politiques de l‘eau catastrophiques notamment avec la construction de grands barrages. Les systèmes les plus résilients sont ceux qui reposent sur une gestion décentralisée parfois collective comme au Moyen Âge car la gestion de l’eau est enchâssée dans la société et les territoires hydro-sociaux.
- Concernant la Seine, il faut noter les progrès importants de la qualité de l’eau. Une inondation comme celle de 1910 n’est pas complètement exclue mais parait moins probable d’une part parce qu’il y a des aménagements en amont de Paris avec des retenues dont le niveau baisse mais qui soutiennent le débit de la Seine, d’autre part parce qu’on constate un changement dans le régime traditionnel des crues hivernales dans le bassin parisien liées autrefois à des neiges importantes dans le haut bassin de l’Yonne et de la Seine. Le changement climatique rend les neiges plus rares et peu abondantes. Par contre, on constate l’été des crues de type méditerranéen liées à des orages parfois violents avec pluies abondantes qui ruissellent sur des sols secs dans les bassins versants des petits affluents comme le Loing.
- Etat des eaux en Bretagne. L’agro-industrie et l’intensité de l’élevage porcin (6 millions de porcs pour 3 millions d’habitants) ont rendu la situation inquiétante par une forte pollution des eaux. Il y a une très forte conscience des problèmes mais il est très difficile et très long de sortir des filières même s’il y a une volonté par certains de remettre en cause le modèle. Il y a aussi de fortes résistances en raison des intérêts financiers. Les agences de l’eau sont peu impliquées. Comme le lien hydro-social avec l’eau est cassé, il n’y a pas de mobilisation forte malgré l’engagement de certaines associations qui cherchent à sensibiliser les populations.
- Quel avenir pour la zone sahélienne très sèche ? le principal problème de cette zone est celui de la variabilité des précipitations associée à de très faibles investissements pour utiliser au mieux les précipitations qui peuvent être assez importantes certaines années. Il y a énormément d’incertitudes sur ce qui peut s’y passer. Le Sahara, pendant les périodes plus chaudes, était plus humide car la mousson africaine remontait plus au nord. A priori, on anticipe une accentuation de la sécheresse pendant la saison sèche et une saison humide avec un volume de précipitations probablement plus importante qui provoquerait des inondations ravageuses. La ressource en eau totale ne va sans doute pas diminuer. Ce ne sont pas les conditions climatiques qui sont le principal facteur de l’émigration qui est beaucoup plus complexe.
*D. Blanchon, Atlas mondial de l’eau, défendre et protéger notre bien commun, Edition Autrement, 2022.
D. Blanchon, Géopolitique de l’eau, entre conflits et coopérations, Edition Cavalier bleu, 2019.
Compte-rendu de Micheline Huvet-Martinet, relu par D.Blanchon, mars 2024
-
 12:48
12:48 La Birmanie, pivot stratégique entre la Chine et l’Inde
sur Les cafés géographiquesLa salle du premier étage du Café de Flore est bien remplie en ce mardi 27 février 2024 pour accueillir l’historien Amaury Lorin. Celui-ci s’est spécialement déplacé depuis Dunkerque pour ce café géo consacré à la situation géopolitique de la Birmanie, sujet trop peu abordé en France alors qu’il représente un enjeu important du monde d’aujourd’hui. Amaury Lorin a récemment écrit un livre, Variations birmanes (Samsa éditions, Bruxelles, 2022, sélection Prix Pierre Loti 2023), où il donne quelques clés de compréhension de cette situation qu’il va évoquer.
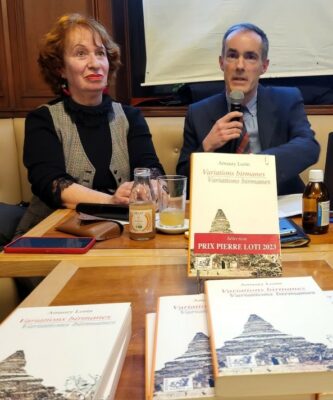
Amaury Lorin (à droite) et Michèle Vignaux (à gauche)
Il se félicite de faire mieux connaître la Birmanie, petit pays asiatique mal connu en France, alors même qu’elle est déchirée par une guerre civile depuis le coup d’état de février 2021 de la junte militaire qui a renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi. La résistance de la population birmane de mieux en mieux organisée entraîne de nombreuses pertes humaines et d’importants déplacements de population (sans doute un million de personnes). Amaury Lorin propose de réfléchir à une question essentielle : où va la Birmanie ? Pour cela, en évitant tout déterminisme, il se demande dans un premier temps d’où vient la Birmanie. Il souhaite donc commencer par une rapide présentation géographique puis historique de la Birmanie, dont le nom officiel est devenu le Myanmar depuis 1989.
Sur la première carte projetée, apparaît nettement l’opposition entre la plaine centrale irriguée par l’Irrawaddy et ses affluents, et les marges, essentiellement montagneuses et peuplées de différentes minorités ethniques.
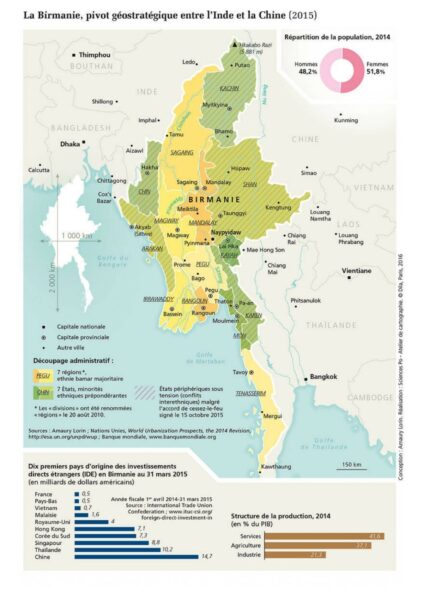
Carte reproduite avec l’aimable autorisation d’Amaury Lorin :
« Birmanie (Myanmar) : une ouverture incertaine », Questions internationales
(La Documentation française), n° 77, janvier-février 2016 p. 102-110La plaine centrale représente le centre historique et culturel du pays où vit l’ethnie majoritaire bamar (69% de la population birmane au dernier recensement de 2014). Le fleuve Irrawaddy est non seulement l’artère principale du pays mais aussi le centre du territoire incarnant l’identité birmane avec l’ancienne capitale Mandalay et l’actuelle capitale Naypyidaw. Pour évoquer la « birmanité » on utilise parfois la formule des « 3 b » (birman, bamar, bouddhiste) associant la nation, la majorité et la religion.
Aux marges du pays se trouvent les 135 minorités ethniques officiellement recensées qui vivent dans sept États périphériques. Ces minorités ethniques forment 25% de la population nationale. Cette disposition marginale des montagnes et des forêts a protégé la Birmanie des invasions au cours de l’histoire, mais en même temps elle a favorisé un repli du pays sur lui-même et a donc longtemps entretenu le fantasme d’une Birmanie hermétique. D’autre part, des conflits interethniques persistants continuent de se déployer dans cette ceinture montagneuse.
Plus de 50 millions d’habitants peuplent la Birmanie dont la superficie est plus vaste que celle de la France et du Benelux réunis. Une mosaïque ethnique caractérise cette population alors que 90% des habitants se revendiquent du bouddhisme (therav?da). Rappelons que 124 ans de colonisation britannique ont pris fin en 1948 avec l’indépendance birmane. Mais celle-ci n’a pas entravé la domination de l’ethnie majoritaire aux dépens des minorités ethniques, ainsi la langue bamar a été érigée comme la norme birmane. La règle de la supériorité bamar s’est comme enkystée dans la vie quotidienne des Birmans. Cette oppression commune à l’encontre des ethnies minoritaires a eu pour effet de liguer celles-ci face à la majorité bamar.
Un fait majeur à souligner : la géographie physique de la Birmanie a sans doute joué un rôle essentiel dans la protection et l’isolement du pays par rapport à l’extérieur. À une autre échelle (celle de l’Asie du Sud-Est), ajoutons l’importance de la position de carrefour de la Birmanie, entre le monde indien et le monde chinois, entre deux géants démographiques « prédateurs ». Une situation géopolitique très particulière pour le moins inconfortable. Au même titre que le Tibet et le Pakistan, la Birmanie est un enjeu de la rivalité sino-indienne. Pour la Chine, la Birmanie appartient à sa périphérie méridionale, en rapport avec sa stratégie des deux océans (océan Pacifique et océan Indien). Soit un nouveau « grand jeu » autour de l’océan Indien entre les deux grandes puissances asiatiques. La Birmanie ne peut pas trop compter sur l’ONU, ni sur l’ASEAN (pays membre depuis 1997), la sous-région des pays du Mékong ou le Japon pour sortir de l’étau sino-indien.
Après la présentation géographique de la Birmanie, Amaury Lorin aborde l’histoire du pays en insistant sur la succession ininterrompue des rois despotes pendant les huit siècles qui ont précédé la colonisation britannique du XIXe siècle. Celle-ci a été réalisée à la suite de trois guerres anglo-birmanes entre 1824 et 1885. Le dernier roi birman a été déposé en 1885 et la Birmanie a été dès lors rattachée au Raj britannique pour rejoindre l’Inde. 124 ans de colonisation britannique (1824-1948) ont été ressentis comme une expérience traumatisante par les Birmans. Les institutions coloniales ont remplacé brutalement la monarchie et les institutions traditionnelles, la modernité occidentale a été plaquée en faisant fi des héritages ancestraux birmans. Le rattachement au Raj a aussi engendré des tensions avec les Indiens, ce qui a laissé des traces.
À la suite d’un coup d’État en 1962 (soit quatorze ans après l’indépendance), une junte militaire installe une dictature féroce jusqu’en 2011. Pendant toutes ces décennies, la Birmanie est coupée du monde extérieur, l’armée birmane se présentant comme l’unique pilier unificateur, la seule garante de la cohésion nationale. En 2011, de façon inattendue, le pouvoir est transféré à un gouvernement « quasi-civil » ; commence alors une ouverture incertaine qui est interprétée comme une « transition démocratique ». Les premières élections générales libres de 2015 profitent à la Ligue nationale pour la démocratie (LND), le parti d’Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991.
Les élections de 2020 amplifient le succès du parti du prix Nobel de la Paix 1991, mais un coup d’État militaire met fin à cette transition le 1er février 2021. Depuis cette date, le mouvement de désobéissance civile a vite laissé place à une guerre civile qui prend de l’ampleur aujourd’hui.
Sur le plan historique, l’intervenant souhaite insister sur deux points : la collusion entre l’armée et l’État depuis l’indépendance ; l’importance du clergé bouddhiste ; soit deux piliers qui ont noyauté toutes les institutions sociales.
Une troisième partie de l’exposé préliminaire exploite le livre d’A. Lorin, Variations birmanes, recueil de quatorze chapitres-tableaux résultant d’enquêtes sur le terrain et de recherches historiques de son auteur. Ces petits reportages réalisés dans différentes régions de Birmanie présentent une exploration personnelle de la réalité birmane que la projection de photos permet d’approcher. Les relations avec l’Occident et avec l’Inde sont notamment évoquées, les problématiques religieuses ne sont pas négligées, ni les ressources minières et forestières, ni les aspects ethnologiques, etc. L’intérêt des questions abordées mérite incontestablement une lecture de l’ouvrage.
Le déroulé des thèmes étudiés dans ces Variations birmanes se termine par la crise des Rohingya qui éclate dramatiquement en 2017 aux yeux du monde entier. Et A. Lorin de réfuter le simplisme de nombreuses analyses insistant sur l’antagonisme religieux entre musulmans et bouddhistes. L’origine foncière de la crise est en réalité déterminante avec l’arrivée de paysans venus d’Inde pour travailler dans les terres rizicoles de l’Arakan au temps de la colonisation britannique. L’antagonisme religieux entre bouddhistes et musulmans (4% seulement de la population birmane) n’est pas au cœur de la crise des Rohingya.
L’intervenant achève sa présentation par l’évocation rapide de certains aspects fondamentaux, notamment géopolitiques. La Birmanie est un espace-clé pour la Chine qui s’y approvisionne en ressources minières et énergétiques et qui y projette ses intérêts stratégiques pour le contrôle de la grande route commerciale de l’océan Indien. La construction d’un oléoduc et d’un gazoduc reliant la Birmanie et la Chine illustre clairement ces intérêts tout comme la construction d’un port en eaux profondes par les Chinois dans le contexte des « nouvelles routes de la soie » et la stratégie chinoise du « collier de perles ». Un des avantages de la Birmanie pour la Chine est de « court-circuiter » le détroit de Malacca. De son côté, l’Inde voit la Birmanie comme un voisin fragile, particulièrement vulnérable face à la poussée stratégique de la Chine vers l’océan Indien.
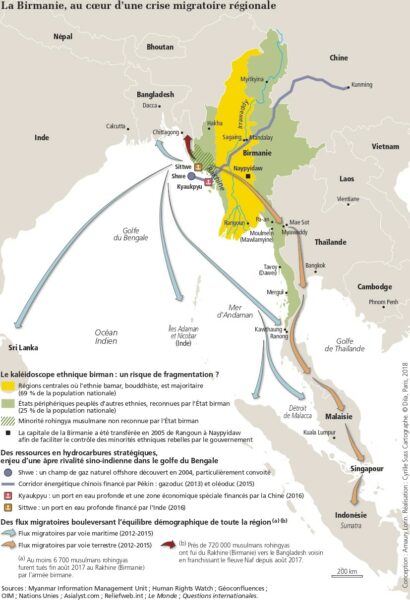
Carte reproduite avec l’aimable autorisation d’Amaury Lorin :
« Birmanie : désastre humanitaire, déstabilisation régionale », Questions internationales
(La Documentation française), n° 93, septembre-octobre 2018, p. 113-119Quant à la crise birmane actuelle à la suite du coup d’État militaire de février 2021, A. Lorin pose la question, sans réponse pour l’instant, des liens entre la crise des Rohingya et le coup d’Etat. Et de revenir une nouvelle fois sur le rôle de la colonisation britannique sur l’exacerbation des tensions ethniques. Et d’évoquer aussi la conférence de Panglong (1947) que le général Aung San, alors président du gouvernement intérimaire birman, avait organisé pour tenter de trouver un accord entre les différents groupes ethniques dans la nouvelle Birmanie indépendante. Un peu avant le putsch de 2021, Aung San Suu Kyi, fille du général Aung San, assassiné en 1947, avait tenté de ranimer « l’esprit de Panglong » pour la « paix ethnique ».
La présentation se conclut par l’évocation rapide de certains aspects fondamentaux, notamment géopolitiques. La Birmanie est un espace-clé pour la Chine qui s’y approvisionne en ressources minières et énergétiques et qui y projette ses intérêts stratégiques pour le contrôle de la grande route commerciale de l’océan Indien. La construction d’un oléoduc et d’un gazoduc reliant la Birmanie et la Chine illustre clairement ces intérêts, tout comme la construction d’un port en eaux profondes par les Chinois dans le contexte des « nouvelles routes de la soie » et la stratégie chinoise du « colliers de perles ». Un des avantages de la Birmanie pour la Chine est de « court-circuiter » le détroit de Malacca. De son côté, l’Inde voit la Birmanie comme un voisin fragile, particulièrement vulnérable face à la poussée stratégique de la Chine vers l’océan Indien.
Questions de la salle :
Trois questions sont posées en ouverture des échanges entre l’intervenant et le public :
- Peut-on comparer l’action de l’armée birmane, issue de l’armée qui a combattu pour l’indépendance, et l’armée de libération nationale en Algérie ?
- L’action de la monarchie birmane pendant les huit siècles ayant précédé la colonisation britannique du XIXe siècle est-elle comparable à l’action de la monarchie française pendant de nombreux siècles en matière d’intégration progressive des différents peuples et régions du territoire devenu français aujourd’hui ?
- Peut-on mesurer le poids respectif de l’armée et de la religion (bouddhiste) dans la Birmanie actuelle ?
Dans ses réponses A. Lorin a préféré développer certains points comme la comparaison entre les colonisations européennes en Asie orientale, les relations de l’armée birmane avec ses voisins (Chine et Inde), les dessous de la crise actuelle…
Intervention de Tin Tin Htar Myint, présidente de l’association La communauté birmane de France :
Cette intervention répond à une triple question posée sur la situation personnelle de cette personne en France, sur la diaspora birmane en France, sur l’analyse et les perspectives de la crise actuelle de la Birmanie. Elle a constitué un temps fort de ce café géo consacré à la Birmanie.
Venue en France pour achever ses études grâce à une bourse de l’Alliance française, cette Birmane vit dans notre pays depuis ce moment. Elle estime la communauté birmane de France à un millier de personnes dont 200 environ vivent à Paris. C’est le coup d’État militaire de 2021 qui l’incite à devenir une activiste désireuse de participer à l’action politique pour la défaite de la junte militaire. Elle décrit l’évolution de la résistance du peuple birman qui a commencé par des manifestations pacifiques pour se transformer en résistance militaire, notamment dans certaines régions peuplées de minorités ethniques. C’est aujourd’hui une guerre civile entre l’armée dirigée par la junte militaire et les groupes armés de la résistance. Un gouvernement d’unité nationale en exil tente de coordonner l’action politique et militaire de cette résistance qui profite des livraisons d’armes de la Chine (double jeu de ce pays qui aide aussi la junte) et des défections de l’armée birmane. Le parallèle est fait avec la Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. L’intervenante birmane croit dans la défaite des militaires et dans l’instauration future d’un régime fédéral où la notion de citoyenneté sera prédominante au-delà de la diversité ethnique et religieuse.
Compte rendu rédigé par Daniel Oster, relu par Amaury Lorin, mars 2024
Pour aller plus loin :
Amaury Lorin, Variations birmanes, Bruxelles, Samsa, 2022, sélection Prix Pierre Loti 2023. – [https:]]
? « La crise des Rohingyas en Birmanie (depuis 2017) : un risque de déséquilibre pour l’océan Indien ? », Carnets de recherches de l’océan Indien, n° 7, 2021, p. 139-148. – [https:]]
? « La Birmanie et le drame des Rohingyas », www.vie-publique.fr, 2020. – [https:]]
? « Birmanie : désastre humanitaire, déstabilisation régionale », Questions internationales (La Documentation française), n° 93, septembre-octobre 2018, p. 113-119. – [https:]]
? « Birmanie (Myanmar) : une ouverture incertaine », Questions internationales (La Documentation française), n° 77, janvier-février 2016, p. 102-110. – [https:]]
-
 12:08
12:08 Décentrer le regard. Ce que la guerre en Ukraine fait aux sciences sociales
sur Les cafés géographiquesL’intervention d’Anna Colin Lebedev à l’Institut Catholique de Paris, ce 7 mars 2024, n’est pas une analyse supplémentaire sur le conflit russo-ukrainien. Cette enseignante-chercheuse, maîtresse de conférences à l’université Paris-Nanterre, se définit comme sociologue politique, spécialiste de ce qu’on appelle encore couramment le monde post-soviétique. Son objectif est de démontrer comment l’agression russe dès 2014 en Crimée remet en cause les grilles de lecture de l’histoire de la Russie puis de l’URSS utilisées par le monde académique occidental et particulièrement français. Ces grilles de lecture proposées par la Russie, plus facilement accessibles, la remettent toujours au centre. Ce sont donc des spécialistes de la Russie que les médias ont invités pour analyser l’« opération militaire spéciale » de Vladimir Poutine. On a pris un regard russe pour considérer l’Ukraine (c’est ce même regard qu’on applique aux pays d’Asie centrale, du Caucase…anciens membres de l’Empire).
Qu’est-ce qui caractérise ce « regard russe » ? C’est d’abord le regard d’une puissance centrale dominante sur une périphérie. Il est accompagné d’un récit exaltant la grande culture russe, porteuse d’un universalisme culturel qui s’impose aux « petites » cultures, folkloriques, de la périphérie. Ce récit rappelle les grands hommes et les grands faits qui ont émaillé son histoire, particulièrement ceux de la Seconde Guerre mondiale, la « grande guerre patriotique » » (cette historiographie soviétique a été largement reprise par les historiens occidentaux). Donc les sources disponibles ont façonné notre regard.
On peut en voir les effets à travers deux exemples dans le domaine culturel. Lors de la récente exposition (2021-2022) qui lui a été consacré au Petit Palais, Ilya Répine a été présenté comme « peintre de l’âme russe » alors qu’il est né à la périphérie de l’empire, en Ukraine, et est porteur de nombreuses influences autres que russes. Quant à Nicolaï Gogol, Ukrainien de naissance, il représente une figure d’hybridité et s’il a écrit en russe, c’est par obligation et non par attachement à la culture russe.
Le monde de la recherche français a produit, ces dernières décennies, de nombreux travaux sur les territoires de l’ex-URSS (autant que sur les Etats-Unis). Or la Russie est surreprésentée dans les sujets de thèse par rapport aux 14 autres pays et les chercheurs qui s’y sont consacrés ont obtenu les meilleures positions académiques. Une observation des journalistes du Monde en 2022 semble conforter ce constat : les travaux sur l’Ukraine étaient surtout le fait des femmes et des jeunes.
Depuis février 2022, la recherche évolue. La Russie est un terrain moins accessible et inquiétant alors que de plus en plus de chercheurs travaillent sur l’Ukraine (même si le terrain n’est pas facilement accessible non plus). Les nouvelles générations sont moins russocentrées. Nous assistons à un basculement dans la manière de construire les connaissances sur ces pays. Le décentrement du regard est indispensable.
Le grand historien américain Timothy Snyder a fortement réagi au discours publié le 12 juillet 2021 par V. Poutine sur L’unité historique des Russes et des Ukrainiens où le maître du Kremlin évoque une unité « naturelle » (celle d’un même corps), unité que cherchent à déconstruire les Occidentaux en instillant le mensonge d’une identité propre dans l’esprit des Ukrainiens. Pour T. Snyder, ce discours annonce une « guerre de recolonisation » de la Russie et c’est une grille de lecture coloniale qui doit guider les travaux des chercheurs sur le passé mais aussi sur le présent.
La guerre en Ukraine a des répercussions sur la façon dont les autres pays ex-soviétiques ont pensé leurs relations avec la Russie (par exemple la politique des nationalités qui a écrasé les cultures autres que russes).
Cette grille de lecture coloniale très forte depuis le printemps 2022 suscite en France l’incrédulité de plusieurs intellectuels qui opposent des arguments plus ou moins pertinents. Le contexte colonial ne s’appliquerait qu’entre une métropole et des colonies lointaines. L’URSS ne peut être qualifiée de « colonisatrice » car elle proclamait l’égalité des droits entre tous les citoyens. Mais dans les faits les inégalités étaient importantes et la langue russe indispensable à toute carrière. L’URSS a été la grande amie de tous les mouvements de décolonisation dans le monde (argument qui est le plus percutant dans une France pas encore pacifiée avec son propre passé colonial).
Les Américains ont adopté beaucoup plus facilement cette grille de lecture. Ils s’interrogent sur la pertinence de l’expression « ex-soviétiques » pour désigner des pays en Asie centrale ou au Caucase qui ont subi beaucoup d’influences (chinoises, persanes…). Les programmes des universités ont changé (les cours sur les littératures périphériques tendent à remplacer les cours de littérature russe). Et les bourses en études russes ont disparu !
Au-delà d’une actualité qui nous touche particulièrement, cette conférence nous permet de réfléchir à la façon dont se construit le savoir dans les sciences humaines et nous invite à toujours questionner nos certitudes.
Michèle Vignaux, mars 2024
-
 14:28
14:28 Le dessin du géographe n°98. Une géographie subjective des Balkans. Skopje (Macédoine du Nord)
sur Les cafés géographiquesLa géographie contemporaine (fin XXe siècle, XXIe siècle) emprunte de nouvelles voies pour représenter le monde qui nous entoure, un monde devenu particulièrement complexe avec l’accélération du processus de mondialisation. Parmi ces nouvelles voies, citons par exemple la géographie « engagée » qui se veut à l’écoute des populations, autrement dit une science appliquée et participative selon le géographe Antoine Bailly [https:]]
Autre voie nouvelle qui nous intéresse ici : la géographie « subjective » ou « sensible ». L’hésitation à choisir la meilleure épithète possible traduit le fait que cette démarche géographique n’est pas encore clairement définie ou même validée par les géographes eux-mêmes. Pourtant, dès les années 1970, le géographe Armand Frémont évoque la notion d’« espace vécu » pour réintroduire « le sujet et la subjectivité dans l’espace de la géographie ». Et le même Armand Frémont de poursuivre en affirmant que « l’espace vécu réconcilie l’art et la géographie » ((A. Frémont, Aimez-vous la géographie ? Flammarion, 2005).
La nouvelle collection Odyssée (ENS Editions) illustre cet objectif d’une géographie sensible, mâtinée de littérature de voyage, en proposant des portraits urbains originaux regroupés en ensembles géographiques européens. Les Cafés Géographiques en ont rendu compte dans plusieurs articles : [cafe-geo.net] ; [https:]] ; [cafe-geo.net] ; [cafe-geo.net] Dans l’introduction du volume sur les Balkans, l’accent est mis sur les impressions et les ressentis au service de la compréhension de l’espace, en rappelant l’originalité de la collection qui est d’associer étroitement des géographes et des artistes.
A propos de ces derniers, il est souligné qu’ils sont à l’origine de « propositions graphiques innovantes » pour localiser et surtout « renforcer l’exploration écrite », notamment en suggérant des ambiances, des impressions, voire des sentiments et des pensées. Pour cela, trois types de dessin sont proposés dans chaque volume : des « cartes subjectives » pour rendre compte de l’organisation et des dynamiques de chaque ville étudiée ; des « dessins de géographie embarquée », formule un peu trop sibylline à notre goût pour évoquer l’ambiance du lieu décrit à l’échelle de la rue ; des dessins de « géographie en mouvement », c’est-à-dire des « cartes de transition » pour représenter l’espace séparant deux villes voisines de la sélection proposée dans chaque ouvrage.
Malgré ce cadre graphique commun à tous les livres de la collection, l’intérêt des productions graphiques varie beaucoup en fonction des choix esthétiques des artistes, des expériences de « l’habiter dans la ville » des auteurs et, bien sûr, de la réceptivité inégale des lecteurs. Pour rendre compte – très partiellement – de l’intérêt et de la diversité de ces dessins nous avons fait le choix de l’exemple de Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord, qui a été illustrée, comme toutes les villes du volume sur les Balkans, par Julien Rodriguez, artiste et paysagiste qui pratique une cartographie « sensible » (voir [www.julienrodriguez.fr] ).
Une carte subjective et sensible de Skopje (Macédoine du Nord)
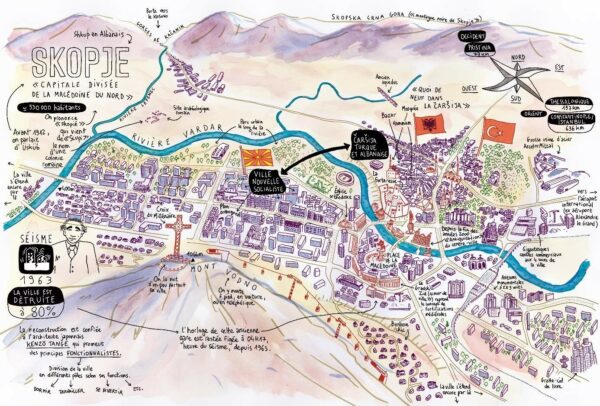
La carte « subjective et sensible » de Skopje, capitale de la Macédoine du Nord (illustration de Julien Rodriguez accompagnant le texte de Laurent Geslin auteur du chapitre sur Skopje (Dir. Jean-Arnault Dérens et Benoît Goffin, Balkans, ENS Editions, 2024)
Il s’agit bien d’une carte, orientée selon les points cardinaux, qui représente l’organisation et les dynamiques de l’espace urbain d’une grande ville balkanique (Skopje). En fait elle relève davantage du schéma dans la mesure où la représentation graphique est délibérément simplifiée et s’exonère des règles habituelles de la cartographie scientifique (notamment l’échelle). Le cadre topographique est réaliste (rivière Vardar, montagnes environnantes, défilé de Ka?anik) mais une expression écrite, non limitée à la toponymie et parfois reliée à des flèches, invite le lecteur à mieux voir et mieux comprendre : ainsi l’exemple de l’horloge toujours figée à l’heure du tremblement de terre de 1963 est probant à cet égard.
Un va-et-vient entre les analyses du texte (rédigé par Laurent Geslin) et les éléments de la carte conforte la compréhension de l’espace de Skopje. A juste titre, la présentation de la collection Odyssée par l’éditeur évoque une chambre d’écho pour évoquer les relations entre les textes des auteurs et les illustrations graphiques. Les déformations et les mises en valeur des phénomènes urbains observables sur la « carte » de Skopje cherchent sans doute à traduire les sentiments et les émotions de l’auteur du texte. La « carte » réalisée par Julien Rodriguez est de ce fait un bon exemple d’une cartographie « sensible » avec en prime des qualités esthétiques indéniables (grâce au choix des couleurs, au style graphique, à l’inclusion de drapeaux colorés, etc.).
Comme le titre de la carte l’affirme, l’espace urbain de Skopje apparaît clairement divisé en deux, de part et d’autre du Vardar représenté par un épais trait bleu qui sépare la vile « turque et albanaise » au nord et l’ex- « ville nouvelle socialiste » au sud. Ce clivage s’accentue depuis le démembrement de la Yougoslavie, même si les autorités macédoniennes cherchent depuis plus de deux décennies à construire un nouveau récit national autour de la figure d’Alexandre le Grand comme en témoigne la nouvelle place de Macédoine à la jointure des deux parties de la ville.
Un zoom graphique sur la place de Macédoine à Skopje
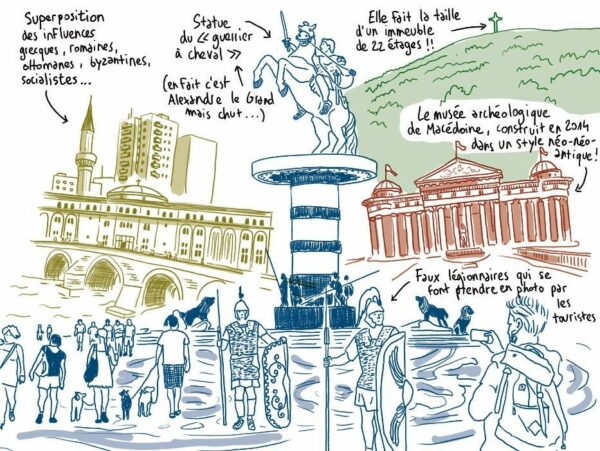
La place de Macédoine à Skopje, capitale de la Macédoine du Nord(illustration de Julien Rodriguez accompagnant le texte de Laurent Geslin auteur du chapitre sur Skopje (Dir. Jean-Arnault Dérens et Benoît Goffin, Balkans, ENS Editions, 2024)
A une échelle plus grande et plus précise, l’illustrateur représente la place de Macédoine à Skopje qui se trouve au débouché du vieux pont de pierre menant au bazar ottoman. Là se trouve depuis 2011 la statue d’Alexandre le Grand, monument emblématique du pouvoir macédonien désireux d’incarner dans l’espace urbain les « origines » de la population macédonienne, manière de rapprocher, autant que faire se peut, des populations et des héritages multiples au lendemain de la disparition de la Yougoslavie.
Le choix de quatre couleurs (vert, bleu, deux ocres différents) et la mention de légendes précises insérées dans le dessin sont ici les deux outils graphiques de l’artiste qui, discrètement, peut aussi user d’une pointe d’humour (« en fait c’est Alexandre le Grand mais chut… »).
Une « carte de transition » sur le défilé de Ka?anik (entre Skopje et Pristina)
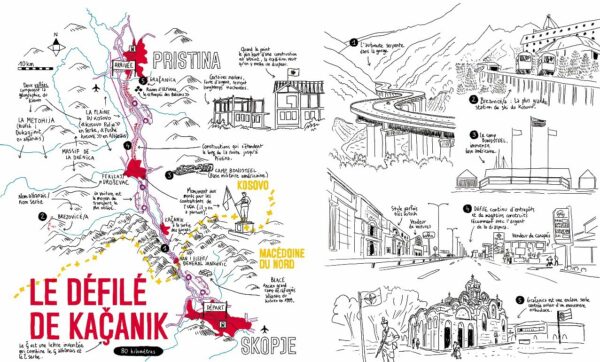
Le défilé de Ka?anik entre Skopje (Macédoine du Nord) et Pristina (Kosovo) (illustration de Julien Rodriguez accompagnant le texte de Laurent Geslin auteur du chapitre sur Skopje (Dir. Jean-Arnault Dérens et Benoît Goffin, Balkans, ENS Editions, 2024)
Un troisième type de production graphique est utilisé pour réaliser des cartes dites « de transition » permettant de représenter un espace unissant deux villes voisines décrites dans les volumes de la collection Odyssée. Ce troisième type de dessin correspond à une troisième échelle, une échelle régionale adaptée à la cartographie d’un espace plus vaste que l’aire urbaine ; l’échelle d’ailleurs figure sur ce type de dessin, contrairement aux deux autres types. Sur la carte, apparaît nettement la nouvelle route (en fait, une autoroute avec des ouvrages d’art spectaculaires) doublant la vieille route sinueuse, aujourd’hui largement délaissée. L’illustrateur a réussi le tour de force d’insérer de nombreux détails sans nuire à la lisibilité et à l’esthétique de l’ensemble.
Daniel Oster, mars 2024
-
 23:32
23:32 Le dessin du géographe n°97. Visions d’Orient
sur Les cafés géographiquesEn 1978 Edward Saïd, alors professeur de littérature anglaise et comparée à Columbia University, publie « Orientalism » dont la traduction française « L’Orientalisme : l’Orient créé par l’Occident » paraît en 1990 aux éditions du Seuil. Cet ouvrage constitue un point de passage obligé pour qui s’intéresse à l’Orient. Il démontre comment une image détournée de l’Orient est devenue en Occident « son double, son contraire, l’incarnation de ses craintes et de son sentiment de supériorité tout à la fois ». E. Saïd s’appuie sur de nombreux ouvrages d’histoire et de sciences sociales. Il analyse par nécessité tous les ouvrages parus sur le sujet depuis le XVIIIe siècle, sa réflexion est celle d’un historien.
Notre propos est plus modeste. On souhaite ici apporter un complément en évoquant non pas des ouvrages théoriques mais des illustrations moins ambitieuses, mises à jour par le remarquable travail de l’historienne Francine Saint-Ramond, « Les désorientés. Expériences des soldats français aux Dardanelles et à Salonique, 1915-1918 » (Presses de l’INALCO, 2020).
L’expédition des Dardanelles puis celle de Salonique furent l’occasion de recycler un Orient imaginaire à l’usage des soldats du contingent intégrés dans « l’Armée d’Orient ». Cette dénomination, d’origine militaire, est en elle-même tout un programme. Dans cette perspective, la presse, les journaux satiriques et même les éditeurs de cartes postales jouèrent leur rôle quand il s’agissait de donner aux familles des nouvelles des mobilisés sur le front d’Orient. Le tout en utilisant des sources d’origine variée dont on ne vérifiait pas l’exactitude. C’était … « bon pour l’Orient » ! Tout cela reposait sur une imagerie qui sous-tend l’abondante littérature du « voyage en Orient » dans les multiples récits de voyage du XIXe siècle. Voir à ce sujet « Le voyage en Orient » de Jean-Claude Berchet (Robert Laffont, collection Bouquins, 1985).
Le but est alors de conforter une imagerie exotique propre à remonter le moral de la troupe en insistant sur des traits à l’opposé de ce qu’on savait sur la bataille de Verdun qui se déroulait au même moment sur le front de l’Ouest.
Par exemple, les militaires chargés de mettre en œuvre des jardins à Salonique pour nourrir la troupe étaient nommés « les jardiniers de Sarrail », lequel était le commandant en chef de « l’armée d’Orient ». Ceci s’inscrivait dans la volonté de créer une image à l’inverse des souffrances subies dans les tranchées.
Le premier thème de l’imagerie « orientale » est celui d’un érotisme que les soldats français sont censés trouver en Orient et plus spécifiquement à Constantinople.
Ci-dessous une image de 1915 parue dans un journal satirique au moment de l’expédition des Dardanelles. Celle-ci se traduisit par un échec militaire et le repli sur Thessalonique. Et naturellement, la désillusion des soldats face à l’érotisme garanti fut grande.
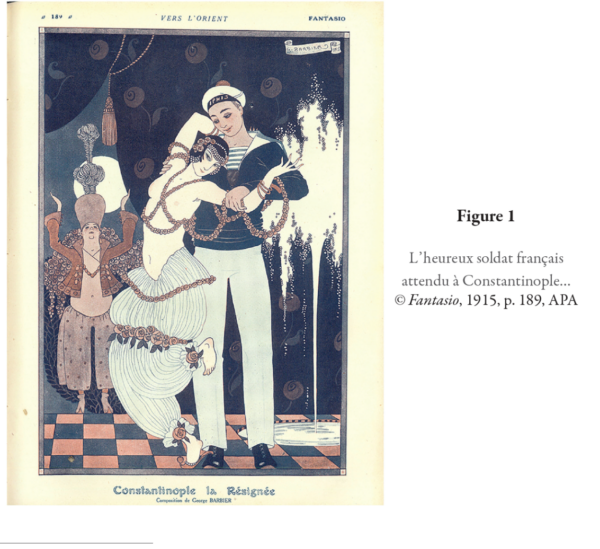
D’une autre nature sont les cartes postales détournées comme celles de l’imprimerie Grimaud fils et Cie (54 Rue Mazenod, Marseille).
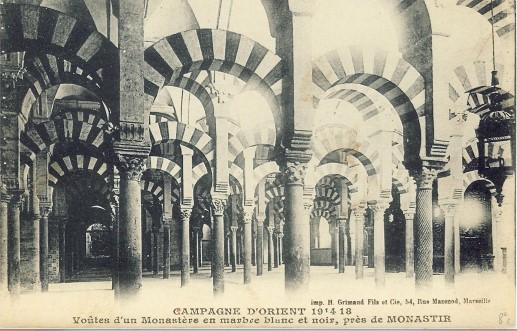
La carte postale ci-dessus appelle plusieurs remarques à propos de ces « voûtes d’un monastère en marbre blanc et noir près de Monastir » (Monastir était en Serbie, son nom actuel est Bitola). Il s’agit en réalité de la cathédrale de Cordoue, mosquée bâtie en Andalousie par les Arabes et transformée après l’éviction de ces derniers en cathédrale catholique par les Espagnols.
Les détournements de photos intéressent aussi les populations.

Impossible de prouver l’origine de cette photo, mais il y a toutes les chances qu’il s’agisse d’une photo d’Afrique du Nord et non pas de jeunes filles grecques de Salonique. Peu importe, cela conviendra pour la « Campagne d’Orient 1914-1918 ». Les soldats et leurs destinataires s’en contenteront.
Michel Sivignon, janvier 2024
-
 16:48
16:48 Volga, l’héritage de la modernité
sur Les cafés géographiquesLa Volga, chère aux romanciers russes, a été transformée par les Bolcheviks au XXe siècle. Rêve ou cauchemar ? Au XXIe siècle, un nouveau destin s’ouvre devant elle, celui de devenir un fleuve d’Asie.
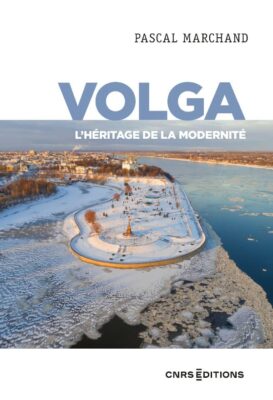
Pascal Marchand, Volga. L’héritage de la modernité, CNRS Editions, 2023
A tous les romantiques attachés à la « Petite Mère Volga » et à ses bateliers (en fait des haleurs) chantés par Ivan Rebrov, l’ouvrage du géographe Pascal Marchand provoquera un difficile retour à la réalité. Le majestueux fleuve de 3700 km est aujourd’hui une succession de barrages en béton et de lacs de retenue ; ses rives sont creusées par l’érosion ; son delta avance dans une mer Caspienne dont le niveau baisse ; et la pollution est un souci majeur. Qui est responsable de ce bilan ? C’est en grande partie l’homo sovieticus dont l’hubris a cru dompter les éléments naturels pour apporter en même temps et de façon massive électricité, irrigation, ressources halieutiques et voie de circulation.

Carte de localisation du fleuve Volga [https:]
Son axe Nord-Sud et sa faible pente (sa source est à 228 m) rendent difficile la gestion du fleuve. Les eaux d’amont sont retenues pendant les mois d’hiver dans une épaisse couche de glace sur laquelle la neige s’accumule. A partir de mars, les eaux peu à peu libérées s’écoulent lentement, inondant de vastes surfaces (les crues peuvent atteindre de 10 à 15 m) tandis qu’à la fin de l’été, la basse Volga, au sud de Volgograd, affectée d’un climat aride, peut connaître de sévères étiages. Quelques rares travaux ont été envisagés au XIXe siècle, mais ce sont les bolcheviks qui ont voulu faire de la Volga un instrument majeur du développement du pays.
Le plan Grande Volga, après plusieurs années d’études, est mis en œuvre à partir de 1937. Son objectif : utiliser l’eau de la crue majeure de printemps pour alimenter de gigantesques lacs de retenue barrés de centrales électriques et pour remplir des canaux d’irrigation dans les régions steppiques du sud. Il devait aussi développer la pêche (de nombreuses espèces anadromes remontaient le fleuve), particulièrement celle des légendaires esturgeons, fournisseurs du précieux caviar, et bien sûr réaliser une voie de transport fluvial entre la Baltique, la mer Blanche et la mer Caspienne grâce à des canaux de jonction. Lorsque le régime soviétique s’effondre en 1989, les travaux sont inachevés mais le paysage est transformé.
Tous les objectifs du plan étaient-ils compatibles ? La gestion bureaucratique a rendu leur coordination impossible. Chaque activité dépendait d’un ministère sectoriel (Energie, Transports, Pêche…) soucieux de dépasser les chiffres du plan pour obtenir primes et promotions. Le ministère de l’Energie exerce le poids le plus lourd grâce aux 11 barrages hydroélectriques qui fournissent le courant pendant les pointes de consommation hivernale (1). 17 948 km2 de terres sont submergées et 500 000 personnes déplacées.
Le développement de la pêche dans les retenues artificielles a impliqué une refonte de la faune aquatique (le remplacement des espèces adaptées aux eaux courantes par des espèces adaptées aux biotopes lacustres). Cette expérience s’est soldée par une succession d’échecs, en grande partie dus à la pollution des eaux engendrée par les grands combinats industriels installés sur les rives. Equipements médiocres, braconnage…la situation s’est dégradée jusqu’à ce que la chute de l’URSS mette fin à la pêche industrielle sur la Volga.
Mais le Plan a-t-il au moins sauvé les prestigieux esturgeons qui quittent les eaux de la Caspienne pour frayer dans le fleuve ? Comment leur faire franchir les barrages ? Les ascenseurs à poissons ont été dédaignés par les esturgeons et les frayères artificielles en aval du barrage de Volgograd inutilisées. Aujourd’hui malgré l’interdiction de la pêche intentionnelle de l’esturgeon en Russie, les prises « accidentelles » sont nombreuses dans la Caspienne d’autant qu’elles sont orchestrées par des groupes mafieux. Peu d’esturgeons remontent donc le fleuve pour se reproduire. On peut ainsi évoquer leur quasi-extinction.
Les besoins de la pêche en basse Volga étaient incompatibles avec un autre objectif du Plan : l’irrigation des steppes transvolgiennes. Au sud de Kazan un apport d’eau est indispensable à l’agriculture. Le Plan de 1969 prévoyait l’utilisation de la crue pour irriguer 6,3 millions d’ha de terres cultivables et équiper en abreuvoirs 13,4 millions d’ha de pâturages. La priorité a été donnée à la céréaliculture autant pour des raisons idéologiques qu’économiques. Mais les bureaux accumulèrent les erreurs d’appréciation. Main-d’œuvre insuffisante et incompétente, sols châtains (forme dégradée des sols noirs par la sécheresse), remontées salines favorisées par l’irrigation…tous ces éléments expliquent la médiocrité des rendements (10 q/ha dans les années 1970/1980). Après la chute du régime soviétique, 90% des surfaces irriguées des steppes transvolgiennes sont abandonnées. C’est donc un échec cuisant.
Les légendes et chansons célébrant les « bateliers de la Volga » relèvent-elles du pur imaginaire ? Avec son gel hivernal, ses crues de printemps et ses étiages d’été, le fleuve ne se prête guère naturellement à la navigation. Aussi pendant longtemps les voyageurs, à l’exception des Varègues, utilisèrent-ils les berges plutôt que le cours d’eau. Au XIXe siècle, les bateaux à voile qui s’aventurent sur le fleuve ont besoin de haleurs (bourlaki) lorsqu’ils remontent le courant, surtout à l’amont de Rybinsk. Les vapeurs ne fournirent pas de solution de remplacement car empêchés de naviguer par les glaces d’hiver et les basses eaux d’été. C’est le chemin de fer, à la fin du siècle, qui fit disparaitre le halage.
Ce sont les soviétiques, dans le schéma Grande Volga, qui décidèrent la réalisation d’un grand axe de navigation reliant les cinq mers (mer Blanche, Baltique, mer d’Azov et mer Noire, Caspienne) (2). Il a fallu creuser plusieurs canaux barrés d’écluses et maintenir une profondeur minimale de 4m sur tout le parcours. Au début des années 1980, le trafic, intense dans l’ensemble, a atteint 232 millions/tonnes par an. En 2019 il n’était plus que de 39,5 millions/tonnes. L’effondrement du trafic a suivi celui du régime communiste. Dégradation de l’état de la flotte, manque de main-d’œuvre spécialisée, absence d’investissements des armateurs privés…
La Volga va-t-elle reprendre son cours naturel ? Ce n’est pas sûr car aujourd’hui deux bouleversements risquent de l’affecter, le premier environnemental, le second géopolitique.
La raréfaction de la neige dans la partie amont du fleuve et de ses affluents risque d’entraîner la disparition de la crue de printemps et donc de modifier toutes les activités qui y sont liées.
Les sanctions occidentales provoquées par l’invasion de l’Ukraine en 2022 ont amené Moscou à se tourner vers l’Asie et le Sud. Le grand projet de corridor sud-nord de transport international (Inde-mer du Nord) retrouve alors toute son acuité. Il comporterait une double composante ferroviaire et navale : bateau de Bombay à Bandar Abbas dans le détroit d’Ormuz, chemin de fer de Bandar Abbas à la Caspienne et pour son contournement, bateau sur la Volga et sur les canaux Volga-Don et Volga-Baltique. Déjà un accord a été signé en 2017 avec l’Iran. L’intérêt de ce projet pour les Russes est d’attirer les flux internationaux pour faire pendant à la Route de la soie et à celle du canal de Suez. Mais son coût est considérable et les polémiques environnementales nombreuses. Néanmoins il est suffisamment marquant pour que l’auteur se pose la question : si la Volga devient une voie majeure du commerce russe vers l’Asie, ne pourrait-elle être qualifiée de limite entre l’Europe et l’Asie à la place de l’Oural ?
Cet ouvrage est très riche en informations précises (sur toutes les espèces de poisson, par exemple), notamment en données chiffrées. Il est dommage que la cartographie ait la portion congrue : une seule carte, très générale, oblige le lecteur à de longues recherches pour localiser les lieux cités. Le livre s’achève sur cette question fondamentale : la Volga est-elle d’Europe ou d’Asie ?
Notes :
1) Cf la déclaration de Lénine : « Le communisme, c’est le gouvernement des soviets plus l’électrification de tout le pays » dans Notre situation intérieure et extérieure et les tâches du parti, 1920.
2) Les Russes appellent l’ensemble de ces voies d’eau EGS (Système Unifié à Grande profondeur).Michèle Vignaux, février 2024
-
 19:10
19:10 Paysans français, paysans indiens : mêmes combats ?
sur Les cafés géographiquesA quelques jours du Salon de l’Agriculture, le monde agricole français (et même européen) n’en finit pas de manifester son mécontentement. Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, des dizaines de milliers de paysans entendent profiter de la tenue prochaine des élections générales en Inde pour converger vers New Delhi afin de protester contre leur situation actuelle. Les contextes sont certes différents mais néanmoins il existe des aspects communs aux deux événements, des aspects relatifs aux raisons de la colère et aux méthodes utilisées pour faire pression sur les autorités.
En France comme en Inde, la méthode choisie pour inciter les pouvoirs publics à tenir compte des revendications du monde agricole vise l’efficacité et le symbole. L’efficacité en bloquant les routes en France, en organisant une nouvelle marche (après celle de 2020-2021) vers New Delhi en Inde. Le symbole avec les tentatives de bloquer les lieux du pouvoir (Paris d’un côté, New Delhi de l’autre). La prise en compte rapide des revendications paysannes en France comme en Inde a empêché la coagulation des mécontentements provenant d’autres secteurs d’activité et des oppositions politiques.
En ce qui concerne les raisons de la colère il y a de nombreuses différences parmi lesquelles l’importance économique et sociale des deux mondes agricoles. En Inde, ce sont « les deux tiers de la population (qui) dépendent directement ou indirectement des revenus agricoles pour leur subsistance » (Le Monde, 20 février 2024). En France, l’agriculture représente certes le troisième excédent commercial après l’aéronautique et les cosmétiques mais sa part dans le PIB français n’était que de 3,4% en 2019 et le nombre d’agriculteurs exploitants est désormais inférieur à 400 000.
Relevons cependant quelques traits communs aux deux situations agricoles et donc à la nature des revendications paysannes en France et en Inde. Cela n’est pas chose aisée car la situation agricole dans chacun des deux pays est marquée par une forte hétérogénéité. Comme en témoigne la diversité du syndicalisme agricole français malgré la prédominance de la FNSEA qui « tient les campagnes » en participant à une sorte de « cogestion » du système agricole national dominé par l’agriculture intensive. Comme en témoigne également la réponse du gouvernement indien qui propose de soutenir la diversification agricole, ce dont devraient profiter le Penjab et l’Haryana, deux riches régions agricoles, productrices de riz et de blé, d’où est partie la nouvelle marche vers la capitale.
Deux traits communs principaux sont observables dans les crises « paysannes » en Inde et en France : la question du revenu des agriculteurs et la question environnementale. A l’évidence, le cœur de la colère paysanne réside, ici et là, dans le niveau du revenu et la volatilité des cours. En Inde, la crise de 2020-2021 avait pour objectif le retrait de trois lois de libéralisation des marchés agricoles. Toutes les promesses n’ayant pas été tenues, la crise agraire actuelle s’inscrit dans le même sillon que la crise précédente avec la revendication de tarifs minimum pour toutes les productions agricoles. Du côté français, la demande d’un revenu « décent » pour l’ensemble des agriculteurs constitue la priorité n°1 de la panoplie des revendications. Pour cela, la dérogation aux 4% de terres non cultivées ainsi que le respect de la loi EGalim (Loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable », promulguée en 2018) apparaissent comme des réponses favorables tout en étant insuffisantes.
Deuxième trait commun à l’origine, au moins partielle, de la crise agraire dans les deux pays : la question environnementale. En Inde, les difficultés de la grande majorité des paysans se sont intensifiées avec le changement climatique et notamment le caractère de plus en plus erratique des précipitations et de la mousson. « Le modèle issu de de la révolution verte instaurée dans les années 1960 n’est plus tenable » (Le Monde, 20 février 2024). Le mode de production intensif a eu des conséquences environnementales catastrophiques : pollutions durables des sols, assèchement des nappes phréatiques, etc. D’où des solutions envisagées comme le soutien financier à la diversification de la production. Mais c’est tout un mode de production qui est à repenser. En France, la question environnementale se déploie largement à l’échelle européenne avec le Green Deal (Pacte vert), cet ensemble législatif qui doit permettre à l’Union européenne de respecter l’accord de Paris et donc de limiter les effets du réchauffement climatique. Aujourd’hui, le vent est devenu favorable à la « pause réglementaire ». La flambée des prix de l’énergie, la hausse des taux d’intérêt et la fin du gaz russe bon marché ont donné le signal des contestations du Pacte vert européen. En accédant aux demandes de la FNSEA, en reculant sur la protection de la santé et de la biodiversité, le gouvernement favorise d’une certaine façon les critiques sur la transition agroécologique d’autant plus que les sondages sur les élections européennes de juin 2024 semblent conforter les appels à une pause écologique et à la « souveraineté alimentaire ».
Daniel Oster, février 2024
-
 13:23
13:23 Balkans
sur Les cafés géographiquesOù visiter dans un même espace urbain mosquées et églises, forteresses ottomanes et palais habsbourgeois ? C’est dans les Balkans. Les villes y ont une histoire ancienne et un présent douloureux.
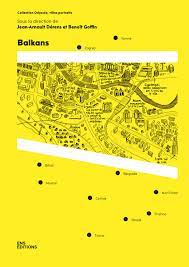
Jean-Arnauld DERENS et Benoît GOFFIN (sous la direction de), ENS EDITIONS, 2024
Quatrième ouvrage (1) de la collection « Odyssée, villes-portraits », consacrée à la géographie subjective qui entrelace savoirs et expériences personnelles, rationalité et subjectivité, Balkans nous emmène dans quelques villes de cette Europe du Sud-Est considérée souvent comme étrange et étrangère par les autres Européens. Vestiges de l’Empire ottoman côtoyant des palais habsbourgeois, populations musulmanes, mosaïque de peuples divers et opposés…cette région européenne « différente » a laissé de plus une image inquiétante dans les livres d’Histoire, celle de « poudrière balkanique ». Aujourd’hui libérés des empires dont le dernier a été l’empire communiste, ces Etats cherchent à s’ « occidentaliser » et à intéger l’Union européenne (2). Aussi ce livre a-t-il pour but de nous les rendre plus familiers grâce aux récits d’auteurs divers, anthropologues, géographes, historiens, journalistes qui ont une connaissance intime de villes dans lesquelles ils et elles ont vécu.
Si la première étape est Vienne, ce n’est pas en mémoire des Habsbourg dont l’empire a intégré les Balkans du nord, c’est par intérêt pour les « Yougos » qui constituent 10% de la population viennoise. Au-delà du Gurtel qui ceinture les quartiers huppés du centre, s’étendent les 15e et 16e arrondissements où vivent les immigrés les plus anciens et leurs descendants, ceux qui sont arrivés dans les années 1960 pour travailler, grâce aux accords signés entre l’Autriche désireuse de main d’œuvre et la R.S.F.Y. (République socialiste fédérative de Yougoslavie) de Tito. Les nombreux logements sociaux construits par les municipalités socialistes successives ont facilité l’installation de ces « gastarbeiters ». Aujourd’hui cafés, restaurants, lieux culturels et un grand marché de 160 stands entretiennent la « yougonostalgie ». A ces « turbo-Yougos » se sont ajoutés les réfugiés des guerres de Yougoslavie dans les années 1990, plus diplômés, qui fréquentent les quartiers du centre pour leurs loisirs.
Pour atteindre la deuxième étape, Zagreb, il faut traverser les Alpes autrichiennes puis slovènes avant d’entrer en Croatie. Comme les trois pays sont membres de l’U.E., la traversée des frontières ne pose pas de problème.
Zagreb qui fut austro-hongroise de 1850 à 1918 avant d’être yougoslave jusqu’en 1991, puis capitale de la Croatie, est la plus « occidentale » des villes présentées (Vienne exceptée). Occupant une position stratégique entre les collines balkaniques et la plaine pannonienne, elle a arrêté, pendant plusieurs siècles, les envahisseurs venus de l’est, les Tatars puis les Ottomans. Aujourd’hui, elle est membre de l’U.E. (depuis 2013), a intégré la zone euro et l’espace Schengen (depuis 2023).
Ce sont deux bourgs situés sur des collines mitoyennes qui ont formé, au Moyen Âge, la ville haute, Gornji Grad. A partir du XVIIIe siècle la ville s’étend sur la plaine, avec ses nombreux quartiers résidentiels où maisons individuelles et jardins s’étagent à flanc de côteau. C’est cette ville basse, Donji Grad, qui séduit beaucoup l’auteur de l’article. Une ville où l’on retrouve les fastes de l’Empire des Habsbourg : façades très décorées, promenades arborées avec pavillons de musique, théâtres…Malheureusement les deux tremblements de terre de 2020 l’ont fortement endommagée. Mais cette douceur de vivre évoquée par la ville d’avant 1914 se retrouve, au grand étonnement du visiteur, dans Novi Zagreb, la ville construite à l’époque socialiste pour faire face à l’industrialisation et à l’exode rural. Ce qui attache l’auteur à ces quartiers, c’est la qualité de vie offerte par les grands parcs et petits jardins, l’abondance des commerces et ateliers d’artisans, les marchés et surtout les cafés, indispensables à la sociabilité quotidienne. On les fréquente à tout moment de l’année comme à Vienne et le « petit noir » y est toujours bon comme en Italie !
L’ « autoroute de la Fraternité » conduit directement de Zagreb à Belgrade. Ce qualificatif que l’on doit à Tito semble bien mal convenir à cette route bordée de fermes abandonnées et des traces des combats des années 1990.
Zagreb était attirante. Belgrade, sous la plume de l’auteur de l’article, est repoussante. Tragique par son passé, grisâtre aujourd’hui (Beograd signifie pourtant « la ville blanche »). Une grande partie du texte est consacrée à la rafle des Juifs et des Roms en 1941 par les nazis. Fusillés puis ensevelis dans les sables du Danube, ils restent présents grâce au monument qui immortalise leur mémoire dans l’ancien parc des expositions, lieu de rencontre des petits revendeurs de drogue.
La ville reconstruite sur les ruines de la IIe Guerre mondiale est une « utopie de béton » développée sans plan d’urbanisme, embrumée par la grisaille du smog produit par les fumées des centrales électriques. Seule touche poétique à la fin du texte : l’arôme d’un condiment aux poivrons embaumant une cour d’immeuble.
Pour atteindre Skopje, capitale de la Macédoine du Nord, la route file plein sud. Un peu avant la frontière, un mur de barbelés traverse les collines serbes. Construit pour arrêter les réfugiés de Syrie, il est un des obstacles de la « route des Balkans ».
Si l’auteur aime revenir régulièrement à Skopje, ce n’est ni pour le pittoresque de son site, ni pour la beauté de ses monuments, c’est parcequ’il y mange bien et qu’il y retrouve des amis avec qui il est agréable de discuter dans la chaleur écrasante des soirées estivales. De nombreux plats sont cités, cevapi, kajmak, lahmaçun…sans doute délicieux mais qui ne sont ni traduits ni décrits. Une petite recherche nous apprend qu’il s’agit de cuisine ottomane. Est-ce une clé pour comprendre la ville ?
La ville a une longue histoire. L’archéologie a mis au jour des traces datant du 4ème millénaire avant notre ère puis plus « récemment » se sont succédé les dominations grecque, romaine, byzantine, normande, bulgare, serbe et turque. C’est donc bien le pouvoir ottoman qui s’est exercé le plus longtemps, de 1392 à 1912. Si aujourd’hui le macédonien est la langue officielle, on parle aussi aujourd’hui à Skopje, albanais, turc, rom et serbe. Mais des vestiges laissés par toutes ces cultures, il reste peu de choses car un séisme en 1963 a détruit 80% de l’agglomération, essentiellement les quartiers des XIXe et XXe siècles. Actuellement il y a donc deux villes. La vieille cité, la Carsija, turque et albanaise, déploie son bazar et ses mosquées sous la protection d’une forteresse. La ville nouvelle qui abrite surtout des slaves orthodoxes, a été reconstruite par la R.S.F.Y. selon les principes de l’architecture fonctionnaliste (un pôle pour chaque fonction de la vie).
Depuis l’indépendance en 1991, les communautés que Tito avait voulu mélanger, se distinguent de plus en plus. Des partis ethniques se sont constitués et on n’envisage pas d’avenir en commun. La volonté des autorités de construire une nouvelle identité nationale fondée sur le passé antique pré-slave (cf. la statue d’Alexandre le Grand érigée sur la place de la Macédoine) saura-t-elle y remédier ?
De Skopje à Pristina au Kosovo, il n’y a qu’un seul passage, le défilé de Kaçanik emprunté aujourd’hui par une autoroute moderne qui enchaîne les viaducs et les tunnels dans la traversée des Monts Sar.
Qu’est-ce qui attire l’écrivain Mathias Enard à Pristina, capitale d’un Etat que ne reconnaissent que 97 Etats à l’ONU, dont l’urbanisme se réduit à de grands bâtiments entourés de friches, où la corruption est généralisée, la nourriture monotone (poivrons à tous les repas) et la pollution forte ? C’est l’amour pour la poésie persane et orientale que cet ancien de l’INALCO partage avec les intellectuels kosovars rencontrés à la Bibliothèque nationale. C’est par la littérature que M. Enard est d’abord entré à Pristina puisqu’il a fait d’un poète ottoman du XVe siècle, Mesihi de Pristina, le héros d’un de ses romans, ce qui lui vaut ici une grande popularité.
On ne sait s’ils sont tous amateurs de poésie persane, mais les jeunes sont nombreux et dynamiques. Ils parlent anglais et allemand et il semble que leur idéal soit la Suisse, facile à atteindre par les airs (un vol quotidien vers plusieurs villes suisses) mais difficile à imiter comme modèle politique.
Pour aller de Pristina à la frontière serbe, on suit la rivière Ibar jusqu’à Mitrovica où elle sépare un quartier sud peuplé d’Albanais et un quartier nord majoritairement serbe. On traverse ensuite un paysage de montagne où vivent des Serbes qui ne reconnaissent pas l’autorité de Pristina.
Au sud-ouest de la Serbie, Novi Pazar, ancienne capitale du sandjak qui porte son nom, et ville bien déshéritée aujourd’hui, concentre beaucoup des caractéristiques des Balkans occidentaux : une histoire compliquée d’affrontements entre Slaves et Turcs, puis entre Serbes, Albanais, Bosniaques, une culture marquée par la longue présence ottomane (du XVe à la fin du XIXe siècle), la juxtaposition de différentes communautés qui ont accueilli chacune leur lot de réfugiés fuyant les guerres de la fin du XXe siècle. Musulmans et orthodoxes s’y côtoient pacifiquement mais sans se mélanger.
La ville a perdu son caractère oriental avec la disparition progressive des bâtiments qui rappelaient le passé ottoman (mosquée, hammam…) dans la vieille Casija au profit du « brutalisme yougoslave » de l’architecture du temps de Tito. Certes on continue à faire une forte consommation de café turc et à déguster pita, burek, mantije…Mais la vie quotidienne est difficile avec un fort taux de chômage que ne résoud pas la fabrication des contrefaçons de jeans copiés sur les grandes marques internationales. La vie politique laisse aussi peu de de place à l’optimisme avec la domination qu’a pu exercer sur la ville le mufti Muamer Zukorlic (mort en 2021), député à Belgrade, qui s’est enrichi en vendant des diplômes et en mettant la main sur de nombreux bâtiments.
Entre la frontière serbe et le cœur du Monténégro, l’étroite route traditionnelle traverse un paysage de montagne magnifique mais propice aux accidents. Qu’à cela ne tienne! Le grand frère chinois a proposé de financer une autoroute reliant Belgrade à Podgorica et à Bar (port sur l’Adriatique), une des plus coûteuses au monde (26 millions € par kilomètre). Aujourd’hui un tronçon central a été construit. Catastrophe environnementale et catastrophe financière !
Il faut plus d’une heure de route pour atteindre Cetinje à partir de Podgorica à travers un paysage de cols et de vallées encaissées. C’est une petite ville de 12 500 habitants, située sur un plateau à 700 m d’altitude, entourée de hautes montagnes karstiques. Est-ce un gros bourg paisible comme le laissent à penser ses ruelles tranquilles, sa population homogène, slave et orthodoxe à 95% ? Cetinje n’a pas connu la domination ottomane – c’est sa grande fierté -. Pourtant cette ville qui apparaît sans histoires aux yeux du touriste curieux de visiter la « capitale historique et culturelle » du Monténégro avec ses monuments anciens (monastère, églises, palais, sépultures anciennes…) est fracturée par l’Histoire. Fondée par un Serbe au XVe siècle, elle a été la capitale de la dynastie monténégrine des Petrovic Njegos de la fin du XVIIe s à 1918, date à laquelle ils ont été remplacés par la dynastie serbe des Karadjordjevic en 1918 au sein du nouveau Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Aujourd’hui le clivage identitaire est violent, que renforce l’affrontement entre l’Eglise orthodoxe serbe et l’Eglise orthodoxe monténégrine autocéphale. Mêmes dogmes, même liturgie mais, à chaque fête, des manifestations dédoublées qui doivent être encadrées par la police !
Direction plein sud. A partir de la frontière entre Monténégro et Albanie, la route longe le lac de Shköder puis file, parallèle à l’Adriatique, jusqu’à Tirana au pied du mont Dajti.
Tirana a eu aussi une histoire compliquée. Domination ottomane pendant des siècles, brève période d’indépendance après la Ière Guerre balkanique (1912), annexion italienne au début de la IIème Guerre Mondiale et longue dictature communiste de 1944 à 1991. Mais l’auteur ne recherche pas de vestiges du passé dans la ville actuelle. Il est atterré par les transformations que connaît la ville depuis la fin de la dictature dans les années 1990. Dans un premier temps, le maire Edi Rama a quelque peu égayé le paysage en repeignant de couleurs vives les immeubles communistes en béton tout en conservant les vieilles maisons en pisé. Mais depuis quelques années il y a une frénésie de construction de gratte-ciel de plus en plus hauts, collés les uns aux autres, sans arrière-cours, un entassement qui laisse peu de place à la lumière. Ces tours de luxe qui font exposer le prix du foncier dans un des pays les plus pauvres d’Europe, sont le produit de la corruption et du blanchiment d’argent. Pour nous réconcilier avec Tirana, il n’y a même pas ici un arôme de cuisine !
Nous remontons vers le nord et enfin rencontrons la mer, l’Adriatique, avec ses sites classés comme Kotor au Monténégro et Dubrovnik en Croatie, et ses plages bondées de touristes. Mais c’est dans une ville intérieure de l’Herzégovine que nous nous arrêtons, Mostar.
Que connaît-on de Mostar quand on n’est pas spécialiste des Balkans ? Son pont, le Stari Most (le « vieux pont ») qui a donné son nom à la ville. Ce pont construit au XVe siècle par un architecte ottoman puis fortifié par deux tours au XVIIe siècle enjambe la Neretva de son unique arche. Trait d’union entre les communautés, il a été détruit par les Croates (destruction matérielle et symbolique) lors de la guerre civile de 1993 puis reconstruit à l’identique sous l’égide de l’UNESCO en 2004. Mais l’auteure ne veut pas s’attarder dans la vieille ville ottomane située à proximité du pont, trop touristique sans doute. Elle veut découvrir la ville secrète, loin du centre, qui se cache derrière de hauts murs, celle des espaces vides qui garde une forte mémoire de la guerre. Elle aime flâner dans le quartier des sokaci, ces ruelles accueillantes aux chats qui s’y promènent et aux enfants qui y jouent. Elles sont bordées de maisons anciennes mais aussi de cours fraîches (avlija) et de jardins qu’on ne peut que deviner. Ailleurs comme sous la colline de Hum, la végétation encore plus foisonnante fait pousser ses rosiers et ses cerisiers sauvages au milieu de maisons vides, en partie détruites. Le vide, c’est aussi le sort des anciennes usines, abandonnées après leur privatisation. Mostar a des secrets bien gardés et sa découverte demande des efforts.
Pour le touriste, la route qui relie Mostar à Bihac est l’occasion d’admirer les montagnes de Bosnie, de goûter aux agneaux rôtis devant eux, de faire étape à Sarajevo. Pour les réfugiés qui empruntent la route des Balkans, elle est le dernier tronçon qui les amène près de Bihac, à la frontière de la Croatie, c’est-à dire de l’Union européenne.
Comme beaucoup de villes visitées, Bihac a un long passé de domination slave puis ottomane. Mais nous ne saurons rien de son histoire ni de son urbanisme. Lorsque l’auteur y séjourne en 2019, un sujet l’emporte sur tous les autres : la crise des réfugiés. Le canton d’Una-Sana au centre duquel se trouve Bihac, est le cul-de-sac de la route des Balkans. Repoussés (après maintes tentatives successives) par les gardes-frontières croates dont les violences ont été dénoncées par la Commission européenne en 2020, les migrants s’entassent dans des camps à Bihac ou à proximité. Dans un premier temps les habitants leur firent bon accueil, puis sont devenus plus réservés et finalement hostiles. De cette évolution les autorités locales sont largement responsables en rendant les réfugiés responsables des difficultés économiques et sociales (chômage, corruption…) de la ville. A Bihac on préfère d’autres voyageurs du Moyen-Orient, les riches touristes du Golfe venus découvrir la Bosnie-Herzégovine. Mais la cohabitation des deux goupes n’est pas possible !
Chaque chapitre de l’ouvrage est accompagné d’une carte et d’un plan de ville. Là aussi il s’agit de « cartographie subjective » sous forme de dessins de type « carnet de voyage », tracés d’un trait rapide et égayés de quelques couleurs. On y trouve des informations complémentaires de celles du texte.
De ce voyage dans les Balkans occidentaux, la subjectivité l’emporte parfois sur la géographie. Certaines villes attirent, d’autres repoussent. Toutes ont une histoire compliquée qui laisse des cicatrices bien loin d’être refermées. Les affrontements entre communautés sont vifs, communautés religieuses – même là où la population est entièrement orthodoxe, le conflit est entre deux Eglises ! -, mais surtout ethniques. Au tragique ancien s’ajoute le tragique contemporain. La « route des Balkans » n’est malheureusement pas une route touristique.
Notes :
2) Ont reçu le statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne : la Macédoine du Nord (2005), le Monténégro (2010), la Serbie (2012), l’Albanie (2012), la Bosnie-Herzégovine (2022)
Michèle Vignaux, février 2024
-
 16:31
16:31 Transition climat-énergie : appétit d’espace, soif de justice socio-écologique
sur Les cafés géographiquesOlivier Labussière est géographe et chargé de recherche au CNRS. Spécialisé sur les relations entre énergie, espace et société en contexte de transition climat-énergie, il est rattaché au laboratoire Pacte à Grenoble en sciences sociales et membre de l’équipe Environnements. Il a soutenu en 2007 une thèse consacrée aux défis esthétiques des aménagements liés à la transition. Adoptant une approche géographique de la question énergétique, son objet de travail est l’habitabilité de l’environnement, qu’il aborde selon une méthode qualitative fondée sur des terrains et des entretiens, sans modèles.
Le 4 avril 2023, il est l’invité des Cafés Géo de Montpellier pour aborder les problèmes d’habitabilité, de justice et de gouvernance que les politiques contemporaines dites de transition climat-énergie suscitent, par le vaste mouvement de colonisation de l’espace par les infrastructures de production d’énergie qu’elles entraînent. L’intervention d’Olivier Labussière s’appuie en effet sur le constat de l’appétit d’espace des infrastructures de production énergétique en France, qui peut être perçu comme une forme de colonisation de l’espace. De plus, en tant que nouvelle question, encore difficile à cerner et à aborder, elle génère parallèlement une soif de justice.
1. Politiques de transition climat-énergieTout d’abord, le processus de « transition » peut s’envisager de plusieurs manières, selon le pays et son héritage infrastructurel, ou le monde énergétique auquel il appartient. En France, cet héritage est le réseau électrique. Le terme de « transition » est lui-même une expression critiquée, puisqu’il s’agit en fait d’un processus invisible et de toute façon incomplet, puisque l’on continue d’utiliser des énergies fossiles en parallèle du développement de l’énergie éolienne et de la géothermie par exemple. De plus, le développement d’un certain type d’énergie renouvelable dans un pays ne dit pas nécessairement la transition ; l’éolien revêt en fait des aspects insoutenables. Il faut aussi envisager plusieurs « briques » à la transition (exploration de gaz non conventionnel, photovoltaïque…).
L’éolien est l’une des politiques publiques les plus polémiques en France. L’arrivée de l’éolien en mer est une initiative de la Direction Générale à l’Énergie et au Climat (DGEC). La visite du président Emmanuel Macron à St Nazaire en 2022 du premier parc éolien de France, avec 80 éoliennes, constitue un tournant politique qui annonce la progression de l’éolien en mer, ainsi que, aux yeux du chercheur, la nécessité d’analyser les effets de ce phénomène à plusieurs échelles. Il introduit une analogie avec la théorie des grands ensembles : au même titre que ceux-ci ont pu être entendus comme un macro objet permettant de penser un changement de paradigme sur la définition de la ville, y amenant des questions systémiques, le déploiement de parcs éoliens en mer modifierait notre rapport avec l’espace marin.
Les objectifs quantitatifs des parcs éoliens sont croissants ; après sa visite du parc de St Nazaire, le président Macron a annoncé qu’on irait jusqu’à 37 giga watts d’éolien en terre. La capacité actuelle est à 20 giga watts, ce qui implique de la doubler d’ici à 2050. En mer, l’objectif est de 40 giga watts, mais cet objectif semble plus ambitieux car le solde actuel est nul pour la même période. On peut à ce titre caractériser notre période comme un moment d’accélération des politiques éoliennes.
En dressant un rapide historique des politiques françaises de l’éolien sur presque vingt-cinq ans, on s’aperçoit qu’elles sont plutôt le fruit de grands textes législatifs et des objectifs fixés par l’État. La production singulière du parc éolien en France a connu un démarrage industriel et privé qui procédait par l’intéressement financier des propriétaires. Ce modèle se distingue des trajectoires d’autres pays tels que l’Allemagne et le Danemark, qui ont plutôt connu des investissements citoyens. La France a aussi vu s’ériger sur son territoire des parcs éoliens de taille industrielle, avec des techniques à prendre en main, sans coopération citoyenne. Une autre particularité française est que le démarrage de l’éolien a été associé à un tarif économique, assurant prix fixe et visibilité ; en dehors du tarif d’achat, l’éolien s’est développé sans politique d’aménagement du territoire. Le problème est que l’espace a donc été lu en termes de métriques ; l’implantation des parcs n’a été décidée qu’en fonction des localisations où le vent était puissant, et n’a pas suscité de questionnement quant à leur densité par exemple. C’est l’une des raisons pour laquelle cet éolien français industriel a suscité de nombreuses oppositions.
Une évolution que l’on peut aujourd’hui observer est le fait que les régions aient pris du pouvoir dans la gouvernance du territoire français. Les régions sont les chefs de file de la planification éolienne, mais induisent une distance au terrain. Par exemple, il est difficile de décider de l’implantation de tels aménagements dans l’Aveyron depuis Toulouse : nos administrations ne sont pas forcément en capacité de gérer les implantations.
De même, la logique économique de l’éolien a longtemps fonctionné sur le principe du tarif d’achat ; aujourd’hui, elle repose davantage sur l’appel d’offre, et l’État sélectionne ce qui est le plus compétitif. On observe toutefois l’émergence d’initiatives citoyennes autour de l’énergie partagée, nourries par la loi transition énergie en France puis en Europe.
2. Recompositions bio-socio-spatialesOlivier Labussière liste différentes approches, différentes métriques et systèmes d’arbitrages qui existent pour qualifier l’espace marin éolien ; selon la perspective des technicités, on considère l’espace en fonction de son exposition au vent. Il s’agit également de considérer, selon les vents et les animaux, la façon de faire relation avec cet espace de façon humaine et non humaine. Il recommande l’utilisation du site Nasa Earth Observatory, dédié à la veille environnementale de grands phénomènes comme la montée des eaux et l’érosion, qui observe notamment le développement des parcs énergétiques.
L’auteur retrace son itinéraire de recherche, entamé en 2006 dans un parc éolien aveyronnais de petite taille, qui l’a conduit à des parcs de plus en plus grands. Cet itinéraire fait écho à celui du développement des parcs. En montrant une photo d’un parc marin éolien en mer du nord, l’auteur décrit une figure à la fois belle et bouleversante ; il s’agit d’une vue satellitaire avec des courants et des flux de sédiments, mais aussi une multitude de points blancs dont chacun représente une éolienne. Le seul parc concerné en contient 175. L’exemple de ce parc, visible depuis l’espace, témoigne d’interactions avec le milieu d’accueil, car les embases y créent des turbulences avec les sédiments. Cette photographie montre que l’éolien n’est pas qu’une question énergétique, mais également bio-socio-spatiale, qui fait entrer en jeu les déplacements de poissons, de larves, de sédiments et de pêcheurs. Il s’agit au fond d’un sujet stratigraphique, biologique et sociétal.
Il s’attache à montrer la diversité des scénarios possibles pour stabiliser le réchauffement climatique à 1,5 degrés ; aucun choix technologique n’est neutre, car tous portent une vision de la société qui comporte des arbitrages économiques et politiques. Ainsi, parmi les options de décarbonisation, une large place est actuellement donnée à la production électrique, réactualisée par la question de la mobilité durant la pandémie de Covid-19, mais l’auteur rappelle que la solution électrique n’est pas sans coût, puisqu’elle nécessite toujours des matériaux et des matières premières minérales et métalliques.
3. L’espace, un facteur critique de la transitionL’auteur aborde un troisième aspect de la question et change de contexte en prenant l’exemple d’un article étasunien faisant état de la notion « d’energy sprowl » ou étalement énergétique, un processus majeur aux États-Unis. Cette idée, empruntée à celle de l’étalement urbain, n’allait pourtant pas de soi. Cet article ne s’arrête pas à la question de l’éolien mais s’intéresse aussi au gaz de schiste.
Ce phénomène a été historiquement abordé en termes de densité énergétique (Watt au m2), par Vaclav Smil, qui a proposé un ratio du rapport de la production à l’espace. Ce ratio permet de mesurer le nombre de mètres carrés occupés par les technologies de production de l’énergie par rapport à leur production effective. La question qui se pose est donc la suivante : a-t-on l’espace suffisant pour les déployer ? La littérature scientifique constate que les énergies thermiques (charbon et pétrole) ont le meilleur rendement, suivies par l’énergie photovoltaïque, l’hydraulique, la géothermie, la biomasse et l’éolien. Toutes ces composantes génèrent de moins en moins d’énergie par rapport à l’espace occupé. On s’inquiète donc au fond du « combien d’espace ? », et les analyses qui en découlent prennent trois chemins distincts :
– Le premier est le calcul des empreintes moyennes des technologies, mais cette approche n’est pas satisfaisante car il ne s’agit que d’une estimation qui ne tient pas compte des différents modèles d’éoliens, et la question de l’impact demeure un point aveugle.
– Le deuxième est la projection spatiale, qui dresse un scénario à l’horizon de 2050 : en imaginant atteindre les objectifs des besoins humains en termes de chaleur à l’aide de l’exploitation du bois, on peut connaître la proportion du volume nécessaire des massifs forestiers, avec des modèles économiques plus ou moins intensifs, par exemple avec l’Angleterre ; mais bien que ce scénario montre des points de tensions, subsistent des mutations écologiques et sociales que ces analyses n’attrapent pas, et l’impossible quantification de ce que cela peut produire en termes de changements d’usage.
– Le troisième est le management by design and land planning, qui fait tenir ensemble développement et conservation sous la forme d’une simulation, avec un présupposé d’harmonisation ; l’enjeu de la justice y est donc invisibilisé car la simulation ne tient pas compte des questions de saturations et des effets de cumuls qui peuvent peser sur des communes.
4. Enjeux de justice énergétique et environnementaleLa question de la transition s’est posée autour des années 2010 à l’aune de la précarité ; les gens s’inquiètent de l’insuffisance de leurs ressources pour vivre. La littérature s’est peu à peu intéressée aux énergies renouvelables, en s’interrogeant sur les possibles situations d’injustice produites.
L’auteur définit tout d’abord la justice dans le contexte de l’implantation des parcs éoliens comme le fait de se considérer comme égaux devant la loi en termes de principes (chacun reçoit la même part), mais la littérature à ce sujet est foisonnante :
– La justice distributive : la répartition des risques et des bénéfices est inégale, on fait état d’effets de cumuls, des impacts sur des localités ou des minorités.
Il est à noter que dans d’autres pays, on peut rencontrer d’autres problématiques : accaparement de terres, parcs fermés et militarisés…– La justice de reconnaissance : la hiérarchie de valeurs et d’attitudes à l’encontre de l’éolien est aussi un enjeu de justice, car on ne peut pas disqualifier des opposants sous prétexte qu’ils ne sont pas d’accord avec des normes implicites, qui interrogent ce qu’est un savoir légitime : qui a la connaissance de l’éolien en mer, les administrations en charge connaissent-elles les temporalités de la mer ? Avec quelle amplitude s’ouvre- t- on aux pratiques ?
– La justice procédurale : des personnes exclues des processus de décisions, en raison de leur appartenance, de leur genre, ou de difficultés d’accès aux procédures ; exemple : l’autorisation d’un permis de construire éolien est-elle toujours le fruit d’une consultation équitable ? L’éolien pose ici des questions de citoyenneté, quand tout le monde ne connaît pas ses droits.
Exemple 1 : La plaine
L’auteur prend l’exemple du partage d’une plaine ouverte entre agriculteurs, riverains, et parc éolien, dans le contexte d’une politique agricole locale dont la synergie est très ancienne. Les conseils municipaux sont en effet composés d’agriculteurs. Dans cet espace, la question de l’éolien n’est pas finalement pas sortie de leur cercle, les intérêts publics et personnels étaient donc trop proches, ce qui a causé des dysfonctionnements démocratiques.
La mise en place d’une zone de développement éolien y a créé une implosion sociale : des habitants qui n’avaient pas forcément d’opinion se sont retrouvés devant le fait accompli et sont donc devenus des opposants radicaux à l’éolien. Cet exemple pose la question de la radicalisation, qui intervient lorsqu’une situation n’est pas discutable. Olivier Labussière insiste sur la nécessité de ne pas considérer ces personnes comme des égoïstes, puisque ce discrédit ne permet pas de saisir les questions qu’elles se posent et leur désir légitime de discussion. À la suite d’entretiens avec les habitants où une carte leur était présentée avec l’instruction de délimiter des zones interdits, ceux-ci ne dessinaient pas simplement autour de leur maison, mais autour de plusieurs communes.
Exemple 2 : La question animale
Un deuxième exemple s’intéresse au partage du vent entre les oiseaux et les éoliennes et questionne les porte-paroles de cet arbitrage. L’État a décidé de cartographier les littoraux en l’espace de trois ans pour ouvrir la mer à l’éolien, afin d’identifier les zones de moindre impact environnemental, mais cette période est trop courte pour en juger.
Dans la Narbonnaise, entre les Corbières et la Méditerranée où passent beaucoup d’infrastructures, la région de Port-la-Nouvelle a connu des développements éoliens précoces. Il s’agit d’un cas de repowering rare, c’est-à-dire une situation de démantèlement et de réinstallation du parc, qui a donné lieu à des échanges avec des ornithologues. Ces spécialistes ont changé leur façon d’observer ; faisant habituellement des sessions de comptage des flux d’espèces protégées aux jumelles, leur expertise a été mobilisée pour répondre à la question de leur capacité à franchir les éoliennes en place. Un système d’observation avec des ornithologues qui se relaient pour observer l’itinéraire plus que la seule espèce et la catégorie de protection a vu le jour. En conclusion, de nombreux oiseaux d’espèces différentes avaient les mêmes problématiques de vols : les plus épuisés évitent le périmètre du parc, d’autres passent entre les pales ou en dessous, d’autres encore changent d’itinéraire et s’épuisent dans leur migration. Ce savoir nouveau a permis d’arbitrer les implantations.
Conclusions et ouvertures sur le monde qui vient• Changer d’énergie est un enjeu majeur de notre époque, mais n’est pas forcément soutenable. Les ressources énergétiques diffuses induisent des problématiques particulières, car contrairement au pétrole, les ressources ne sont pas concentrées, ce qui rend leur exploitation plus difficile et cause un nouveau processus de colonisation de l’espace, comme des implantations fixes dans l’eau. L’éolien induit des composantes nouvelles.
• Selon Bernard Stiegler, il existe des disruptions possibles ; des écosystèmes peuvent être mis en stress au risque de perdre de leur cohérence. Face à ces mutations, il convient de prendre la mesure des responsabilités humaines et éthiques qui accompagnent nécessairement la colonisation de milieux qui ne nous ont pas attendus pour être dynamiques.
• De nouvelles manières de penser l’espace sont aussi introduites : de nouvelles normes et métriques, un nouveau système de compensation naturelle qui ne règle pas tout (ce n’est pas parce qu’on ferme un espace qu’en ouvrir un autre règle le problème). Il semble aussi au fond possible de décrire les attachements et les négociations, qui sont des enjeux qualitatifs auquel il faut donner de l’importance.
Remarques finales :
• Les conflits d’implantation d’éoliennes sont plus complexes qu’il n’y parait, en ce qu’ils réactivent d’anciens conflits territoriaux qui ne sont pas spécifiques à l’installation mais émergent à nouveau, stimulé par l’éolien. Par exemple, des associations de défense de l’environnement se sont constituées autour d’autres objets, et d’autres acteurs se sont remobilisés autour de l’éolien, en France et en Europe. Ce constat renvoie aux modes de concertation, notamment l’enquête publique, et conduit aussi à observer une radicalisation progressive des positions car personne ne cherche véritablement à rendre discutable l’éolien pour lui-même. Cette réserve est immédiatement assimilée à une position rétrograde, ce qui sabote la discussion.
• La place d’une approche qualitative pour penser l’espace autrement qu’en termes de métrique reste difficile à trouver, bien que tous les corps soient touchés. Ainsi, l’observatoire pour l’arrivée de l’éolien en mer utilise la DGEC. Ces deux bureaux opposés ont des vocations naturalistes ou socio-économiques et ne se sont pas concertés alors qu’il aurait fallu les coordonner, or en France, la réponse a été qu’il était difficile de prendre le temps de le faire à cause du retard énorme de la France sur l’éolien.
• L’avenir de l’éolien en France semble tourné vers une accélération du déploiement des parcs, qui se fait à travers des lectures de l’espace assez frustes qui ne tiennent pas compte des acteurs ou des paysages. On observe aussi des expériences de coopératives citoyennes, qui ne visent pas forcément le plus haut niveau de rentabilité, mais s’enquièrent par exemple d’un cahier des charges sur la qualité paysagère ou architecturale, afin de sortir de la rentabilité comme seule modèle d’occupation de l’espace.
• Les modèles participatifs changent dans le secteur de l’énergie éolienne ; il est possible d’organiser en France des appels à capitaux et des financements participatifs partiellement encadrés dont certains projets se prévalent, qui voient des gens de tout le territoire soutenir des projets qui seront implantés loin d’eux. Le participatif n’est pas l’objet de beaucoup de développeurs, il est plutôt question du montage de projet et d’évaluation du « gisement » avant que le projet soit revendu sous cinq ans. Des composantes sociales peuvent aussi parfois être majoritaire dans certains villages et avoir des effets de clan, et aussi connaitre des projets qui fonctionnent très bien. Par exemple en Allemagne du nord, on observe des réorganisations citoyennes constantes mêmes pour de grands parcs.
• L’auteur referme son intervention en reprenant l’analogie avec les grands ensembles, sur les éventuels effets inattendus du vieillissement de ces aménagements sur l’environnement.
Annabel Misonne, janvier 2024
-
 22:48
22:48 La France, l’Allemagne et l’Europe : le regard d’un ambassadeur
sur Les cafés géographiquesLes relations internationales sont l’objet de nombreuses études de journalistes, de politologues et d’historiens. Mais le témoignage des diplomates, participants discrets aux négociations entre les Grands, est précieux. Claude Martin, notre intervenant, a œuvré à la tête de deux ambassades prestigieuses à Pékin et à Berlin.
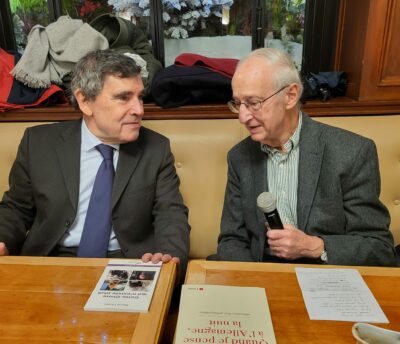
Claude Martin et Henry Jacolin au Flore (photo de Micheline Huvet Martinet)
Mardi 19 décembre Claude Martin (C.M) qui fut ambassadeur de France en Chine (1990-93) puis ambassadeur de France en Allemagne (1999 – 2008) est venu au Flore faire part de sa vision personnelle du rapport entre la France, l’Allemagne et l’Europe.
Passionné très jeune par l’Allemagne et sa culture au point de parcourir à vélo l’été de ses 14 ans la distance entre Chambon sur Lignon et Francfort afin de de visiter la maison natale de Goethe, il découvre alors la langue, la culture et les qualités de ce pays encore maudit à l’époque.
Après lEP, l’ENA et l’INALCO (où il étudie le chinois et le russe) il gravit les échelons diplomatiques jusqu’à devenir ambassadeur de France en Chine, expérience racontée dans son livre La diplomatie n’est pas un dîner de gala. Au retour de Chine il constate les désaccords entre la France et l’Allemagne, situation qu’il regrette. Il est devenu ambassadeur de France à Berlin à la demande de J.Chirac. C’est ce qu’il raconte dans son dernier livre intitulé Quand je pense à l’Allemagne la nuit (titre tiré des premiers vers des Poésies nocturnes de Heine en exil à l’époque à Paris), ouvrage dont il va tirer les éléments pour traiter le thème du jour.
D’emblée Claude Martin tient à dire que les deux livres se tiennent. Il les a écrits comme un récit, un témoignage de ce qu’il a vu personnellement même si avec le recul certains peuvent considérer qu’il a fait preuve d’un excès de candeur. Il dresse également le portrait des personnages qu’il a connus.
Il montre dans son premier livre comment la Chine était devenue puissante et comment l’Europe n’avait pas su répondre à ce défi. Il explique ensuite que dans son 2e livre il a voulu se concentrer sur l’Europe car après avoir consacré 25 ans de sa vie à la Chine, il a passé 25 ans à participer à la construction européenne à partir de l’Allemagne autour de ce qu’on appelle le couple franco-allemand en se demandant pourquoi l’Europe n’a pas été au RDV face au défi chinois qui nous pressait d’organiser la construction européenne.
Dans cet avant-propos, il dit à deux reprises que le but de la construction européenne était le rapprochement des peuples et que la réconciliation franco-allemande à laquelle il a cru et participé dans le cadre de négociations très difficiles l’a déçu. Ce sont les difficiles relations franco-allemandes qui sont à l’origine de bien des dysfonctionnements car la France et l’Allemagne auraient dû être davantage un moteur pour exercer une dynamique positive dans la construction européenne surtout au moment des élargissements. C.M a suivi dès le début toutes les étapes de la réconciliation franco-allemande contemporaine de la construction de l’Europe. Il dit que le défi chinois aurait dû inciter l’Europe à mieux s’organiser dans sa construction. C.M considère que de ce point de vue, il s’agit d’un échec et s’interroge sur ses raisons. Préalablement il précise deux points. Le récit qui s’arrête à son départ de Berlin est un témoignage personnel dont le but est de susciter l’opinion du lecteur. Le terme « couple franco-allemand » n’est pas approprié : il vaut mieux parler de « moteur ». Il n’y a pas eu de couple mais des couples selon les époques en fonction des réactions personnelles entre les dirigeants des deux Etats.
Les rapports France-Allemagne et la construction de l’Europe au fil de la succession des couples.
Le premier couple De Gaulle-Adenauer est celui de la réconciliation. C.M a vécu avec beaucoup de passion les épisodes qui ont mené au traité de 1963. Avec K.G. Kiesinger en 1966, De Gaulle n’a plus vraiment de partenaire. Un peu plus tard le couple Pompidou-Willy Brandt a vu l’émergence du rôle de la Grande Bretagne. Pompidou était plus méfiant vis-à-vis de W. Brandt dont on connaissait mal le passé. Il a commencé à mener son Ostpolitik, ce qui amène Pompidou à regarder vers un contrepoids en ouvrant les négociations avec la Grande-Bretagne que De Gaulle avait refusées par deux fois car il considérait qu’elle n’était pas prête. C.M a été chargé du dossier. Après 3 ans, les pourparlers aboutissent. C.M avait pu constater la bonne foi de la G.B qui était décidée à participer à la construction européenne ce qui, pour lui, était un bon point car la G.B pouvait être un complément de l’Allemagne et non un contre-feu. C.M considère qu’au fur et à mesure des élargissements qui se concrétisaient il fallait plus qu’un duo. Un trio avec la G.B serait un moteur positif.
Ensuite le couple V. Giscard d’Estaing-H. Schmidt fonctionne bien. Ils sont tous les deux d’anciens ministres des finances et ont une vision de l’Europe. Il y a une complémentarité de caractères des deux hommes, entre la superbe de VGE et la simplicité de H. Schmidt qui est un homme solide, ni keynésien, ni libéral qui pense qu’il faut faire des investissements et faire du déficit (il passe alors pour un hérétique) et sait tenir tête à Nixon au moment où celui-ci abandonne l’étalon-or (1991). Ce fut le meilleur couple de tous car il avait le souci commun de la solidarité, du soutien aux faibles et non pas celui de la rigueur. Les années VGE- H.M sont les « années d’or » des relations franco-allemandes et de la construction européenne grâce à un vrai souci de solidarité de l’Allemagne vis-à-vis de ses partenaires.
La relation F. Mitterrand-H. Kohl, qui laisse un souvenir positif est en fait beaucoup plus compliquée mais les deux dirigeants en tirent avantage ce qui facilite le tournant de la rigueur et leur accord sur le choix de J.Delors à la tête de la Commission européenne. J.D sera la « cheville ouvrière » des relations entre les deux hommes. Mitterrand détestait Schmidt, ce socialiste qui lui donnait des leçons de rigueur budgétaire et l’arrivée de Kohl a été une « bénédiction » pour lui. En effet Kohl qui n’est pas un intellectuel, admire Mitterrand et a besoin d’une entente avec la France pour poursuivre sur la lancée de VGE/ H.S. Les deux hommes se comprennent et savent faire les compromis nécessaires face à M. Thatcher. En 1989, après la chute du mur, les choses changent. La réunification inquiète le président français qui redoute que l’Allemagne ne soit tentée par le retour à l’idée d’un espace vital. Mitterrand veut arrimer l’unification allemande à la construction de l’Europe et pratiquer une ouverture commune vers l’Est. D’où Maastricht dont le contenu est beaucoup plus favorable à l’Allemagne qu’à tous les autres pays car les négociations ont été menées à un moment où ce pays avait pris du poids.
Selon C.Martin la politique extérieure de l’époque aurait dû être prioritaire. Mais la France se focalise sur la création de la monnaie européenne alors qu’en réalité le vrai problème était la mise en place d’une politique extérieure commune de l’Union. Les Allemands pensent que dans ce domaine il faut pratiquer la recherche du consensus, et « l’abstention positive » en cas de désaccord, alors que la France qui possède l’arme nucléaire et un siège au conseil de sécurité de l’ONU n’accepte pas de s’aligner sur cette position. Finalement toutes les négociations vont se concentrer sur la monnaie. Au même moment, dans l’éclatement de la Yougoslavie, l’Allemagne va jouer le premier rôle en reconnaissant l’indépendance de la Croatie pour plaire aux électeurs bavarois. Après, l’Europe a essayé d’apporter la paix mais n’y est pas parvenue. Elle n’a pas empêché la guerre et l’éclatement de la Yougoslavie.
Le processus européen se poursuit en élargissant considérablement le champ de coopération entre les Etats, notamment sur les plans diplomatique et judiciaire. C.M considère que l’élargissement a été trop important en intégrant des pays microscopiques dont certains, issus de l’ex bloc soviétique, sont dirigés par d’anciens dirigeants communistes devenus ultra- libéraux et entourés de conseillers américains. En entrant dans l’Europe, ils veulent surtout entrer dans l’OTAN pour assurer leur sécurité militaire. C.M qui a mené les négociations a pu constater que ce qui motivait ces nouveaux entrants n’était pas d’appliquer les règles communes et d’affirmer la puissance européenne dans le monde. En réalité, ils veulent intégrer plus entrer le camp occidental pour mettre un mur entre eux et la Russie. Dans ces négociations qu’il a menées, C.M reconnait que la coopération franco-allemande a bien fonctionné dans le cas de la Pologne. Les négociations ont duré cinq ans dans le cadre du « triangle de Weimar ». Tout a été accéléré en 2004 pour l’entrée dans l’U.E. des dix nouveaux venus de l’Est et du Sud.
G.Schröder, le successeur de H. Kohl, est hostile à la PAC qu’il trouve trop favorable aux agriculteurs français et s’appuie sur Tony Blair pour réduire la place de la France, ce qui met J.Chirac mal à l’aise car il avait bien conscience de la popularité de H.Kohl. Les relations Schröder-Chirac sont d’abord conflictuelles et même deviennent violentes lors d’un conseil européen à Nice où les deux protagonistes se quittent sans se serrer la main. C’est George W. Bush qui permettra de nouveau la reprise de relations plus cordiales entre J.Chirac et G.Schröder qui s’opposent à la guerre en Irak. A partir de là C.M en poste à Berlin voit se développer une relation de confiance et d’affection entre J.Chirac et G.Schröder qui prennent l’habitude de se téléphoner souvent. C.M voit deux limites à cette relation : G. Schröder fait des réformes courageuses qui font souffrir ses électeurs en misant sur des résultats positifs à terme dans l’espoir d’être réélu (ce qui ne sera pas le cas en 2005) alors qu’en France, J. Chirac, au pouvoir jusqu’en 2007, ne fait pas les réformes nécessaires ce qui a créé un déséquilibre surtout économique entre les deux pays.
Angela Merkel que C.M connait bien pour avoir négocié avec elle le protocole de Kyoto, poursuit la politique de G.Schröder et progressivement noue une bonne relation avec Jacques Chirac qu’elle admire pour son expérience et son audience internationale, lequel le lui rend bien en ayant de l’admiration pour une femme capable de s’imposer à la CDU et à la chancellerie.
Avec N. Sarkozy, ce sera « effroyable » et comme le dit N.Sarkozy dans ses mémoires la relation avec Angela Merkel a été « un long chemin de croix ». Dès le départ, elle ne pouvait pas le supporte car C.M pense qu’elle avait espéré l’arrivée de Villepin pour qui elle avait une grande estime. De plus, Obama sème la division dans le couple franco-allemand en rendant de fréquentes visites à Angela Merkel qu’il considère comme le pilier de l’Europe. Le problème des relations avec la Russie et l’Ukraine s’est très vite posé. Alors que Jacques Chirac et Gerhard Schröder pensaient qu’il fallait négocier à deux avec Poutine pour encourager une politique de « bon voisinage », à partir de 2006-2007, les pays de l’ex bloc soviétique récemment entrés dans l’UE, préfèrent privilégier les relations avec l’Ukraine. Dans le même temps, N.Sarkozy décidait la ré-intégration de la France dans le commandement militaire de l’OTAN dans laquelle G.W Bush voulait faire entrer l’Ukraine. N.Sarkozy était pour mais Merkel contre. Il est finalement décidé en 2008 que « l’Ukraine sera un jour membre de l’OTAN ». Pour C.M, c’est le début de l’engrenage infernal du problème ukrainien. Les mauvaises relations N.S/A.M ne le sont pas seulement sur le plan personnel mais elles le sont aussi sur le fond car les positions ne sont plus les mêmes : en effet Angela Merkel veut poursuivre sa politique allemande active vers l’est.
A partir de 2012, les relations personnelles de François Hollande et Angela Merkel sont aussi très mauvaises alors que les économies allemande et française continuent de diverger davantage.
E. Macron intéresse A. Merkel un temps, mais ses deux discours de la Sorbonne et de la Pnyx brisent son image. Les Allemands, plus préoccupés par le déficit français, comprennent mal les ambitions européennes d’E. Macron qu’ils prennent pour un intellectuel. La compétition Macron-Merkel est avivée par l’arrivée de Donald Trump, anti-allemand que Macron « cajole » dans un premier temps.
Conclusion : le point de vue de C.M sur les leçons à tirer :
- L’Europe depuis l’après-guerre, c’est, dans la continuité de la déclaration Schumann de 1950, celle de la réconciliation France-Allemagne
- Peu de politiques communes ont été menées en dehors de la PAC. Ce sont les Allemands qui ont poussé aux convergences budgétaires et monétaires.
- Il n’y a pas eu de solidarité franco-allemande forte car ces deux pays ont été progressivement « noyés » dans un cercle de plus en plus large et hétérogène avec des pays de plus en plus prêts à contester le couple franco-allemand à l’image de ce que pensent souvent les Polonais.
- Le Brexit a été très dommageable
- L’Europe actuelle est très éloignée du rêve originel. Elle peut être un facteur de divisions entre ses membres comme on l’a vu au moment de la guerre de Yougoslavie ou au moment du Brexit avec les positions de l’Ecosse et de Irlande.
- L’entreprise initiale de rassembler les peuples a vu les liens entre ceux-ci se distendre par l’exaspération entre ses membres. Il aurait fallu imposer des règles plus strictes de solidarité et notamment l’interdiction de sortir de l’Union après y être entré.
- L’UE n’a pas de politique étrangère. A 27 membres, l’Europe est impotente et la conduite d’une politique extérieure commune est impossible car il faut de la souplesse. Il n’y a pas de politique commune ni vis-à-vis de l’Ukraine, ni dans le conflit israélo-Hamas.
- L’Allemagne est très frustrée, voire irritée de ne pas siéger au Conseil de sécurité de l’ONU alors que c’est le cas de la France
Questions de l’auditoire
Elles ont permis à C M d’apporter les précisions, les explications et les compléments suivants :
- Le Brexit est catastrophique car le trio France-Allemagne-G.B. était très opérationnel dans certains dossiers. Les Anglais étaient franchement pro-européens au moment de leur entrée. C.M. pense qu’on a commis des erreurs à leur égard en se faisant parfois entrainer par l’Allemagne. On a sans doute imposé des règles trop communautaires. L’Europe est devenue progressivement « à la carte » pour les Anglais.
- La coopération diplomatique n’a rien à voir avec la coopération économique et commerciale. La politique étrangère demande de la discrétion et du poids. La diplomatie c’est l’art du sur-mesure, donc c’est la spécialisation. Il faut connaitre les interlocuteurs, parler leur langue. La diplomatie c’est la continuité. Il ne faut pas briser du jour au lendemain des grandes alliances.
- Toute la construction européenne est fondée sur le respect des intérêts nationaux. Le problème en ce moment, c’est l’exacerbation des nationalismes.
- Les Italiens sont les plus européens de tous les Européens, mais de façon passionnée et presque doctrinale. Il faut aussi compter avec la fierté et l’instabilité italiennes car les Italiens se comparent toujours aux Allemands. L’échec du traité d’Amsterdam en 1997 pour former une espèce de conseil de sécurité à quatre (Allemagne, France, Italie, Grande Bretagne) plus l’Espagne et la Pologne est lié en partie à l’attitude nationaliste de l’Italie qui s’est emportée contre l’Espagne.
- L’Allemagne doit être connue. Il faut parler l’allemand. L’Allemagne a toujours des gouvernements de coalition et donc il faut en tenir compte quand on négocie. Il faut toujours avoir en tête que l’industrie est capitale pour elle et que cela interfère dans sa diplomatie.
C’est là que Claude Martin termine sur une pirouette : « Il faut faire des Airbus dans tous les domaines car là on a un intérêt commun ».
Marie-Thérèse Le Corre janvier 2024
-
 15:13
15:13 Géopolitique du rail
sur Les cafés géographiques
Antoine Pecqueur et Henry Jacolin au Café de la Mairie (cliché de Denis Wolff)
Antoine Pecqueur qui nous présente son ouvrage, Géopolitique du rail (1), ce lundi 15 février au Café de la Mairie fait partie de ces amoureux des trains dont la passion remonte à l’enfance. Aujourd’hui journaliste, spécialiste des questions culturelles et économiques, il a écrit ce livre pendant la crise sanitaire alors qu’on ressentait la nécessité de repenser les mobilités. Les « beaux livres » sur les chemins de fer ne manquent pas, mais peu en ont étudié la géographie et la géopolitique. A. Pecqueur a donc voulu faire un travail documenté analysant les enjeux du ferroviaire à plusieurs échelles, tout en faisant part de son expérience personnelle, celle d’un homme pour qui le train est non seulement un moyen de déplacement mais aussi un moyen de rencontre. Nous allons donc faire avec lui un tour du monde de deux heures en chemin de fer, nous posant à chaque étape une question récurrente : y a-t-il actuellement une renaissance du train ?
Le voyage commence en Ukraine où le chemin de fer joue un rôle majeur dans le conflit. La compagnie ferroviaire ukrainienne, minée par la corruption avant l’invasion russe, doit répondre aujourd’hui à trois défis : assurer l’acheminement des réfugiés vers l’ouest du pays et les frontières polonaise, slovaque et roumaine, transporter le fret, notamment les céréales, qui ne peuvent plus utiliser les ports de la mer Noire (la différence d’écartement des rails complexifie la circulation chez les voisins européens), et assurer le transport militaire (troupes et matériel).
Le rail est aussi le lieu d’une bataille symbolique avec la Russie qui a cherché à « annexer la Crimée par le rail ». Le franchissement du détroit de Kertch (2) par un pont routier (mai 2018) puis ferroviaire (décembre2019) est un événement majeur pour les Russes car il permet une liaison directe entre la Crimée et le territoire russe. En octobre 2022 et juillet 2023 le pont est affecté par des explosions qui interrompent la circulation, sans doute dues à la marine ukrainienne.
Avant la guerre russo-ukrainienne, les Chinois avaient choisi la traversée de l’Ukraine comme un des axes de leurs Nouvelles routes de la soie reliant la Chine à l’Europe occidentale dans lesquelles le train joue un rôle crucial.
La Chine est la première puissance ferroviaire au monde. Le chemin de fer a servi à la mainmise idéologique du pouvoir central sur les cultures minoritaires, tibétaine et ouïghoure, grâce à la construction des lignes Pékin-Lhassa et Pékin-Ürümqi. Mais le système ferroviaire a connu récemment un essor stupéfiant de la grande vitesse. Premier fabricant mondial de TGV, le pays peut ainsi répondre aux besoins de déplacement d’une classe moyenne en expansion. Cette compétence lui ouvre le marché de nombreux pays asiatiques et, au-delà de l’Asie, de l’Amérique latine.
L’Amérique latine est le théâtre d’un grand projet, la réalisation d’un corridor ferroviaire bi-océanique reliant la côte Pacifique du Pérou à la côte Atlantique du Brésil en traversant la Bolivie. Ce « nouveau canal de Panama » est d’un coût économique et écologique très élevé. C’est Pékin qui doit financer ce projet – inabordable pour les pays sud-américains – qui servira ses intérêts commerciaux, particulièrement ses importations de soja et de minerais comme le cuivre. Cet ambitieux projet n’est pas sans susciter quelques inquiétudes sur les ambitions chinoises.
Antoine Pecqueur attire notre attention sur une utilisation tragique des chemins de fer en Amérique centrale. Les migrants cherchant à atteindre la frontière des Etats-Unis se hissent sur les conteneurs des trains de fret au péril de leur vie. On les appelle les « trains de mort ».
Les Etats-Unis sont par excellence le pays pionnier de la conquête territoriale par le chemin de fer. Le pays s’est unifié par le rail. Mais au XXe siècle, le train a connu une décadence continue au profit de la voiture pour le transport des passagers. C’est le fret qui fait la prospérité des compagnies ferroviaires. Pourtant dans ces premières décennies du XXIe siècle, un homme cherche à redonner au ferroviaire toute sa place ; c’est Joë Biden, un « amoureux du rail » qui utilise le train pour ses déplacements. Vice-président puis président, il cherche à assurer le renouveau du train, ce qui n’a pas forcément bonne presse dans un pays où ce mode de transport est considéré comme « communiste ». Il a voulu réaliser des « corridors ferroviaires » sur les côtes Est et Ouest. Ces travaux nécessitent de gros investissements publics. Malgré l’effort fourni, ceux-ci sont insuffisants. Le projet de la côte Est peut néanmoins être considéré comme une réussite, mais J. Biden n’en a tiré aucun bénéfice politique.
Autre espace où les capitaux chinois trouvent à s’investir dans le ferroviaire, l’Afrique subsaharienne. Dès les années 70, un chemin de fer Tanzanie-Zambie, le TAZARA, est construit pour désenclaver la Zambie avec, en partie, des capitaux chinois. 50 000 ouvriers chinois participent aussi aux travaux dans des conditions pénibles et dangereuses. Actuellement Pékin a surtout le souci de permettre un accès direct des matières premières de l’intérieur du continent aux grands ports. De nouvelles lignes sont construites et des lignes coloniales reprises, mais les Chinois ont beaucoup de difficultés à faire fonctionner les lignes de train.
Les équipements ferroviaires ont aussi attiré les intérêts privés. On peut citer le projet de V. Bolloré de construire une boucle ferroviaire Côte d’Ivoire- Bénin. Ce fut un échec car le groupe a préféré investir dans les médias plutôt que dans les infrastructures. Aujourd’hui celles-ci sont à l’abandon et les rails perdus, ce qui contribue à alimenter un sentiment anti-français.
Certains pays gèrent eux-mêmes leurs lignes de chemin de fer, comme la Mauritanie dont le train minéralier, longeant le Sahara occidental, est considéré comme le plus long du monde (2,5 km).
Nous terminons notre voyage en Europe dont les différents Etats présentent des situations très différentes, notamment en matière de tarification. Les CFF suisses sont un modèle en matière de ponctualité et d’accessibilité, même dans les zones les plus isolées. Grand avantage pour l’environnement, tout le fret est obligé de circuler par train. La situation est plus complexe en France, comme en témoigne la question des trains de nuit. Alors qu’en 2019 un rapport sénatorial hostile avait accéléré leur disparition, on annonce actuellement le grand retour des trains de nuit. Il est dommage qu’entre temps les voitures aient été vendues et que les nouvelles commandes prennent des années. Cette décision a profité à l’Autriche qui a racheté le matériel SNCF à bas prix.
A l’échelle de l’U.E. on envisage de relier les grandes villes européennes par des trains de nuit. Un grand projet ferroviaire européen, le rail Baltica, prioritaire dans le cadre du réseau transeuropéen de transport, reliera en 2030 la Finlande, les pays baltes et la Pologne, en évitant la Russie (Kaliningrad) et la Biélorussie. La liaison ferrée Varsovie-Talinn sera prolongée par une portion empruntant un tunnel sous-marin entre Talinn et Helsinki. Dans cette réalisation, d’un coût colossal, l’OTAN est partie prenante car la ligne, essentiellement réservée au transport des passagers et du fret, doit aussi servir au passage du fret militaire. Intérêt de l’OTAN, participation chinoise au financement du tunnel, vives critiques russes qui en exagèrent la portée militaire…Ce projet résume bien le rôle crucial du train dans la géopolitique.
A Pecqueur répond à plusieurs questions de l’auditoire très intéressé par son exposé.
- Les différences d’écartement des voies ralentissent le passage des frontières. C’est le cas notamment entre la France et l’Espagne. Les trains Talgo ont bénéficié d’un système de changement d’écartement automatique dans les principales gares sur la frontière franco-espagnole. Aujourd’hui l’Espagne préfère les LGV pour contourner le problème.
- Les gros écarts de tarification entre pays voisins s’expliquent par le coût des péages que les compagnies ferroviaires doivent payer aux gestionnaires des réseaux. Très chers en France, ils sont bien meilleur marché en Italie.
- Les trains à sustentation électromagnétique sont-ils l’avenir ? on peut citer le train aéroport-ville à Shangaï et surtout le train polonais, le Maglev, récemment testé, « en lévitation » au-dessus d’une voie classique. Mais A. Pecqueur pense qu’il faut renoncer à la course à la vitesse.
- L’ancien Premier ministre (2020-2022) Jean Castex a fait acte de militantisme auprès d’E. Macron pour relancer le train (3).
- Quel problème environnemental pose le train ? De la fabrication à l’exploitation, a-t-il moins d’impact environnemental que les autres modes de transport ? on ne peut faire de réponse générale. Les situations varient selon les cas. Le prolongement d’une ligne à grande vitesse a plus d’impact que celui d’une ligne classique. Quant à l’artificialisation des sols provoquée par les chemins de fer, elle est difficile à mesurer. Certes l’emprise des rails est très faible, mais il faut tenir compte de toutes les infrastructures adjacentes.
- La ligne POLT (Paris, Orléans, Limoges, Toulouse), un moment célèbre à l’époque du Capitole, est un exemple de ces lignes vétustes délaissées par la SNCF au profit du TGV. Elle devrait être rénovée.
- En France la séparation de l’ancien système ferroviaire intégré en deux entités, infrastructures et exploitation, pose problème. Le TGV n’aurait pas pu être construit après cette séparation.
1) Antoine PECQUEUR, Géopolitique du rail, Autrement, 2021 2) Le détroit de Kertch relie la mer Noire à la mer d’Azov. Il est bordé à l’ouest par la Crimée et à l’est par la Russie 3) J. Castex a montré son intérêt pour l’histoire des chemins de fer en publiant en 2017 La ligne de chemin de fer de Perpignan à Villefranche. Prélude de la ligne de Cerdagne
Michèle Vignaux , Janvier 2024 -
 11:43
11:43 L’Iran, une puissance en mouvement
sur Les cafés géographiques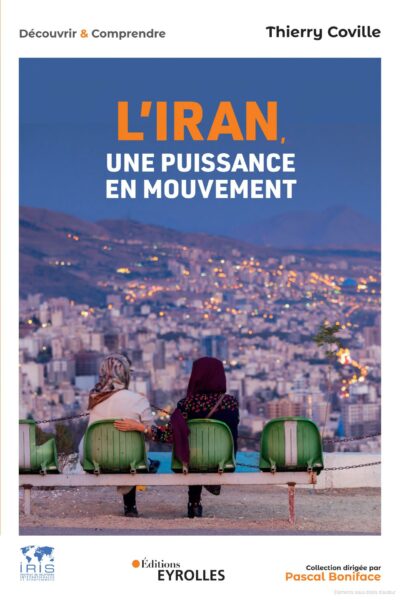
Thierry COVILLE (1), L’Iran, une puissance en mouvement, Editions Eyrolles, 2022
Ecrit un an avant que le Hamas ne déclenche un conflit majeur en Israël, dans lequel de nombreux politologues mettent en cause le rôle de l’Iran, l’ouvrage de T. Coville analyse les aspirations de l’Etat chiite à être « la » grande puissance régionale du Moyen-Orient. Destiné à un lectorat de non-spécialistes ayant une image souvent manichéenne et simpliste de l’Iran actuel, il a deux mérites principaux : replacer les décisions des dirigeants politiques dans une histoire de long terme – l’influence culturelle de la Perse sur le Moyen-Orient et l’Asie centrale se compte en millénaires – et montrer la complexité et les paradoxes de la société iranienne contemporaine.
L’auteur pose une question qui pourrait sembler superflue à beaucoup d’Occidentaux, tant la réponse leur semble évidente : la République islamiste (instaurée en 1979) est-elle une théocratie ? Pourtant sa réponse n’est pas catégorique ; c’est un « oui, mais ».
Certes le système politique est contrôlé par le « Guide » (docteur en jurisprudence islamique) qui décide de la politique générale de l’Etat, arbitre les conflits entre les pouvoirs, est le chef du pouvoir judiciaire et le directeur de l’audiovisuel. Et le Conseil des Gardiens de la Constitution veille à la compatibilité entre les lois de l’Islam et la Constitution. Mais il a fallu concilier des institutions de nature autoritaire et des institutions de nature démocratique (élection d’un Président de la République et de parlementaires). Et Khomeiny lui-même a déclaré en 1988 qu’on devait faire prévaloir la raison d’Etat sur la loi religieuse si cela était nécessaire. Dans plusieurs domaines le pragmatisme l’emporte, comme dans la Justice où certaines dispositions du Code pénal islamique sont considérées comme inapplicables. On peut donc parler d’un projet hybride politico-religieux.
Les islamistes au pouvoir depuis 1979 ne forment pas un bloc compact. Ils sont divisés en plusieurs courants qui débattent de la place de l’Etat de droit, des relations avec le reste du monde, de l’identité islamique. On peut distinguer une extrême-droite qui ne reconnait que la charia, une droite voulant allier la prééminence de l’ordre moral islamique avec l’ouverture économique au monde extérieur, une droite pragmatique favorable à un ordre moral moins sévère et à une libéralisation de l’économie, et des « réformateurs » privilégiant l’exportation de la révolution et la réduction des inégalités.
Les élections parlementaires de 2020 ont ramené les radicaux au pouvoir et le Président élu en 2021 est un ultraconservateur, Ebrahim Raïssi. Pourquoi cet échec des réformateurs ? Il ne traduit pas un enthousiasme populaire pour l’extrémisme religieux car le pourcentage d’abstentions a été très élevé, mais une déception des classes moyennes à l’égard du gouvernement précédent qui n’a pas su redresser une situation économique désastreuse (l’inflation a été de 36,4% en 2020).
Principaux responsables de cette paupérisation de la population qui est un frein à la démocratisation du régime, les choix politiques américains. Alors que sous la présidence de Rafsandjani, en 1989, l’Iran renouait des contacts avec les républiques d’Asie centrale et l’Arabie saoudite mais aussi normalisait ses relations avec les Européens, les tensions avec les Etats-Unis restaient fortes. Dans les années 2000 (présidence d’Ahmadinejad), le programme militaire iranien faisant une large place à l’enrichissement de l’uranium amène les E.U. et l’U.E. à prendre des sanctions économiques : réduction des exportations pétrolières et gel des avoirs iraniens à l’étranger, ce qui entraine une forte récession économique en 2012. Les négociations reprennent sous la présidence du modéré Rohani. Un Accord international (2) est signé en juillet 2015 à Vienne, qui prévoit la levée des sanctions contre l’Iran en échange de son engagement à réduire le taux d’enrichissement de l’uranium. Mais la décision de D. Trump de sortir de cet accord nucléaire en mai 2018 engendre un traumatisme sur la scène politique iranienne. Elle affaiblit les modérés. Face aux représailles américaines à l’égard de toute entreprise commerçant avec l’Iran, les Européens sont incapables de défendre leur « souveraineté économique ». Les exportations pétrolières s’effondrent. Cette nouvelle crise favorise la mouvance proche du « Guide » et l’élection du radical Ebrahim Raïssi.
Le fossé est croissant entre les dirigeants et la société, mais ce qui soude les Iraniens, c’est leur « nationalisme de résistance », appuyé sur une identité originale nourrie par une langue et une culture très anciennes (3). Au XIXe siècle il s’est manifesté contre les Russes et les Anglais qui imposaient leur domination économique. Aujourd’hui, il est facile de désigner les Etats-Unis et Israël comme les ennemis majeurs de l’Iran. Même si une grande part de la société est opposée au Velayat-e-faqih (primauté du religieux sur le politique), elle ne souhaite pas un affrontement avec le pouvoir qui mènerait au chaos que connaissent les voisins irakien et syrien. Le nationalisme assure la cohésion.
Dans un contexte régional instable, l’Iran cherche à appuyer sa politique de « profondeur stratégique » sur les chiites. La république islamique a favorisé et subventionné la création de milices chiites en Irak (al-Hashd al Shaabi) et au Liban (Hezbollah), soutient les alaouites en Syrie et les Houthis zaïdites au Yémen. Mais le gouvernement des mollahs fait aussi preuve de pragmatisme en entretenant de bonnes relations avec des Etats voisins non chiites, comme l’Arménie chrétienne, le Tadjikistan et a un accord de partenariat avec la Russie contre l’Azerbaïdjan, pays pourtant à majorité chiite. Quant aux relations avec l’Afghanistan, elles sont complexes : faut-il célébrer la victoire des talibans contre les Etats-Unis ou combattre des sunnites radicaux ? Dans son soutien à l’« axe de résistance » contre Israël, l’Iran défend les Palestiniens, ce qui explique le rôle central du Hezbollah dans sa politique régionale. Mais peut-il assumer le rôle de grande puissance régionale alors que son poids économique est bien inférieur à celui des deux poids lourds du Moyen-Orient, l’Arabie saoudite et la Turquie ?
Le pays dispose pourtant d’atouts économiques notables : des réserves pétrolières et gazières considérables, des infrastructures de qualité dans lesquelles l’Etat a beaucoup investi, un positionnement géographique central entre Europe et Asie, une société moderne urbanisée (75% de la population en 2019) et éduquée (4). La situation économique désastreuse a donc des raisons politiques, externes et internes. L’effet des sanctions internationales (5) est primordial, mais aussi le choix d’une économie rentière basée sur le clientélisme dans les années 1990 puis exacerbée sous la présidence d’Ahmadinejad. Peu d’emplois sont créés, ce qui crée la colère des jeunes diplômés et la « fuite des cerveaux ». La crise économique se double d’une crise environnementale profonde (pollution atmosphérique et pénurie d’eau).
Les aspirations de l’Iran à être la grande puissance régionale du Moyen-Orient dépendent donc de facteurs internes (succès des modérés ou des radicaux) et de facteurs externes (l’Iran pourrait remplacer la Russie sanctionnée dans l’approvisionnement de l’Europe en gaz, mais son implication dans le nouveau conflit israélien risque de renforcer son isolement).
Notes :
(1) Thierry Coville est chercheur à l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques). Docteur en sciences économiques, il effectue depuis près de 20 ans des recherches sur l’Iran contemporain et a publié de nombreux articles et plusieurs ouvrages sur ce sujet.
(2) Le Plan d’action global commun est signé par l’Iran, le P5+1 (les cinq membres du Conseil de Sécurité et l’Allemagne) et l’Union européenne.
3) Les lecteurs les plus âgés se souviennent sans doute du fastueux Festival des arts de Shiraz-Persépolis organisé par le chah Mohammad Reza Pahlavi en 1971/1972 pour célébrer le 2500e anniversaire de la fondation de l’Empire perse. Les dirigeants du monde entier y furent invités.
4) Paradoxalement le régime islamique a favorisé la scolarisation des filles des milieux traditionnalistes en rassurant les parents.
5) Aux sanctions américaines s’ajoute le placement de l’Iran sur la liste noire du GAFI, organisation mondiale de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le refus de transparence financière des Iraniens s’explique par leur souci de ne pas dévoiler leur soutien au Hezbollah et aux groupes palestiniens.
Michèle Vignaux, janvier 2024
-
 18:59
18:59 Le dessin du géographe n°96. Croquer le terrain au tournant du siècle : un carnet de Vidal de la Blache
sur Les cafés géographiquesLe terrain… un mot mythique pour des générations de géographes qui, ne se contentant pas d’une recherche livresque, sortent de leur bureau, munis d’un appareil photos et d’un carnet de notes. Mais ces carnets ont le plus souvent disparu. On en retrouve parfois, tels ceux d’Albert Demangeon en Limousin au début du XXe siècle, que nous avons dénichés dans les archives de la Bibliothèque Mazarine.
Auparavant, à la fin des années 1970, on découvre par hasard les 33 carnets de terrain de Vidal de la Blache dans un tiroir de l’Institut de géographie de Paris. Un travail de transcription et d’étude commence alors. Symboliquement, les Cafés géographiques inaugurent en 2010 la série des Dessins du géographe par un dessin de Vidal de la Blache !
En 2019, on publie le carnet n°9 qui rapporte les notes prises par Vidal [1] lors d’un voyage en Allemagne en 1885. Pour notre part, nous nous sommes intéressé au carnet 22 [2] qui correspond à des déplacements postérieurs, effectués en 1899 et 1900 : deux brèves escapades à Saint-Gobain (Aisne) et à Lille (mai-juin 1899), puis des voyages dans le Jura (août 1899), en Corse (avril 1900) pour terminer par un périple dans les Vosges, le Jura et en Suisse romande (juillet 1900).
Au cours de ces voyages, Vidal écrit sur ses carnets, mais il dessine également. Nous voudrions ici évoquer les croquis qu’il a esquissés. Ce sont, le plus souvent, de petits dessins, dans les limites de la taille du carnet (en l’occurrence, 95 x 142 mm). Avec seulement une brève indication sur la localisation, certains feraient plutôt penser à une photographie, telle cette représentation du Monte d’Oro. Il en est de même pour un second sur une vue de l’ouest de ladite montagne corse.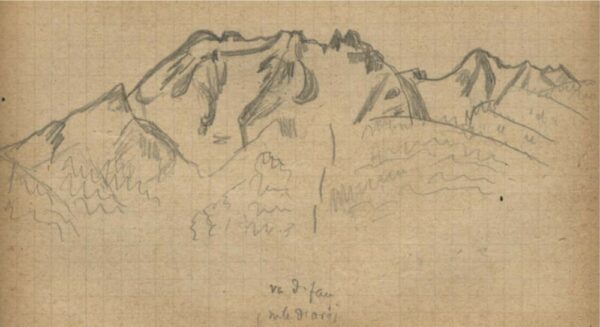
Dessin n° 1 [3] Vue de face Monte d’Oro . Vidal de la Blache
Mais, le plus souvent, texte et dessins sont intimement liés : c’est particulièrement frappant sur cette double page qui en comporte en fait trois : lac des Rousses, Dent de Vaulion et la Dôle (deux sommets du Jura suisse).
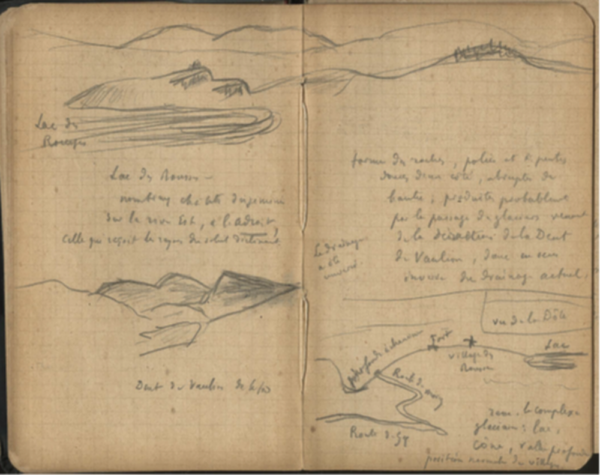
Dessin n°2. Trois croquis. Vidal de la Blache
Les indications sont parfois purement factuelles, comme sur cet autre dessin de la Dôle.
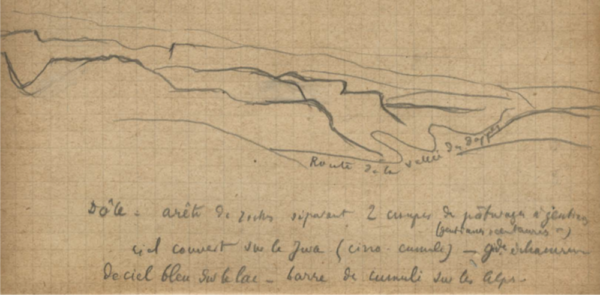
Dessin 3. La Dôle [Route de la vallée des Dappes. Dôle – Arête de roches séparant 2 croupes de pâturages à gentianes (gentianes centaurées) ; ciel couvert sur le Jura (cirro-cumuli) – Gde échancrure de ciel bleu sur le lac – Barre de cumuli sur les Alpes]. Vidal de la Blache
Cela dit, le plus souvent, Vidal ne se limite pas aux informations factuelles, : il donne des explications et pose des problèmes. Ainsi, en face du croquis de la Dent de Vaulion (Dessin n°2), : « Forme des roches, polies (…) produites probablement par le passage des glaciers venant de la désaltération de la Dent de Vaulion, donc en sens inverse du drainage actuel. » Il esquisse même des coupes géologiques : on distingue ici aisément un superbe anticlinal. Au-dessous, Vidal donne l’altitude de quelques lieux (Morez, Morbier, St-Laurent…) ; ces indications sont-elles en rapport avec la coupe ?
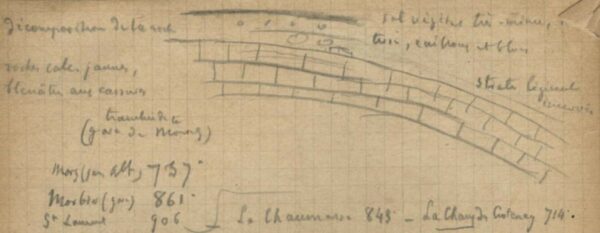
Dessin n°4. Coupe géologique. [Décomposition de la roche – roches calcaires jaunes, bleuâtres aux cassures – tranchée haute (gare de Morez). Sol végétal très mince, cailloux et blocs – Strates légèrement émincées]. Vidal de la Blache
Vidal travaille aussi à grande échelle et s’intéresse à l’habitat rural. Il livre ici le croquis d’une maison en précisant où se trouve la grange, les écuries, le jardin… Et, à Saint-Cergue (station suisse), il dessine une maison, mais aussi la place du village avec prés et forêt en arrière-plan.
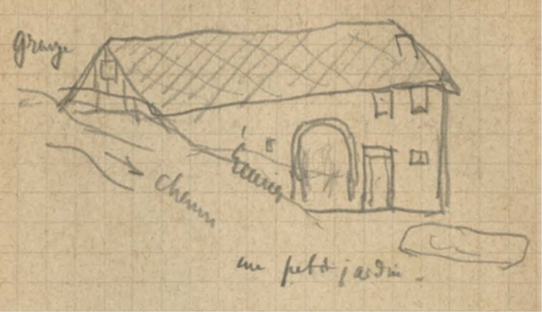
Dessin n°5. Une maison rurale. Vidal de la Blache
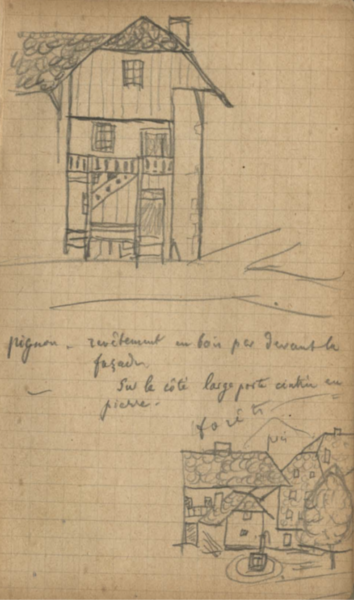
Dessin n°6. Saint-Cergue (Suisse). [Pignon – Revêtement en bois par devant la façade. Sur le côté, large porte cintrée en pierre]. Vidal de la Blache
Quoiqu’extraits d’un seul carnet (sur une trentaine), ces dessins sont révélateurs de la manière de faire de Vidal : croquer sur le vif, apposer les indications nécessaires, qu’il s’agisse de localisation, de végétation, de relief, de nature de roche, de maison… et éventuellement donner une explication. Dans d’autres cas non représentés ici, il fait des comparaisons avec d’autres lieux parcourus auparavant : les réminiscences sont fréquentes. Vidal a un goût et une maîtrise du dessin qui en dit souvent plus qu’un long discours. N’est-ce pas non plus ce que les Cafés géo cherchent à démontrer au fil de la série des Dessins du géographe ?
Denis Wolff, janvier 2024
P.S. Si l’on s’intéresse aux carnets de Vidal de la Blache, commencer par « visiter » trois expositions en ligne : la première sur le site de l’ ENS (Ecole normale supérieure, rue d’Ulm), la seconde sur le portail du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et la dernière, spécifiquement dédiée à ses carnets sur celui de la BIS (Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne).
[1] Les crochets au-dessous des dessins encadrent la transcription du texte ; celle-ci n’est pas systématique. Les abréviations de Vidal de la Blache ont été conservées.
[2] Paul VIDAL DE LA BLACHE, Carnet 9, Allemagne et Varia, Présentation par Marie-Claire ROBIC et Jean-Louis TISSIER, Paris, Macula, 2019, 200 p.
[3] Vidal n’a pas numéroté ses carnets. Leur numérotation a quelque peu fluctué au fil de leur découverte.
-
 19:39
19:39 Paris colonial et anticolonial
sur Les cafés géographiques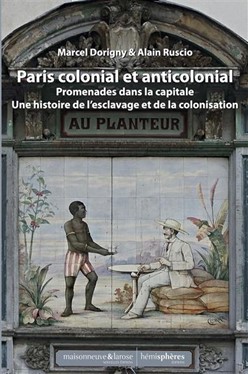
Dorigny M., Ruscio A., 2023, Paris colonial et anticolonial. Promenades dans la capitale. Une histoire de l’esclavage et de la colonisation, Maisonneuve et Larose Nouvelles Éditions/Hémisphères-Éditions, Paris, 315 p.
Marcel Dorigny et Alain Ruscio livrent une importante publication, sur les traces, sur l’empreinte viaire et statuaire, dans l’espace public parisien, à travers quatre siècles d’histoire esclavagiste et coloniale. Ces deux historiens placent au cœur de leur recherche la traite négrière et les conquêtes coloniales. La posture intellectuelle adoptée évite tout excès de paradigme victimaire, toute proximité avec certaines positions woke contemporaines, et recommande une contextualisation des statues et des noms de rues qui sont en débat ou contestés. Cette publication, qui a demandé douze ans de recherches, a été conduite à son terme par Alain Ruscio, postérieurement au décès de Marcel Dorigny en 2021.
Deux composantes occupent une grande part de l’ouvrage, d’une part une recension des noms de rues, des places et des monuments, en lien avec la colonisation, présentés par arrondissement, d’autre part un long inventaire biographique des personnalités citées dans l’étude. La qualité de l’iconographie, en particulier photographique, souvent l’œuvre de Alain Ruscio et de Françoise Dorigny, mérite d’être soulignée.
La méthode retenue pour mesurer l’empreinte coloniale et anticoloniale, dans l’espace public, a recours à l’odonymie, à l’analyse des monuments, à celle des effigies, au contenu des musées et des cimetières. Par contre, les auteurs excluent les œuvres trop éphémères de l’art urbain.
Les deux historiens privilégient le terme de roman national, plus ouvert aux figures artistiques et aux personnalités religieuses, à celui de récit national, une notion davantage politique et moins inclusive. Il n’est donc pas surprenant que l’entrée sur le Panthéon, temple du récit national, soit assez restreinte, bien que commémorant certaines personnalités opposées à l’esclavagisme (Victor Schoelcher, Toussaint Louverture, Louis Delgrès). Mettre en avant le roman national permet également aux auteurs d’évoquer certaines figures littéraires : Albert Camus, André Breton, Louis Aragon, Roland Dorgelès, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Kateb Yacine.
Participant des recherches contemporaines et de la publication de la Liste des 318, réunie par l’historien Pascal Blanchard, à la demande du Président Emmanuel Macron, le volumineux inventaire biographique de cet ouvrage consacre une large part aux « nouveaux héros », dont les noms sont utilisés de manière croissante par les municipalités françaises, pour dire l’espace public. Ils ont pour noms Abd-el-Kader, Faraht Hached, la mulâtresse Solitude, Abdelkader Mesli, louis Delgrès, Franz Fanon, Toussaint Louverture. Les hommages récents aux femmes dans la colonisation ou dans la décolonisation, rendus à Paris, par une odonymie volontariste, sont judicieusement présentés (les sœurs Nadal, Isabelle Eberhardt, Madeleine Rebérioux).
Les auteurs insistent également sur le peu de noms liés au monde religieux, partisans ou opposés à la colonisation, dans l’odonymie parisienne (cardinal Lavigerie, le père Charles de Foucauld, Albert Schweitzer, la religieuse Anne-Marie Javouhey). Les figures musulmanes ayant gravité autour de la mosquée de Paris (Kaddour Benghabrit, Abdelkader Mesli), mais également Mohamed Akroun, font également partie de la recension biographique.
Le livre montre bien également, l’absence de deux régions du monde, dans le paysage viaire parisien : l’océan Pacifique et l’Afrique subsaharienne. À l’inverse, l’empreinte nominale des anciennes colonies françaises d’Amérique, sans recourir à une incarnation historique, mais au moyen de noms d’îles, de régions et de pays, maille le quartier dit de l’Olive, en fait le marché de la Chapelle, dans le XVIIIe arrondissement. Il s’agit des rues de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Louisine, du Canada et de la place de la République Dominicaine.
Jean Rieucau, Professeur émérite de géographie, janvier 2024
-
 21:23
21:23 Protéger la forêt au pays du soja ? (Brésil)
sur Les cafés géographiquesLes Cafés Géo de Montpellier ont reçu Ludivine Eloy, directrice de recherche au CNRS et membre du laboratoire ART-Dev à Montpellier, afin de parler des causes et des conséquences sociales, économiques, politiques et surtout environnementales de la déforestation au Brésil.
La déforestation au Brésil
Le phénomène de déforestation au Brésil commence avec la colonisation au Sud et à l’Est du pays et progresse depuis, en direction du Nord et de l’intérieur des terres. Sur les 82 millions d’hectares de végétation naturelle perdus entre 1985 et 2020 (9,6 % de la superficie nationale), 71 millions d’hectares (86%) sont situés en Amazonie et dans le Cerrado, c’est-à-dire la moitié nord du pays, où se trouvent également l’essentiel des aires protégées (90%). Pendant cette période, le Brésil a innové dans la lutte contre la déforestation avec la mise en place de différents outils financés et issus de mobilisations locales, régionales et internationales. Malgré ces innovations la question reste la même, pourquoi la déforestation continue-t-elle de progresser ? Le Brésil a mis en place différents instruments de politique environnementale selon le statut foncier : alors que les aires protégées correspondent, pour la plupart, à des terres publiques, sur les propriétés privées, c’est le code forestier qui s’applique. Les aires protégées, dépendantes de l’Etat, bénéficient normalement d’un périmètre délimité, avec une équipe de protection. Cependant, le mandat de Bolsonaro a sapé ce système de contrôle, qui, combiné à une baisse drastique du budget, a conduit à un déboisement record dans les aires protégées. Les terrains privés sont régis par le code forestier. Ce code a été créé dans les années 1930 et a établi depuis 1965 deux nouvelles modalités : la Réserve Légale et l’Aire de Protection Permanente. Il impose aux propriétaires d’avoir sur leur terrain une réserve légale. Il s’agit d’un pourcentage de la propriété privée qui doit être préservé en végétation naturelle, avec un pourcentage qui varie selon la région considérée indiqué dans la loi : il varie entre 20% dans le Cerrado et 80% dans l’Amazonie.
Cependant, jusque dans les années 2000 le pays avait peu de moyens de contrôle de ces règles. Un tournant est marqué par l’arrivée à la tête du gouvernement de Luiz Inácio Lula da Silva, qui place Marina Silva au ministère de l’environnement. En effet, de nouveaux moyens sont mis en place afin d’endiguer le déboisement illégal. Parmi eux, entre autres, une police environnementale, l’usage de la télédétection pour contrôler les parcelles, le blocage des crédits bancaires des municipalités en tête de la déforestation. C’est à partir de 2005 que la déforestation diminue, ce qui s’avère être une nouvelle importante pour le Brésil qui peut par la suite se positionner de manière plus forte sur la scène internationale, notamment dans les négociations sur les changements climatiques. Le taux de déforestation remonte cependant en 2012 et s’accentue en 2019 sous la présidence de Jair Bolsonaro. Depuis 2021, le gouvernement du président Lula a remis en place une politique forte de lutte contre la déforestation en Amazonie, mais au détriment de la région du Cerrado.La région du Cerrado : un eldorado de l’exploitation ?
La baisse de la déforestation ne s’applique qu’à l’Amazonie. C’est en effet vers le Cerrado, un territoire composé majoritairement de terres privées, que la pression et l’utilisation agricole extensive des terres se sont déplacées. Légalement, dans le biome Cerrado, la réserve légale oscille entre 20% et 35% du territoire. En 2021 seulement 13,4% de ce territoire rentre dans le classement des aires protégées, contre 34,4% de l’Amazonie (où 65% des terres sont publiques). Même si depuis 2021, la politique de lutte contre la déforestation en Amazonie bat son plein, la déforestation dans le Cerrado ne cesse d’augmenter. En 2023 les chiffres le prouvent, avec une baisse de la déforestation de 7,4% en Amazonie et une hausse de 16,5% dans le Cerrado (Gabriela Monceau, 2023). Le Cerrado est la région des hauts plateaux centraux et la savane tropicale la plus riche en biodiversité du monde. La région alterne entre des prairies naturelles, des forêts sèches, humides, des palmeraies et des cours d’eau. Le Cerrado abrite par exemple le Jalapão, une mosaïque d’aires protégées qui abrite une grande biodiversité. Le Cerrado abrite les sources de huit des douze fleuves principaux du pays, ce qui lui donne le nom de “Château d’eau du Brésil”. Il s’agit en fait d’une « forêt inversée » composée d’arbres tortueux et petits avec un système racinaire très développé qui permet à l’eau de s’infiltrer et d’alimenter les nappes phréatiques. Toutes ces caractéristiques font du Cerrado un biome considéré comme sacrifié face à une déforestation deux fois plus élevée qu’en Amazonie. Le Cerrado, comme d’autres savanes, n’a été reconnu comme “utile à l’environnement” et donc comme un espace à protéger qu’à la fin des années 1990. Les forêts tropicales comme l’Amazonie étaient, elles, reconnues et protégées dans les années 1960. La protection tardive du Cerrado a contribué à faire de ce territoire un haut lieu de la déforestation. L’explosion de la production de soja à des fins d’exportation en Europe et en Asie (transformation du soja en nourriture pour l’élevage), dans les années 1990, est décisive dans ce processus. Aujourd’hui, la production de soja et les investissements se concentrent dans la région.Le rôle et le poids de la production de soja, de l’agroindustrie et de l’agrobusiness dans la déforestation et la réformation du code forestier.
Le soja[1] est le fer de lance de l’agriculture entrepreneuriale brésilienne. En effet, il représente à lui seul 20% de la surface cultivée, et ce sont plus de 45 millions d’hectares qui lui sont consacrés : il façonne ainsi le territoire brésilien. Le démantèlement progressif des politiques environnementales au Brésil, dans le but de favoriser l’implantation du soja, a commencé en 2012 avec le changement du code forestier appuyé par les lobbies de l’agrobusiness. Ce dernier consiste, entre autres, à réduire les Aires de Protection Permanente, les pourcentages réglementaires des réserves légales ; ou encore une diminution des moyens de contrôle du déboisement illégal, notamment dans les aires protégées. Bien qu’un système de compensation via un marché de quotas a été mis en place, ce dernier ne fonctionne pas. En outre, les réserves légales peuvent être déplacées d’un lieu à un autre, permettant de choisir des lieux moins propices à l’agriculture. Cette nouvelle réglementation favorise l’expansion agricole et donc la déforestation.
Un autre point central de la réforme du code forestier en 2012 est la création du Cadastre Environnemental Rural (CAR). Outil de contrôle contre la déforestation, ce registre obligatoire conditionne l’obtention de prêts bancaires, mais reste auto déclaratif. On constate une quasi absence de contrôle sur les informations rentrées par les agriculteurs (taille de la parcelle, taille de la réserve, etc.) et laisse une part de fraude possible. L’adhésion en masse au CAR s’explique par des campagnes d’enregistrement sur le terrain, financées en partie par le “Fonds Amazonie”. En effet, l’équivalent de 90 millions d’euros est utilisé entre 2008 et 2020 de ce fonds pour financer la mise en place du CAR.
Pourtant, le CAR est la condition pour obtenir des licences de déboisement et des droits d’eau. Des conflits émergent donc : entre l’accès à l’outil pour des personnes sans titre de propriété et les figures de l’agrobusiness, et entre les agriculteurs et les aires protégées.
Le soja était auparavant cultivé par des petites entreprises familiales, aujourd’hui l’agro-industrie les absorbe en prenant la forme de plus grosses entreprises familiales ou de sociétés d’investissement qui se développent en filiales. Ce secteur déploie par ailleurs un discours environnemental qu’il convient d’analyser. Dans les faits, les entreprises sont multi-situées et organisées en filiales. Elles peuvent donc se positionner sur les fronts de déforestation via leurs filiales et afficher un contrôle du déboisement et le respect de la loi dans les zones dites « consolidées ». Ainsi, le soja induit de nombreux conflits socio-environnementaux, notamment dans la préservation des ressources et de l’accaparement de celles-ci.Quelles conséquences pour ces territoires : liens entre conflits de déboisement, conflits hydrauliques et d’usage
Dans l’ouest de l’État de Bahia, un scénario de conflit autour des ressources hydriques et forestières a émergé, opposant les agriculteurs de l’agrobusiness aux petits exploitants. Cette lutte est alimentée par une utilisation intensive de l’eau par le secteur de l’agrobusiness, mettant en péril l’équilibre hydrique de la région. Face à cette situation, les communautés locales ont pris l’initiative de clôturer les sources des rivières (veredas) dans le but de protéger la ressource en eau, essentielle à la survie de plus de 3000 familles. Ces clôtures sont pourtant peu de chose face au déploiement de systèmes d’irrigation en pivot sur les plateaux en amont, utilisés par les grands agriculteurs, privant ainsi les communautés locales de leur accès à cette ressource vitale.La surexploitation de l’eau a conduit à une diminution significative du volume et du débit du Rio Grande. A l’échelle du Cerrado, c’est environ une perte de 15% des réserves d’eau. Cette réduction drastique affecte également les canaux d’irrigation ancestraux, cruciaux pour la culture durant la saison sèche par les petites exploitations, mettant en péril les moyens de subsistance de nombreuses populations locales.
En parallèle, l’intensification de la culture du soja a eu des conséquences dévastatrices sur les écosystèmes. L’arrachage des systèmes racinaires, essentiels à la rétention et à la circulation de l’eau, a engendré une érosion accélérée des sols. Cette dégradation combinée à l’amendement des sols en calcaire a perturbé la capacité d’infiltration de l’eau, ce qui, associé au pompage croissant de l’eau souterraine, favorise ainsi la baisse du niveau de la nappe phréatique. Ce rabaissement de la nappe a augmenté les risques de feux de tourbières (incendies souterrains), aggravant davantage la détérioration des écosystèmes locaux.
Conclusion
Face à ces défis multiples et interconnectés, la collaboration des communautés locales pour préserver les ressources naturelles et restaurer l’équilibre écologique s’avère cruciale, mais il est également essentiel de mettre en évidence et de quantifier l’impact environnemental de l’agrobusiness. Ces actions collectives visent non seulement à assurer l’accès équitable à l’eau, mais aussi à protéger les écosystèmes fragiles du Cerrado, nécessitant une approche durable et collaborative pour un avenir environnemental plus viable dans la région de l’ouest de l’État de BahiaUn constat grave et des enjeux multiples et interconnectés
Les enjeux de géopolitique environnementale, de déforestation, de gestion hydrique de conflits agro-pastoraux et de conflits d’usage sont liés. La stratégie du secteur agroindustriel et des réglementations gouvernementales a des impacts environnementaux et sociaux qui alimentent les inégalités sociales. Historiquement, un contre-pouvoir se dresse face à ces pratiques à travers des associations locales, régionales, organisées en fédération, mais qui se focalisent sur les problématiques foncières. Les ONG (Organisations Non Gouvernementales) ont une position ambivalente et tentent surtout de produire des informations environnementales. Ces structures, agissant à différentes échelles, pointent du doigts les irrégularités de réglementations contournées.Des pistes futures
Un des enjeux de la régulation de l’agriculture semble s’orienter vers le numérique et la télédétection, mais les outils de vérification restent peu nombreux et peu appliqués. Il serait intéressant de pousser les chercheurs à travailler sur cette thématique. Un durcissement des réglementations brésiliennes et européennes permettrait également de protéger les ressources de bois et d’eau. Finalement, la responsabilité du consommateur entre aussi en jeu par le biais d’une responsabilisation et d’une sensibilisation à ce qui compose les produits consommés.Esmée Parada, Sarah Traoré, Laura Delaunay
Compte rendu du Café Géo du 15/11/2023
-
 20:06
20:06 Questions à la géographie féministe, Marianne BlidonCafé géo du 3 janvier 2023
sur Les cafés géographiquesCafé géo de Montpellier du 3 janvier 2023Marianne Blidon est géographe féministe, spécialiste de géographie sociale et politique au prisme du genre et des sexualités. Elle est maître de conférences habilitée à diriger des recherches à l’Institut de Démographie de l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne (IDUP) où elle est aussi référente égalité et membre du comité d’éthique de l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne. Par ailleurs, elle est membre du bureau de la commission genre et géographie de l’UGI et de la commission diversité de l’alliance UNA Europa.
Ses recherches récentes concernent la géographie du trauma et son élaboration épistémologique, théorique et méthodologique. Elle conduit actuellement une enquête longitudinale et un suivi de cohorte sur les projets d’émigration vers Israël et l’Amérique du Nord en lien avec l’expérience et les représentations de l’antisémitisme. Elle est aussi membre du projet collaboratif européen RESIST – Fostering Queer Feminist Intersectional Resistances against Transnational Anti-Gender Politics (EU Horizon Europe) sous la direction de la géographe irlandaise Kath Browne[1].
Définir le féminisme et la géographie féministeIl n’est pas possible de concevoir la géographie féministe, et de la définir, sans d’abord définir le féminisme. Cependant, comme l’a souligné Marianne Blidon, le féminisme étant multiple, il est lui-même difficile à définir, au point que certain·es résistent à le faire. L’idée première, simpliste, que nous avons du féminisme est celle d’une lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Or, le féminisme ne concerne pas que les femmes, ni seulement cette lutte vers l’égalité des genres. C’est ce qu’a proposé de nous montrer Marianne Blidon en se basant sur diverses sources théoriques. Selon Angela Davis, le féminisme serait une méthode pour mieux lutter pour le changement, dans tous les domaines, ce qui explique que l’autrice y ajoute des notions de race et de classe (2008). Cette idée trouve sa continuité dans le concept d’intersectionnalité de Kimberley Crenshaw, qui propose de penser l’ensemble des intersections des situations de discrimination et leurs impacts (1989). Prenant tout ceci en compte, on peut s’accorder sur le fait que le féminisme est un moyen de penser le changement social au sens large (S. Bourcier et A. Molinier, 2012).
La géographie féministe est influencée par ces définitions, mais reste complexe à définir de manière succincte. Aussi Marianne Blidon nous a-t-elle proposé de reprendre la définition de la géographe afro-américaine Rickie Sanders, qui définit la géographie féministe à partir de 8 caractéristiques :
– Remettre en question les relations de pouvoir, à la fois comme objet et comme pratique réflexive, c’est-à-dire que les relations de pouvoirs sont non seulement un objet d’étude à part entière, mais elles servent aussi de grille d’analyse d’autres phénomènes ;
– Avoir une approche intersectionnelle ;
– Prêter attention à l’ordinaire, au quotidien, plutôt qu’à l’extraordinaire ;
– Donner une voix à celleux qui n’en ont pas, grâce à des travaux collaboratifs ; travailler « avec » les personnes étudiées et pas seulement « sur » elles ;
– Agir en accord avec ses principes féministes ;
– S’engager dans des débats épistémologiques sur la vérité et la production de la connaissance ;
– S’inscrire dans la perspective des savoirs situés ;
– Donner quelque chose en retour de ces études.Cette première définition nous donne une bonne idée de ce que la géographie féministe est, et de ses perspectives tant épistémologiques que méthodologiques. Malgré cela, féminisme et géographie féministe font face, comme l’a très bien expliqué Marianne Blidon, à des résistances qui les empêchent de trouver une place reconnue et durable notamment dans les institutions universitaires françaises.
Les résistances au féminisme et à la géographie féministe : quelles raisons, quels arguments ?Au cours de sa conférence, Marianne Blidon a insisté sur la résistance à l’institutionnalisation de la géographie féministe en France aujourd’hui alors qu’elle s’est largement développée dans les espaces académiques anglo-saxons (première chaire en GB en 1994 par Liz Bondi, création de la revue Gender, Place and Culture, etc.). Elle demeure un angle mort de la géographie nationale. Ce désintérêt et cette invisibilisation sont renforcés par une présentation stéréotypée et peu informée ainsi que la stigmatisation dont ce champ fait l’objet. La géographie féministe est soit disqualifiée comme un champ a-scientifique car engagé et militant, soit réduite à une particularité anglo-saxonne de la géographie culturelle. JF. Staszak ou C. Chivallon ont parfois cette lecture culturaliste : la géographie française s’intéresse à la classe, l’anglo-saxonne au genre et à la race. Ainsi, elle reste souvent en marge ou absente des appels à projets, des manuels et des présentations généralistes. Par ailleurs, l’ancienneté et la vitalité de ce courant de la géographie sont gommés au profit du récit de la figure pionnière – Jacqueline Coutras – qui aurait fait seule émerger le champ sans continuité, appuis ou ancrages ; invisibilisant par la même d’autres figures importantes comme Jeanne Fagnani ou Renée Rochefort (voir notamment Ginsburger, 2017).
Par ailleurs, la France souffre d’une ambiguïté quant au féminisme et, par extension, à la géographie féministe. La portée de cet héritage est ambiguë et le combat pour l’égalité apparaît pour beaucoup comme un combat dépassé du fait du « mythe de l’égalité déjà-là » et ce malgré les nombreuses objectivations chiffrées des inégalités et des violences systémiques (harcèlement de rue, violences de genre et féminicides, inégalités salariales et inégales disposition des temps sociaux…). Si le mouvement #Metoo a suscité beaucoup d’espoirs de changement parmi la jeune génération, le bilan demeure en demi-teinte et la vigueur et les attaques des mouvements antiféministes ont de quoi inquiéter. Ces discours sont éclairants quant à la résistance aux idées et aux épistémologies féministes. Marianne Blidon nous en a proposé une liste non exhaustive. Les arguments vont d’une considération du féminisme comme un combat dépassé, l’égalité effective étant atteinte, au refus de la victimisation, en passant par une attention se reportant sur une crise de la masculinité qui voudrait que les hommes soient en réalité les véritables victimes dans la société actuelle. Tous ces arguments sont réfutables par les statistiques, qui prouvent que l’égalité hommes-femmes est loin d’être atteinte et que les violences de genre persistent. Marianne Blidon a aussi insisté sur la nécessaire distinction entre expérience personnelle et les rapports sociaux. Vivre dans un couple hétérosexuel égalitaire, être mieux payée que son conjoint, avoir eu régulièrement des promotions face à des hommes n’invalident pas des inégalités systémiques qui ne se situent pas seulement à un niveau individuel mais collectif.
La géographie féministe fait face à des résistances similaires, notamment en raison de son lien avec le mouvement féministe. Le féminisme n’étant pas considéré comme une démarche scientifique, mais comme un engagement politique et militant, la géographie féministe souffre donc d’une forte disqualification. N’étant pas prise au sérieux, elle ne trouve pas, ou peu, sa place dans les institutions universitaires françaises. Ainsi, on ne trouve pas, ou peu, en France de cours sur la question et encore moins de départements ou de cursus dédiés contrairement aux espaces anglophones. Ce déséquilibre entre la France et ses voisins britanniques ou nord-américains conduit à envisager à l’instar de Christine Chivallon que ce champ serait le propre de ces espaces académiques plus ouverts à une approche communautaire. Cette lecture culturaliste achoppe sur l’histoire de cette discipline et l’oubli que dès 1982, le CNRS lance l’Action Thématique Programmée « Recherches sur les femmes et recherches féministes », à la suite du colloque « Femmes, féminisme, et recherche », tenu à Toulouse (Rouch, 2001).Tout ceci explique que, comme le dit Gillian Rose, citée par Marianne Blidon lors que sa conférence, « la géographie féministe reste “en dehors du projet” de la géographie » (1993).
Néanmoins, la géographie féministe est aujourd’hui plus visible en partie grâce à une nouvelle génération plus demandeuse et au courant des luttes féministes et de leurs apports. Dans le milieu universitaire, la mise au jour d’affaires de harcèlement et d’agressions sexuelles permet l’apparition de discours et de pratiques militantes et critiques. Les questions féministes trouvent aussi leur place dans le monde universitaire via la circulation des savoirs académiques et le poids des normes anglophones dans le milieu, permettant d’imposer plus durablement la géographie féministe. Enfin, les institutions s’emparent des questions féministes, conscientes de leur impact dans la protection du système démocratique. Tout cela tend à rendre la géographie féministe plus visible et reconnue, et avec elle ses nombreux apports à la discipline géographique.
Apports de la géographie féministeComme l’a montré la définition de R. Sanders rappelée par Marianne Blidon, la géographie féministe est vectrice de changements importants dans la discipline géographique et dans les sciences humaines au sens large. Marianne Blidon nous a permis de le voir en nous présentant les apports de la géographie féministe. Même s’il existe plusieurs mouvements de géographie féministe avec leurs spécificités, on peut résumer de manière globale les apports de la discipline à une refondation des principes de la discipline à la fois ses concepts, ses catégories et ses théories mais aussi sa manière d’enseigner et de conduire des recherches. C’est tous les fondements androcentriques de la discipline que la géographie féministe invite à dévoiler et à transformer. Parmi les perspectives ouvertes par ce courant de la géographie, on peut citer :
– Redonner leur place aux femmes en géographie en revisitant les travaux des pionnières mais aussi des petites mains qui ont fait la science dans l’ombre des pères fondateurs (voir les travaux de Janice Monk) ;
– Dévoiler les biais androcentriques des catégories et des concepts de la discipline à l’instar du travail réalisé par Claire Hancock avec le terme territoire ;
– Favoriser le développement d’une science plus réflexive et éthique (Cf les travaux de Gillian Rose) ;
– Questionne la place du corps, des sens et du sensible dans la production d’un savoir géographique médié par le terrain (voir notamment les travaux d’Anne Volvey).La géographie féministe, enfin, travaille à l’historicisation des rapports de pouvoir dans la science et à la conscientisation de ces rapports. Elle nous montre que plus qu’une lutte politique et sociale, le féminisme est une épistémologie, un corpus théorique mais aussi une praxis et une éthique, et une volonté de sortir de la victimisation dans une perspective d’empouvoirement, d’émancipation, et de justice sociale.
Au cours de sa conférence, Marianne Blidon nous a donc montré les spécificités et les apports de la pratique scientifique et politique qu’est la géographie féministe, et nous a permis de mieux comprendre son intérêt pour une science et une société émancipatrices. Nous la remercions chaleureusement pour cette intervention passionnante et au cours de laquelle nous avons pu vérifier certaines des thèses de la géographie féministe grâce aux interventions véhémentes et parfois agressives d’une partie du public.
Compte-rendu de Léo Boulanger – Relecture de M. Blidon, 2023.
-
 19:49
19:49 Produire et manger localement, utopie ou réalité ?
sur Les cafés géographiquesLors du café-géo du 6 décembre 2022 à Montpellier, Nabil Hasnaoui Amri (chercheur associé, UMR Innovation) (1) a présenté les résultats de sa thèse (2) dans laquelle il observe toute une collectivité s’interrogeant sur les emplacements à dédier à l’agriculture. Sont observés les jeux d’acteurs qui président à la mise en place de cette politique de réintroduction d’espaces agricoles au sein de l’agglomération; les leviers d’action utilisés pour la mise en place de cette agriculture urbaine ainsi que les limites spatiales, foncières et actorielles de ce projet. Quelles sont les réalités géographiques et politiques de ce jeune projet innovant et quelles en sont les dimensions utopiques ?
Contexte généralLe projet P2A s’inscrit dans un contexte général de mutation de l’agriculture :
Une défiance générale des citoyens au sujet de la qualité des produits agricoles suite aux différentes crises sanitaires comme celle de la vache folle dans les années 90. Le souci des pays riches porte désormais davantage sur la qualité des produits agricoles que sur leur quantité.
Une évolution du monde agricole marquée par une baisse des actifs agricoles, une diversification de leur profil social et une crise de légitimité au plan tant politique, social que sur le plan des pratiques agricoles (usage des ressources, pollutions…)
Une délégation croissante de l’action publique vers les collectivités locales et une prise en charge par ces mêmes collectivités des actions liées à la transition agricole.Le projet P2A : une transition qui accompagne une vaste transformation politique.
La métropole vise dans ce cas une transition vers une agriculture nourricière en partie implantée au sein des espaces urbains. De nouvelles compétences économiques et de développement ont été déléguées à la Métropole de Montpellier du fait de la loi NOTRe. Elle devient ainsi l’interface entre les problèmes locaux et les changements globaux (environnement, alimentation de proximité) mais aussi entre les différentes sphères sectorielles (agriculture, urbanisme …). La collectivité locale devient médiatrice entre les échelles et les acteurs alors que c’était autrefois l’État qui jouait ce rôle de régulation comme l’avait montré P.Muller (Le technocrate et le paysan, 2014, L’Harmattan). Dans le cas de Montpellier, N.Hasnaoui Amri, est parti de l’hypothèse qu’il existait de nombreux décalages entre les attendus des acteurs urbains, des citoyens engagés dans la transition agro-alimentaire de la métropole et les projets de tout un archipel agricole fait d’une diversité d’agriculteurs devant coexister dans cet espace.
Une généalogie agraire de l’agglomération permettant de distinguer plusieurs périodes.1820-70 : un système traditionnel de polyculture et d’élevage + développement du vignoble de masse.
1950-80 : une modernisation de la viticulture et une urbanisation accélérée 1980-2000 : arrachage viticole et « désactivation » des vignes + extension de l’urbanisation
2006-2012 : de plus en plus de désactivation, les terres étant en attente d’urbanisation, on y plante du blé dur subventionné par la PAC. Les travaux du SCOT montrent que la surface urbaine passe de 1000 ha à 10 000 ha entre 1960 et 2004 dans l’agglomération érodant largement les espaces agricoles restants.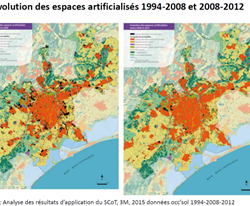
Trois modèles urbains se succèdent donc à Montpellier :
Technopole à bâtir
Ville durable ? création des Agriparcs
Ville en Transition ? P2A: Politique Agroécologique et Alimentaire
L’agriculture devient un objet urbainLes leviers pour une transition agroécologique et agro-alimentaire existent bien que la métropole ait peu de compétences proprement agricoles :
– La gestion du foncier peut se faire du fait de compétences d’urbanisme et grâce à des liens avec la SAFER
– Quelques entrées agricoles peuvent se faire par la gestion des déchets, celle des risques ou de questions économiques.
– L’impulsion du pôle de compétitivité Agropolis permet également une entrée agricole.
– La promotion des produits du terroir est un levier d’action.
– L’application de l’Agenda 21 (issu des préconisations de Rio en 1992) a permis la mise en place d’un projet d’Agriparc pour y répondre.
– La rédaction des documents d’urbanisme offre une réflexion nouvelle sur les espaces agricoles notamment cette du SCOT 2 qui propose “d’inverser le regard” et de mettre l’accent sur l’aménagement des espaces de nature et des espaces agricoles dans la ville au lieu de les percevoir comme des « vides de la carte ».L’adhésion en 2010 de Montpellier à la politique des villes en transition a motivé d’autres actions au plan agricole…
L’agriculture est ainsi introduite comme un objet d’aménagement de la ville à travers une complexe superposition de référentiels et d’outils.
En 2010 apparaît ainsi la première politique alimentaire de la métropole ce qui n’empêche cependant pas que la ville ait continué à perdre des espaces agricoles (120 ha perdus entre 1994 et 2008). L’espace occidental de la métropole (autour de Lavérune et Fabrègues) est présenté comme la plaine nourricière à venir. Les demandes sociales d’écologisation des productions et de relocalisation des productions (une proximité entre consommateur et producteur) sont portées en 2015 par le « pacte alimentaire de Milan » qui donne l’occasion aux élus de Montpellier de s’associer à la démarche d’un réseau international de « grandes villes ». L’agriculture change alors de statut, c’est une agriculture multifonctionnelle que l’on promeut : nourricière d’une part mais également apte à résoudre les changements globaux et dotée de fonctions environnementales multiples (alimentation durable, lutte contre les risques, services écosystémiques contre l’inondation, contre l’érosion de la biodiversité …).
Le marketing urbain se transforme dans ce sens comme le montre le marketing territorial de la métropole de Montpellier (ci-dessous): on passe de l’imagerie de la technopole hors-sol à l’image d’une métropole enracinée…
Hasnaoui Amri évoque enfin les logiques du projet P2A (Politique Agricole et Alimentaire) qu’il a analysé dans plusieurs articles (voir bibliographie). Ce projet montpelliérain consiste à promouvoir des productions agroécologiques urbaines et des circuits plus locaux grâce à plusieurs actions :
– mettre à disposition du foncier public pour les agriculteurs dans la continuité du projet du SCOT de conserver des espaces agricoles et freiner l’étalement urbain à Montpellier (2000) ;
Nabil Hasnaoui Amri évoque 3 projets :
– introduire des procédures de New public management par appel à projets (un instrument d’action public qui s’est développé depuis 15 ans) pour initier des projets agroécologiques ;
– négocier directement avec les agriculteurs qui souhaitent s’investir dans le P2A.1) L’aménagement d’un agri-parc : en 2010, la Communauté d’Agglomération de Montpellier (CAM) acquiert le domaine de Viviers situé au Nord de Montpellier. 20 % des 111ha de terres sont dédiés à des cultures vivrières, viticulture et céréaliculture en conventionnel pour le reste (commercialisées en filières longues). Seul un projet agricole alternatif (TerraCoopa) est présent – plus en adéquation avec le discours tenu sur la multifonctionnalité et qui a réussi à obtenir une part (10 % environ) du foncier alloué.
2) Installation de fermes nourricières: La question agri-alimentaire est alors actionnée comme ressource politique pour favoriser des alliances entre Montpellier et les communes périurbaines et rurales de son territoire. Le choix est ainsi fait d’attribuer à nouveau du foncier agricole appartenant à la Métropole (14 ha sur deux domaines à l’abandon, des friches agricoles dont une part est en attente d’urbanisation) à des agriculteurs pour installer des micro-fermes maraîchères. L’allocation foncière se fait directement sans passer par la SAFER, syndicats viticoles et chambre d’agriculture. Une allocation est donnée en fonction de réseaux affinitaires et idéologiques (la critique du modèle productiviste faisant l’unité). Cela conduit à l’installation de nouveaux agriculteurs sur de petites parcelles dans des interstices urbains. N. Hasnaoui Amri souligne que la marginalité et précarité de ces nouveaux fermiers demeure une donnée qui empêche d’en faire un modèle vertueux au plan social et spatial.
3) Redéploiement pastoral en garrigue : appel à bergers pour entretien des garrigues et de la biodiversité. Les espaces concernés sont le Domaine de Mirabeau à Fabrègues (il s’agit d’y évincer un projet de décharge), des terres acquises en compensation de grandes infrastructures – achat par les aménageurs selon la procédure Éviter-Réduire-Compenser (dite « ERC ») (renforcée par loi Grenelle 2011 et 2016) et gérées par le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN)
La fin de l’intervention a permis à Nabil Hasnaoui Am ri de répondre à quelques questions sur la quantification de cette agriculture urbaine (il ne s’agit pour le moment que d’une centaine d’hectares sur la métropole), sur la nécessité de politiques inter-territoriales intégrant espaces ruraux et espaces urbains, sur les actions de « Terres de liens » dans l’acquisition du foncier.
Pour aller plus loin
ASNAOUI AMRI Nabil, « Entre utopie, transition et rupture, quelle politique pour accompagner le développement d’une agriculture écologique et nourricière ? Illustration à partir du cas de Montpellier Métropole », Pour, 2018/2-3 (N° 234-235), p. 271-278. URL : [https:]
HASNAOUI AMRI Nabil, « La ville comme moteur de recompositions viticoles ? Réflexions à partir du cas montpelliérain », Pour, 2019/1-2 (N° 237-238), p. 319-334. URL : [https:]
HASNAOUI AMRI Nabil, MICHEL Laura, SOULARD Christophe-Toussaint, « Vers un renouvellement du dialogue entre agriculteurs et régions urbaines autour de l’accès au foncier agricole. Cas de la Métropole de Montpellier, France », Norois, 2022/1 (n° 262), p. 61-78. URL : [https:]Prise de notes : Sian CERRATO, Margot PEREMARTI, Ch.CASTAN, juin 2023
(1) Agronome et géographe, N. Hasnaoui Amri travaille sur la re-territorialisation de l’agriculture en ville dans le cadre de la politique de transition P2A à Montpellier (Politique Agro-écologique et Alimentaire menée par les 31 communes de l’Agglomération).
(2) HASNAOUI AMRI Nabil, « La participation des agriculteurs à une politique alimentaire territoriale : le cas de Montpellier Méditerranée Métropole », thèse soutenue en 2018 à Montpellier (Direction Laura Michel et Christophe Soulard – Géographie sociale et approche cognitive des politiques publiques).
Thèse fondée sur des observations participantes, l’analyse des délibérations des collectivités, des entretiens qualitatifs avec élus, agriculteurs, éleveurs, agents de développement (= métropole, communes, autres collectivités, chambre d’agriculture…), travaux sur des appels à projets, travaux dans le cadre du renouvellement du SCOT de Montpellier)
-
 17:48
17:48 La rue : évolution d’un espace public en France
sur Les cafés géographiques
Michèle Vignaux présente Claude Gauvard (au centre) et Danielle Tartakowsky (droite), cliché M.Huvet-Martinet
Les Cafés Géo ont eu le plaisir d’accueillir au Flore à l’occasion de la sortie récente de l’Histoire de la rue, de l’antiquité à nos jours * deux éminentes historiennes intéressées par la géographie urbaine. Claude Gauvard (C. G) est professeure émérite d’histoire médiévale à Paris I-Panthéon Sorbonne, spécialiste de la société et de la justice du Moyen Âge. Danielle Tartakowsky (D.T) est professeure émérite d’histoire contemporaine à Paris 8, spécialiste des mouvements sociaux.
La rue est à ce point familière au citadin qu’on n’y prête plus guère attention. C’est aussi un espace à connotation affective : on parle de « gosses des rues », « chansons des rues » … Quel était cet espace autrefois, quel est-il aujourd’hui ? Quelle place pour le piéton ? A quoi ressemblait cet espace avant l’éclairage, l’automobile ? Quelles sont les permanences, les ruptures depuis l’Antiquité ?
Interrogée en introduction sur le choix d’un découpage chronologique original, privilégiant « un long Moyen Âge » (du 5ème au 19ème siècles). C.G insiste sur le fait que les médiévistes travaillent toujours sur le long terme voire le très long terme. En ce qui concerne la rue en France, on peut considérer que du Moyen Âge à Haussmann, la configuration, la largeur, l’hygiène, la sociabilité des rues, les hommes et femmes qui la fréquentent et y travaillent, demeurent pratiquement les mêmes.
La rue, lieu de circulation.
C.G. La continuité dans le temps long est frappante. Les embouteillages décrits par Boileau pourraient dater du Moyen Âge, voire de l’Antiquité. Dans toutes les villes moyennes (environ 20 000 à 30 000 habitants) tout comme à Paris (200 000 habitants au début du 14ème siècle), l’espace est le plus souvent totalement saturé. La congestion anarchique est provoquée par le nombre croissant de véhicules et d’hommes concentrés dans un tissu urbain resté identique, constitué d’un lacis de ruelles et de rues étroites et tortueuses souvent de deux mètres de large atteignant très rarement six mètres maximum comme la rue neuve construite (1160) par l’évêque de Paris pour rejoindre Notre-Dame au palais royal dans l’IIe de la Cité en faisant détruire des blocs d’habitations. Il y a certes quelques villes neuves qui dérogent à la règle générale avec des rues au carré plus spacieuses à l’image des rues de l’Antiquité qui découpaient l’espace en lignes droites bordées de portiques.
Ceux qui circulent sont des marchands, des artisans, qui travaillent sur place et évacuent leur production. Les bêtes de trait et les charrettes provoquent beaucoup d’accidents. D’après les sources, on sait il y a beaucoup d’hommes mais c’est plus difficile de connaitre la place des femmes. Celles-ci circulent comme travailleuses : elles sont nombreuses notamment dans le travail de la soie à Paris et elles vendent parfois à la criée leur production. Les femmes se promènent-elles dans les rues ? C.G n’a pas de réponse quantitative car les sources sont extrêmement fugitives sur ce point.
D.T. fait remarquer que la perception de la rue comme lieu d’embarras est vieille comme la rue. L’apparition de l’automobile a été une rupture majeure dans une histoire de longue durée qui n’est pas univoque et dont l’évolution n’est pas linéaire mais où se superposent les mutations technologiques et politiques. Les travaux qu’Haussmann a imposés à la ville médiévale méritent d’être réévalués positivement dans la mesure où il a repensé l’espace urbain avant l’arrivée de l’automobile, en ayant une vision avant-gardiste remarquable. L’automobile ne devient un élément essentiel dans les interactions avec la ville que dans les années 1950 qui constituent une rupture majeure dans l’histoire longue de la rue. C’est en 1832 qu’une ordonnance de la préfecture de police de Paris définit, pour la première fois, les usages fonctionnels de la rue en affectant la voie publique à la circulation, principe réitéré théoriquement par Le Corbusier. Mais ce sont les années Pompidou qui marquent la ferme volonté d’adapter la ville à la circulation automobile, remettant en cause, pendant environ une vingtaine d’années l’hégémonie de la rue comme espace public même si les architectes recourant à l’urbanisme de la dalle ont souhaité préserver la rue comme structure de base du plan urbain.
La rue, lieu de sociabilité.
C.G. La rue au Moyen Âge et pendant très longtemps est un lieu de vie où on se rencontre, se parle, se connait, où on se jauge et où on définit ce qu’on est. En effet, jusqu’au 18èmesiècle, surtout pour certaines catégories sociales, on aime se comparer aux yeux des autres qui font ce que vous êtes, c’est à dire votre renommée, bonne (la fama) ou mauvaise (la diffamation). On est alors dans une société d’honneur et c’est dans la rue ouverte, dans l’atelier, entre gens qui se connaissent que se fait et se défait la réputation à un point tel qu’il y a des rues honorables et d’autres pas : on voit au 15ème siècle des bourgeois de Paris aller se plaindre au Châtelet de la présence de prostituées qui déshonorent leur rue. Il y a un honneur de la rue qui par osmose se répercute sur l’honneur de la ville qui décide, parfois, à certains moments, d’exclure les prostituées comme à Toulouse, Paris, Dijon, Lyon…Les bagarres commencent le plus souvent à la taverne mais se terminent toujours dans la rue, lieu public où se défend l’honneur.
Beaucoup d’enfants, de pauvres, de mendiants vivent dans la rue, plus ou moins bien acceptés parfois expulsés.
D.T. Si les enfants sont autrefois nombreux dans la rue jusque dans les années 1950, ce n’est plus le cas actuellement car les parents ont peur pour leur sécurité. Les petits boutiquiers qui veillaient ferment tour à tour ; il y a une nostalgie de la « rue creuset » qui n’est plus. A chaque époque, et sous des formes qui diffèrent, il y a les exclus de la rue : dans la longue durée ce sont les pauvres, les prostituées, les SDF. On peut ajouter plus récemment la question de la construction des mosquées.
Les trottoirs ont pour fonction de protéger les piétons. L’Antiquité avait ses portiques, Pompéi avait des trottoirs mais ceux-ci disparaissent pendant près de deux millénaires pour réapparaitre au début 19ème siècle mais surtout au 20ème siècle. Ils sont une réponse ordonnée à l’organisation de l’espace en protégeant les piétons car les villes grandissent avec l’industrialisation, elles se transforment et s’ouvrent. Avec les travaux d’Haussmann et les grandes percées, la rue et les boulevards deviennent des lieux de promenade : les piétons doivent être protégés de la circulation car maintenant ce sont des promeneurs qui flânent dans les rues élargies où on trouve toutes sortes de sollicitations, notamment les kiosques à journaux. Être dans la rue, ce n’est plus être dans sa rue.
La construction des trottoirs a engagé un phénomène de segmentation, voire de semi-privatisation qui se poursuit actuellement avec les couloirs d’autobus, de vélo. A Shanghai on trouve même, parallèlement aux couloirs pour cyclistes, des couloirs réservés aux joggeurs.
C.G. Au Moyen Âge on ne flâne pas dans les rues qui sont immondes. La flânerie est un luxe et la rue devient progressivement et plus récemment, un lieu du luxe tout en se démocratisant.
La rue, lieu d’expression politique.
D.T. La rue est un lieu d’échanges et est, dans notre histoire très spécifique, depuis le 18ème siècle jusqu’à la Commune, le lieu fantasmatique de l’expression du peuple en armes. C’est la rue du peuple des barricades glorifié par Victor Hugo, Delacroix, qui peut faire et défaire les régimes. Avec la victoire des Républicains dans les années 1880, on assiste à un lent processus de basculement de ces mouvements de rue, révoltes du peuple des faubourgs qui descend dans la rue, aux manifestations de rue. Tous les acteurs politiques et sociologiques peuvent descendre dans la rue, espace public pour manifester, revendiquer, protester. Le mot manifestation est polysémique et a recouvert longtemps des évènements divers : processions, parades, défilés…ce n’est que tardivement qu’il prend son sens actuel familier : la manif’. La centralité politique récurrente de la rue au 19ème siècle, puis, sous d’autres formes, en 1934 ou 1968, constitue une spécificité française.
C.G. Au Moyen Âge aussi on exprimait ses opinions dans la rue, lieu de transmission des rumeurs, et lieu possible des insurrections. La rue fait peur aux autorités. C’est donc un lieu qu’il faut dominer et contrôler, éventuellement en installant des chaines comme en 1382 à Paris lors de la révolte des Maillotins. Les 14ème et 15ème siècles sont dans plusieurs pays (France, Angleterre, Italie) des moments de révoltes urbaines, le plus souvent d’origine fiscale, qui partent de la rue. Ainsi celle d’Etienne Marcel (1356-57) qui devient une véritable guerre civile.
C.G. La rue médiévale est aussi le lieu d’information et de transmission des décisions du pouvoir politique par les crieurs royaux et tout un personnel urbain affecté à l’information. Et les villes s’informent entre elles et savent très bien ce qui se passe ailleurs. L’affichage existe dès le Moyen Âge souvent sur les portes des églises, il est systématisé avec la création par François Ier d’un corps chargé des affichages dans les rues de Paris.
Les efforts pour assurer la sécurité notamment sanitaire de la rue.
C.G. Les épidémies ravageuses témoignent des mauvaises conditions sanitaires notamment en raison de la saleté mais aussi en raison des rivalités entre les juridictions, administrations, et seigneuries qui se chevauchent. Ainsi la place Maubert à Paris, place importante économiquement par la présence d’un marché et d’artisans, est réputée pour sa saleté : le roi et l’abbaye de Ste Geneviève veulent tous les deux se l’approprier. Il y a cependant des efforts pour aménager la voierie et les communes imposent des règlements, souvent répétés, pour interdire de jeter les immondices par les fenêtres, pour enlever le fumier et les détritus en dehors de la ville, pour empêcher les bêtes, particulièrement les porcs de divaguer. A Paris, le roi essaie de mettre la main sur les grandes artères pour imposer son contrôle sur la voirie. Au Moyen Âge, les épidémies, la peste particulièrement, se propagent très vite aussi car la coutume est de rester en famille et de mourir entouré de ses proches. C’est aux 14ème – 15ème siècles qu’on commence à comprendre timidement l’intérêt du confinement et celui de fermer les portes des villes en cas d’épidémie.
D.T. Au 18ème siècle les progrès sont évidents quand, en abattant les murailles, la ville close s’ouvre, et qu’avec les Lumières un courant hygiéniste émerge et réfléchit à la circulation de l’air. Nicolas Delamare dans son Traité de la police (en trois volumes 1717-1719), s’indigne que Paris soit un cloaque et met l’accent sur la propreté nécessaire. Le choléra de 1832, les travaux de Rambuteau puis ceux d’Haussmann à Paris permettent l’accélération des progrès de l’hygiène en veillant à l’alimentation de la ville en eau potable et à l’évacuation des eaux usées par les égouts. En 1883, le préfet Poubelle transforme la physionomie de la rue en imposant le ramassage et même le tri des ordures. La période haussmannienne et immédiatement post-haussmannienne a véritablement transformé les rues et la ville dans de multiples domaines y compris dans le ravitaillement avec la construction de halles modernes.
La rue, lieu d’expression culturelle.
D.T On a évoqué l’effacement du mot « rue » au profit de la « street ». A partir des années 1960, le street art venu des Etats-Unis est une des formes de réappropriation de la rue. La première exposition de ces nouveaux usages culturels de la rue, en rupture avec les normes et les usages convenus, a lieu à New-York en 1968. IL y a aussi tous les sports de rue (le skate, le roller), la street dance, mais aussi la street food…Toutes ces activités témoignent de la popularité grandissante de la culture de la street-rue, évidente volonté de casser l’ordre établi. Ces usages hors-normes, au début combattus, conduisent progressivement à une redéfinition de l’espace public et produisent des effets sur les conceptions urbaines.
C.G. Au Moyen Âge, toute expression est très ordonnée : il y a des enseignes, des sculptures religieuses, des bornes. En revanche, le spectacle envahit la rue : montreurs d’ours, jongleurs, manifestations parfois très grivoises des charivaris, du carnaval, des processions, toutes faites à la fois de ritualité et de spontanéité. Quelques scènes de théâtre peuvent être montées aussi dans la rue.
Interventions de la salle :
Trois remarques d’un géographe qui applique à la rue, la méthode de la géohistoire chère à F. Braudel réutilisée par Ch. Grataloup. La rue a une topographie (sa forme, sa longueur, sa largeur), mais la place sous ses diverses formes (place de grève, du marché, parvis de la cathédrale…) mérite aussi une réflexion. Par ailleurs dans la temporalité courte et moyenne, il est intéressant de distinguer ce qui se passe le jour et la nuit, l’été et l’hiver, en temps ordinaire et temp festifs. Enfin, l’étude des noms de rues, l’odonymie qui a fait l’objet d’un café de géo ( [https:]] ) est aussi un objet d’intérêt.
D.T. fait remarquer que les places, surtout les places royales à l’époque moderne sont largement étudiées dans l’ouvrage.
La rue : lieu d’insécurité ? Quelle place pour les piétons ?
C.G. La rue peut faire peur mais le sentiment d’insécurité n’est pas forcément rattaché à la rue. Au Moyen Âge la police est indigente (200 sergents à Paris). On a peur du viol, du meurtre, de l’homicide. Les viols, certainement nombreux mais difficiles à évaluer, sont des crimes punis mais peu déclarés. Ils concernent peu les « femmes d’honneur », davantage les servantes et encore plus les pauvres. La rue, notamment la nuit peut être un coupe-gorge. L’éclairage public n’arrive tardivement qu’au 19ème siècle en raison de la fréquence des incendies.
D.T. La « mort de la rue » préconisée par Le Corbusier avec les grands ensembles et l’urbanisme sur dalles (remis en cause dans les années 1970) puis les esplanades, créent des conditions de circulation et de sociabilité différentes. Dans le retour récent de la rue-street , le rôle des politiques présidentielles a été essentiel. V. Giscard d’Estaing a mis un terme aux grands travaux et projets de Pompidou en faveur de l’automobile, notamment à la radiale Vercingétorix qui devait enjamber Paris. Giscard D’Estaing mais aussi Mitterrand, avec Jack Lang, ont développé une politique volontariste dans la redéfinition des usages de l’espace public notamment à l’occasion des fêtes. Les Champs-Elysées « voie sacrée » deviennent un espace festif, en accueillant le Tour de France à partir de 1975 et autres les sportifs (joueurs de foot) ; les nuits blanches à partir de 2002, la fête de la musique le 21 juin font repenser le rapport jour/nuit.
*Histoire de la rue, de l’Antiquité à nos jours, s.d Danielle Tartakowsky avec Joël Cornette, Emmanuel Fureix, Claude Gauvard, Catherine Saliou, éditions Tallandier, 2022
Compte rendu de Micheline Huvet-Martinet, relu par Claude Gauvard et Danielle Tartakowsky décembre 2023
-
 14:37
14:37 Les centres militaires d’essais français au Sahara
sur Les cafés géographiquesLes trois principaux centres militaires d’essais, objets du présent article, étaient situés en Algérie et apportèrent à la France des possibilités très intéressantes pour développer et mettre au point, après la Seconde guerre mondiale, son expertise spatiale et nucléaire. Nous passons en revue ce que furent leurs activités qui, conformément aux accords d’Evian de 1962, furent arrêtées entre 1965 et 1967.
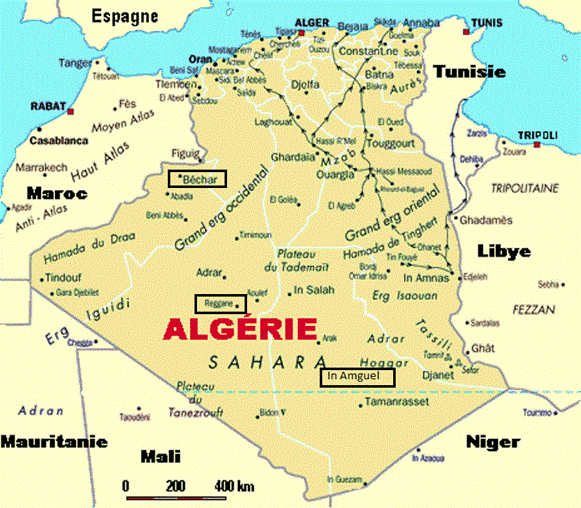
Le Centre Interarmes d’Essais d’Engins Spatiaux (CIEES)
Dès 1946, l’Etat-Major français avait compris la nécessité de faire évoluer la stratégie militaire en y incluant l’espace et l’atome. La conquête de l’espace passa par la construction de missiles initialement inspirés par les V1 et V2 allemands. Mais, en parallèle à ces travaux, on suscita fin 1947 des vocations (surtout au sein des régiments et écoles d’artillerie) pour constituer les premières sections appelées à aller servir trois ans, sans retour en métropole, à… (secret militaire) ? Ce fut à Colomb-Béchar.
Cette ville était déjà correctement desservie par deux voies ferrées, une piste allant jusqu’à Kenadza (mine de charbon), une piste d’aviation en terre puis ensuite en béton pour les avions à réaction civils et militaires. Soit tout un ensemble propice aux exigences d’installation d’un centre militaire : éloignement, isolement, secret, facile à défendre.
L’Etat-Major y a retenu 3 zones pour installer 3 champs de tir qui disposeront chacun, à terme, de leur terrain d’aviation : Béchar, pour les essais type V1 et Air-Air ; Ménouar, à 70 kilomètres au sud, pour les tirs de petites et moyennes fusées ; Hammaguir, à 120 kilomètres au sud, destiné aux gros engins.
Les premiers tirs sont effectués fin 1948 à Béchar, où une première logistique de suivi des engins a été mise en place. Mais ces engins sur rampe sont encore mal maîtrisés et l’un d’eux explosera au décollage (1 mort, 1 blessé grave). Les conditions initiales de vie et de travail étaient dures et pas les meilleures pour développer ce nouvel aspect des armes françaises. Mais le CIEES eut la chance d’avoir pour chef le Colonel Michaux, homme très exigeant pour lui-même comme pour ses hommes. Il est vraiment celui qui a permis au CIEES de se construire et de « décoller ».
A Ménouar, on testa des fusées à propergols liquides. Elles conduiront à la définition du 1er étage de la fusée Diamant, qui mit en orbite le 26 novembre 1965 le premier satellite français (Astérix A1).
La base d’Hammaguir, opérationnelle en 1952, comprenait 4 aires de lancement : 2 pour les fusées sondes (type Véronique), 1 pour les missiles sol – air et 1 (Brigitte) pour les gros engins comme le 4200 (à propergols solides) d’une portée de 120 kilomètres ou le 4500 dont un vol, prématurément interrompu par une panne technique, causa dans son vol erratique une grande frayeur à des spectateurs qui n’avaient pas respecté les consignes de sécurité.

Aire de lancement de la fusée Diamant
Conformément aux accords d’Evian, les 3 bases de Colomb-Béchar furent transférées à l’Algérie en 1967, après 4 lancements réussis de la fusée Diamant entre 1965 et 1967. Le relai fut assuré par le CEL (Centre d’Essais des Landes) pour les engins militaires et Kourou, en Guyane, pour les lancements de satellites par les fusées Ariane.
Le Centre saharien d’expérimentations militaires de Reggane (CSEM)
Le 18 octobre 1945 le général de Gaulle avait créé le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA). La décision d’accéder au nucléaire militaire est prise le 5 décembre 1956. Le Groupe mixte des expérimentations nucléaires, présidé par le général Ailleret, choisit le 10 mai 1957 une zone de 108 000 km2 au sud-ouest de Reggane, qui est alors classée terrain militaire. Les raisons de ce choix ? « …l’absence totale, je dis bien totale, de vie animale ou végétale…Il apparaissait clairement que ce serait l’endroit idéal pour y faire des explosions nucléaires sans danger pour les voisins, puisqu’il n’y en avait pas…l’absence de vie était bien entendu l’élément essentiel en faveur du choix de ce site… ». Ces propos du général Ailleret prêtent aujourd’hui à sourire car nous savons tous que les nuages radioactifs ne restent pas stationnaires au-dessus du site d’explosion mais s’en vont quelque fois très loin !
Les travaux d’aménagement commencent fin 1957. Le commandant du Centre et les familles civiles logeront à Reggane-Ville tandis que le base vie (Reggane-Plateau) rassemblera plus de 1 500 personnes (militaires des trois armes, civils du CEA, de la DAM, des entreprises de construction…ainsi que la main d’œuvre locale) (cf. note 1). Tous les services nécessaires y sont progressivement installés. Les transports aériens utilisent plusieurs aérodromes provisoires avant que le définitif, avec sa piste de 2 400 mètres, n’entre en service en mai 1958.

Porte de l’Enfer
Dès son retour aux affaires en 1958, le général de Gaulle assure une priorité absolue à l’entreprise en disant que la bombe atomique sera « un moyen politique de s’asseoir à la table des Grands ». La DAM (Division des Applications militaires) est créée le 12 septembre 1958.
Pour les tirs, les postes de commandement de l’armée et du CEA sont installés à Hamoudia, à 45 km au sud-ouest de Reggane-Plateau. Le champ de tir lui-même se situe au sud d’Hamoudia. Le Point Zéro (PZ) en est à 16 km. C’est là que seront érigés les pylônes de 106 m, supports des engins expérimentaux. A 900 m du PZ, les caméras et instruments de mesure se trouvent dans un très grand blockhaus en béton. En complément, 9 points d’observation (M01 à M09) disposent d’instruments enterrés dans des caissons.
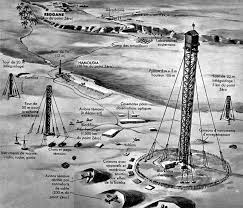
En 1959, 4 avions Vautour sont transformés en version PP (prélèvement poussières) par adjonction sous l’aile gauche d’un bidon tronqué dont l’entrée comporte une tuyère de prélèvement, ouverte par le navigateur lorsque l’avion traverse le nuage de l’explosion. Ces avions ont été rendus étanches. Leur pressurisation, assurée normalement par prélèvement d’air au niveau des compresseurs des réacteurs l’est ici par emploi de bouteilles d’air comprimé, afin d’éviter toute entrée dans l’appareil d’air contaminé.
En complément à ces 4 Vautour, un Mistral télécommandé effectue un travail similaire grâce à une tuyère fixée sous son aile droite. Au sol de nombreux dispositifs sont mis en place pour tester les effets souffle et chaleur des bombes. Après chaque tir, les avions PP ayant traversé le nuage subissent une décontamination totale par aspersion d’eau sous pression. Les équipages sont soumis à des douches abondantes.
Les appareils et équipements tests passifs, après examen de leur état et de leur contamination, sont enterrés. Les essais suivants auront lieu à In Eker, qui fut préparé parallèlement à l’utilisation de Reggane. Le CSEM restera militairement occupé jusqu’en 1967, en vertu des accords d’Evian. Dans le cadre de mes fonctions à In Amguel, je me suis rendu plusieurs fois à Reggane en 1964. L’essentiel du dispositif était constitué par un détachement de la Légion (4ème REI). Il y avait aussi une compagnie de l’Infanterie légère d’Afrique (les Bat’d’Af), quelques éléments de l’armée de l’air pour le fonctionnement de l’aéroport et des services d’intendance.
Le Centre d’expérimentations militaires des oasis à In Amguel (CEMO)
Le CEMO prend la suite du CSEM. Sa création a été lancée en parallèle avec celle de Reggane, afin de remplacer les essais aériens, aux retombées très critiquables, par des essais souterrains a priori « inoffensifs », mais également pour éviter trop de problèmes politiques avec les pays voisins de l’Algérie, mécontents des risques liés aux essais aériens. La structure du CEMO est donc similaire à celle du CSEM et les problèmes à résoudre sont les mêmes : création d’un aérodrome, approvisionnement en eau et électricité, ravitaillement d’une population importante, etc.
Le site retenu est le massif granitique Taourirt Tan Affela, situé à environ 180 km au nord de Tamanrasset, près de l’ancien bordj militaire d’In Eker.

Vue aérienne du massif Taourirt Tan Affela
La base vie principale est créée à quelques kilomètres au nord de l’oasis d’In Amguel. Elle n’abrite que des militaires, les civils (essentiellement du CEA et de la DAM) étant logés plus au nord, à proximité d’In Eker. Au total ce seront parfois près de 9 000 personnes qui seront présentes lors des expérimentations (2 500 militaires, 4 000 civils et 2 500 PLO). (cf. note 2)
Le tableau ci-dessous situe les 13 essais souterrains réalisés à In Amguel.
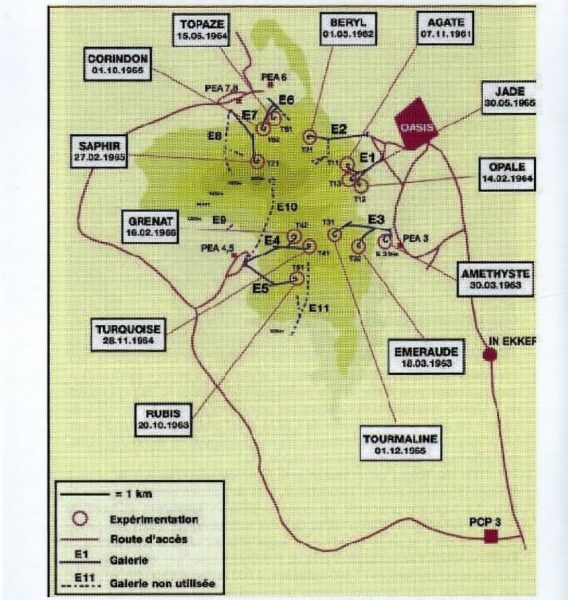
La bombe était déposée au fond d’une galerie en spirale de 800 à 2 000 m de longueur, apte à contenir la radioactivité résultant de l’explosion. Un seul essai (Béryl) fut défaillant : le 1er mai 1962 les bouchons de la galerie ne résistèrent pas au choc et un nuage radioactif se répandit en direction de la base vie, créant une grande panique et obligeant de très nombreuses personnes – dont le Ministre des Armées Pierre Messmer, présent ce jour là – à passer à la douche ! Cet incident entraina une surveillance accrue de la structure de la montagne et, avant un nouveau test, toute faille suspecte au-dessus de la galerie était cimentée par précaution.
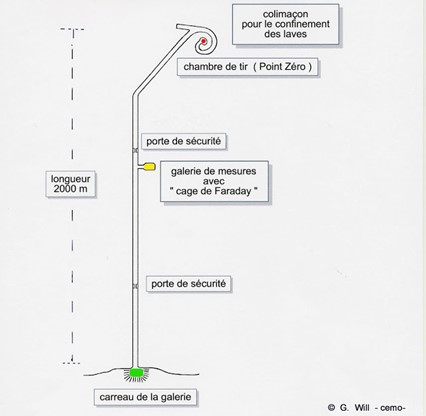
Schéma type d’une galerie
Mais Béryl laissa aussi des traces au sol. Une zone dite contaminée fut délimitée. Elle était bien sûr interdite d’accès, sauf pour ceux qui, comme moi, y allaient régulièrement pour mesurer la radioactivité et éliminer les pierres radioactives que l’on pouvait y trouver.
L’un des problèmes, pour les concepteurs, était de mesurer la puissance de la bombe. De nombreuses méthodes furent testées. L’analyse des ondes sismiques en fut une. Mais il y eut aussi la boucle du Professeur Rocard (Père de Michel Rocard) : une boucle de 1 km (?) de diamètre, posée à même le sol, où l’on mesurait le courant induit par la variation du champ magnétique terrestre après l’explosion.
Les bases d’In Amguel et d’In Eker ont été fermées en 1965, lors du transfert des expérimentations dans le Pacifique. On dit que les matériels contaminés lors de la fuite Béryl ont été sommairement enterrés. Vrai ? faux ? je ne le sais pas. En 1969 le Sous-préfet de Tamanrasset m’a dit qu’il disposait d’une carte les localisant. Mais certains journalistes, encore aujourd’hui, se font régulièrement l’écho de demandes algériennes de réparations financières pour soigner des victimes locales, dont les dossiers n’ont jamais été présentés.
Notes :
(1) Cette main d’œuvre locale fut baptisée PLBT (Population laborieuse du Bas-Touat) en évocation, parait-il, de la contrepèterie sur les « Populations laborieuses du Cap ».
(2) Après les PLBT de Reggane, on eut les PLO (Populations laborieuses des oasis) à In Amguel. Leur nom fut vite déformé et, à mon arrivée en 1964, j’entendis parler des Pélots et de leurs femmes les Pélotes. Je crus alors qu’ils venaient d’une tribu touarègue ainsi nommée.
(3) L’auteur, Marcel Cassou, fut officier en 1964 à In Amguel au titre du CERAM (Centre d’Etudes et de Recherches Atomiques Militaires), avec supervision de certaines installations de Reggane. En 1965 et 1966 il participa à plusieurs campagnes de tirs à Hammaguir (missiles de la force de frappe).
Bibliographie : de nombreux documents sont disponibles sur internet. Soulignons l’apport du rapport d’Yvon Chauchard sur le CIESS (1948-54) et des diaporamas de Pierre Jarrige sur le CSEM et le CEMO.
Toutes les illustrations sont publiées avec l’aimable autorisation de Pierre Jarrige. Elles sont extraites de ses diaporamas sur l’armée française en Algérie.
Marcel Cassou, décembre 2023 (cf. note 3)
-
 15:03
15:03 Gibraltar, un détroit stratégique
sur Les cafés géographiquesMaryse Verfaillie a rédigé ce texte pour accompagner les participants du voyage organisé par les Cafés géo de part et d’autre du détroit de Gibraltar.
-
 13:58
13:58 Les Cafés géo ont 25 ans.Rendez-vous dans 25 ans. En 2048.
sur Les cafés géographiquesUtopie ? Dystopie ? Difficile de choisir pour imaginer ce que nous pourrions être dans un quart de siècle. Car en 1998, nous n’aurions pas imaginé les centaines de Cafés géo qui se sont réunis à Paris et ailleurs. Nous n’aurions pas imaginé les voyages, poussés par la curiosité de quelques-uns d’entre nous, des voyages-cultes notamment sur une… des très antiques Routes de la Soie.
Nous n’aurions pas pensé qu’ils se seraient installés dans le paysage des géographes, lorsqu’on veut débattre, se retrouver, se confronter, diffuser des savoirs. Les cafés tels que nous les pratiquons sont nés au 18e siècle. Jean-Sébastien Bach y écrivit et y jouait une Cantate du café dans le célèbre Café Zimmermann de Leipzig. Un siècle plus tard, le géographe allemand Frédéric Ratzel a pu imaginer que ces cafés pourraient aider les jeunes géographes à penser leur métier. Cent ans plus tard, l’idée germe en France lors d’un festival de géographie autour des bières allemandes, à Saint-Dié, là où des cosmographes inventèrent l’Amérique cartographiée pour la première fois au 16e siècle.
Du « 1507 », bar historique de la Déodatie, ils migrent sur l’ancien forum romain de Lutèce, rue Soufflot en 1998 et s’installent sur Internet. Deux ans plus tard, les voici sur la place de la Sorbonne, au pied d’une chapelle baroque, où ils se mêlent aux touristes de l’Europe du Nord qui les chassent à l’heure du dîner. D’où la migration au Flore, ronflante adresse où l’on croisait encore à l’époque de célèbres grands couturiers, des stars du cinéma et de l’art, parce que cet antre des philosophes existentialistes offrait une belle salle dédiée aux débats à l’étage.
De là, est né place de la Bastille, un café dédié à la géopolitique, qui, à son tour a migré dans le Marais. Des dizaines d’autres ont campé à Lyon sur la grande place louis-quatorzienne, à Metz, Annecy, Toulouse, Albi, Rouen, Reims, Lille, Orléans, Tours, Besançon, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Chambéry, Pau, Bruxelles, Genève, Liège, Montréal, etc. et se sont tenu occasionnellement lors de rencontres de géographes à Washington, Mexico, San Paulo, Kyoto, Moscou, Le Cap, Abu Dhabi, Istanbul, Bologne, Lausanne, Varsovie… Les voici devenus Cafés « histoire » dans le quartier populaire de la très chic ville de Sceaux. Comme les hirondelles sur le fil, ils apparaissent, disparaissent, réapparaîtront sous d’autres formes en Afrique, en Océanie, au Groenland ou à la Réunion. Et qui ont-ils invité » ? Reclus plus que Vidal, et ils ont redécouvert la physique de la Terre avec Humboldt, adoré Lacoste et ses élèves.
A Paris, l’écran a changé le Café qui a pu reprendre une forme doctorale. Sur les tables, la bière, l’eau minérale ou le vin ont été souvent préférés à la boisson noire. Les étudiants se sont serré la ceinture pour grimper sur l’addition mais ont pu se régaler à écouter un vieux ponte ou telle chercheuse sur des sujets parfois haut perchés…
Demain ? On dit déjà que les écrans vont bientôt être remplacés par des implants oculaires bioniques. D’exocentriques, ils deviendront égocentriques. Ce qui est sûr : notre interprétation du monde se renouvelant à chaque génération, ils vont nous surprendre. On traque les dominations, les violences, les inégalités au fur et à mesure qu’elles augmentent, changent de forme, deviennent plus subtiles.
En 2048, les Cafés géo ont 50 ans. Ils ont de nouvelles interfaces rétiniennes et neuronales, comme on visite une exposition avec le regard de quelqu’un d’autre, on peut voir, en archive, Delphine Papin imaginer la dernière carte de la guerre israélo-arabe qui s’est achevée le 14 mai 2048, centenaire de la création de l’Etat hébreu. On remonte, en séance virtuelle, sur le Haut-Karabakh avec Henry Jacolin dont ChatGPT aura reconstitué la voix pour comparer la situation qu’il a évoquée en 2023, vingt-cinq ans plus tôt.
A moins que le changement climatique ruine la planète par des températures dignes du Rub al-Khali saoudien, qu’El Niño ait desséché l’Amazonie, accéléré la fonte des glaciers himalayens dont l’eau manque dans les fleuves asiatiques… Rien de tout cela est vrai comme il était impensable à la Révolution que les femmes ne meurent plus en couche, que les humains ont des robots qui les dispensent d’apprendre les langues étrangères et qu’ils peuvent désormais se nourrir sans agriculture. Mais, pour l’instant, on n’a pas montré qu’ils pourraient se passer de géographie. Alors ? Les Cafés géo sont toujours là pour peu qu’ils sachent dépasser les folies de leur jeunesse qui s’achève aujourd’hui.
Gilles Fumey, 2 décembre 2023
-
 13:35
13:35 Le Haut-Karabakh : la question des frontières dans le Caucase
sur Les cafés géographiques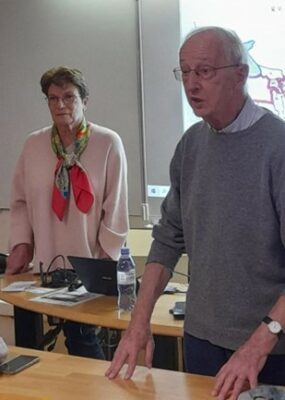
Henry Jacolin et Micheline Huvet-Martinet (modératrice) Photo J.P.Némirowsky.
L’Institut de géographie accueillait le 18 novembre 2023 Henry Jacolin (H.J), ancien diplomate, ambassadeur de France à Sarajevo pendant le siège ( [https:]] ), fin connaisseur de la géopolitique du Caucase puisqu’il a assuré, de 2002 à 2005, la médiation du conflit du Haut-Karabakh en tant que co-président groupe de Minsk.
Qui sont les Arméniens et les Azeris ?Les Arméniens, originaires de la région entre la mer Noire et la mer Caspienne se sont convertis très tôt au christianisme (dès 113 ap.J.C) faisant de l’Arménie le plus vieil Etat chrétien du monde. Ils ont été disséminés au cours de leur longue histoire autour de différents foyers dont les frontières ont évolué au gré des conquêtes des empires Perse, Grec, Romain, Ottoman, et Russe. Quant au XIXème siècle l’empire russe s’empare progressivement de la totalité du Caucase au détriment de l’empire ottoman, les Arméniens ont tendance à remonter vers le Caucase, préférant à l’autorité ottomane celle du Tsar prétendu protecteur des Chrétiens. En 1914, il y avait 1,8 million d’Arméniens dans l’empire russe dont 700 000 dans la région d’Erevan et 2 millions dans l’empire ottoman, répartis dans toute l’Anatolie et au sud jusqu’en Cilicie. Pour les Turcs les Arméniens sont une minorité encombrante et considérée comme une « cinquième colonne » qui mine la turcitude de l’empire. Les pogroms anti-arméniens ont été nombreux (ceux de1894-95, 1908 ont fait plus 25000 morts) avant le génocide de 1915, qui a fait de 1 à 1,5 million de victimes.
Les Azeris de la Transcaucasie sont proches des Turcs et turcophones ; musulmans chiites, ils sont aussi présents en Iran où ils constituent une très grosse minorité de 15 millions (sur 80 millions d’Iraniens).
La révolution bolchévique et la période soviétique (1917-1991).En mai 1918, le Caucase est partagé entre trois républiques qui déclarent leur indépendance : l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. Dès ce moment l’Arménie et l’Azerbaïdjan s’affrontent à propos du tracé de leurs frontières du fait de l’enchevêtrement des populations. La nouvelle Turquie pan-turque de Mustapha Kemal rêve de faire la jonction avec l’Azerbaïdjan en supprimant l’obstacle de l’Arménie ce qui conduit les Arméniens à préférer se soumettre aux Bolchéviques qui proposent dès 1921 la reconnaissance de l’autonomie du Haut-Karabakh (signifiant en turc « le jardin noir »), petit territoire montagneux de 4400km2 très majoritairement peuplé d’Arméniens (89%), au sein de la république soviétique d’Azerbaïdjan. Cette proposition est validée par Staline en 1923 : ce statut d’autonomie restera inchangé pendant 65 ans. Se pose dès lors le problème du Nakhitchevan, province d’Azerbaïdjan peuplée d’Azeris mais géographiquement séparée (enclave au sein de l’Arménie).
De 1923 à 1989, la situation est assez stable car l’ensemble de la région est administré par l’URSS et contrôlé par la police et les services secrets soviétiques ce qui malgré tout n’empêche pas des violences ponctuelles et récurrentes des deux côtés. La mémoire du génocide est restée vive en Arménie qui célèbre en 1965 à Erevan le cinquantenaire du génocide.
Avec la politique de Glanost et la Perestroïka de Gorbatchev, les tensions se font plus vives entre les deux républiques. En juin 1988, le Haut-Karrabakh se déclare en sécession ; 500 000 Arméniens quittent l’Azerbaïdjan suite au pogrom de Soumgaït.
La période post-soviétique est marquée par des tensions constantes et des guerres en 1991-94, 2016, 2020-21, 2023.Les deux républiques auto-proclament leur indépendance en aout et septembre 1991 alors que le Haut-Karabakh, soutenu par l’Arménie, proclame sa propre indépendance (non reconnue par la communauté internationale ni même par l’Arménie) chasse les Azeris et entre en conflit avec Bakou qui envoie des troupes.
La guerre de 1991-94 : victoire de l’Arménie.L’Arménie soutient les séparatistes Karabaki, les opérations militaires opposent Bakou et Erevan qui dispose d’une armée alors bien supérieure. Cette guerre fait des dizaines de milliers de victimes et génère d’importants transferts de populations : 200 000 AzebaIdjanais habitant en Arménie quittent le pays, 700 000 Azeris ont été réfugiés et 520 000 sont chassés des territoires entourant le Haut-Karabakh occupés par l’armée arménienne qui procède à un véritable nettoyage ethnique détruisant les villages de façon à bien marquer que ceux-ci ne pourraient jamais revenir dans cette région. Le cessez-le-feu de mai 1994 ne règle rien et le problème kharabaki devient un « conflit gelé » ou plutôt pour H.J un « conflit non résolu ». La défaite de 1994 a été vécue comme une humiliation en Azerbaïdjan et a alimenté un nationalisme anti arménien très virulent.
Pourquoi l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont eu recours à la guerre sans pouvoir régler diplomatiquement le conflit ?Plusieurs réponses à cette question. D’abord il s’agit d’un conflit entre deux droits : celui du respect des frontières héritées des accords d’Helsinki (1975) et celui du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. La très grande méfiance entre les deux peuples culturellement différents est nourrie par le souvenir toujours présent chez les Arméniens du génocide de 1915. La situation géographique enclavée et le tracé des frontières de l’Arménie sont un obstacle à la continuité du monde turc : il s’agit bien d’un conflit territorial et non pas religieux. De plus, la Russie conformément à sa longue histoire préfère entretenir la conflictualité entre les peuples.
De 1994 à 2020, début de la deuxième guerre, la tension est permanente, les incidents de frontières sont fréquents parfois violents comme en 2016 (« la guerre des 4 jours ») quand l’Azerbaïdjan de plus en plus ouvertement soutenue par la Turquie, parvient par des opérations militaires rapides appuyées sur des blindés et un armement lourd, à modifier la ligne de démarcation de 1994, témoignant ainsi des progrès considérables de son armée. En 2017 le Haut-Karabakh prend le nom de République d’Artsakh (hérité de l’ancien royaume d’Arménie).
Henri Jacolin et le groupe de Minsk (2002-2005)Nommé en 2002 co-président du groupe de Minsk, avec un ambassadeur russe (Nikolaï Gribkov) et un américain (Rudolf Perina), H.J participe aux tentatives de règlement du contentieux Karabaki. Fondé en 1992 sous l’égide de l’OSCE, le groupe de Minsk était ainsi nommé car la Biélorussie avait proposé de l’héberger mais il ne s’est jamais réuni à Minsk. Au moment de sa nomination (2002), il y avait bon espoir que « les principes de Paris » conclus sous l’égide de Jacques Chirac en 2001, conduisent à un accord. Pendant trois ans les trois diplomates travaillent en totale liberté et en harmonie réfléchissant dans un premier temps à la situation sur le terrain pour analyser les raisons de l’échec des négociations en vue de les reprendre. Ils s’aperçoivent vite qu’ils doivent jongler avec trois grilles contradictoires de lecture de la situation. En effet, d’un côté il fallait identifier clairement les problèmes à résoudre : statut du futur Haut-Karabakh, retrait par l’Arménie des territoires occupés et leur reconstruction, retour dans leurs villages des déplacés Azéris, liaisons entre l’Arménie et le Haut-Karabakh mais aussi entre l’Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, normalisation des relations Arménie-Azerbaïdjan avec garanties de sécurité pour les deux Etats. La deuxième grille faisait apparaitre deux méthodes opposées de négociation : l’Arménie qui maitrisait alors le terrain, exigeait une reconnaissance définitive du statut du Haut-Karabakh avant tout retrait des zones occupées alors que l’Azerbaïdjan qui redoutait une « chypriotisation » de la situation, voulait une négociation étape par étape. La troisième grille mettait en évidence deux conceptions opposées du temps : l’Arménie était convaincue de la pérennité de sa supériorité militaire alors que l’Azerbaïdjan, forte des ventes de son pétrole, était alors en capacité de financer le développement d’une armée moderne.

Entretien de Henry Jacolin avec Ilham Aliyev, président d’Azerbaidjan, septembre 2004, ds magazine Gömrükcü
En 2003, les trois diplomates parviennent à rétablir les relations entre les deux Etats et organisent trois rencontres entre les deux Présidents ainsi que des rencontres régulières entre leurs ministres des Affaires étrangères (Elmar Mammadierov pour l’Azerbaidjan et Vartan Oskanian pour l’Arménie). En 2004 quatre rencontres toutes les cinq semaines sont organisées. Ceci permet de revisiter, en les contrôlant, tous les paramètres de la négociation, tenant compte des lignes rouges de chaque pays, alors que sur le terrain des observateurs militaires de l’OSCE veillaient au maintien du calme. Si l’Azerbaïdjan maintient ses positions, celles de l’Arménie évoluent alors acceptant de se retirer des territoires occupés en échange d’un statut pour le Haut-Karabakh, d’un référendum et de la mise en place de garanties de sécurité. Les diplomates insistaient auprès des deux présidents sur le fait que le temps jouait contre eux mais le message passait mal tant à Erevan qu’à Bakou pour des raisons de politique intérieure mais aussi en raison de l’énorme méfiance entre les deux protagonistes convaincus chacun de la mauvaise foi de l’autre. Le président arménien Kotcharian, originaire du Haut-Karabakh, n’avait guère la culture de la négociation et que le Président d’Azerbaïdjan Aliyev restait sur ses positions et cherchait à gagner du temps, chacun étant très soucieux de tenir compte de son opinion publique ; c’est pourquoi, les trois diplomates, lors de leurs voyages à Erevan ou à Bakou, prenaient bien soin de réunir ou recevoir la presse et, les milieux d’affaires pour expliquer le cours des négociations. Les trois diplomates qui rendaient régulièrement compte de l’évolution de la situation à leurs autorités de tutelle respectives et à l’OCSE prirent conscience qu’ils sous-estimaient la force des revendications nationalistes dans les deux Etats.
L’originalité de l’accord finalement concocté (mais non validé) tenait dans sa capacité de se mettre en place progressivement, commençant par le retrait des Arméniens par étapes des territoire occupés. Ce caractère évolutif permettait aux opinions publiques d’évoluer positivement, constatant les progrès engagés. Néanmoins, au final le groupe de Minsk n’est pas parvenu à empêcher le retour de la guerre.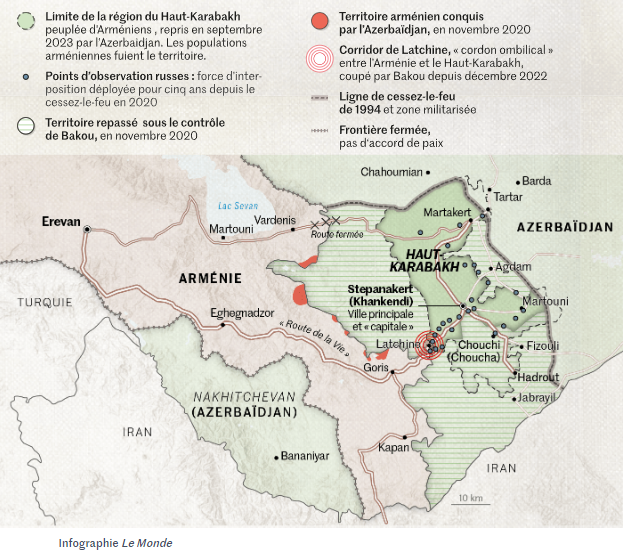
Carte reproduite avec l’aimable autorisation du journal Le Monde [https:]]
La 2ème guerre (2020-21) : la revanche de l’AzerbaïdjanDe violents affrontements éclatent en septembre 2020 entre les forces azerbaïdjanaises et les séparatistes soutenus par l’armée arménienne qui recule et perd une partie des zones tampon. Un cessez-le-feu immédiat est proclamé mais quelques mois plus tard, la guerre reprend dans un contexte régional modifié par l’échec des négociations, par l’entrisme de la Turquie pour s’affirmer contre la Russie (par rapport aux opérations alors menées en Syrie), par le comportement assez trouble et méfiant de la Russie envers l’Arménie depuis la révolution de velours de 2018. La Russie s’affirmait l’alliée de l’Arménie davantage contre la Turquie que contre l’Azerbaïdjan. A noter enfin l’attitude de l’Iran préoccupé par la possible contagion des revendications séparatistes dans sa minorité Azéri.
Les opérations militaires sont rondement menées par Bakou qui mène une offensive en juillet 2021 au nord près du gazoduc sud Caucase (Bakou-Erzurum) le long de la ligne de démarcation. La capitale Stepanakert est bombardée et des opérations sont menées sur les zones tampon avec des drones fournis par la Turquie alors que l’armée arménienne réplique par des bombardements sur Gandja à proximité du gazoduc. A l’automne plusieurs cessez-le-feu obtenus par Poutine du 9 octobre au 29 novembre sont nécessaires pour stabiliser la situation et obliger les deux ennemis à négocier. L’Azerbaïdjan, avec le soutien turc, contrôle la zone frontière le long de l’Iran. La reprise de Choucha permet le contrôle du corridor de Latchin, reliant l’Arménie au Haut-Karabakh placé sous un quasi protectorat russe. La rétrocession de la région d’Agdam est une faiblesse par les creux constitués sur la ligne de démarcation. Poutine obtient de placer une force militaire russe d’interposition de 2000 hommes pour sécuriser les positions. L’Arménie se voit imposer l’obligation d’offrir à l’Azerbaïdjan une voie d’accès sécurisée par les Russes vers le Nakhitchevan.
Le bilan est clairement en faveur de l’Azerbaïdjan qui a su, avec le soutien turc, transformer sa victoire militaire en victoire politique. La Turquie et la Russie s’installent comme des puissances régionales incontournables alors que l’Arménie qui a fait sa révolution démocratique, reste vassale de Moscou. Le groupe de Minsk et l’OSCE ont échoué dans leurs médiations.
2022- 2023 : la 3ème guerre.En 2022 la guerre continue. Après avoir lancé des offensives au sud dans la région de Syunik saisissant quelques territoires arméniens (200km2) proches de l’Iran, Bakou bloque le 12 décembre 2022 le corridor de Latchin mettant en état de siège les 120 000 habitants du Haut-Karabakh qui seront ensuite chassés de leur territoire en deux jours suite à une opération militaire éclair menée le 19-20 septembre 2023. Le 23 septembre la République du Haut-Karabakh s’autodissout et proclame que « toutes les institutions gouvernementales et organisations seront dissoutes au 1° janvier 2024 ». Fin de la partie.
Conclusions de cette longue aventure du Haut-Karabakh et de cette guerre éclair de 2023.H.J s’intéresse aux acteurs politiques et note que les dirigeants du Haut-karabakh ont tous été des vétérans de la première guerre de 1994, couvés par les services de renseignement russe. Ils ont fait preuve d’une certaine hubris en se montrant très intransigeants : ils ont refusé sept plans de paix successifs, provoquant même parfois des tensions avec Erevan. Ils ont cru que la victoire de 1994 leur assurait à jamais la supériorité témoignant ainsi d’une certaine myopie face à la montée en puissance des forces militaires de Bakou financées par la vente des hydrocarbures.
La France n’a pas bougé même si elle a récemment proposé des armes à Erevan pour assurer sa sécurité. La Russie a toujours cherché, selon son habitude à maintenir un faible niveau de conflictualité pour mieux tenir en main la situation. Le conflit a permis à l’entente entre la Russie et la Turquie de s’affirmer sur le dos des Occidentaux. L’Arménie est maintenant directement menacée de devoir céder à Bakou sa région méridionale qui permettrait à l’Azerbaïdjan d’établir la jonction avec le Nakhitchevan.
Questions de la salle.Comment se font les liaisons entre l’Azerbaïdjan et Le Nakhitchevan ? Il n’existe actuellement pas de route qui passerait par Meghri. La topographie à l’ouest permettrait de construire une route en plaine mais à l’est de Méghri le relief de hautes montagnes imposerait la construction d’une route de corniche. De ce fait, la jonction s’établit en passant par l’Iran à raison du passage de plusieurs dizaines de camions par jour. Il n’y a donc pas de problème de transit sur le terrain, le réel problème est la volonté de l’Azerbaïdjan d’obtenir un corridor de souveraineté à travers l’Arménie dans la province méridionale de Syunik.
Pourquoi la France est-elle plutôt pro-arménienne ? Il y a plus de 100 000 français d’origine arménienne en France qui a condamné le génocide de 1915.
Quels sont les objectifs d’Erdogan dans la région ? Clairement au nom de la turcitude, il s’agit de faire la jonction avec tous les peuples de Basse-Asie centrale anciennement soviétique qui sont turcophones à l’exception du Tadjikistan. Dans un premier temps (vers 2000), il s’agissait surtout d’objectifs économiques mais plus récemment les objectifs politiques ont pointé.
Quelles sont les relations Iran-Arménie ? Elles sont très bonnes et les Russes sont très intéressés à ce qu’elles le restent car ils peuvent ainsi établir des liaisons plus facilement pour entretenir le trafic de transit (notamment la livraison des drones iraniens utilisés contre l’Ukraine).
Quelle est la position de la Chine et de l’Inde dans ce conflit ? Aucune de ces puissances ne sont réellement présentes dans la région ; elles n’ont pas manifesté pour le moment de réel intérêt dans ce conflit.
L’Arménie n’a-t-elle pas été trop naïve vis-à-vis de son allié russe ? La Russie s’est montrée très molle dans son soutien de l’Arménie surtout après la révolution de velours de 2018, restant méfiante envers le processus de démocratisation en cours en Arménie. Elle préfère laisser le conflit en l’état ; diviser pour régner.
Compte rendu rédigé par Micheline Huvet-Martinet, relu par Henry Jacolin, décembre 2023
-
 19:42
19:42 Le dessin du géographe
sur Les cafés géographiquesUn certain nombre de géographes dessinent lors d’excursions sur le terrain ou de missions scientifiques. Certains en ont même fait une activité régulière, et en illustrent leur production. Mais cette activité demeure presque confidentielle. Beaucoup de dessins restent dans les tiroirs, n’ayant bénéficié que d’un regard furtif et admiratif des collègues qui jettent un coup d’œil sur le carnet. Rares sont les géographes qui comme Pierre Deffontaines en ont fait l’argument central d’un ouvrage (Petit Guide du voyageur actif, réed.1980 Presses d’Ile de France). Nous souhaitons sortir cette activité artistique et scientifique de cet anonymat.
En même temps les dessins géographiques qui ont illustré les publications de nos prédécesseurs méritent d’être revus (et relus comme on le fait dans les recherches sur l’épistémologie de la Géographie)
Il conviendra alors de distinguer le croquis fait par le géographe sur le motif ou d’après nature, du croquis d’après photographie qui fut beaucoup pratiqué aussi longtemps que l’appareil photographique demeura lourd et encombrant. Le croquis du géographe professionnel diffère aussi du croquis à usage pédagogique des manuels de l’enseignement primaire et secondaire, croquis le plus souvent supervisé et contrôlé par un géographe.
Le croquis à finalité géographique a changé de place au cours du temps. Les expéditions de découverte, de recherche scientifique, de conquête coloniale ont souvent été accompagnées par des artistes dessinateurs et ont produit des croquis qu’on peut considérer comme les premiers paysages géographiques, puisqu’ils avaient une finalité documentaire et qu’ils ont souvent été repris ensuite par les premiers ouvrages de géographie (cf les relations des voyages d’Alexandre von Humboldt ou les images de la géographie universelle d’Elisée Reclus,). Et les « pères fondateurs » de la science géographique, dans les écoles allemande, française, américaine, ont été parfois de bons dessinateurs sur le terrain.
A la fin du XIX° siècle, quand se met en place l’enseignement de la géographie dans sa forme moderne, les manuels sont illustrés de nombreux dessins ; les photographies sont rares, pour des raisons techniques, dont la qualité de l’impression et du papier. Puis les photos élargissent leur champ au détriment des dessins.
En même temps surgit avec Vidal de la Blache une géographie si soucieuse des paysages qu?elle en fait une des bases fondamentales de sa réflexion. La géographie est alors conçue comme une description raisonnée des paysages. Les paysages incitent au croquis. La prééminence de la géographie physique et à l’intérieur de celle-ci, la domination de la géomorphologie encouragent alors l’usage du dessin et du bloc-diagramme dont de Martonne se fait le chantre et le propagandiste.
Notre propos n’est pas de retracer une histoire du croquis géographique : cette histoire se construira d’elle-même chemin faisant. Elle est plutôt de sortir de l’oubli une pratique et de la raccrocher au devenir de la géographie, comme nous avons pu le faire par ailleurs pour la chanson des géographes. Enfin, la technique du croquis reste une pratique d’aujourd’hui et chacun des lecteurs peut proposer ses croquis, si leur esprit se raccroche à cette rubrique.
Les carnets de terrain illustré à la main gardent leur séduction : l’édition et les expositions en témoignent. Si l’appareil photo numérique est devenu un outil quasi indispensable, les perfectionnements technologiques de ce dernier, ne lui confèrent pas la puissance analytique d’un croquis de terrain qui trie et hiérarchise les éléments du paysage : et aide à comprendre le monde avec une feuille de papier et un crayon.
Remarques importantes :
*Le dessin de paysage (naturel, rural, urbain) proposé sur le site, sera accompagné d’un court commentaire, qui l’identifiera (auteur, date, lieu, site représenté, source) et le situera dans la production géographique de l’auteur en question : contexte, place du dessin dans l’analyse, dans l’illustration du texte, des faits décrits…, afin de le resituer dans la production générale de dessins géographiques.
*Chaque proposition devra se préoccuper des droits d’auteur et de reproduction de l’image sur le site des cafés géo : Les droits de l’auteur (propriété intellectuelle) s?éteignent 70 ans après sa mort (et jusque là leur édition dépend de l’autorisation des ayant-droit). Mais les droits de reproduction de l’image, liés à la source dont elle a été tirée (éditeur d’un ouvrage, musée, bibliothèque, archives, etc?) sont plus difficiles à connaître et souvent plus compliqués à obtenir.
Roland Courtot, Michel Sivignon
• Retrouvez également la liste des dessins du géographe
-
 19:41
19:41 Le dessin du géographe n°95. Les ciels brésiliens d’Hercule Florence (1804-1879)
sur Les cafés géographiquesEn France, son visage n’est connu de personne ou presque, sa maison natale à Nice n’est pas un musée, son existence n’a intéressé que quelques Monégasques qui lui ont consacré une exposition à la Villa Paloma en 2017. Au Brésil, l’Institut Hercule Florence n’a été créé qu’en 2006 à Sao Paulo. Pourtant, c’est un génial inventeur que l’Atlantique a séparé des savants de son temps. Cet isolement l’a privé d’une quelconque notoriété. Cet héritier des Lumières n’a eu de cesse, sa vie durant, d’inventer, de chercher des procédés pour améliorer la distribution de l’eau (noria permanente), le séchage accéléré des grains de café, le filage du coton, la reproduction d’écrits et d’images (découverte de la photocopie qu’il appelle « photographie »), l’écriture du langage des oiseaux, etc. Il souffre de l’ingratitude de ses contemporains comme en témoigne son journal : « Pourquoi ma vie n’est-elle qu’adversité ? Comment briser l’étau de l’isolement de cette lointaine province de l’empire sud-américain ? Parmi les milliers de documents, dont il est l’auteur, accessibles seulement depuis la fin du XXe siècle, figurent des dessins zoologiques, botaniques, ethnologiques et cartographiques. Dans cette œuvre graphique, nous avons choisi d’étudier les dessins de paysages célestes.
Un « dessinateur », membre de l’expédition scientifique russe en AmazonieFils d’un médecin militaire, également professeur de dessin, Hercule Florence est né à Nice en 1804. Son oncle et son grand-père Vignali furent peintres à la cour du Prince de Monaco. A 14 ans, Hercule rêve d’aventures et se fait embarquer sur une frégate. A 19 ans, il est apprenti dans la Marine royale. Et à 21 ans, il répond à une petite annonce vue dans un journal à Rio de Janeiro et parvient à se faire embaucher comme « géographe », deuxième dessinateur et chroniqueur de l’expédition scientifique amazonienne du baron Von Langsdorff.
Ce baron hessois est un naturaliste, qui a déjà fait le tour du monde. Il vit près de Rio où il est chargé d’affaires du tsar Alexandre 1er et consul général de Russie au Brésil. Il est mandaté pour explorer le Mato Grosso depuis la région de Sao Paulo afin d’atteindre l’Amazone. Un projet un peu fou car le pays est politiquement instable depuis la récente indépendance de 1822. Pour cette campagne de prospection scientifique, il engage quarante personnes, dont des savants et deux jeunes dessinateurs : Adrien Taunay et Hercule Florence. Le baron achète aussi du matériel, dont sept embarcations et des mules. Toute l’équipe quitte Rio le 3 septembre 1825, longe la côte jusqu’à Sao Paulo et remonte vers le nord-ouest par le Rio Tieté. Tout va bien jusqu’à l’arrivée à Porto Feliz à 300 km de Sao Paulo, en octobre 1826. Mais ensuite, les embarcations chavirent dans les rapides, les hommes souffrent de la fièvre jaune… L’expédition parvient en janvier 1827 à Cuiaba, la capitale du Mato Grosso. Les hommes y passent un an car le baron est malade et sénile. Un groupe de morts-vivants finit par arriver le 1er juillet 1828 à Santarèm, là où le rio Tapajos se jette dans l’Amazone. Épuisés, les survivants embarquent sur un brick qui les ramène à Rio le 13 mars 1829. Les données recueillies lors de l’expédition sont envoyées à l’Académie impériale de Saint-Pétersbourg (objets, dessins, cartes, notes, graines, fruits, spécimens de bois, ossements, etc.). Le recensement du contenu des caisses et leur analyse devait donner matière à une publication, synthèse de l’expédition. Mais, Langsdorff ne peut s’en charger et tout est délaissé jusqu’à ce que les autorités soviétiques retrouvent les caisses en 1930. Aujourd’hui, une partie des objets rapportés est exposée au musée ethnographique de la ville.Après l’expédition, Hercule Florence revient à Porto Feliz. En janvier 1830, il épouse Maria Angelica, la fille du notable, Francisco Alvares Machado e Vasconcellos, futur gouverneur du Rio Grande do Sul. Machado possède une plantation de café à Sao Carlos (aujourd’hui Campinas), une petite ville de 6000 habitants. Le jeune couple s’y installe. Les inventions multiples pour alléger le travail des esclaves rendent les méthodes d’Hercule Florence très impopulaires dans la communauté des planteurs de la région, dont il fait partie en tant qu’héritier de la plantation de son beau-père. Trois ans après le décès de Maria Angelica, Hercule fonde une école à Campinas en 1863, avec sa seconde épouse Carolina Krug. Ce Colégio Florence est destiné aux filles. Il y enseigne des méthodes expérimentales de dessin comme l’emploi de l’huile de ricin dans la peinture à l’huile appelée cellographie, l’aquarellographie, la peinture solaire…
Un « aquarelliste » d’arrière-plans célestes, au service de ses confrèresLes dessins d’Hercule Florence les plus reproduits sont ceux de l’expédition : des spécimens de la flore et de la faune, des paysages de rivières et leurs rapides, des forêts, les coutumes des indiens Apiacas observés en 1828. Moins connues, sont les images des activités rurales (l’élevage bovin, les cultures sur brûlis, les champs de café ou de canne à sucre) et du travail de transformation des produits agricoles. Elles datent de son installation à Campinas.
Curieux de tout, dès 1830, Hercule Florence est intrigué par le rayonnement solaire et ses effets. Après avoir constaté que le soleil efface les couleurs des tissus, il reconstitue la chambre noire de Léonard de Vinci. En 1832, il réalise des ‘‘Tableaux Transparents de jour’’ issus de la projection concentrée des raies de soleil sur du papier recouvert de nitrate d’argent. A la lueur de la bougie, dans l’obscurité, des ombres de nuages sont visibles.
Son intérêt pour la nature et la qualité de la lumière le pousse à se pencher sur la couleur du ciel, la forme et la genèse des nuages. Il découvre tout du sujet puisqu’il semble n’avoir entendu parler « que d’un homme très instruit, qu’un artiste allemand [qui] s’occupait principalement des ciels dans des paysages ». Est-ce une allusion à Goethe et son Traité des couleurs ? En tout cas, Hercule Florence tente de comprendre les ciels et leurs nuages par le dessin. Une méthode largement partagée à l’époque. En effet, de très nombreuses peintures de ciels ont été réalisées de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle. Les artistes les plus connus sont : Caspar Friedrich, Alexandre Cozens, Corneille Cels, et bien sûr Luke Howard et John Constable. Les dessins d’Hercule Florence répondent à une curiosité scientifique très similaire. Mais, son originalité vient du fait qu’il n’habite pas les moyennes latitudes d’Europe mais le Brésil à la latitude du tropique du Capricorne. Cela fait de lui le pionnier de l’étude des nuages aux basses latitudes australes. Et il en est bien conscient puisqu’il écrit : « On pourra dire que ces études ayant été faites sous le tropique du Capricorne, ne peuvent servir que pour les peintres qui habitent les régions intertropicales, parce que les ciels de la zone torride sont différents des ciels des contrées tempérées. »
Les ciels qu’il observe lui inspirent un Atlas pittoresque des ciels à l’usage des jeunes paysagistes. Cet ensemble comprend 22 aquarelles. Une sorte de catalogue, qui s’adresse en priorité aux peintres afin qu’ils représentent des arrière-plans vraisemblables (saison, heure du jour) dans leurs tableaux. Chaque ciel est en principe numéroté, daté et décrit plus ou moins minutieusement. Le descriptif prend souvent le point de vue critique d’un utilisateur potentiel artiste-peintre.
On y retrouve des archétypes de ciels plus ou moins nuageux des deux grandes saisons du climat de la région de l’état de Sao Paulo. A la latitude du tropique, la température n’est pas le facteur discriminant de la périodisation. C’est au contraire, la fréquence et l’abondance des pluies déversées par les nuages (près d’1,5 m/an en moyenne) qui divisent le cycle annuel.
La période la plus nuageuse et pluvieuse débute en octobre par des ondées et dure jusqu’à fin mars. En décembre-janvier, le ciel est couvert 90 % du temps. De grosses masses de nuages à fort développement vertical, très noirs et menaçants (22 janvier 1833) se déplacent rapidement. Ils font dégringoler des pluies très drues un jour sur deux (16 décembre 1832) parfois accompagnées d’éclairs et de tonnerre. En février et surtout mars, l’atmosphère est plus calme et engendre des nuages bourgeonnants contigus. Ils montent, près du sol, dans l’air « équatorial amazonien » surchargé d’humidité et apportent des ondées en fin d’après-midi (9 mars 1835).
22 janvier 1833, 4 h du soir. © Hercule Florence. Instituto Moreira Salles

16 décembre 1832 © Hercule Florence. Instituto Moreira Salles
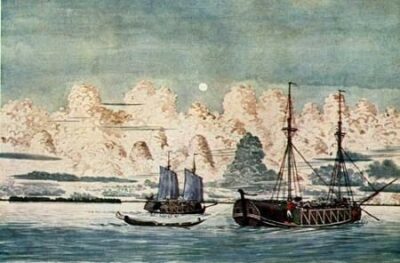
9 mars 1835 © Hercule Florence. Instituto Moreira Salles
A l’opposé dans l’année, pendant la saison relativement sèche (avril-septembre), les ciels sont plus dégagés. C’est le cas un jour sur deux, en juillet-août-septembre. Pourtant, il n’y a aucun « grand bleu » dans l’atlas d’Hercule Florence. Le peintre est trop soucieux du pittoresque. Il cherche à donner aux peintures de la profondeur de champ et des contrastes. Une autre raison peut justifier cette rareté. Campinas est à près de 700 mètres d’altitude et l’air maritime atlantique de l’alizé s‘élève sur les contreforts de la Serra do mare. Cette ascendance conduit à la saturation et la condensation. Vers 2000 mètres d’altitude, des altocumulus isolés s’alignent en rues, dans le sens du vent (27 juillet 1832) laissant les rayons du soleil atteindre le sol par des trouées. Parfois, des ciels d’un bleu plus vif et plus vert accompagnent les coulées d’air frais à froid venu de l’Antarctique, via la Patagonie. En haute altitude, de grands cirrus zèbrent alors l’azur (25 avril 1844, 16 octobre 1832). Sous ces ciels d’apparence radieuse, l’air gélif peut brûler les feuilles, les branches et les cerises du caféier, et ainsi mettre en péril la qualité et la quantité de café récolté. Ce qui arrive malheureusement plusieurs fois par siècle.
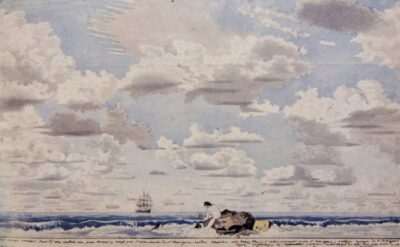
27 juillet 1832, 3 h de l’après midi © Hercule Florence. Instituto Moreira Salles
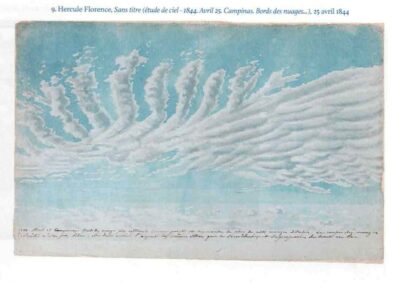
25 avril 1844 © Hercule Florence. Instituto Moreira Salles
L’Atlas est structuré par ordre chronologique ; des commentaires figurent en marge du dessin mais aussi dans un texte descriptif. Quant au travail sur les images, il est inabouti parce que la pensée de l’inventeur est, entre autres, accaparé simultanément par la mise au point d’un papier monnaie inimitable et surtout par la quête d’un appareil, efficace et bon marché, pour reproduire des images et du texte.
Un « artiste », à l’écart de la science météorologiqueCet inventaire de types de ciels brésiliens ne se comprend qu’à la lueur de l’histoire sud-américaine de la science météorologique. Des décennies après l’Europe, l’INEMET (Institut National de Météorologie) est créé en 1909. Il ne gère alors que 74 stations de mesures, un réseau très insuffisant pour un si vaste pays. Les premières publications scientifiques, comme celle de Henrique Morize datent de 1892. Elles permettront des synthèses fondatrices au début du XXe siècle (Climatologie du Brésil, en 1916 et Météorologie du Brésil, en 1917). Hercule Florence ne dispose donc que des connaissances vernaculaires, empiriques, nécessaires aux pratiques de l’agriculture vivrière. Elles sont largement partagées et mises en scène par des « prophètes de la pluie », des anciens souvent illettrés qui prédisent l’arrivée et l’abondance des précipitations de chaque saison pluvieuse. Les productions agricoles d’exportation comme la canne ou le café se calent également sur ce calendrier climatique subtropical à deux saisons. Le peintre fait allusion à cette bipartition annuelle du climat pour les brûlis.
Dans ses descriptifs de nuages, Hercule Florence n’emploie jamais la terminologie en usage aujourd’hui. Il n’en a pas connaissance. Certes, c’est en 1802, lors d’une conférence à l’Askesian Society,que l’Anglais Luke Howard, a proposé sa classification, publiée un an plus tard, sous le titre On the modifications of Clouds and on the Principles of their production, suspension and destruction. Sa typologie de nuages aux noms latins (cumulus, cirrus, stratus) les définit d’après leur physionomie (altitude et forme). Elle a été complétée du nimbostratus en 1830, du stratocumulus en 1841 et du cumulonimbus en 1880, avant d’être officiellement adoptée en 1891 par les services météorologiques internationaux. L’année suivante paraissait le premier atlas des nuages. Dans l’ignorance de ce vocabulaire, Hercule Florence utilise un langage populaire, très descriptif comme la classification oubliée de Lamarck. Les mêmes images y sont utilisées pour caractériser les formes des nuées. Les termes : pommelé (1 sept 1832, 28 octobre 1832, 5 novembre 1832, 22 janvier 1833, 1er janvier 1833), cotonné (5 novembre 1832, 27 juillet 1832), arrondi, moelleux, etc. s’appliquent aux nuages cumuliformes. Le caractère échevelé (27 juillet 1832), arqué, strié, en filet léger (28 octobre 1832) est le propre des cirriformes. Quant au nuage fondu sur ses bords, ce ne peut être qu’un stratus (5 novembre 1932, 28 octobre 1832). Comme l’artiste privilégie les heures du levant ou du couchant, les teintes des nuages du blanc pur au noir sont modifiées par les reflets, jaunes, rouges, orangés, voire pourpre, des rayons du soleil.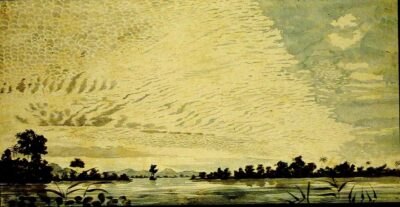
Date effacée, 10 h du matin © Hercule Florence. Instituto Moreira Salles
Hercule Florence décrit aussi leur agencement linéaire (horizontal, oblique, vertical par rapport à l’horizon), en grille ou quadrillage (16 octobre 1832), en pyramide inversée (19 septembre 1832) etc. Par deux fois, des rideaux de pluies drues apparaissent à l’horizon comme le 16 décembre 1832. Les effets des nuages chauds des brûlis sont aussi observables dans les très basses couches de l’air ainsi que la mise en suspension de cendres. Tel est le cas le 28 octobre 1832, qu’il décrit ainsi : « l’horizon est rempli de la fumée d’une grande partie des feux qu’en ce pays et dans cette saison, on allume pour brûler de grands abattis que l’on fait dans les bois pour semer des grains ». Depuis 2017, la nomenclature internationale intègre une nouvelle classe pour ces nuages d’origine le plus souvent humaine : les pyrocumulus ou cumulus flammagenitus.
Modestement, Hercule Florence met l’accent sur des ciels « mal exécutés », sur « l’insuffisance de ses esquisses », à cause en partie des « difficultés du lavis, et le mauvais papier, [qui] m’ont empêché de faire mieux ». Compte tenu de son objectif artistique, il suggère des premiers plans pour accompagner ces ciels. Pour celui du 28 octobre 1832, il écrit : « ce ciel me paraît convenir à une vue de cascade, où la blancheur de beaucoup d’eaux écumantes serait rehaussée par le sombre de l’horizon ». Le 27 juillet 1832, il propose, pour améliorer les contrastes de couleur, « un ciel d’invention » en redoublant « les masses obscures à volonté ». Et, le 9 mars 1835, il juxtapose au ciel, un « accessoire, une vue de l’Amazone, dans la Guyane portugaise ». Plus que la réalité d’un ciel d’une journée donnée, c’est la vraisemblance d’un type de temps dans sa saison, qu’il convient de chercher dans ces dessins. Et d’ailleurs, cet inventeur touche à tout n’installe pas de station météorologique dans sa propriété, parce que les données quantitatives ainsi recueillies ne résoudraient aucune de ses préoccupations esthétiques.
Conclusion
Florence conclut même au sujet de son travail sur les ciels : « je prie les connaisseurs de les examiner, et si elles méritent leur approbation, je les recommande à leur zèle pour les arts, afin qu’elles ne restent pas dans l’oubli qui est mon partage, et ce qu’elles auront d’appréciable, sera alors plutôt leur ouvrage que le mien ».A la toute fin de sa vie, en 1879, la traduction en portugais de ses notes sur l’expédition Langsdorff est enfin publiée. Elle va lui valoir d’intégrer l’Académie des sciences à Rio. Par contre, ses découvertes dans le domaine de la photographie ne sont reconnues que plus timidement. Son inventivité multiforme est résumée par le qualificatif de l’historien Komissarov qui parle de “Léonard de Vinci” du Brésil.
Depuis peu, Hercule Florence connaît un début de reconnaissance posthume en tant que dessinateur. Et en effet, ses ciels n’ont rien à envier à ceux de Constable, ses dessins naturalistes à ceux de Bernard Germain de Lacépède, ses planches de travailleurs à celles de Louis-Jacques Goussier qui œuvra pour les Encyclopédistes…Illustrations :
Toutes les images sont reproduites avec l’aimable autorisation de Julia Kovensky, Coordenadora de Iconografia, Instituto Moreira Salles.
+ 55 21 3284 7432
www.ims.com.brBibliographie :
Beaud Marie-Claire et al., 2017, Hercule Florence. Le Nouveau Robinson, éditions du Nouveau Musée National de Monaco, 381 p.
Carelli Mario, 1992, A la découverte de l’Amazonie. Les carnets du naturaliste Hercule Florence, Découverte Gallimard, 144 p.
Dubreuil Vincent, Fante K., Planchon O., Sant’Anna Neto J., 2019, Climate change evidence in Brazil from Köppen’s climate annual types frequency, International Journal of Climatology, 39 (3), pp.1446-1456.
Florence Hercule. L’ami des arts livré à lui-même ou Recherches et découvertes sur différents sujets nouveaux, 1837-1859. Manuscrito, Tinta ferrogálica sobre papel, 30,0 x 20,0 cm (fechado). Coleção Instituto Hercule Florence (São Paulo).
Florence Leila (org.), 2010, Céus. O teatro pitoresco-celeste de Hercule Florence. São Paulo, Florescer Produções Culturais – Coleção Cyrillo Hércules Florence.
Jefferson Mark, 1924, New Rainfall Maps of Brazil , Geographical Review, Vol. 14, No.1, pp. 127-135.
Komissarov, Boris N. 2010. “Langsdorff: Com o Brasil, para Sempre.” In Expedição Langsdorff [catálogo da exposição], 14-35. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil. [https:]]
Luret William, 2001, Les trois vies d’Hercule Florence, éditions Jean-Claude Lattès, 305 p.Mendonça Francisco, 2012, La connaissance du climat au Brésil : entre le vernaculaire et le scientifique Confins, numéro 15/7610.
Monbeig Pierre, 1952, Pionniers et planteurs de Sâo Paulo, A. Colin, 376 p.
Morize Henrique, 1889. Esboço da climatologia do Brasil. Observatorio Astronômico, Rio de Janeiro, 47 p.
Papy Louis, 1954, Au pays des plantations caféières de Sâo Paulo, avec M. Pierre Monbeig, Les Cahiers d’Outre-mer, 7-26, pp. 195-203.
Planchon Olivier, 2003, Transition entre climats tropicaux et tempérés en Amérique du sud : essai de régionalisation climatique, Les Cahiers d’Outre-mer, 223, pp. 259-280.Martine Tabeaud, novembre 2023
-
 14:52
14:52 Aux îles
sur Les cafés géographiques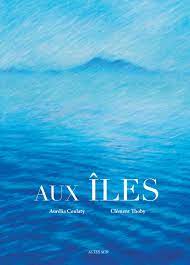
Aurélia Coulaty, Clément Thoby, Aux îles, Actes Sud, 2023
Le goût du voyage géographique peut être suscité par un guide, un documentaire, un ouvrage spécialisé mais aussi par un « beau livre ». Les amoureux des îles pourront choisir leur destination après avoir lu l’album écrit par Aurélia Coulaty et illustré par Clément Thoby, Aux Îles (1). L’auteure, écrivaine et artiste polyvalente, a approfondi sa passion du voyage et de l’« ailleurs » en consacrant son master de lettres modernes à Nicolas Bouvier (2). Dans Aux Îles, elle entrelace informations géographiques (sur l’environnement particulièrement), récits mythologiques, références littéraires et impressions subjectives.
Ouvrir le livre donne un premier plaisir sensuel : contempler des dessins aux couleurs saturées et aux traits de crayon rapides tout en caressant un papier épais et satiné. Toutes les îles trouvent leur place. De petites îles comme Socotra, au large du Yémen, à la biodiversité exceptionnelle ou Ouessant, vigie sur l’océan Atlantique. De grandes îles comme l’Irlande, façonnée par des vagues successives d’occupants mais qui ne fut pas romanisée. Une île-continent, l’Australie. Les archipels sont aussi nombreux : les Galapagos offrent leurs 200 000 km2 de réserve naturelle maritime alors que les Kerguelen, dans les TAAF (3), abritent la recherche des météorologues, vulcanologues, biologistes…sous la protection de la Marine nationale. Les îles de lacs et de lagunes ne sont pas non plus oubliées (Venise, bien sûr…).
Les îles ne sont pas regroupées selon un critère géographique. La localisation des îles des contes et légendes, telle l’Atlantide, serait hasardeuse. Tout aussi difficiles à situer sur une carte les îles nées de l’imaginaire littéraire de deux Britanniques, Nulle part (Utopia de Thomas More (4) et Le pays du Jamais (Neverland de J. M. Barrie) (5). D’autres îles sont regroupées selon la fonction que les hommes leur attribuèrent, qu’il s’agisse d’abriter des bagnards (Nouvelle-Calédonie, Sakhaline…), de garder de grands prisonniers (Napoléon à Sainte-Hélène…) ou de fournir des repaires aux pirates (Cocos et La Tortue).
Voici donc une occasion de faire un beau tour du monde en 86 pages.
Notes :
(1) Aurélia COULATY, Clément THOBY, Aux Îles, Actes Sud, 2023
(2) Nicolas BOUVIER est un écrivain, voyageur, photographe suisse, considéré comme un maître de la littérature de voyage. Son ouvrage L’Usage du monde (1963) est aujourd’hui une référence reconnue dans le monde universitaire.
(3) TAAF : Terres antarctiques et australes françaises
(4) L’Utopie ou Le Traité de la meilleure forme de gouvernement a été écrit par Thomas More en 1516.
(5) J. M. BARRIE est le créateur du personnage de Peter Pan qui vit dans un lieu imaginaire, Neverland. Le roman, Peter et Wendy, a été publié en 1911.Michèle Vignaux, novembre 2023
-
 12:54
12:54 Aménager le territoire en France : la question du logement (Philippe Mazenc, 14 octobre 2023)
sur Les cafés géographiques
Philippe Mazenc (cliché de Denis Wolff)
Invité des Cafés géo, Philippe Mazenc a un parcours original. Elève à Sciences-po Bordeaux, il passe le concours des Affaires maritimes et devient administrateur des Affaires maritimes, corps d’officiers de la Marine nationale. Puis il quitte ce corps et part dans la fonction publique civile, d’abord à la direction du Budget, puis au Secrétariat général du ministère de l’Ecologie, puis à la sous-direction de la Législation de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages, et fait partie de ceux qui mettent en place la loi ALUR (2014). Il travaille ensuite à la préfecture de l’Ile-de-France puis à celle de Bretagne. Après y avoir passé quelques années, il devient directeur de cabinet adjoint de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires puis, depuis quelques mois, il est directeur général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature. Il est donc fort bien placé pour exposer les principaux aspects de la question du logement en France.
1. Situation du logement en France.Le ministère est chapeauté par Christophe Béchu. Autour de lui, il y a plusieurs ministères délégués et secrétariats d’Etat. Naturellement, celui qui concerne en premier lieu Philippe Mazenc est le ministère délégué au Logement, Patrice Vergriete. Il y a aussi la ministre déléguée aux Collectivités territoriales et à la Ruralité (Dominique Faure) qui est sous la double tutelle de Christophe Béchu et Gérald Darmanin, le ministre délégué aux Transports (Clément Beaune) et la secrétaire d’Etat à la Ville (Sabrina Agresti-Roubache). Le premier patron de Philippe Mazenc est Christophe Béchu ; il dépend aussi de Patrice Vergriete, ainsi que de Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat à la Biodiversité. Il est également à la disposition de deux autres ministres : Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique et Hervé Berville, secrétaire d’Etat à la mer. Cela plante le décor. Philippe Mazenc dépend de sept ministères, sept cabinets, quarante conseillers, pas toujours coordonnés !!!
Quelques chiffres donnent une idée, un ordre de grandeur des problèmes. La politique du logement coûte environ 43 milliards d’euros par an. L’hébergement d’urgence généraliste offre 203 000 places tous les soirs. Il faut compter en plus 100 000 places dans le dispositif général d’asile (DNA) géré par le ministère de l’Intérieur. Tous les soirs en France, il y a donc 300 000 personnes hébergées au titre d’un de ces dispositifs. Il y a enfin le logement social. Mais, malgré les aides publiques sur le logement, les bailleurs sociaux sont des entreprises qui ont besoin de solvabilité. Un choix s’opère à l’entrée dans le logement social (des commissions d’attribution des logements). L’attente moyenne serait de douze ans en Ile-de-France, mais si l’on est fonctionnaire ou que l’on a un CDI, c’est beaucoup moins ; en revanche, si l’on n’a qu’un CDD et/ou que l’on sort d’un hébergement d’urgence…
En 2021, on avait en France un peu plus de 37 millions de logements ordinaires dont 56 % de logements individuels, 82 % de résidences principales (en légère baisse), 10 % de résidences secondaires (en légère hausse), 8 % de logements vacants (soit plus de 3 millions). 1,6 million de personnes logent en logement non ordinaire (logement social, CROUS…). Contrairement aux pays du Nord, la maison individuelle, le fait d’être propriétaire, est un fait marquant en France : 58 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale, 25 % sont locataires dans le parc privé et 18 % locataires dans le parc social (ce qui est relativement important). Il est très difficile de faire des comparaisons internationales sur le logement social car il ne dépend pas toujours de l’Etat et les définitions du logement social varient d’un pays à l’autre.
19 % des ménages déclarent souffrir du froid pendant l’hiver, 10 % sont confrontés au surpeuplement et 9 % ne disposent pas de logement personnel (partage du logement). Les pouvoirs publics ont la volonté de réduire le nombre de personnes à la rue : ainsi, ces dernières années, le nombre de places en hébergement d’urgence dit « généraliste » a sensiblement augmenté (154 000 places en 2019, 203 000 aujourd’hui). Dans ce type d’hébergement, 52 % des personnes sont en situation irrégulière (absence de titre de séjour) ; le plus souvent, elles ne peuvent pas entrer dans le dispositif national d’asile (la plupart des demandes sont rejetées). Ce chiffre est en hausse et va continuer à croître.
Il est souvent argué qu’il faudrait construire 500 000 logements neufs par an, dont 150 000 logements sociaux. En fait, personne n’en sait rien car il est difficile de mesurer le besoin en logements. Cela supposerait des études territorialisées actuellement non réalisées. En 2023, on va péniblement construire 90 000 logements sociaux ; depuis un an et demi, la réduction des constructions est particulièrement forte dans les zones tendues.
Plusieurs programmes aident les particuliers et la collectivité. Les APL (aides personnelles au logement) et les AL (aides au logement) représentent le plus important : 13,3 milliards d’euros avec peu de marges de manœuvre car il s’agit d’une dépense de guichet pour aider les particuliers. Le programme Eau et biodiversité est en nette augmentation : 274,5 millions d’euros cette année et on espère 414 millions d’euros l’an prochain. Pour l’eau, il s’agit surtout des agences de l’eau : l’eau ne vient jamais du robinet (elle vient d’un fleuve, d’une nappe phréatique, de l’eau de surface… Pour Paris, voir ici). Cela représente environ 2,3 milliards d’euros. Il y a aussi le Fonds vert, lancé en 2022, doté de 2 milliards d’euros en 2023 (en 2024 augmentation prévue de 500 millions d’euros qui serviront à la rénovation des écoles) et déconcentré (géré par les préfets), et le programme Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat doté de 800 millions d’euros. Enfin, les bailleurs sociaux sont soumis à une contribution qui alimente le FNAP (Fonds national des aides à la pierre) et qui représente 400 millions d’euros.
Philippe Mazenc présente ensuite quelques documents. Le premier, sur l’exode urbain après le Covid, remet en cause certaines idées reçues (par exemple : beaucoup de Parisiens ont acheté une maison sur le golfe du Morbihan). La migration de Paris vers la province s’est un peu accélérée mais n’est pas considérable, les déménagements se sont surtout faits de grande ville à grande ville et on continue à avoir une extension de la périurbanisation. Le second est le fruit d’un partenariat du ministère avec l’IGN (Institut géographique national) ; il porte notamment sur l’artificialisation des sols
2. La transition écologique.Il convient d’abord de mesurer la hauteur du mur devant nous. Les bâtiments représentent en France environ 17 % des émissions de gaz à effet de serre. Il y a quelques années, dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), on avait voté un premier budget carbone : entre 2015 et 2018, on devait réduire les émissions. En fait elles ont augmenté de 11 % entre ces deux dates. Le Green Deal (= Pacte vert) a été lancé par la Commission européenne en 2020 ; sa déclinaison en France s’est traduite par est la création du secrétariat général à la Planification Ecologique (SGPE), service du Premier Ministre dirigé par Antoine Pellion ; il a pour but de coordonner les efforts de toutes les administrations de l’Etat, en particulier pour réduire l’émission de gaz à effet de serre. C’est ce secrétariat qui, après une large concertation, fixe des objectifs de réduction. Dans le secteur du bâtiment, l’objectif est de réduire de 61 % les émissions de gaz à effet de serre en 2030, par rapport aux émissions de 2019 (il faut réduire les émissions de ces gaz pas uniquement dans la construction, mais de la conception au recyclage). C’est un chantier énorme, et qui va encore être renforcé, car on sait que des directives européennes vont sortir, notamment sur la performance énergétique des bâtiments. On travaille beaucoup avec la direction des Affaires européennes et internationales (DAEI). Cela dit, il n’est pas certain qu’après les élections européennes de juin 2024, la nouvelle majorité au sein du Parlement européen soit aussi favorable à la transition écologique que la majorité actuelle : les élections européennes auront des conséquences considérables sur notre vie quotidienne en France car on est sur des directives européennes et des financements européens sur la transition écologique.
Voyons maintenant les enjeux. Compte tenu des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols (la loi Climat et résilience de 2021 fixe un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols en France à l’horizon 2050) et des projections démographiques, on estime aujourd’hui que 80 % de la ville de 2050 est déjà construite. L’enjeu est donc au moins autant sur la rénovation que sur la construction neuve. Or la rénovation coûte aussi cher (voire plus cher) que la construction et est souvent plus compliquée. L’enjeu est la massification de la rénovation énergétique. Or le secteur du bâtiment non résidentiel est essentiellement composé de toutes petites entreprises qui ne sont pas en mesure d’effectuer une rénovation globale. D’une manière plus générale, changer une chaudière n’est guère compliqué ; faire une rénovation globale d’un logement l’est beaucoup plus.
Les dispositifs d’aide sont nombreux, à commencer par MaPrimeRénov’ qui représente 6 milliards d’euros cette année, 4 milliards en 2024. Les gens se demandent parfois pourquoi l’Etat finance la rénovation des chaudières. Il faut certes favoriser la rénovation globale, mais on ne peut se passer de la simple rénovation. On essaie donc de réduire le reste à charge, notamment pour les personnes modestes. Le but est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. L’éco-PTZ (éco-prêt à taux zéro) est un dispositif pour la rénovation des logements : c’est un crédit d’impôts qui peut couvrir jusqu’à 30 % du coût de la rénovation pour les petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, on estime que, pour la rénovation des logements sociaux, il faudrait entre 4 et 9 milliards d’euros par an (si on veut réduire de 60 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030). Pour cela, l’Etat apporte 400 millions (c’est certes une somme, mais est-elle à la hauteur de l’enjeu ?). Enfin, on applique la norme RE 2020 (RE = Réglementation environnementale) pour la construction et la rénovation des bâtiments. Elle augmente le coût de construction de 3 à 4 %, et va augmenter avec la mise en œuvre de toutes les mesures pour atteindre 10 % dans quelques années. Cela s’explique par l’usage de meilleurs matériaux, par l’isolation et, de manière générale, par la performance énergétique. Philippe Mazenc est sensible au problème des surcoûts mais rappelle que ceux-ci doivent se mesurer par rapport à la totalité du cycle de vie du bâtiment… ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Et a-t-on vraiment le choix en matière de transition écologique ?
3. Une approche transversale.L’écueil serait d’examiner les enjeux et la politique du logement, d’hébergement et d’aménagement au travers du seul prisme de la transition écologique. La clé est d’avoir cette approche transversale. Le SGPE (secrétariat général à la Planification écologique) a d’ailleurs adopté cette approche transversale. La transition écologique ne doit pas être vécue comme seulement descendante et uniquement axée sur la réduction des gaz à effet de serre. Des réunions vont être organisées sous l’égide des Présidents de conseils régionaux et des préfets de région : ces sortes de COP (comme la COP 21) vont être organisées dans les treize régions métropolitaines d’ici la fin de l’année. Cela paraît ambitieux. L’idée est d’abord de poser un diagnostic puis d’avoir des plans régionaux de planification écologique d’ici à l’été 2024. Les COP vont avoir une approche transversale : cela ne concernera pas que le bâtiment mais aussi les transports, les universités… On devrait aborder des sujets très importants : diminution très forte des constructions, augmentation des taux pour les particuliers, mais aussi pour les constructeurs, et notamment pour les bailleurs sociaux. En effet, le logement social est en partie financé par des prêts bonifiés de la Caisse des dépôts, fonds qui proviennent essentiellement de la collecte du livret A. Or, si les épargnants apprécient l’augmentation du taux d’intérêt de ce livret, celle-ci provoque aussi une augmentation du coût à la construction pour les bailleurs sociaux.
Par ailleurs, il faut s’interroger sur les effets des résidences secondaires et de la location saisonnière, surtout dans les zones très tendues où il y a un vrai problème d’accès à la résidence principale. On est dans la transversalité car cela pose le problème de l’accès au foncier et de l’accès au logement. Des groupes de travail ont été lancés pour lutter contre l’attrition des logements en zone touristique. Il y aura sans doute une proposition de loi d’une députée du Finistère et d’un de l’Eure à ce sujet. C’est un phénomène qu’on a du mal à quantifier. Les logements meublés non professionnels (LMNP) sont imposés à différents taux, mais meilleurs que la location nue. Il faudrait harmoniser les taux d’imposition (mais les parlementaires ont du mal à trouver un point d’accord) : est-il normal qu’on bénéficie d’un abattement fiscal plus important quand on vit en zone touristique qu’au centre de Paris ?). Cela dit, il faut nuancer. Dans le Finistère, la majorité des résidences secondaires sont le fait de mutations ou d’achats infrarégionaux, voire infra-départementaux : plus de 50 % des résidences secondaires appartiennent à des gens qui habitent soit dans le Finistère, soit en Bretagne. Le mantra consistant à dire : ce sont de riches Parisiens qui achètent leurs résidences sur le golfe du Morbihan est faux ! Cela dit, ça ne résout pas le problème…
Philippe Mazenc rappelle qu’il a été recruté au cabinet de Christophe Béchu pour s’occuper de la décentralisation des politiques du logement. Il y a eu une évolution entre 2012 et 2023. En 2012, il y avait à l’Assemblée nationale des députés-maires, présidents des offices publics de l’habitat, donc au fait des problèmes liés à l’habitat. Or, avec la fin du cumul des mandats, les députés ne sont en général plus spécialistes du logement. Et la question du logement est devenue complexe en raison de la réglementation et notamment du grand nombre de lois : code de la construction, code de l’action sociale et des familles, loi de 1989, loi de 1965 sur la copropriété privée… Sans prendre position sur la réforme de la fin de cumul des mandats, Philippe Mazenc estime que n’avoir que peu de spécialistes au Parlement pose problème. Aujourd’hui, on a une réglementation nationale avec un zonage de tout le territoire en A, A bis, B1, B2 ou C : un décret va dire que Plogoff, dans le Finistère, est en zone C, que Rennes est en B1 … Ce zonage détermine l’éventuel encadrement des loyers, les aides et la fiscalité : on a ainsi le droit de faire du Pinel (= dispositif d’investissement locatif : réduction d’impôt sur le prix d’achat d’un logement mis en location) ou du logement locatif intermédiaire en A ou en B1 mais pas en B2 ou en C. Tout cela est décidé depuis Paris… L’idée est de faire sauter ces zonages et de responsabiliser les collectivités en fixant seulement quelques critères objectifs de tension. Les maires sont très mobilisés sur cette question, mais il n’existe pas à ce jour de consensus interministériel.
Par ailleurs, on subit les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation. Quel est aujourd’hui l’intérêt pour un maire d’avoir de nouveaux habitants ? Cela induit des coûts : services supplémentaires : crèches, écoles, transports, réseaux d’assainissement… Comment fait-on pour inciter les maires à accueillir de nouveaux habitants ? La fiscalité locale serait à repenser pour inciter les maires à construire de nouveaux logements.
Aujourd’hui, l’Etat intériorise toutes les contraintes sur le logement. Il est souvent très critiqué, mais que peut-il faire ? De plus, un certain nombre de maires ne font pas grand-chose pour construire des logements. D’ailleurs, les collectivités comme les associations d’élus ne demandent pas aujourd’hui de nouvelles mesures de décentralisation… sauf pour récupérer l’argent de MaPrimeRénov’ (4 milliards d’euros) et pour bénéficier des aides à la pierre (800 millions d’euros). Or ce n’est pas de la décentralisation ! Aujourd’hui le préfet dispose d’un contingent-Etat de 25 % des attributions de logements sociaux ; un ménage sur quatre présenté en commission d’affectation de logement chez un bailleur social se voit attribuer un logement par le préfet. Il s’agit de ménages fragiles, par exemple des DALO (= Droit au logement opposable). Si on est reconnu ménage prioritaire au titre du DALO, l’Etat a six mois pour vous proposer un logement ; sinon, on peut faire un recours contre l’Etat qui est alors condamné à payer des astreintes qu’il verse à un fonds appelé AVDL (Accès vers et dans le logement), qui sert à reloger les ménages. L’Etat fait très attention dans les zones tendues, notamment en Ile-de-France. En Bretagne, alors qu’il y a pourtant des enjeux, il a abandonné cette prérogative depuis longtemps aux bailleurs sociaux. Derrière tous ces problèmes, il y a une question de responsabilisation de tous les échelons de collectivités et de l’Etat.
Le débat est très complexe. Aujourd’hui, il y a un enjeu autour de la mixité sociale dans les quartiers. Cela fait partie de réflexions en vue de futures dispositions législatives. Il y a quelques années, un certain nombre de décrets ont été pris contre l’avis du gouvernement notamment sur les résidences à enjeu de mixité sociale, où un bailleur peut s’opposer à l’entrée de telle ou telle famille. Ce sont des sujets hypersensibles. Il y a une proposition de loi déjà citée sur l’attrition des logements en zone touristique, il va y avoir un projet de loi sur les copropriétés dégradées. On ne peut pas dire qu’il y ait un manque de financement de l’Etat dans les quartiers où s’exerce la politique de la ville (cf. chiffres de l’ANRU, Agence nationale pour la rénovation urbaine). Face aux copropriétés dégradées, l’Etat met en place des prêts bancaires à taux zéro mais il est difficile de financer une copropriété dont les ménages sont très peu solvables. Peut-on monter des prêts collectifs ? Peut-on renforcer des dispositions sur les expropriations et les préemptions, notamment dans les parties communes ? Un projet de loi devrait sortir à l’automne. Enfin, Philippe Mazenc espère que le projet de loi sur la décentralisation sortira au premier semestre 2024.
Il y a quand même eu beaucoup de réalisations. L’objectif est de décentraliser et de déconcentrer beaucoup plus. On a mis en place depuis deux ans le fonds vert (2 milliards d’euros jusqu’à cette année et on va passer à 2,5 l’an prochain). En matière de décentralisation et de déconcentration, la clé est l’approche globale. Et il faut surtout être proche du terrain.
4. Questions.Question. On parle de transition énergétique punitive. De quoi s’agit-il ? Il faut faire cette transition énergétique mais on recule souvent la mise en application des mesures prises.
Réponse. Philippe Mazenc acquiesce à ce dernier point. Il ne sait pas ce qu’est la transition écologique punitive. Il était la veille à Lorient, à l’Assemblée générale de l’Association nationale des élus du littoral (ANEL). On y a abordé de nombreux sujets dont un qui va encore mobiliser les réflexions : la gestion du trait de côte (pouvoir étatique). On ne va pas décréter la fin de la montée du niveau de l’eau et de l’érosion ! Et l’Etat ne pourra pas indemniser tous les propriétaires. Par ailleurs, selon le ZAN, voté dans la loi Climat et Résilience de 2021, d’ici à 2031, il faudra consommer deux fois moins d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la période entre 2011 et 2021 (grosso modo, on a consommé 244 000 hectares pendant cette période). Cela dit, face à la fronde des maires, une dernière loi, votée en 2023, prévoit des concessions. Selon Laurent Wauquiez, il s’agit d’écologie punitive ; donc il voudrait retirer « sa » région Auvergne-Rhône-Alpes du ZAN. Mais il ne peut naturellement pas sortir d’une disposition législative.Question. Dans l’habitat collectif privé (les copropriétés), les DPE (diagnostics de performance énergétique) apparaissent comme compliqués et, quand on veut faire des travaux, c’est très long (exemple : sept ou huit ans pour changer le chauffage !) en raison d’une réglementation très rigide. Est-il envisagé de faire quelque chose afin que les travaux puissent être réalisés plus rapidement ?
Réponse. Dans le cas d’un DPE, il faut considérer la nature des murs et pas uniquement le chauffage… Et il y a le problème des règles de majorité en copropriété qui font perdre un temps fou. Au ministère du Logement, on voudrait régler ces problèmes collectifs, notamment en abaissant les seuils de majorité et peut-être en en diminuant le nombre ; mais le ministère de la Justice est extrêmement attentif au droit de propriété ainsi que la section du Conseil d’Etat qui s’occupe de ces questions.Question. Quelle part représente l’habitat collectif privé ?
Réponse. C’est la part la plus importante, surtout en zone urbaine. Il y a un vrai sujet sur les copropriétés, notamment sur la rénovation énergétique. Philippe Mazenc est favorable aux pompes à chaleur (PAC), mais on n’en mettra jamais une à Paris en raison des nuisances sonores ! Dans certaines villes, il y a un réseau de chaleur urbain (RCU, communément appelé chauffage urbain) ; ce serait à développer mais on ne peut pas en mettre partout. Ainsi, à Lamballe où l’une des plus grandes coopératives de Bretagne, la Cooperl, a monté une usine de méthanisation qui alimente le réseau de chauffage urbain de la ville qui se chauffe donc à la fiente de porc. La géothermie a fait beaucoup de progrès mais on ne peut pas en profiter partout ; il y a derrière un problème de gestion d’eau.Question. Y a-t-il une réflexion sur la récupération des eaux de pluie ?
Réponse. Oui, il y a une réflexion mais débouchera-t-elle ? Aujourd’hui, un préfet n’a pas la possibilité règlementaire de s’opposer à un lotissement qui ne serait pas raccordé à un réseau d’eau, car le code de l’urbanisme actuel ne le permet pas . Aujourd’hui, même si on doit étendre un réseau d’eau, ce n’est pas un motif de refus du PLU (Plan local d’urbanisme) ou d’un permis de construire. Par ailleurs, on mesure mal les effets de la récupération de l’eau de pluie sur les nappes phréatiques et le cycle de l’eau, si elle était pratiquée à haute dose. Enfin, il faut aussi considérer la réutilisation des eaux usées. La responsabilité politique est du ressort du ministère de l’Ecologie… sauf que, si le ministère de l’Ecologie est responsable de l’eau sortant des stations d’épuration, il ne l’est pas de la réglementation dans le bâtiment, de la réutilisation dans l’alimentaire… Dès qu’on parle d’agro-alimentaire, cela relève du ministère de l’Agriculture. Le ministère de l’Ecologie a la responsabilité politique autour de cette question de l’eau mais n’a pas le pouvoir règlementaire. Dès qu’on touche au bâtiment, cela relève du ministère de la Santé. Il faudrait pouvoir garantir qu’une eau usée réutilisée ou l’eau de pluie a une qualité absolument identique à une eau « normale », y compris pour un usage non domestique (lavage de surface ou toilettes). Et, sauf à séparer les réseaux d’eau, jamais un bailleur social ne va prendre le risque d’utiliser de l’eau qui ne serait pas complètement conforme, même pour nettoyer les sols ! Si on a une obligation en termes de qualité de l’eau à la sortie, cela signifie qu’on ne réutilisera pas les eaux usées. Il faudrait seulement qu’il y ait une obligation de moyens. Aujourd’hui, on réutilise 1 % de l’eau en France, 7 à 8 % en Espagne et en Italie (réglementation plus souple) et 40 % en Israël.Question sur le mouvement des gilets jaunes.
Réponse. Le mouvement semble autant lié au logement qu’à la mobilité. La poursuite de la périurbanisation est très inquiétante. Elle induit des surcoûts, notamment en matière de transports… Tant que la périurbanisation continuera, on aura ces problèmes de mobilité et de logement. La structuration de la politique urbaine ne produit d’effet qu’à quinze ou vingt ans. Le problème de l’accès au logement pour les jeunes a pris beaucoup d’importance depuis deux ou trois ans. On a eu une conjonction de facteurs qui n’aident pas : augmentation du coût et manque de disponibilité du foncier, augmentation des taux, pouvoir d’achat qui n’a pas suivi l’inflation…Question. Le conseil régional d’Ile-de-France parlait de construire la ville sur la ville, ce qui pose la question de la hauteur des bâtiments. Quelle est la réflexion à ce sujet ?
Réponse. Si on souhaite une non-artificialisation des sols, il faut construire la ville sur la ville. C’est l’objectif, mais il n’est pas entre les mains de l’Etat car ce sont les maires qui délivrent les permis de construire. Or les maires n’ont pas d’incitation financière (ils ne perçoivent plus la taxe d’habitation) et ils ont une opposition sociale à la densification de plus en plus forte. L’Etat ne délivre des permis de construire que dans des cas très rares.Question. Qu’est-il fait pour la revitalisation des centres des villes petites et moyennes et pour freiner l’étalement pavillonnaire ?
Réponse. Pas mal de choses ont été faites, essentiellement pour les petites villes et les moyennes (de moins de 20 000 habitants). Ce sont toujours des opérations mixtes : on subventionne des opérations à la fois pour la revitalisation du commerce et aussi du logement. Il y a aussi des dispositifs fiscaux dans l’ancien : la loi Malraux (pour la réhabilitation) et la loi Denormandie. Il y a aussi des politiques publiques, notamment pour les villes en déprise. Pour les villes un peu plus grandes, tout ne va pas bien : il y a la question des permis de construire délivrés pour des centres commerciaux en périurbain malgré une réglementation qui essayait de les freiner. Aujourd’hui, les centres commerciaux périurbains sont en difficulté et commencent à appeler l’Etat à l’aide ; est-on dans une période de bascule ? Et il y a tout le débat autour de la France moche (cette formulation date de 2010) mais, que faire ?Question. Avec la décentralisation, que peut-on attendre de l’Etat demain ? Quelle sera sa place ?
Réponse. L’Etat, aujourd’hui, porte seul l’ensemble de la contrainte, alors qu’il ne détient pas tous les leviers : il faudrait rapprocher la responsabilité de tous les acteurs. Il faut exclure l’hébergement d’urgence de la décentralisation. A côté, l’Etat a des obligations et des enjeux de solidarité nationale. Ainsi, la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) oblige les communes à disposer de 20 ou 25 % de logements sociaux (article 55) ; il est hors de question que l’Etat se désengage.Question à propos du rejet du fait régional dans les régions fusionnées.
Réponse. Dans une région non fusionnée comme la Bretagne, avec seulement quatre départements, il y a une cohérence régionale et une cohérence de l’Etat régional. Mais qu’en est-il dans le Grand Est ou en région Nouvelle Aquitaine ? Et, paradoxalement, non seulement la réforme n’a pas renforcé le pouvoir des régions mais elle a au contraire considérablement affaibli le pouvoir régional. Sur une région à quatorze départements, où est la cohérence de l’action de l’Etat ? Or 80 % des politiques non régaliennes de l’Etat se situent à l’échelle régionale. Et, si on n’est pas capable s’assurer la coordination à l’intérieur de régions composées de tant de départements, cela pose un grave problème de cohérence de politique de l’Etat.Compte rendu rédigé par Denis Wolff, novembre 2023.
-
 20:20
20:20 Dictionnaire insolite des frontières
sur Les cafés géographiques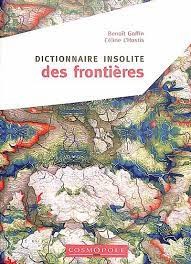
Dans notre monde, pourtant connecté et globalisé, la question des frontières n’a rien perdu de son importance, bien au contraire. « Les frontières non seulement ne s’effacent pas mais connaissent dans plusieurs points du globe un processus de fermeture et de durcissement » (Michel Foucher, Les frontières, CNRS Editions, 2020). Ce petit ouvrage (format de poche, 189 pages) des éditions Cosmopole vient occuper une place originale et remarquable dans l’abondante bibliographie sur le sujet.
Benoît Goffin et Cécile L’Hostis, les deux auteurs, ont réussi le tour de force d’écrire un livre agréable à lire tout en multipliant les points de vue objectifs et subjectifs : données factuelles, analyses historiques et géopolitiques, références littéraires et imaginaires… S’inscrivant dans une collection de « dictionnaires insolites » inaugurée en 2010, cet ouvrage explore le thème des frontières en n’oubliant pas « l’insolite » sous forme d’anecdotes et d’exemples rares qui révèlent des mythes, des rêves, des paradoxes, des histoires surprenantes. Bien sûr, les 173 entrées ne permettent pas l’exhaustivité mais elles aboutissent malgré tout à dresser un tableau riche et souvent passionnant.
Des frontières au sens large
Si les frontières terrestres (continentales et maritimes) occupent une large part du livre, les frontières technologiques, idéologiques, imaginaires, ne sont pas oubliées comment le prouvent les entrées : cyberespace, extraterrestre, extraterritorialité des lois américaines, Google Maps, littérature-monde, lumière, lune, Mur (Game of Thrones) (1), polycentrisme, reconnaissance, religion, sionisme, Tchernobyl, ubuesque…
Développons quelques exemples tirés de ce dictionnaire. Les frontières numériques existent bel et bien, qu’elles soient techniques (les « zones blanches »), technologiques (absence d’accès au réseau pour les populations pauvres) ou politiques (certains Etats cherchent à cloisonner l’accès à l’internet et à contrôler les réseaux). Dans la série Game of Thrones, le Mur aurait été construit dans des temps anciens avec l’aide de Géants pour se protéger des dangers venus du Nord. Cette frontière physique réputée infranchissable révèle sa dimension symbolique au fil de l’intrigue en modifiant la représentation de l’autre et en alimentant des peurs ancestrales. Quant à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (Ukraine, 1986), elle a montré au monde un nouveau danger que les frontières ne peuvent arrêter. D’une façon générale, certains Etats regardent d’un mauvais œil la présence ou la construction de nouvelles centrales nucléaires à proximité de leurs frontières.
La genèse des frontières
La genèse des frontières s’est faite de différentes manières, parfois après de longues négociations, parfois au contraire dans la précipitation. De nombreuses entrées en témoignent : balkanisation, conférence de Berlin, Cachemire, Cour internationale de justice, découpe, ligne Durand, partition des Indes, Traités inégaux, intangibilité, Kurdistan, frontière naturelle, Poutine, Rio Grande, Sykes-Picot, rocher de Vélez de la Gomera…
Qu’en est-il des « frontières naturelles » ? L’expression a été largement utilisée pendant la Révolution française pour justifier des projets expansionnistes. Pour nos deux auteurs, la réponse est claire : une frontière n’est jamais « naturelle », même si des éléments géographiques peuvent appuyer leur délimitation (chaînes de montagnes, lacs…). Pourtant, à titre d’exemple, les fleuves constituent des supports répandus pour définir des frontières. Mais cette délimitation apparemment simple ne l’est pas toujours : ainsi, le cours de la rivière peut changer et poser la question du nouveau tracé de la frontière (problème non tranché entre Croates et Serbes le long du Danube) ; le statut des îles sur la rivière peut être source de conflits (incidents sur le fleuve Amour entre la Russie et la Chine).
Depuis les années 1950, le nombre d’Etats a beaucoup augmenté mais peu de frontières nouvelles ont été tracées, le principe d’intangibilité ayant favorisé la conservation des anciens tracés. Toute reconnaissance risquerait de créer un dangereux précédent et d’attiser les revendications nationalistes d’autres régions. Ainsi, la Russie prend souvent l’exemple du Kosovo pour justifier la possibilité de nouvelles frontières, et donc de nouveaux Etats (Ossétie, Abkhazie…).
Le tracé des frontières témoigne des négociations qui l’ont défini en laissant parfois des territoires enclavés dans le pays voisin. Jusqu’en 2015, la situation la plus complexe du globe se situait entre l’Inde et le Bangladesh où, sur environ 100 kilomètres, les territoires des deux pays s’imbriquaient inextricablement. Un accord récent a permis à de nombreuses enclaves indiennes de devenir bangladaises tandis que des enclaves bangladaises, également nombreuses, devenaient indiennes. D’autres curiosités géographiques existent comme les tripoints (plus de 150 dans le monde) qui sont les lieux où se recoupent les frontières entre trois pays. Un bornage ou une construction peut marquer la symbolique de ces points comme la table triangulaire qui a été installée là où se rejoignent précisément l’Autriche, la Hongrie et la Slovaquie.
Les frontières, révélateurs des enjeux du monde contemporain
Face à la mondialisation triomphante qui prophétisait leur fin, les frontières font un retour en force. « Celles qui étaient autrefois considérées comme des barrières à surmonter pour faire triompher la coopération et le commerce international sont redevenues des zones de conflits potentiels au détriment des principes de libre circulation, de coopération et de solidarité entre les peuples » (…) « Les zones limitrophes, si elles sont des espaces d’échanges privilégiés, restent largement le théâtre de tensions politiques, de conflits et de migrations forcées, qui mettent en évidence les inégalités et les injustices qui persistent dans notre société mondialisée » (Benoît Goffin, Céline L’Hostis, Dictionnaire insolite des frontières, Editions Cosmopole, 2023).
La présence des frontières est une composante importante du rapport de force visant à obtenir l’accès aux ressources de la région concernée. Ainsi, les fleuves traversés par des frontières sont la source de tensions entre les Etats riverains. L’Etat qui se trouve en aval peut contester la consommation, les grands projets de construction de barrages ou la pollution causée par les Etats situés en amont (cas du Tigre et de l’Euphrate ou du Nil).
La littérature pour parler des frontières
Parce que la frontière fait rêver, elle est un thème de prédilection pour les « écrivains voyageurs » comme Nicolas Bouvier (L’usage du monde) ou Ella Maillard (Oasis interdites), mais aussi pour d’autres écrivains (Gracq, Le Clézio, etc.), ceux de la « littérature-monde » et d’autres qu’on ne saurait ranger dans une quelconque catégorie, sinon celle de la littérature. Julien Gracq, écrivain de la frontière par excellence, est joliment présenté dans l’entrée « Syrtes » du dictionnaire. Citons seulement ces quelques lignes : « Le roman de Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes, (…) est entièrement construit autour de la fonction sacrée de la frontière, dont la violation constitue l’action principale ».
Notes :
(1) Game of Thrones : série télévisée américaine de fantaisie médiévale diffusée aux Etats-Unis entre 2011 et 2017. L’histoire de la série, située sur les continents fictifs de Westeros et Essos, entrelace trois grandes intrigues. La première intrigue raconte la menace croissante, avec l’hiver approchant, des créatures légendaires situées au nord du Mur de Westeros.
Daniel Oster, novembre 2023
-
 20:09
20:09 Vietnam et Etats voisins
sur Les cafés géographiques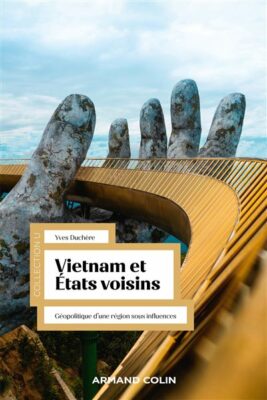
Le titre du dernier ouvrage du géographe Yves Duchère, Vietnam et Etats voisins (1), suscite une première interrogation : quelles sont les limites de l’espace étudié ? Certes, Laos et Cambodge sont l’objet de pages peu nombreuses mais bien documentées, mais quelle place donner au troisième voisin, la Chine ? C’est l’étude des relations millénaires, complexes et ambigües, entre Vietnam et Chine qui constitue le principal intérêt du livre, un livre débordant d’informations, de tableaux, de cartes. Sans doute le plan a-t-il été difficile à construire car les retours sur une même question sont nombreux…ce qui a une efficacité pédagogique.
On peut analyser les divisions de l’espace vietnamien en fonction du relief, de l’ethnologie, de l’histoire, de l’entrée dans la mondialisation…
A un Vietnam continental des hautes terres de l’ouest s’oppose un Vietnam des plaines et du littoral. Le premier (au-dessus de 300 m), faiblement peuplé, a été longtemps le domaine d’ethnies minoritaires (2), nomades vivant dans la forêt, autonomes, accueillant les populations fuyant la volonté hégémonique des Etats des plaines. Le second est occupé par l’ethnie majoritaire des Kinh (Viets), sédentaires soumis, de longue date, à un Etat centralisateur qui contrôlait les infrastructures hydrauliques nécessaires à la riziculture. Au XXe siècle, le pouvoir colonial puis le nouvel Etat communiste ont cherché à intégrer les montagnards au sein d’une nation multiethnique. Aujourd’hui, les autorités veulent développer la migration de Kinh des villes engorgées vers les marges montagneuses avec un double objectif, économique (caféiculture…) et militaire.
Les conquêtes et influences culturelles exogènes ont aussi pendant longtemps distingué les territoires du nord du Vietnam actuel profondément marqués par une colonisation chinoise progressive dès le 1er siècle avant notre ère jusqu’au Xe siècle, alors que ceux du sud subissaient l’influence indienne, hindouiste et bouddhiste, puis khmère. Les populations Viet, fortement sinisées, sont descendues vers le sud le long des plaines littorales jusqu’au delta du Mékong, du XIe siècle au XIXe siècle. C’est la France coloniale qui fit l’unité du nord (Tonkin), du centre (Annam) et du Sud (Cochinchine) dans le cadre de l’Union indochinoise (1879) dans laquelle furent incorporés le Cambodge et le Laos. Cette unité se fractura après 1955 entre deux modèles antagonistes d’Etat, une République démocratique du Vietnam, dirigée par un parti communiste, au nord, et une République du Vietnam, bénéficiaire d’une aide américaine massive, au sud. L’une procède à une réforme agraire sur le modèle chinois et développe une industrie rurale tandis que l’autre favorise une urbanisation à marche forcée. Après deux décennies de conflit (la « deuxième guerre d’Indochine » de 1959 à 1975), les communistes du nord imposèrent leur régime à l’ensemble du territoire et réunifièrent à nouveau le pays.
Héritage de cette histoire, le Vietnam peut être qualifié d’Etat bicéphale. Deux pôles se font concurrence, deux deltas, deux métropoles : au centre du delta du fleuve Rouge, Hanoï, capitale millénaire, forme une ville-province de 8 millions d’habitants alors qu’au sud, dans le delta du Mékong, Ho Chi Minh-Ville (ex Saïgon) en regroupe près de 9 millions. Dans ces métropoles résident, au sein des districts urbains, les populations les plus riches, engagées dans une économie mondialisée, mais aussi des populations plus modestes dans les districts agricoles.
L’ouvrage consacre toute une partie aux mutations du Vietnam depuis le Doi Moi, c’est-à-dire le « Renouveau », à partir de 1986 (quelques réformes ont été amorcées en 1979). Quelques années auparavant en Chine, Deng Xiaoping avait amorcé le passage de l’économie planifiée à un système introduisant le marché. Même s’il y a une « voie vietnamienne », le « modèle chinois » est bien présent. « Socialisme de marché », « économie de marché à orientation socialiste », « capitalisme de connivence », « capitalisme hybride »…les expressions sont nombreuses pour qualifier le phénomène.
L’objectif était de sortir l’économie nationale de la situation désastreuse dans laquelle elle se trouvait. La « Rénovation » a eu recours aux investissements étrangers, a créé des ZES (3) et a multiplié les liens avec les autres pays (entrée dans l’OMC en 2007). Ce sont les secteurs manufacturiers puis les infrastructures qui en ont surtout bénéficié. Les exportations ont été multipliées par cent entre 1990 et 2020, date à laquelle la balance commerciale est pour la première fois positive.
L’organisation de l’agriculture connaît aussi une profonde transformation. La collectivisation des terres dans le cadre de très grandes coopératives était un échec patent (sur des parcelles qui ne représentaient que 5% des terres des coopératives, les paysans produisaient 54,3% des revenus en 1975). Elles furent démantelées à partir de 1988, la fixation des prix par l’Etat abandonnée, et grâce à l’intensification de la production, le pays est devenu autosuffisant en riz puis exportateur (6ème rang mondial).
Ces transformations ont amené une montée en puissance de la classe moyenne qui a adopté de nouveaux modes de vie, mais la pauvreté n’a pas disparu, surtout dans le monde rural et les inégalités se sont accrues. Travailleurs du secteur informel, membres des minorités, femmes rurales sont les laissés-pour-compte de la croissance. Corruption, dégradation environnementale, spéculation foncière, urbanisation informelle…sont la face noire du « Renouveau ».
L’introduction du marché n’a pas entraîné de libéralisation politique. Comme en Chine, l’autoritarisme du régime se manifeste par la toute puissance d’un parti-Etat, une surveillance constante de la population à la fois par la police et par la pègre, l’absence de presse indépendante, la sanction de toute « idéologie déviante » au sein même du parti. Mais les autorités vietnamiennes font preuve d’une certaine flexibilité politique, recherchant un certain consensus entre l’Etat et la société. Les critiques qui ne peuvent s’exprimer dans les médias empruntent la voie de la littérature ou de la chanson et les blogs hébergés à l’étranger soutiennent la contestation.
Le souci de préserver une « voie vietnamienne » de développement n’empêche pas le Vietnam d’être intégré de gré et/ou de force dans la sphère d’influence chinoise (ainsi que ses voisins cambodgien et laotien).
La Chine, dans sa volonté de devenir la première puissance mondiale, a besoin de renforcer son influence sur l’Asie orientale et particulièrement sur l’Asie du Sud-Est. Une partie des « Nouvelles routes de la soie » emprunte un réseau de voies de circulation Nord-Sud fournissant aux produits chinois un accès direct à l’océan Indien.
Face à la poussée chinoise vers les mers du Sud, les Vietnamiens sont méfiants. Ils souhaiteraient mettre en œuvre une politique étrangère multilatérale mais la présence chinoise est de plus en plus forte alors que l’aide américaine régresse.
Soft power et capitaux sont les atouts majeurs de Beijing. Les Chinois utilisent l’arme idéologique de leur philosophie, des valeurs asiatiques s’opposant aux valeurs universelles que voudrait imposer l’Occident. La promotion des thèmes confucéens est un moyen de recouvrer une grandeur passée où la Chine dominait ses voisins. Les autorités vietnamiennes défendent aussi l’universalité du confucianisme, mais elles ont le souci d’harmoniser valeurs traditionnelles et « droits de l’homme », à condition qu’ils ne soient pas imposés de l’étranger (il est intéressant de remarquer que des intellectuels vietnamiens au pouvoir sont restés marqués par certaines valeurs occidentales).
Les Chinois ont aussi des moyens financiers pour s’imposer. Ils fournissent les IDE (4) dont le Vietnam a besoin, même si ces capitaux sont investis surtout dans les ZES situées le long des corridors des « routes de la soie ». Le pays bénéficie aussi de l’aide publique chinoise au développement sous forme de prêts préférentiels, ce qui n’est pas sans susciter une certaine méfiance.
Les relations entre le Vietnam et la Chine sont empoisonnées par la question de la mer de Chine méridionale dont les deux Etats revendiquent l’intégralité de la zone. Riche en ressources halieutiques et en hydrocarbures, cet espace maritime a surtout un intérêt stratégique (il est traversé par la principale route maritime du commerce international). Face aux volontés chinoises, le Vietnam ouvre ses portes aux marines occidentales, mais aussi russes et indiennes. Néanmoins la croissance récente des activités chinoises dans la zone semble annoncer la victoire plus que probable du grand voisin du nord. Et il va être difficile au Vietnam de trouver sa place dans l’Indopacifique, entre les ambitions chinoises, indiennes et américaines.
Vietnam et Etats voisins fournira une mine d’informations à son lecteur qui pourra l’utiliser comme une encyclopédie grâce à son Index très fourni. Il est dommage que sa relecture ait été négligée. A titre d’exemple, on peut signaler la confusion entre indice de fécondité et taux de natalité (p.117-119), entre balance commerciale négative et positive (p.141), etc… et regretter l’absence de légendes sous quelques cartes (p.116, p.162). Mais les apports l’emportent largement sur ces quelques défauts.1) Yves Duchère, Vietnam et Etats voisins, Géopolitique d’une région sous influences, Armand Colin, 2023.
2) 53 minorités (14,7% de la population) vivent dans les montagnes et les plateaux forestiers. Les langues qu’ils utilisent appartiennent majoritairement au groupe tibéto-birman
3) Zones économiques spéciales
4) Investissements directs à l’étrangerMichèle Vignaux, novembre 2023
-
 17:53
17:53 Dans quel monde vivons-nous ?
sur Les cafés géographiques
Delphine Papin, Frank Tétart et Daniel Oster (modérateur)
(photo de Micheline Martinet)Pour fêter le 25ème anniversaire de la création de l’association, Les Cafés géographiques ont invité Frank Tétart, docteur en géopolitique, à présenter une question d’actualité sous le titre : « Dans quel monde vivons-nous ? ». Quel meilleur choix que cet ancien co-auteur de l’émission Le Dessous des cartes et coordinateur du Grand Atlas 2024 (1) pour analyser les crises qui affectent la planète ? Delphine Papin, responsable du service Infographie et Cartographie du journal Le Monde, complète son intervention.
En introduction, F. Tétart rappelle que depuis 2022 l’opposition entre démocraties et régimes autoritaires (présents dans de grandes nations : Chine, Russie…) gagne du terrain, ce dont témoignent régulièrement médias et réseaux sociaux. On se pose aussi des questions sur le rôle que pourrait jouer la communauté internationale dans la résolution des conflits actuels et on s’inquiète de l’avenir du monde face au défi du changement climatique. Il y a urgence mais les négociations piétinent et le choix de Dubaï, gros producteur de pétrole, comme lieu d’accueil de la prochaine COP (2) laisse perplexe. L’enjeu climatique concerne toute la planète, mais surtout les pays les plus précaires.
Quels sont les principaux points chauds étudiés dans l’Atlas ?
L’Ukraine subit une guerre d’agression qui, loin d’être la guerre courte voulue par Poutine, s’inscrit dans une durée indéterminée. Les modalités de combat rappellent la Grande Guerre : les ennemis se font face de part et d’autre d’un front qu’ils sont incapables de percer. C’est dès maintenant un échec politique pour le dirigeant russe car il a amené la Finlande et la Suède à rejoindre l’OTAN. C’est un jeu à somme nulle.
Au Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien, de basse intensité ces derniers temps, est redevenu une guerre ouverte d’une grande violence, le 7 octobre dernier. Il concerne tous les Etats de la région et même au-delà :
– l’Iran, principal ennemi, apporte son soutien au Hamas et au Hezbollah libanais présent également en Syrie.
– les Etats arabes souhaitant se rapprocher de l’Etat israélien se trouvent dans une situation paradoxale vis-à-vis de leur opinion publique. C’est le cas des signataires des Accords d’Abraham (3) et de l’Arabie saoudite.
– la Turquie souhaiterait jouer un rôle de médiateur dans le conflit, ce que sa proximité idéologique du Hamas rend plausible.
– la Russie a accordé son soutien successivement à Israël et aux Palestiniens qu’elle défend désormais.
– Israël soutient l’Azerbaïdjan, pays musulman proche de la Turquie.
Les relations et alliances entre Etats sont donc désormais marquées par une grande complexité.
Le retour des nationalismes est aussi une caractéristique du monde actuel. Depuis l’été 2022, entre le Kosovo (4) et la Serbie se sont accrues de nombreuses tensions que chacun des deux Etats cherche à instrumentaliser. En témoignent les dernières élections municipales qui ont été boycottées par les Serbes du Kosovo. Le mythe toxique d’un Kosovo qui serait le berceau de la Serbie, nuit à des négociations que semblait pourtant favoriser une adhésion possible à l’UE. Une solution pacifique semble par conséquent difficile, même si la présence américaine (base militaire de l’OTAN au Camp Bondsteel) et l’aide de l’UE devraient contribuer à la pacification.
En Bosnie-Herzégovine, les partis nationalistes jouent un rôle important, contribuant à de fortes tensions.
Le Caucase est le lieu de plusieurs conflits gelés depuis 1991, dont le Haut-Karabakh qui est redevenu conflictuel.
A l’époque soviétique, le Haut-Karabakh était une région autonome peuplée de 75% d’Arméniens, au sein de l’Azerbaïdjan. Les frontières entre les Républiques socialistes avaient été tracées par Staline dans le but de briser les élans nationalistes. Après 1991, une République du Haut-Karabakh est proclamée dans les frontières de l’oblast soviétique, mais elle n’est pas reconnue internationalement car faisant partie d’un territoire souverain, entraînant une guerre jusqu’à 1994 et au statu quo territorial. Pendant la guerre de septembre-novembre 2020, l’Azerbaïdjan, soutenue par la Turquie, reconquiert certains territoires. Il s’agit d’une guerre brève s’achevant avec la médiation de la Russie qui obtient le maintien de la paix et la préservation de la population arménienne du Haut-Karabakh. En septembre 2023, une nouvelle attaque des Azéris a obligé la population arménienne du H.-K. à choisir entre l’exil et la nationalité azerbaïdjanaise. L’absence d’intervention de la Russie, occupée « ailleurs », a entraîné l’exode des trois quarts de la population vers l’Arménie. Peut-on qualifier ce drame d’« épuration ethnique » ?
L’Indopacifique est le nouveau terrain d’affrontement des Etats-Unis qui ont fait du Pacifique leur premier objectif, et de la Chine qui se veut, non seulement puissance politique mais aussi puissance navale. Dans l’océan Indien, l’expansionnisme des Chinois est au service de leurs routes commerciales. Aussi ont-ils constitué un « collier de perles », c’est-à-dire des bases navales le long de leur principale voie d’approvisionnement maritime vers le Moyen-Orient (Djibouti, Maldives, Pakistan…), ce qui rencontre l’opposition des Etats-Unis et de l’Inde, très soucieuse de la poussée chinoise. Pour contrer cette influence, les deux puissances, auxquelles se sont joints l’Australie et le Japon, se sont accordées sur la mise en place de points d’appui dans toute la région.
Sur toute la planète on assiste à une remise en cause des démocraties.
En Afrique, plusieurs coups d’Etat ont fait reculer la stabilité et la démocratie.
En Europe, la démocratie régresse au sein même des pays démocratiques (Hongrie) et les Etats-Unis en donnent une image déplorable.
La circulation de l’information passe de plus en plus par les réseaux sociaux, ce qui favorise la croyance dans les fake news et une forte polarisation des sociétés. La liberté de la presse est très menacée dans certains pays comme la Russie qui ne diffuse que de la propagande. Même là où elle peut s’exercer, les chaînes d’information en continu (par exemple Fox News aux Etats-Unis) créent un chaos informationnel. De plus les journalistes sont de plus en plus des cibles. On a déploré la mort de 60 d’entre eux en 2022.
Pourquoi y a-t-il aussi peu d’action face à l’urgence climatique ?
Plusieurs facteurs interviennent. Le premier tient à l’attitude des citoyens eux-mêmes qui ne veulent pas renoncer à leur mode de vie. On peut aussi mettre en cause le décalage entre calendrier politique et calendrier climatique. Les responsables politiques ont peur d’être en porte-à-faux par rapport à leurs électeurs. Enfin les moyens incitatifs sont insuffisants. Pourtant les risques climatiques sont grandissants. Ils entraîneront des perturbations sociales et des migrations.
Questions de la salle
1-Que peut-on dire du rôle des religions dans le monde actuel ?
Partout dans le monde, la religion redevient un élément identitaire essentiel pour de nombreux peuples, remettant en cause le processus de sécularisation des sociétés lié à l’expansion du modèle occidental depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Le monde s’avère aujourd’hui plus religieux qu’il ne l’était il y a un demi-siècle, notamment dans les anciens pays communistes d’Europe de l’Est, en Chine ou en Afrique. On peut parler d’une globalisation du religieux qui favorise le sentiment d’appartenance à une communauté dans une société en voie d’uniformisation mondialisée.
Ces identités de type religieux sont souvent instrumentalisées par les pouvoirs politiques ou divers groupes contribuant à des violences ou des conflits, par exemple entre juifs et musulmans en Israël, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, entre sunnites et chiites au Moyen-Orient, entre hindous et musulmans en Inde, entre bouddhistes et minorité musulmane des Rohingyas en Birmanie, etc.
Ainsi, ce qu’on appelle « guerres de religion » sont en réalité des guerres où les religions agissent comme des facteurs aggravants plutôt que les mobiles et causes profondes des conflictualités.
2-La dissuasion nucléaire reste-t-elle un facteur déterminant des relations internationales ?
9 Etats détiennent des armes nucléaires, dont 5 puissances reconnues par le traité de non-prolifération (TNP) établi en 1968. A ces 5 Etats (Etats-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France) se sont jointes 4 autres puissances nucléaires : Inde, Pakistan, Israël, et Corée du Nord. Les armes nucléaires sont déployées pour prévenir des agressions majeures dans le cas de doctrines de « dissuasion ». L’affirmation doctrinale de l’arme nucléaire est perçue alternativement comme une garantie de sécurité ou un frein au processus de désarmement.
Le nucléaire militaire participe à la « réalité crisogène » au Moyen-Orient (crise liée au programme nucléaire iranien depuis 2003) et en Asie du Nord-Est (crise nucléaire ouverte avec la Corée du Nord en 1993). Mais en même temps, la dissuasion est plus que jamais pertinente dans le contexte du retour de la compétition entre les puissances et des tensions exacerbées par la guerre en Ukraine.
3-La question des pertes humaines et de la guerre au sol
L’évolution de la technologie (drones, roquettes, missiles…) accroît les capacités de destruction des bombardements faits à une certaine distance du « champ de bataille ». Sans compter que faire la guerre de nos jours devient de plus en plus complexe (guerre informationnelle, cyberconflits…). Mais pour gagner la guerre il arrive un moment où les interventions terrestres sont nécessaires avec la conduite d’opérations au sol (pensons aux stratégies militaires mises en œuvre au Sahel, en Ukraine, dans la bande de Gaza…). Or, dans les démocraties les pertes humaines liées à la « guerre au sol » sont devenues encore plus difficilement supportables qu’autrefois, ce qui conduit ces pays à faire des choix stratégiques tenant largement compte de ce facteur.
4-L’ordre international de 1945 de plus en plus remis en cause
Il y a près de 80 ans que l’ordre international est organisé selon les règles établies dans l’immédiat après-guerre par les vainqueurs de la Seconde guerre mondiale (Bretton Woods, ONU, etc.). En 1989-1991, le modèle démocratique et libéral incarné par l’Occident et son chef de file les Etats-Unis a semblé triomphant. Mais aujourd’hui l’ordre international dit libéral est contesté de toutes parts.
Les puissances émergentes contestent le mode de fonctionnement des institutions de l’après-guerre. Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) se réunissent chaque année depuis 2011, ils seront 11 le 1er janvier 2024, rejoints par 6 Etats (Arabie Saoudite, Argentine, Egypte, Ethiopie, Iran, Emirats Arabes Unis). Le PIB mondial à parité de pouvoir d’achat (PPA) des BRICS 11 s’élève aujourd’hui à 36 % (soit déjà plus que le G7), et les BRICS englobent désormais 47 % de la population mondiale. L’institution multilatérale cherche à redéfinir les relations internationales, à réformer le cadre institutionnel actuel – du Conseil de sécurité de l’ONU au FMI et à l’OMC.
Dans les relations internationales l’opposition entre les démocraties et les régimes autoritaires est de plus en plus marquée, même si les facteurs qui interagissent sont parfois contradictoires. Ainsi que penser du rapprochement politique et diplomatique entre la Russie et la Chine alors que les intérêts économiques de ces deux pays sont parfois antagonistes ?
Notes :
1) Grand Atlas 2024, Franck Tétart, Editions Autrement, Paris, 2023.
2) COP : Conférence des Parties. La COP est une conférence internationale de l’ONU sur les changements climatiques, la première s’est tenue à Berlin en 1995, la 28e se tiendra à Dubaï (EAU) du 30 novembre au 12 décembre 2023 (ce sera donc la COP 28).
3) Les Accords d’Abraham sont des traités de paix signés par Israël avec les Emirats arabes unis, Bahreïn, puis avec le Soudan et le Maroc (décembre 2020).
4) Le Kossovo, auparavant province serbe, a déclaré unilatéralement son indépendance le 17 février 2008 contre la volonté de Belgrade. Il n’est pas reconnu par l’ONU (opposition de la Russie), ni par l’UE (opposition de 5 Etats sur 27).Michèle Vignaux et Daniel Oster, octobre 2023
-
 19:34
19:34 Dessiner l’architecture en géographe par Simon Estrangin
sur Les cafés géographiquesQuelles sont les similitudes entre les dessins des géographes et ceux d’autres professions, les architectes par exemple ? Le dessin du géographe n° 88 abordait déjà cette question à travers des exemples pris dans l’espace méditerranéen. Ici, il s’agit de se pencher sur la façon dont le géographe Jacques Pezeu-Massabuau dessinait l’architecture.
En effet, Jacques Pezeu-Massabuau (1930-), s’est beaucoup penché dans la seconde moitié du XX° siècle sur les cas des maisons japonaises et chinoises. Dans ses travaux il défendait notamment l’idée, réinterrogée aujourd’hui (Pelletier, 2022), que la maison japonaise traditionnelle était inadaptée à son milieu et notamment aux tremblements de terre et aux typhons, ou encore aux rigueurs de l’hiver. Il cherchait donc à en rendre compte à l’aune d’autres critères : esthétiques, techniques, économiques, sociaux… Un élément d’explication tenait par exemple à l’histoire du peuplement de l’île, en provenance du sud-ouest : la maison japonaise pouvait se lire comme un héritage d’origine tropicale.
Dans deux articles des années 60 des dessins illustraient ce propos. Certains peuvent se rapprocher de ceux qu’auraient livré à la même époque un architecte (fig.1), avec une attention fine à la structure de la maison (pannes, chevrons, voligeage etc.). D’autres, dans une démarche plus spécifique à la géographie, appuient le raisonnement en jouant sur les échelles spatiales : aux plans de maisons suivent ceux des complexes architecturaux, des vues de rues, de villages. Et la réflexion se poursuit naturellement à plus petite échelle par la carte. Les dessins illustrent aussi les disparités en fonction du niveau social, mais aussi les différences entre milieu urbain et rural (fig.2). Enfin, une comparaison et un parallèle entre maison chinoise sur pilotis du Yunnan et maison japonaise permet de donner de la substance à la thèse de la diffusion d’un modèle architectural (fig.3).Fig. 1 — Structure de la maison japonaise.
1. Fondations (tamaishi). — 2. Sablière basse [dodai). — 3. Lambourde [ashigatame). — 4. Nuki. — 5. Solive (neda). — 6. Parquet. — 7. Poutre maîtresse (honbari). — 8. Sablière haute (Aera). — 9. Pannes (moya). — 10. Chevrons (taruki). — 11. Voligeage (nojiita). — 12. Bardeaux (kokeraita). — 13. Tuiles (kawara). — 14. Poutre faîtière [????). — 15. Tatami. — 16. Seuil rainuré (shikii). — 17. Linteau rainure (kamoi). — 18. Shôji. — 19. Fusuma. — 20. Nageshi. — 21. Ramma. — 22. Plafond suspendu. — 23. Toit de la véranda. — 24. Plafond de la véranda. — 25. Fenêtres vitrées coulissantes (garasudo). — 26. Tokonoma. — 27. Tokobashira. — 28. Shoin. — 29. Chigaidana.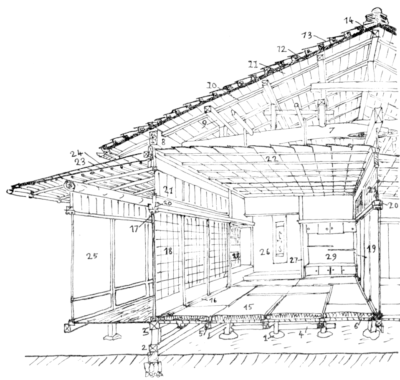
Figure 2 — Les habitations urbaines (en haut) et rurales de style tibétain, d’occupation indifféremment tibétaine ou chinoise ; toits en terrasse ou couverts en chaume abritant une solide construction de pierre. 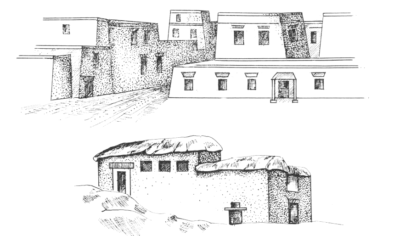
Fig. 3 — La maison chinoise sur pilotis.
A. – Type archaïque de la région du Yunnan (d’après M. Liu Tun-Chen). —
B. – Type moderne (Taiwan) ; la maison japonaise des villes semble dérivée directement de ce type.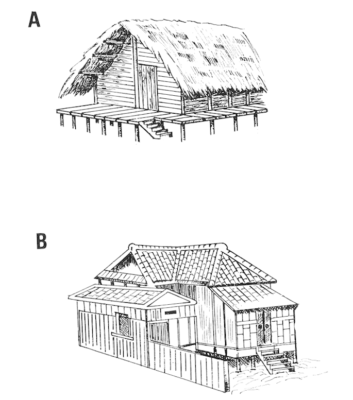
Notice biographique
Jacques Pezeu-Massabuau, né en 1930, agrégé d’histoire-géographie, docteur ès-lettres, a réalisé de nombreuses études sur les thèmes, souvent croisés, de l’Extrême-Orient, de l’habitat, de l’urbanisme, du confort, et de Jules Verne. Il a abordé ainsi, comme géographe, des sujets qui ont trait également à l’architecture, l’urbanisme et l’anthropologie. Il a vécu, enseigné, participé à des actions d’aménagement au Japon.
Simon Estrangin octobre 2023
Bibliographie indicative
2017, BONNIN P., PEZEU-MASSUBAU J., Façons d’habiter au Japon, CNRS
2014, PEZEU-MASSUBAU J., Trente-six manières d’être chez soi, un art de vivre universel menacé, L’Harmattan
2013, Jules Verne, les voix et les voies de l’aventure, L’Harmattan
2007, Construire l’espace habité, l’architecture en mouvement, L’Harmattan
2003, Habiter, rêve, image, projet, L’Harmattan
2002, Du confort au bien-être, la dimension intérieure, L’Harmattan
2001, La maison, espace réglé, espace rêvé, Belin
1983, La maison, espace social, PUF
1977, Pays et paysages d’Extrême-Orient, PUF
Les dessins ci-dessus sont extraits des deux articles suivants :1966, PEZEU-MASSUBAU J., « Problèmes géographiques de la maison japonaise.», Annales de Géographie, t. 75, n°409, pp. 286-299 ;
1969, PEZEU-MASSUBAU J., « Les problèmes géographiques de la maison chinoise », Cahiers d’outre-mer. n° 87 – pp. 252-287 ;Pour aller plus loin sur la maison japonaise :
2022 PELETIER P., « la maison japonaise, un quiproquo géographique », La Géographie, n°1587, PP. 20-25
-
 15:14
15:14 Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges 2023
sur Les cafés géographiques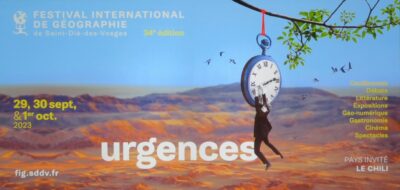
Le FIG (Festival international de géographie) a fêté en 2023 sa 34e édition. Le thème choisi cette année m’intriguait : Urgences. Le pays invité était le Chili.
C’est quoi l’urgence ?L’édition du FIG 2023 nous propose de réfléchir sur la notion du mot « urgences ». En cette fin d’année difficile, le choix de ce sujet était excellent !
Dans les années 1970, la planète n’apparaît pas réellement menacée par l’homme. Les planifications étatiques, les plans d’urbanisme semblent suffisants pour faire face à l’accroissement de la population mondiale. Aujourd’hui, tout s’accélère, l’anxiété des hommes s’est généralisée et on s’interroge pour savoir comment préparer le long terme.
On a longtemps utilisé le mot « transition » pour désigner les changements : la « transition démographique » est analysée depuis déjà plusieurs décennies ainsi que la notion de développement durable.
C’est la pandémie de Covid qui a provoqué la notion d’urgence sanitaire explique Clélia Gasquet-Blanchard. Transition, crise ou urgence ? Tout le monde cherche le terme le plus pertinent pour qualifier la période actuelle.Eric Fottorino, fidèle du FIG, rappelle que le mot urgence est polysémique. Il est utilisé par exemple quand on est mis face à une catastrophe, sans capacité d’anticipation : par exemple lors des inondations récentes en Libye et à New York ou lors du séisme à Marrakech.
Dans un grand entretien avec Rony Brauman, ancien président de Médecins Sans Frontières, il est rappelé que son livre, Penser dans l’urgence, a été publié au Seuil en 2006. Déjà !
Inondations, feux de forêts, érosion du littoral, sécheresses se sont amplifiés avec le dérèglement climatique. Il y a donc urgence, pour les géographes et pour les dirigeants, à observer ce qui se passe et à agir.
L’urgence est économique, politique (urgence démocratique), sociale (face aux inégalités qui s’accroissent), environnementale. Elle est aussi « urgence créative » depuis que l’intelligence artificielle peut reproduire et peut-être produire des œuvres d’art.Sous la direction de Florian Opillard et de Thibaut Sardier, un petit livre a été publié, aux éditions du CNRS avec pour titre « Il y a urgence ! Les géographes s’engagent ».
Florian Opillard s’interroge sur les missions de nos forces armées. « Alors qu’incendies ou cyclones s’annoncent plus fréquents et au moment où l’invasion de l’Ukraine marque le retour de la guerre de haute intensité en Europe, comment assurer toutes les missions avec des moyens suffisants ? ».
Magali Reghezza-Zitt analyse : « nous allons vivre les conséquences du changement climatique, et les premiers touchés seront souvent les précaires. S’il y a urgence, c’est parce que nous pouvons encore agir pour éviter le pire. Et pour cela, il va falloir fixer le cap démocratiquement ».
Etienne Walker écrit à propos de la crise des Gilets jaunes, mouvement social qui a débuté fin 2018 en France : « Qui décide de ce qui est urgent ? Fin du monde, fin de mois, même combat ? Peut-on réconcilier urgences écologique et sociale ? Qualifiée de « crise », entend-on l’urgence qu’il y a pour l’Etat à gérer une contestation sociale, elle-même suscitée par l’augmentation des prix des carburants, pour faire face à l’urgence environnementale ? »
Angélique Palle évoque l’urgence énergétique. Plusieurs options s’offrent à la décision politique. « La transition énergétique est souvent présentée comme la plus efficace techniquement et aussi la moins coûteuse politiquement. Mais changer de système énergétique, c’est changer de société ».
Michel Lussault ironise : « Dans quel état nous met l’urgence ? Et si l’urgence venait d’une globalisation de la menace, à travers les grands ensembles urbains. Car aujourd’hui tout point du globe peut être touché par une catastrophe. Faut-il remettre en cause les World Cities, ou hyperlieux ? Et si contre l’urgence, nous faisions le choix de la vulnérabilité ? ».A Saint-Dié, Judicaëlle Dietrich s’interroge également, avec un exemple précis : y a-t-il urgence à déménager la capitale d’Indonésie ? Djakarta, « géant silencieux », agglomération de 30 millions d’habitants située sur l’île de Java, subit des inondations dramatiques. Elle est largement située au-dessous du niveau de la mer et les digues actuelles se révèlent submersibles. La pollution de l’air y est aussi énorme. L’urgence à changer de capitale est d’abord environnementale. Mais elle est aussi devenue géopolitique. La nouvelle capitale sera située sur l’île de Bornéo, plus centrale et infiniment moins peuplée que l’île de Java. La nouvelle capitale sera érigée en hauteur et se nommera Nusantara. Changer de capitale, c’est aussi vouloir oublier que Djakarta fut un comptoir créé par les colonisateurs hollandais pour contrôler le détroit de Malacca. C’est oublier le passé et devenir « un pays émergent et libre ».
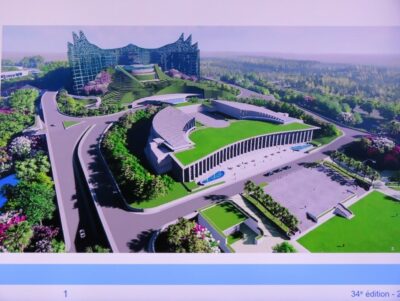
Plan de Nusantara (la future capitale de l’Indonésie) présenté par J. Dietrich (photo de M. Verfaillie)
Dans son dernier ouvrage (Atlas historique de la Terre, Les Arènes, 2022), Christian Grataloup, éminent géohistorien, analyse de nombreuses cartes. Retenons celle qui présente les forêts au début du XXe siècle, puis la déforestation galopante, pour nourrir les hommes (carte p 180 de l’ouvrage). Voir ci-dessous :
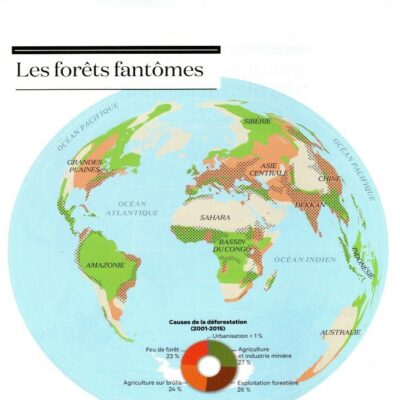
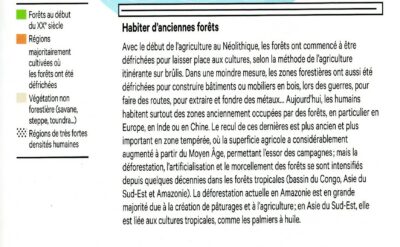
La Société de Géographie dans sa revue La Géographie a publié un Dossier spécial FIG 2023 (n° 1590 juillet-août-septembre 2023). Jean-Robert Pitte, son Président, écrit dans l’Editorial : « Le pessimisme est à l’ordre du jour, la population s’inquiète de la pression démographique, de son alimentation, des inégalités sociales, mais aussi de la montée des extrémismes politiques et culturels, du « choc des civilisations ». A longueur de journée les médias ne laissent plus aucune raison d’espérer.
L’humanité a connu bien d’autres crises, poursuit-il et un minimum de culture géographique et historique permet de reprendre espoir. Mais l’optimisme ne se décrète pas, la véritable urgence est là », affirme-t-il à la cathédrale en grès rose de Saint-Dié.Le Chili, pays invité du FIG 2023
Citons Cécile Faliès : « Bien que prévenus par Jean Dresch qu’il n’y a pas de géographie sans drame (Un géographe au déclin des empires, Maspero- 1979) les apprentis géographes ne mesurent pas toujours à quel point le choix de leur premier terrain les oblige par la suite. Le Chili est-il le miroir grossissant du monde s’interroge Cécile ? Il a connu ces dernières années des bouleversements majeurs. En octobre 2018, l’augmentation du prix du ticket de métro provoque d’immenses manifestations, l’armée est envoyée et l’état d’urgence proclamé. Les Chiliens exigent de remplacer la constitution rédigée sous la dictature de Pinochet en 1981.
A la Tour de la Liberté, Sébastien Velut propose d’étudier la situation du Chili. Pays du Cône sud-américain, à peine plus grand que la France mais trois fois moins peuplé, le Chili s’étend du Tropique du Cancer (désert d’Atacama) jusqu’au cap Horn. Il est bordé par trois océans et contraint par la cordillère des Andes sur son flanc est. Sa ZEE (zone économique exclusive) est la 10e mondiale avec 3,7 millions de km2.
Le pays a retrouvé un régime démocratique mais fragile. Son économie est extravertie, fondée sur l’exportation de matières premières minières (dont le lithium) et de produits agricoles. L’exploitation des richesses de la mer (pêche, aquaculture) n’est pas négligeable.
Ce pays, issu de la colonisation espagnole, a aussi une culture américaine par son mode de développement et s’efforce d’intégrer à présent la culture des peuples autochtones de Patagonie et de la Terre de Feu, sans oublier les Rapa Nui de l’île de Pâques.
Les urgences auxquelles doit faire face le Chili sont donc multiples : urgence politique à stabiliser la démocratie ; urgence culturelle ; urgence à recomposer d’immenses territoires littoraux menacés par le changement climatique et la montée des eaux (d’où l’urgence à relocaliser).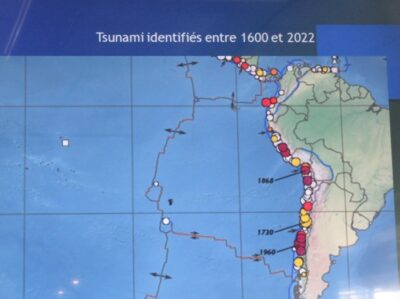
Carte présentée lors de la conférence par Sébastien Velut (photo de M. Verfaillie)
Le FIG a projeté de nombreux films et documentaires sur le Chili, pays invité.
Les Cafés géographiques, sous l’égide de Gilles Fumey, ont organisé plusieurs soirées dans les cafés de Saint-Dié.
Le Chili au prisme de ses vulnérabilités, une cartographie des urgences territoriales, avec Eloise Libourel,
Vins chiliens : expressions liquides de paysages multifacétiques avec Gilles Fumey et Claire Manvieux, sommelière
Le Chili, 50 ans après le coup d’état avec Sébastien Velut, Anne-Laure Amilhat Szary et Cécile Faliès.
Le paysage viticole chilien, de la conquête à nos jours, avec Gilles Fumey et Louis-Antoine Luyt, producteur de vins chiliens.Les 25 ans des Cafés Géo, créés à Saint-Dié ont été célébrés avec Gilles Fumey, géographe, et Christian Grataloup, géohistorien.
Etaient présents à cette soirée de nombreux confrères invités à répondre à la question : Comment devient-on géographe ?
Christian Grataloup a choisi la géographie pour faire l’histoire qu’il aimait à travers les coupes topographiques.
Yvette Veyret détestait la géographie mais aimait l’histoire, Yves Lacoste l’a réconciliée avec notre discipline.
Jacques Lévy fut un enfant malade, mais on lui offrit un atlas pour passer le temps.
Emmanuel Vigneron évoque aussi son père, pédologue à Montpellier qui adorait la géomorphologie.
Roland Courtot, confie que petit il avait peur de se perdre, que son chef d’un camp de scout faisait exprès de les perdre, qu’il n’eut de choix autre que de dessiner, ce qu’il fait depuis toujours et depuis longtemps avec son ami Michel Sivignon.
Michel Lussault confie que son choix fut dicté par l’émotion, dans son enfance en Bretagne, quand un ami de son père l’invite à regarder le paysage.
Daniel Moreaux qui fut président de l’AP-Géo devient géographe parce que son père voyage souvent à l’étranger.
Olivier Godard responsable de l’Association Concours Carto, à Angers, s’affirme « historien en train de devenir géographe ».
Christiane Barcellini, présidente des Cafés géo de Saint-Brieuc, parle de son professeur du lycée Edgar Quinet, Mademoiselle Boeuf (qui fut le mien aussi) qui lui inocula le virus.
Dix jeunes étudiants en Master géo avec Myriam Houssay sont venus dire que si celle-ci était géographe, c’est parce qu’elle avait eu Maryse Verfaillie comme enseignante, au lycée Lakanal à Sceaux. Myriam était invitée du FIG l’an dernier, elle est entre autres, spécialiste des questions urbaines en Afrique du Sud.
Enfin, Christian Pierret en personne, ancien maire de Saint-Dié, à l’origine du FIG, a indiqué qu’il était devenu géographe après avoir reçu le Prix de géographie dans un lycée de la banlieue parisienne.Le FIG a beaucoup d’autres atouts à son arc :
Le Salon du livre Americo Vespucci accueille cette année sous son pavillon plus de 60 éditeurs et plus de cent autrices et auteurs en dédicace.
L’Espace Géo-Numérique offre une vue d’ensemble des méthodes et outils utilisés par les géographes pour s’approprier la géographie de demain, à l’aide de drones par exemple.
Sous le Chapiteau Gourmand, on n’oublie pas que la géographie se trouve aussi dans l’assiette et que l’on peut y savourer des produits venus du monde entier. Une autre urgence tempère nos envies de goûter à tout : dans sa Géographie de l’alimentation, Gilles Fumey considère l’obésité qui affecte un être humain sur cinq, comme une véritable pandémie.Hommage particulier à Olivier Godard et à son équipe, qui met à la disposition des enseignants, des étudiants et du grand public une variété infinie de cartes que vous pouvez retrouver sur les sites :
concourscarto@gmail.com ou https:///www.concourscarto.com/
Il est soutenu par Christian Grataloup, Delphine Papin, cartographe du journal Le Monde, la Société de Géographie et bien d’autres organismes.Le Festival International de Géographie connaît un succès croissant, année après année. Dans le magazine Télérama (n° 3846), Michel Foucher recense les atouts de la géographie. Géographe, ancien ambassadeur, il a publié de nombreux ouvrages et continue d’arpenter le monde. Il explique que la géographie est une science de l’espace et que les géographes sont des « éclaireurs ». Il rappelle que de Gaulle affirmait que « la politique d’un Etat est dans sa géographie ». Et, poursuit-il, s’il est nécessaire de savoir d’où l’on vient pour savoir qui l’on est, et donc de connaître l’histoire, il l’est tout autant de savoir se situer géographiquement afin d’avoir une vision globale d’un territoire donné. « Parlons de l’horizon, mes amis, de quoi pourrions-nous parler d’autre » a écrit le poète Yves Bonnefoy.
Sur le site des cafés géographiques, lire aussi le texte sur le FIG 2021 :
[https:]]Maryse Verfaillie, octobre 2023
-
 19:36
19:36 Haïti, un Etat en faillite
sur Les cafés géographiques
Jean-Marie Théodat au Café de la Mairie, le 9 octobre 2023
(photo de Michèle Sivignon)Le Café de la Mairie (Paris 3e) recevait en cette soirée du 9 octobre le géographe Jean-Marie Théodat pour un café géo consacré à Haïti. La double appartenance, haïtienne et française, conditionne non seulement la vie personnelle mais aussi le travail de recherche de cet universitaire qui a enseigné aussi bien à Paris 1 Panthéon-Sorbonne qu’à Port-au -Prince. Aussi est-ce sa position personnelle qu’il nous donne lorsqu’il analyse la situation catastrophique de son pays natal. Cette situation est pourtant contradictoire car elle comporte deux faces. Un inventaire de mots-clés, de mots-clichés qui sautent à la mémoire à l’évocation du vocable Haïti.
Côté pile, on peut lui accoler une série de termes négatifs (pauvreté, Etat failli, drogue, tuerie de masse, ouragan, famine, désolation, trafic d’armes, kidnapping …). Ces termes pourraient être attribués à de nombreux pays de la terre, mais à Haïti , tous y convergent pour pour désigner un même territoire.
Côté face, on peut témoigner d’une culture vibrante portée par de nombreux écrivains et artistes ( Dany Laferrière, Lionel Trouillot, Jocelyne Trouillot, René Depestre, Jacques Roumain, Jacques Stephen Alexis, Gessica Généus…), tous intellectuels et créateurs qui font honneur à la patrie de Toussaint-Louverture. On peut parler d’un Haïti-Janus.
Haïti, premier Etat noir à entrer dans l’Histoire, est aujourd’hui un « trou noir » dans les Caraïbes.
Comment en est-on arrivé là ? Comment parler d’Haïti en géographe ?
Haïti témoigne, nous dit notre conférencier, de ce qui arrive lorsqu’on foule aux pieds les principes de liberté, d’égalité et de solidarité pour ne laisser place qu’à la loi du marché. Témoignent de cette situation les 85% d’Haïtiens diplômés de l’enseignement supérieur qui ont choisi de vivre et de travailler à l’étranger.
J.-M. Théodat organise son exposé en trois parties.
La triple faillite de l’Etat haïtien
Haïti partage avec la République dominicaine Hispaniola, la deuxième île (en superficie) des Grandes Antilles, dont elle n’occupe que 27 000 km2.
Carte des deux entités de l’île depuis 1697
Mons.wikimedia.org/w/index.php ?curid=74277953Quelques chiffres rendent compte de la situation difficile de la population. Avec une moyenne de 441 hab./km2 et une concentration humaine dans les plaines, peu étendues, la densité est très forte sur certaines portions du territoire. La capitale, Port-au-Prince, regroupe 3,3 millions des 11 millions d’habitants du pays. 30% des Haïtiens vivent au-dessous du seuil de pauvreté (fixé à 1,80 €/jour), ce qui explique une faible espérance de vie (63 ans, alors qu’elle est de 83 ans à Cuba). En 2020 le PIB n’était que de 13 milliards de $/an, un des plus faibles des Caraïbes, notamment beaucoup plus faible que celui du voisin dominicain.
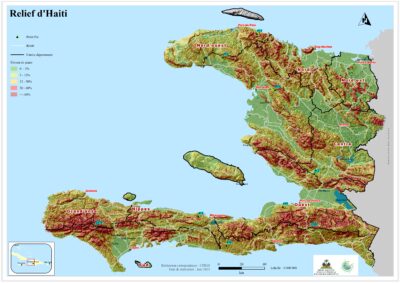
Réalisation cartographique : CNIGS, juin 2023
La première failite de l’Etat est d’ordre écologique.
Lorsque les Européens ont débarqué au XVe siècle, la forêt recouvrait 90% du territoire ; aujourd’hui, elle n’en occupe plus que 3%. On a déforesté pour planter de la canne à sucre, puis pour la cuisson du jus de canne, étape nécessaire à la fabrication du sucre brut, et pour exporter le bois. A cette exploitation coloniale fait suite le front pionnier des petits paysans apès l’abolition de l’esclavage. S’ajoute l’utilisation massive du charbon de bois pour la cuisson et la production artisanale (boulangerie, blanchisserie, rhumerie traditionnelle…). Le milieu naturel a donc été soumis à rude épreuve. Les pentes dénudées ont été fortement érodées par les pluies tropicales, d’autant que les Noirs amenés sur l’île ne connaissaient pas les techniques agricoles des Amérindiens qui les ont précédés dans l’île.
La situation du milieu marin est catastrophique (blanchissement des coraux et exploitation de la mangrove) et le pays est soumis au double aléa sismique et climatique.
La deuxième faillite touche l’économie et la société.
Après l’indépendance, les anciens esclaves voulaient sortir de l’aliénation économique. Leur premier souci était d’assurer leur autosubsistance sans rapport de dépendance à l’égard de l’Etat. Mais le Code rural de Toussaint Louverture n’a pas répondu à leurs espoirs, se contentant de remplacer « esclaves » par « cultivateurs » dans les grands domaines. L’Etat prédateur d’Ancien Régime s’est prolongé au cours des XIXe et XXe, siècles sans création d’écoles ni de système de santé. Aujourd’hui la société haïtienne est une des plus inégalitaires des Amériques. 20% de la population concentrent 64% des richesses alors que 20% des plus pauvres n’en possèdent qu’1%.
La troisième faillite est celle du politique.
Le XXe siècle a vu se succéder les dirigeants autoproclamés, comme François et Jean-Claude Duvalier protégés par les Tontons Macoutes, milice à la sinistre réputation de 1957 à 1986.
Dans les années 1980, il y a un glissement vers la démocratie dans toute l’Amérique latine (Argentine, Chili, Brésil). En Haïti le Père Aristide est élu à la présidence de la République en 1990. Inscrivant sa démarche politique dans la « théologie de la libération », il suscite l’espoir de la Gauche. Pourtant ses deux mandats sont un échec. Le pays entre dans une spirale de violence avec coups d’Etat et appel à des gangs armés après l’abolition de l’armée en 1995.
Aujourd’hui il y a effondrement de l’Etat de droit. Le trafic de drogue est intense, aux mains de réseaux mafieux qui instrumentalisent le pays pour faire leur business. Les élites sont éclaboussées par le recyclage de l’argent sale. Il n’y a plus eu d’élections depuis 2016. C’est le règne des « bandits légaux ». les gangs rançonnent la population et terroisent les faubourgs.
Seul recours, l’émigration qui nourrit une diaspora puissante qui compterait actuellement 3 millions de personnes (en comptant la deuxième et troisième génération) transférant 3 milliards de dollars par an dans leur pays d’origine. La diaspora fait vivre le pays intérieur.
Haïti, la France et moi : entre racines et ancrage
J.-M. Théodat est né dans une famille de la classe moyenne, qui se situe dans l’opposition aux Duvalier. Il arrive à Paris à 17 ans, animé par une certaine fascination pour la France et un grand désir de liberté. Plongé dans un milieu d’intellectuels de gauche au Quartier latin, il fait des études littéraires au lycée Fénelon, en Hypokâgne et lycée Duruy en Khâgne, classes dont l’atmosphère n’est pas exempte de racisme. Il choisit la géographie et poursuit ses études à l’Université Paris 4. Cette discipline lui semble offrir la meilleure voie pour comprendre le monde grâce au concept-clé qui est l’apanage des géographes : le territoire.
Il oriente ses travaux de recherche sur son île natale. Hispaniola est le territoire de deux entités distinctes, Haïti et la République dominicaine, proches mais séparées par une frontière terrestre et maritime.
Il en tire le concept d’un île pour deux. Une relation dialectique s’installe, faite de solidarité et d’inimitié. Aujourd’hui beaucoup d’Haïtiens vont chercher chez leur voisin les services dont ils ne bénéficient pas chez eux (école, santé…). Mais pour freiner immigration illégale et commerce mafieux, le gouvernement dominicain décide d’ériger un mur en béton de 164 km de long sur les 376 km de frontière terrestre. La construction commence en février 2022. En septembre dernier, la situation empire lorsque ce même gouvernement décide de verrouiller totalement la frontière.
Pour un Afrodescendant, l’Afrique est à la fois un lieu d’ancrage et de racines profondes. J.-M. Théodat a rencontré tardivement la négritude africaine grâce à un voyage en Gambie où il est allé mettre en place une école francophone. Il se demande ce que représente l’Afrique dans son appareillage intellectuel, l’Afrique dont il essaye de trouver les traces du passé le plus ancien par l’archéologie.
Haïti, France et Afrique sont les trois ancrages qu’il revendique. Ce sont les trois côtés d’une identité triangulaire.
« Haïti en nous »
Comment transmettre l’héritage d’Haïti autrement qu’à travers les clichés véhiculés par les médias, tous négatifs ?
Peut-on dire d’Haïti qu’elle a été une « fille aînée de la Révolution » ?. C’est plutôt le contraire qu’il faut dire. La révolution haïtienne commencée en août 1791, sous la conduite de Toussaint Louverture, défend l’idée que « tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits ». La Convention proclame l’abolition de l’esclavage le 4 février 1794, mais c’est sous la pression du soulèvement des esclaves et de la menace des Anglais et des Espagnols en guerre contre la République. Les Haïtiens combattent aussi pour l’indépendance qui est proclamée en 1804 après douze années de conflit avec la France.
Mais pour être reconnu par la plupart des nations, Haïti,pourtant victorieuse des troupes françaises sur le terrain, avait besoin de l’onction de la France. Après de difficiles négociations, Charles X signe, en 1825, un décret qui « vend » l’indépendance contre le paiement d’une indemnité, versée aux descendants des colons expulsés de l’île. Cette dette a lourdement pesé sur le destin du pays.
La mémoire haïtienne de J.-M. Théodat et sa mémoire française se ressourcent à la même fontaine qui est l’esprit des Lumières.
Questions de la salle
1-Comment passe-t-on d’Haïti à la République dominicaine ?
J.-M. Théodat rappelle l’édification d’un mur sur le tracé de la frontière et le besoin d’un visa payant très difficile à obtenir, ce qui entraine de nombreux passages illégaux. Il annonce une information de dernière minute : la réouverture partielle de la frontière fermée en septembre pour le 11 octobre.
2-Comment la communauté internationale (ONU, ONG…) intervient-elle à Haïti depuis un certain temps ?
Des aides d’un montant de 9 milliards $ ont été apportées après le séisme de 2010, mais cet argent venu du monde entier a peu servi. Même si une partie est peut-être retournée vers son pays d’origine, la principale cause de cette inefficacité est l’incapacité de l’Etat à prendre la relève des ONG après leur départ.
3-Y a-t-il eu une réforme agraire ? A qui appartiennent les terres ?
En 1804, la taille des plantations coloniales variait entre 300 et 400 ha sur lesquelles travaillaient de nombreux esclaves. Toussaint Louverture les a transformées en propriétés d’Etat où les paysans, anciens esclaves, étaient soumis à un régime sévère. Aussi beaucoup prirent-ils la fuite et sont devenus « possesseurs » et non « propriétaires » de très petites exploitations (moins de 0,5 ha) où ils pratiquaient un jardinage d’autosubsistance. S’est constituée une bourgeoisie rentière vivant du travail des paysans grâce à l’exportation des denrées tropicales (café, sucre…) et à l’importation d’outils. On peut parler d’économie de comptoir.
4-Quel est le rôle de la force kenyane envoyée par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 2 octobre 2023 ?
J.-M. Théodat précise qu’à cause de l’abstention de la Russie et de la Chine, cette mission est financée, non par l’ONU mais par des contributeurs volontaires, essentiellement les Etats Unis. Le Kenya s’est dit prêt à envoyer 1000 policiers pour lutter contre les gangs, ce qui semble bien peu pour un pays qui n’est guère habitué à la gestion des crises (1). Le choix du Kenya a été un choix par défaut.
5-Quelles sont les conséquences de la situation en Haïti sur la Guadeloupe et la Martinique ?
Deux visions s’opposent, celle des intellectuels qui vouent un culte sacré à Haïti (particulièrement Aimé Césaire) et celle des Caribéens de base qui rejettent les Haïtiens. Cette posture est un héritage de l’image entretenue par les colons, celle d’un pays soumis aux forces négatives (pays du vaudou…). Les ouvriers sont nombreux parmi les ouvriers agricoles sur les plantations de banane, surtout en Guyane.
Les événements haïtiens sont suivis de près par la presse antillaise et guyanaise. En Guyane l’apport des Haïtiens permet à la créolitude de se maintenir à flot par rapport aux flux migratoires venus du Brésil ou d’ailleurs.
6-Peut-on espérer une sortie du gouffre ?
Dès l’origine, le pays s’est battu seul et a maintenu son indépendance ; la révolte des esclaves a été victorieuse alors qu’elle aurait dû être écrasée.
Aujourd’hui des gens courageux maintiennent l’esprit de résistance. Ne pas oublier que les Haïtiens sont les descendants des esclaves qui ont réchappé à la grande traversée transatlantique.
Note :
1) Le 9 octobre, la Haute Cour du Kenya a interdit le déploiement des forces de sécurité du pays dans d’autres pays pendant deux semaines jusqu’à ce qu’une plainte déposée par un homme politique local soit examinée.Michèle Vignaux, octobre 2023
-
 11:26
11:26 Une rencontre avec Hervé Le Bras sur les « inégalités en France »
sur Les cafés géographiques
Daniel Oster, modérateur, et Hervé Le Bras
Les Cafés Géo ont eu le plaisir d’accueillir au Flore Hervé Le Bras dont L’Atlas des inégalités. Les Français face à la crise (1) est sorti récemment.
Hervé Le Bras a un parcours universitaire et professionnel original car il a acquis autant de compétences dans les sciences dites « dures » que dans les sciences humaines. Jeune polytechnicien, il est parti au Tchad en tant qu’anthropologue, puis a fait des études de démographie et de mathématiques économiques. Mais c’est comme démographe qu’il est surtout connu du grand public grâce à de nombreux travaux et de fréquentes interventions dans les médias. Son intérêt pour l’espace et les localisations précises a enrichi des travaux que la plupart des démographes ne fondaient que sur des données statistiques.
Dans un premier temps notre invité s’attache à définir le sujet de son ouvrage et quelques points de méthode.
Le terme « inégalité » est à distinguer de « différence » qui ne comporte pas de contenu dépréciatif. Les inégalités de revenus, de patrimoines…sont des phénomènes mesurables derrière lesquels se trouvent un certain nombre de déterminants et qui entrainent des ségrégations. Pour montrer l’évolution des inégalités au sein de la population, on utilise l’indice (ou coefficient) de Gini qui range les individus par ordre de revenus. On peut ainsi en constater la plus ou moins grande régularité. En baisse jusqu’à 2005, les inégalités augmentent légèrement depuis, et n’ont pas été accentuées par la COVID.
L’indice de Gini n’est pas utilisable dans l’espace. La représentation spatiale des inégalités pose un problème d’échelle. Selon que l’on choisisse l’échelle de la région, du département ou de la commune, l’indice ne sera pas le même. On peut alors parler de « tromperie écologique ». L’étude de la relation entre le vote RN et la présence d’immigrés montre une corrélation au niveau régional l’absence de corrélation au niveau départemental et une corrélation inversée au niveau communal (plus il y a d’immigrés, moins il y a de votes RN). On observe le même phénomène en Suisse et en Allemagne. Il est donc essentiel de travailler à plusieurs échelles, celle des départements, des communes et des quartiers des agglomérations, au sein desquelles les différences sont de plus en plus fortes.
Mais comment représenter les 34 000 communes métropolitaines sur une carte ? On utilise la technique du lissage pour rendre les cartes plus lisibles et celle des anamorphoses (par exemple, la surface occupée par une commune sur une carte est proportionnelle au nombre d’habitants et non à sa superficie). Il est bon de juxtaposer cartes classiques et cartes par anamorphoses.
Dans un second temps, Hervé Le Bras nous donne le résultat de ses travaux.
La première observation porte sur les régularités et les permanences qui caractérisent la société française.
Au niveau régional, on peut distinguer deux France, de part et d’autre d’une ligne Le Havre/Belfort : une France du Nord aux paramètres peu satisfaisants et une France du Sud plus diverse.
Ces différences ont leurs sources dans une histoire séculaire. La France du Sud, naguère de droit écrit, où les héritages étaient inégalitaires, a maintenu une petite propriété paysanne et de nombreux artisans alors que le Nord où l’égalité était plus stricte dans le partage des biens, est une région de grande propriété où les ouvriers agricoles sont nombreux jusqu’à l’exode rural ou plus exactement vers l’industrie.
La distinction entre pays de tradition catholique et pays peu catholiques perdure depuis la Révolution. Les réactions à la Constitution civile du clergé (vote en juillet 1790 mais obligation de serment en janvier 1791) sont encore perceptibles dans l’espace national. Là où il y eut une majorité de prêtres réfractaires (hostiles au texte), la pratique religieuse reste plus élevée – c’est le cas de la Bretagne ou du pays basque – ; là où les prêtres jureurs (favorables au texte) l’emportèrent, cette pratique est faible – c’est le cas du Limousin ou de la Champagne-. Une grande enquête de 1965 dans chaque paroisse portant sur l’assistance chaque dimanche à la messe a montré la persistance de cette géographie.
Les différences entre pays d’agglomération et pays de population éparse appartiennent aussi à l’histoire longue. Par exemple, au XIXème siècle, 95% de la population de la Marne vivaient en agglomération, ce qui n’était le cas que de 25% en Ille et Vilaine. Or les sociabilités ne sont pas les mêmes entre ces deux « façons d’habiter ». L’occupant de bocage, maître sur sa parcelle, voit peu ses voisins. Cette coupure se retrouve au jourd’hui sur le plan politique : faible dans les régions de population éparse, le RN connait des taux élevés dans les régions d’agglomération.
Le second enseignement des recherches d’Hervé Le Bras porte sur les évolutions.
Les migrations internes actuelles dépeuplent les zones qui se situent au Nord d’une ligne Saint-Malo-Genève, alors que les communes du Sud ont un solde positif. Ce contraste ne s’explique pas par un différentiel de dynamisme économique comme le montre l’exemple du Roussillon qui combine solde positif et fort taux de chômage.
Les agglomérations les plus importantes concentrent les revenus les plus élevés. Mais depuis une quinzaine d’années, ils ont moins augmenté dans les villes que dans les campagnes « profondes », ce qui pourrait être expliqué par le remplacement d’agriculteurs pauvres par des retraités).
Peut-on expliquer les cartes politiques en combinant plusieurs données ?
L’analyse de la carte montrant le vote en faveur d’E. Macron, commune par commune, en 2017, indique clairement qu’il a récupéré les voix de F Bayrou et la moitié des voix de F Hollande. L’électorat du Président de la République est aussi majoritaire dans l’Ouest et une grande partie du Centre, là où les enfants des agriculteurs sont montés dans l’échelle sociale et ont confiance dans la continuité de l’ascension sociale. Dans l’Est et le Nord-Est, au contraire, beaucoup d’enfants d’ouvriers ont connu le chômage et le déclassement. Cette carte correspond à l’étude faite par Daniel Cohen sur la France des optimistes et celle des pessimistes.
En fin d’exposé, Hervé Le Bras montre quelques photos de cartes dont nous pouvons retenir les conclusions : une croissance plus forte, entre 2001 et 2005, dans les régions rurales (Cotentin, Massif Central) que dans les agglomérations, un plus grand nombre d’ouvriers qualifiés (CAP, BEP)aujourd’hui dans le Massif Central et en Bretagne que dans les métropoles, des contrastes entre les taux de chômage selon les quartiers d’une même ville (forts dans le centre à Perpignan et dans la périphérie à Rennes), une division spatiale nette entre quartiers d’immigrés européens et non-européens à Marseille…
Questions posées par le public
- Quelle corrélation peut-on trouver entre les Gilets jaunes et les territoires ?
Les statistiques faites à partir des déclarations des personnes ayant annoncé sur Internet qu’elles manifesteraient le 17 novembre 2018 montrent une forte implication des habitants de la « diagonale du vide » (Ardennes- sud du Massif Central). Il s’agit de régions à très faible densité, en voie de dépopulation où l’accès aux services, notamment ceux de santé, est difficile. L’Etat n’est pas le principal responsable de cette situation car les fonctionnaires sont assez nombreux dans la « diagonale du vide ». Mais le gouvernement a sous-estimé la place occupée par la voiture dans la vie et le budget des ménages (aux alentours de 30%).
- Quelle est l’évolution des inégalités de revenus ?
Les cartes des revenus sont élaborées à partir des statistiques de l’INSEE qui prend en compte les revenus après redistribution. Elles montrent une faible augmentation des inégalités. Si les plus pauvres ont connu une légère détérioration de leurs ressources, les classes moyennes ont bénéficié d’une faible augmentation. Dans les 10% des revenus les plus élevés, le 1% supérieur a gagné 14% alors que les 9% suivants ont connu une érosion de leurs ressources selon l’institut des politiques publiques (IPP).
- Comment définir les « classes moyennes » ?
C’est une expression qu’il est impossible de définir, même si son utilisation est ancienne (elle a déjà été utilisée par Aristote !). C’est un moyen de mettre « quelque chose » entre les capitalistes et les prolétaires.
- Pourquoi avez-vous qualifié de « scandaleuse » la réforme des retraites ?
Elle a mal pris en compte les carrières longues, commencées avant 21 ans mais qui ne présentent pas toujours 43 ans de cotisation car beaucoup de carrières sont hachées et certains trimestres ne sont pas cotisés. Ce sont les plus pauvres qui payeront le maigre bénéfice obtenu par le gouvernement (5,7 milliards en 2030 selon le COR)
D’autre part si globalement les actifs payent les retraites (cf A Sauvy), plusieurs régimes séparés fonctionnent différemment. C’est le cas de la FPE (Fonction publique d’Etat) qui reçoit 58 milliards € de subventions d’équilibre car il y a 1 retraité pour 0,9 actif contre 1 pour 1,7 actifs dans le régime général. Il faut donc compenser le déséquilibre, par les autres caisses, mais l’Etat n’ose pas le faire et allonge une subvention « d’équilibre ». La présentation du déficit par le conseil d’orientation des retraites (COR) néglige ce fait et n’a donc aucune réalité.
- Où se trouvent les abstentionnistes ?
On peut se référer aux travaux d’Alain Lancelot sur l’abstentionnisme électoral.
L’abstention est difficile à représenter géographiquement. Dans l’ensemble, on peut dire qu’il y a moins d’abstentions dans les zones rurales, mais il n’y a pas de structure régionale stable ni véritablement interprétable dans les termes des résultats des partis.
- Peut-on traiter des inégalités sans carte ?
Politologues et géographes ont intérêt à travailler ensemble. Les premiers travaillent avec des enquêtes qui montrent les changements rapides ; les seconds soulignent notamment les permanences. Hervé Le Bras et Jérôme Fourquet ont ainsi collaboré à un ouvrage commun (2).
- Pourquoi ne traiter que de la France métropolitaine sans évoquer les DOM TOM ?
L’absence de continuité territoriale et les passés différents font qu’il s’agit d’autres mondes qui relèvent d’un traitement à part.
- Comment traiter des émeutes ?
Leur étude se heurte à un problème de sources, de fiabilité des chiffres. De plus dans les manifestations les personnes viennent souvent de très loin. Leur origine est donc difficile à localiser. Ce qu’il est possible d’évaluer, c’est l’augmentation ou la diminution du nombre de manifestants d’une manifestation à la suivante dans le même lieu, une ville, en particulier.
Notes :
- LE BRAS, Atlas des inégalités. Les Français face à la crise, deuxième édition, Editions Autrement, 2023
- FOURQUET et H. LE BRAS, La religion dévoilée. Nouvelle géographie du catholicisme, Fondation Jean Jaurès, 2014
Michèle Vignaux (relecture de H. Le Bras), septembre 2023
-
 15:53
15:53 Prix du Livre de géographie 2024
sur Les cafés géographiquesLe Prix du Livre de géographie des lycéens et étudiants sera décerné en 2024 à un des ouvrages cités ci-dessous.
Gilles Fumey, Alexandre de Humboldt. L’eau et le feu, Double ligne, 2022.
Raphaël Mathevet et Roméo Bondon, Sangliers. Géographies d’un animal politique, Actes Sud, 2022.
Basile Michel, Les quartiers culturels et créatifs, Le Manuscrit, 2022.
Marion Tillous (dir.), Espace, genre et violences conjugales, ce que révèle la crise de la Covid 19, GéoTraverses, 2022.
Nephtys Zwer (dir.), Ceci n’est pas un atlas, Éditions du commun, 2023.
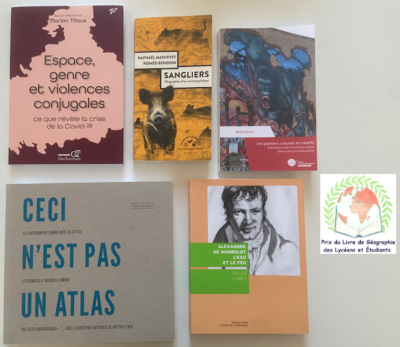
-
 15:47
15:47 Un prochain colloque sur l’Intelligence artificielle à Albi
sur Les cafés géographiquesNos amis d’Albi nous informent de la tenue d’un colloque, les 5 et 6 octobre 2023 sur “l’IA et les Institutions publiques”, au campus de Champollion à Albi. Vous pouvez vous inscrire grâce au lien [https:]]
Le programme se trouve sur la page des Cafés d’Albi. -
 11:14
11:14 Partir pour Israël. Une nouvelle migration des juifs de France ?
sur Les cafés géographiques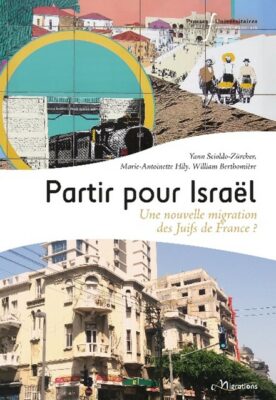
Cet ouvrage (1) de taille modeste est enrichi d’un lexique, d’une abondante bibliographie et d’annexes présentant des données statistiques. Il traite d’une question d’actualité : l’alya des juifs de France depuis les années 2000, c’est-à-dire leur migration vers Israël depuis deux décennies. Même si ce phénomène est ancien et bien replacé dans son contexte historique par les auteurs, il a connu une recrudescence dans les années 2010. Pourquoi et comment s’effectuent ces flux migratoires ? Les trois auteurs (un historien, une sociologue et un géographe) ont confronté leurs méthodes disciplinaires pour expliquer un mouvement qui pose question à la société française, aux motivations complexes des olim (personnes qui font leur alya) et aux politiques menées par les autorités d’Israël. A l’échelle de la communauté juive mondiale ou de l’Etat israélien, le sujet peut sembler marginal (de 1948 à 2017 les olim venus de France n’ont représenté que 3,5% des immigrants), mais son analyse apporte de nombreux thèmes de réflexion, politiques, culturels et sociologiques que les auteurs exposent avec clarté et nuance.
Qu’est-ce qui amène une personne ou une famille juives à quitter le pays natal, la France, pour s’installer en Israël ?
Une réponse semble s’imposer : l’antisémitisme et le sentiment d’insécurité qu’il entraîne. Le phénomène est ancien mais ce terme recouvre des réalités différentes selon les périodes. Caractérisant l’extrême-droite dans le passé, il a été ravivé ces dernières décennies par le conflit israélo-palestinien et par l’islamisme radical. En fait le niveau d’antisémitisme est bas dans l’ensemble de la population française, mais attaques ciblées et attentats ont créé une nouvelle peur dans la communauté (une interrogation : quitter la France, même la banlieue est de Paris, pour une colonie en Cisjordanie, est-ce gagner en sécurité ?).
Si l’antisémitisme peut être évoqué par tous les olim, l’étude des entretiens que les auteurs ont réalisés montre une diversité de motivations, même si tous adhèrent au discours nationaliste du gouvernement et voient en Israël un avenir protecteur. L’idéologie socialiste qui animait beaucoup de migrants dans les décennies qui ont suivi la création de l’Etat (1948) a peu à peu été remplacée par des mouvements de droite.
Trois groupes se distinguent par leur âge, leur appartenance religieuse, leur style de vie et le lieu de leur implantation en Israël.
Le groupe le plus déterminé, le plus homogène, est celui des religieux, traditionalistes et surtout ultra-orthodoxes pour qui vivre en Israël dans un entre-soi étroit est une « prescription ». La majorité s’installe à Jérusalem. Les ultra-orthodoxes constituent un « monde à part » au sein d’un Etat qui leur accorde des avantages particuliers : ils sont exemptés du service militaire et bénéficient d’allocations mensuelles qui leur permettent de consacrer leurs journées à l’étude des textes religieux dans les yeshivot et les kollels.
Beaucoup de jeunes, étudiants et actifs, sont attirés par l’image de « pays neuf » que présente Israël, un pays qui leur permettrait de changer de milieu, de « changer de vie ». Le néo-libéralisme qui prévaut dans la société israélienne, sa réputation de « start up nation » sont des atouts pour ceux qui ont le « souci d’entreprendre ». Pour cette catégorie d’olim, le lieu d’implantation est le District Centre (2) et surtout Tel Aviv mais certains gardent des liens professionnels avec la France.
L’héliotropisme et les avantages fiscaux (impôts sur les pensions moins lourds en Israël qu’en France) semblent séduire les retraités qui s’installent sur la frange littorale, dans des stations comme Netanya.
Les interviews des nouveaux migrants évoquent aussi des motivations difficiles à classer comme l’échec scolaire en France ou le désir de « vivre près de la mer ».
Le départ de France et l’installation en Israël sont rarement des aventures solitaires. L’Agence juive qui coordonne la politique de l’alya et de la klita (assimilation) joue un rôle considérable auprès des jeunes comme des adultes pour susciter le désir de migrer et faciliter l’installation (elle a pris en charge 70% des olim de France en 2019). Pour promouvoir l’alya, elle dispose de nombreux programmes surtout destinés aux jeunes (voyages offerts, insertions temporaires, accueil de lycéens…) mais aussi organise des Salons où les aspirants au départ trouvent toutes les informations possibles sur les démarches à effectuer, les conditions d’installation, les aides apportées, le soutien donné sur place par les associations francophones, le service national considéré comme intégrateur. Actifs et retraités ont aussi leurs espaces d’information et chaque migrant est en contact avec un chargé de projet en Israël. D’autres associations non étatiques contribuent à cette prise en charge, comme l’association « Alya » qui prône l’idéologie du « Grand Israël » et facilite l’installation dans les territoires palestiniens.
Alors l’alya des juifs de France est-il une réussite ?
La réponse des auteurs est nuancée car la recherche bute contre un obstacle majeur : l’absence de données chiffrées sur les olim qui retournent en France, sujet tabou pour le gouvernement israélien. La confrontation avec une société idéalisée est parfois difficile et plusieurs témoignages décrivent des difficultés d’intégration pour des raisons matérielles et/ou culturelles.
La paupérisation menace une partie des migrants, notamment ceux qui sont munis de diplômes non reconnus en Israël. Un architecte, une dentiste…témoignent de leur déclassement. Leur situation financière est d’autant plus fragile que des services quasiment gratuits en France (santé, éducation…) sont coûteux dans le pays d’accueil.
Même sur le plan religieux, l’ambiance est différente. Les pratiques rigoristes ne correspondent pas exactement à ce qu’un juif de France appelle « judaïsme traditionnel ». L’enseignement en donne un exemple : il est difficile de trouver une école où coexistent enseignement religieux et matières laïques. L’opposition entre orthodoxes et laïcs est totale en Israël.
Les fortes inégalités, la lourdeur du service national, la faiblesse des services publics expliquent aussi les retours d’olim récemment installés. Ce qui caractérise l’alya française aujourd’hui, c’est la forte proportion d’une population mobile qui partage sa vie entre Israël et la France pour conserver son niveau de vie. Ce va-et-vient est source d’inquiétude pour les autorités chargées d’assurer la réussite de l’alya.
Notes :
1) Yann SCIOLDO-ZÜRCHER, Marie-Antoinette HILY, William BERTHOMIERE, Partir pour Israël. Une nouvelle migration des Juifs de France, Presses universitaires François-Rabelais, 2023.
2)District Centre : nom donné à l’un des six districts israéliens, peuplé d’environ 1 800 000 habitants et dont la capitale administrative est Ramla.
Michèle Vignaux, septembre 2023
-
 22:41
22:41 Les stations de ski fantômes : mythes et réalité d’un angle mort de la géographie du tourisme
sur Les cafés géographiquesPar Pierre-Alexandre Metral
Doctorant en géographe – Université Grenoble AlpesPierre-Alexandre Metral qui réalise actuellement une thèse à l’UGA dans le cadre du Labex Innovations et Transitions Territoriales en Montagne (ITTEM) intitulée « La montagne désarmée, une analyse des trajectoires territoriales des stations de ski abandonnées » est intervenu le 18 avril 2023 à Chambéry dans le cadre d’un Café Géographie.
En guise de préambule, l’intervenant est revenu sur ce « phénomène des stations de ski fermées qui revient de plus en plus fréquemment dans les médias à travers le mythe de la station de ski fantôme ». Selon lui, le terme de « station de ski fantôme » est une dénomination bien particulière qui fait éminemment référence à une activité ancienne qui viendrait marquer l’histoire d’un territoire vécu et qui s’ancrerait comme un traumatisme qui ne passe pas.
Pour ce dernier, la station de ski fantôme renvoie à l’omniprésence des friches constituées d’un certain nombre de bâtiments et d’infrastructures délaissés, qui s’établissent comme des marqueurs de déprises sur les territoires, symbolisés par la rouille de ces installations. Des friches qu’il caractérise comme des espaces en « accès libre pour des pratiques contre culturelles ».
A partir de ce cadrage, Pierre-Alexandre Metral propose la problématique suivante pour ce Café géo : Est-ce que le mythe de la station de ski fantôme est représentatif de la mise à l’arrêt des domaines skiables français ?
1/ La « fin touristique » : normalité ou anomalie ?
Pour l’intervenant, la vie de tout produit économique est marquée par l’idée de cycle de vie allant d’une introduction sur un marché jusqu’à son retrait. Pour transposer ce cycle de vie au cadre du tourisme, il évoque les travaux de Michel Chadefaud pour qui « le tourisme est un bien non durable […] marqué par une activation et une désactivation ». Pour illustrer ses propos, Pierre-Alexandre Metral projette la figure du cycle de vie d’un bien touristique.
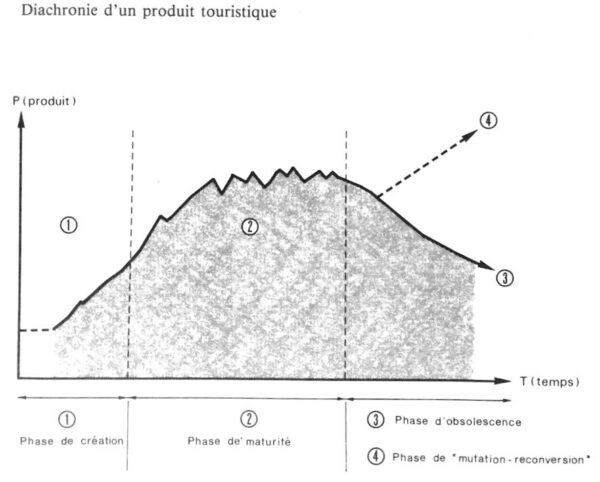
Fig 1 : cycle de vie des produits touristiques – Michel Chadefaud 1988
A l’issue de la présentation de cette figure, le doctorant a proposé une série d’illustrations de proximité au public en présentant diverses « fins touristiques » du bassin chambérien. Il a notamment évoqué le cas de l’abandon du téléphérique du Mont Revard qui a fonctionné jusqu’à la fin de la décennie 1960 en lien avec l’activité thermale de la ville d’Aix-les-Bains.

Fig 2 : La gare de départ en 2022 – P-A Metral
2/ Pourquoi un domaine skiable ferme-t-il ?
En réponse à cette interrogation, Pierre-Alexandre Metral évoque des conditions d’exploitation de plus en plus vulnérables :
– Obsolescence des conditions d’exploitation liée au manque de neige
– Obsolescence face à la concurrence entre petits et grands domaines skiables
– Obsolescence du site d’implantation en raison d’accès routiers complexes
– Obsolescence de l’équipement avec des coûts d’exploitation et de maintenance de plus en plus onéreux corrélé au vieillissement des installations
– Obsolescence de certains modèles de développement en lien avec la disparition des classes de neige par exempleConcrètement, il lui est possible d’identifier 3 causes majeures de fermeture. En premier lieu et principalement, le motif économique avec des domaines skiables non rentables (ex : Pugmal dans les Pyrénées et ses 9,2 millions d’euros d’endettement). Vient ensuite l’épuisement des ressources humaines avec le départ en retraite d’exploitants privés sans transmission du capital touristique. Ce fut par exemple le cas dans le Jura où le petit téléski des Clochettes cessera son exploitation à la suite au décès de son fondateur et exploitant. Enfin, le cas des fermetures stratégiques liées à la mauvaise qualité des sites d’implantation et au redéploiement des activités sur de meilleures pentes. Pierre-Alexandre Metral évoque pour cela l’éphémère domaine de Supervallée à la Bresse (5 années d’exploitation), implanté sur un secteur pluvieux, qui deviendra suite à son déplacement en altitude la station de La Bresse, plus grand domaine skiable du massif vosgien.

Fig 3 : stade de neige du Puigmal en 2020, P-A Metral
3/ Quelle est la géo-histoire du phénomène de fermeture ?
Cette troisième partie est l’occasion pour l’intervenant de mettre en avant l’absence d’inventaire des domaines fermés. Pour remédier à cet écueil, il s’est attaché dans le cadre de sa thèse à réaliser un inventaire exhaustif à partir de différentes sources qu’il présente au public : ouvrages et articles scientifiques anciens sur le ski, articles de presses locales, cartes topographiques, cartes postales et vues aériennes anciennes … Tout cela lui permettant « d’établir une base de données spatialisée des sites fermés en France. S’ensuit la présentation d’une animation cartographique qui présente les ouvertures et les fermetures de stations sur l’hexagone entre 1920 et 2022.
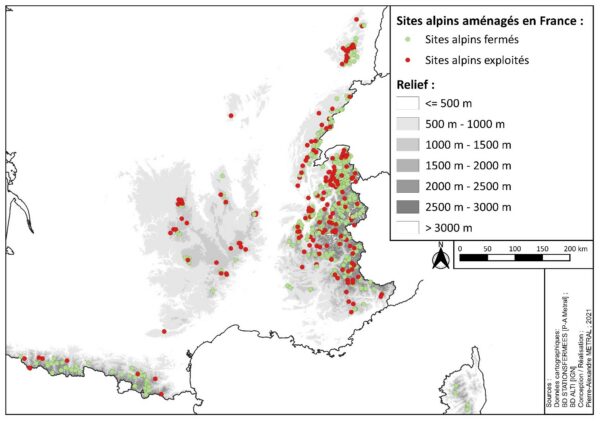
Fig 4 : Carte de localisation des sites français fermés et actuellement actifs en 2022 – BD STATIONSFERMEES, P-A Metral, 2022
A l’issue de cette animation Pierre-Alexandre Metral indique que ce phénomène de fermeture de stations touche tous les massifs montagneux en France (sauf la Corse) avec un épicentre dans les Alpes compte tenu de l’ampleur de ce dernier. Il présente également un taux de fermeture (rapport entre le nombre de sites fermés et actifs) tiré de ces travaux de thèse à hauteur de 31 %. Un taux apparaissant inégal en fonction des massifs de montagne : la moyenne montagne apparaissant en moyenne bien plus marquée par le phénomène de fermeture. Il termine son analyse statistique en cherchant à recontextualiser l’ampleur des fermetures en France : « les petits domaines skiables de basse ou moyenne montagne apparaissent donc les plus fragiles. Ils représentent au total 350 kilomètres de pistes en cumulé, soit une perte sèche de 3,34 % du domaine skiable français actuel ».
4/ Les stations fantômes sont-elles réellement des stations ?
Cette nouvelle interrogation proposée par Pierre-Alexandre Metral, lui permet de faire remarquer qu’un grand nombre de « stations fantômes » sont en réalité : des centres de ski (135/186) , soit des sites mono-spécialisés dans la pratique du ski, parfois rudimentaires, ne comptant uniquement les équipements essentiels à la pratique (parking + remontée mécanique) des stades de neige (43/186) auquel il faut ajouter la fonction de services touristiques in situ (location de ski, petite restauration…) et enfin de toutes petites stations touristiques (8/186) qui comptaient quelques lits marchands pour une offre de séjours. Il conclut ce quatrième temps en indiquant qu’en réalité les sites apparentés à de « petites stations touristiques » sont encore peu concernés par les mises à l’arrêt de leurs domaines skiables. Pour autant, la dynamique de ces 20 dernières années expose que ces sites tendent de plus en plus à être touchés par l’arrêt de l’offre de ski.
5/ Une incarnation de la station fantôme : la friche touristique
Ce cinquième temps proposé par le doctorant lui permet d’évoquer les pistes possibles de reconversion des appareils de remontées mécaniques définitivement mis à l’arrêt. Néanmoins, il avertit d’emblée le public que ces reconversions sont pour beaucoup illusoires : les réactivations des domaines skiables sont risquées, la mono-spécialisation des équipements fait que le réemploi du matériel pour des loisirs d’été est extrêmement rare, que le marché de l’occasion est devenu une niche impénétrable faute à un matériel vieillissant et totalement obsolète.
Toujours en lien avec cette question de la friche touristique, l’intervenant aborde la question du démontage des appareils dont le coût est très élevé (entre 5000 et 20 000 € pour un téléski), avec bien souvent à la sortie des installations laissées en place et qui se détériorent faute de financements et parfois même à l’oubli des appareils le temps passant. Le « bilan comptable » du délaissement des appareils des sites fermés français est ainsi présenté : 92 appareils en friche en France en 2023 répartis en 3 catégories : 87 téléskis, 3 télésièges, 2 téléphériques. Si la majeure partie des appareils délaissés sont issus de fermetures récentes et qu’ils pourront éventuellement être réactivés, 30 appareils ont tout de même été abandonnés il y a plus de 20 ans ; les plus anciens depuis 1951.
6/ Vers la fin des friches touristiques ?
Cet avant-dernier point permet à Pierre-Alexandre Metral de revenir sur les initiatives nouvelles visant à accompagner le démontage et contenir le phénomène de délaissement. Au premier chef, les dispositions de la Loi Montagne II (2016) fixant notamment un échéancier dans le temps pour aboutir à un démontage. Le doctorant dans une posture plus critique pointe cependant ses limites, notamment la non-rétroactivité de ces dispositions faisant que les appareils d’ores et déjà délaissés ne sont pas concernés.
Par la suite, les corps intermédiaires engagés dans le démantèlement sont présentés. D’une part, Mountain Wilderness, l’acteur historique du démontage des installations obsolètes qui depuis 2001) a opéré par la voie bénévole au retrait d’une vingtaine d’appareils. D’autre part, la chambre professionnelle des exploitants de domaines skiables (Domaines Skiables de France) est engagée à l’organisation du démontage de 3 appareils délaissés par ans avec le concours d’opérateurs régionaux encore actifs qui vont réaliser les travaux dans une logique de solidarité.

Fig 5a et 5b : Le démantèlement des téléskis de Sainte-Eulalie (07) – P-A Metral, 2020
7/ La reconversion des anciennes stations de ski
Ce dernier temps proposé par l’intervenant est l’occasion de dresser des perspectives en matière de revivification des sites après la fermeture des domaines alpins. Il identifie ainsi un ensemble de trajectoires : le retour à l’état pré-touristique (alpages, forêt) et des activités agro-sylvo-pastorales. La reconversion des sites en bases de loisirs de montagne avec le développement d’activités organisées sur la saison d’été. Le réinvestissement des logements touristiques pour de l’habitat permanent, transformant ainsi les anciennes stations en hameaux de montagne. Enfin, Pierre-Alexandre Metral ne minore pas les pratiques récréatives réalisées en autonomie (ski de randonnée, vtt…), parfois aussi furtives, dissidentes et contre-culturelles (free party, street ski, street art…) qui dans une logique de réappropriation, redonnent de la vie et du sens aux anciens sites abandonnés.
Conclusion :
Pour Pierre-Alexandre Metral « le phénomène de fermeture est important en effectif avec 186 sites concernés », néanmoins la plupart sont de tailles insignifiantes, bien loin de l’image de la station fantôme évoquée en introduction. Ce mythe s’ancre en réalité sur « des cas sensationnels, très visuels et au final peu représentatifs du paysage réel des fermetures françaises ». Ces mises à l’arrêt illustrent, « plus que la fin du ski », la disparition d’un modèle de développement spécifique aujourd’hui presque disparu : les centres de ski. La carte du ski français se voit progressivement amputée des sites « de proximité », dédiés à l’apprentissage ; un ski de village, résolument social, où les tarifs pratiqués étaient aux antipodes des grands domaines alpins qui font la renommée du ski français.
Il termine ce café géo par ces mots « la station fantôme c’est le temps de l’incertitude, l’enjeu demain c’est de pouvoir anticiper en amont des fermetures la question de la remise en état des sites et leurs éventuelles reconversions ».
Par Yannis NACEF
Professeur agrégé de Géographie
Doctorant en Géographie – UMR 5204 EDYTEM – Université Savoie Mont Blanc – CNRS -
 19:30
19:30 L’épicerie du monde. La mondialisation par les produits alimentaires du XVIIIe siècle à nos jours
sur Les cafés géographiques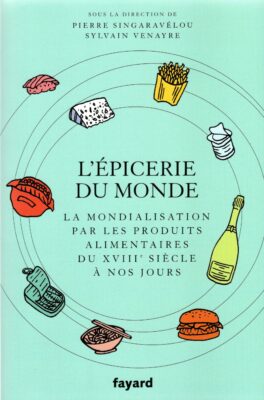
Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre ont convié à l’écriture « d’une histoire du monde par les produits alimentaires » de très nombreux auteurs. Pas moins de 400 pages qui se dévorent à pleines dents. Vous ne serez pas surpris que le chapitre sur le vin soit confié à Jean-Robert Pitte et que Christian Grataloup vous invite à la consommation du thé et à la dégustation de la baguette de pain tandis que Philippe Pelletier vous propose sushi et saké. Emmanuelle Perez Tisserant offre le chili con carne et le guacamole. Sylvain Venayre nous sert des charcuteries et du ketchup, Pierre Singaravélou opte pour le whisky et le rhum. Une centaine de produits sont proposés, dans un inventaire à la Prévert, où chacun pourra tout à la fois s’instruire gaiement et se mettre l’eau à la bouche. A vous tous, gourmands ou gourmets, ils offrent un savoureux voyage dans la grande « épicerie du monde ». Vous terminerez avec une coupe de champagne proposée par Stéphane Le Bras.
L’épicerie, magasin consacré aux produits alimentaires, se généralise au milieu du XVIIIe siècle. Mais le commerce des épices est bien plus ancien. En Angleterre la guilde des poivriers date de 1180 et l’épicerie est « magasin d’épices » avant de devenir boutique de produits alimentaires. La Révolution industrielle et la révolution des transports vont mondialiser les désirs identitaires, dont ceux liés à la gastronomie. Les expositions universelles apporteront à leur tour une mondialisation des offres. La baguette française, le roquefort et bien sûr les vins français doivent paraître sur les grandes tables, au XXe siècle.
Qui ne connaît à présent le Christmas pudding, emblème de l’empire britannique, la pizza italienne, le saké japonais, la féta grecque ou le ceviche péruvien ! Mais êtes-vous sûrs de connaître la patrie du couscous, du houmous, de la vodka ?L‘accès aux produits alimentaires est vital pour les populations. Des guerres peuvent éclater ici ou là. Les historiens ont noté la destruction du thé britannique par les colons de Boston en 1773. Dans un contexte différent, la guerre entre l’Ukraine et la Russie (ou plus exactement l’invasion de l’Ukraine), enclenchée en février 2022, comporte un volet alimentaire : celui des céréales exportées par l’Ukraine mais à présent retenues par les navires russes. Cela va provoquer des crises alimentaires graves, deux milliards de personnes restant frappés de malnutrition.
Les pratiques sociétales évoluent. Il n’y a pas si longtemps on pouvait rester plusieurs heures à table lors des repas dominicaux ; il y avait l’heure du thé en Angleterre, l’heure du raki en Turquie. Les femmes au foyer préparaient « avec amour » des plats appétissants. Mais la généralisation du travail féminin a conduit à la consommation de boîtes de conserves puis de plats surgelés. La publicité s’est chargée de vous faire acheter du Coca Cola dès 1916 !
Au début du XXIe siècle, la restauration doit être rapide, autour d’une baraque à frites ou à hot-dogs, ou à hamburgers. Le fish and chips eut son heure de gloire, mais s’affirmer végétarien ou vegan, c’est « être tendance » dans les années 2020.Consommer tel ou tel produit pouvait être recommandé par le corps médical. Ainsi le whisky et le vin de Porto facilitaient la digestion ou bien soignaient la goutte. Mais aujourd’hui l’OMS nous met en garde en listant des produits cancérigènes ou favorisant l’obésité… On ne sait plus à quel saint se vouer… Rassurez-vous, les Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) vont nous permettre non seulement de choisir les meilleurs produits mais aussi ceux qui bénéficient d’un contrôle sanitaire.
Dans l’introduction de l’ouvrage, on peut lire une citation de Roland Barthes qui déclarait que la nourriture suscitait trois sortes de plaisir : celui de la convivialité, par le fait de partager le même plat ; celui de la réminiscence, qui nous fait retrouver les goûts de notre enfance ; et celui du nouveau, de l’insolite qui nous attire vers celles et ceux que nous ne connaissons pas encore.
Un savoureux voyage à ne rater sous aucun prétexte.Maryse Verfaillie, août 2023
-
 13:24
13:24 Partager la géographie
sur Les cafés géographiques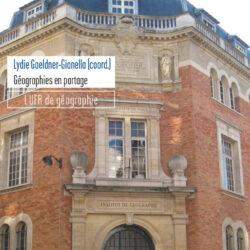
Institut de géographie de Paris.- Géographies en partage, coord. par Lydie Goeldner-Gianella ; préf. de Christian Grataloup, Ed. de la Sorbonne, 2023
Les Editions de la Sorbonne viennent de publier un livre sur l’UFR (Unité de formation et de recherche) de géographie de Paris I dans leur collection consacrée au jubilé de cette université. Intitulé Géographies en partage1, cet ouvrage auquel ont participé 55 auteurs, est coordonné par Lydie Goeldner-Gianella, directrice actuelle de l’UFR. Il sort un peu plus de cinquante ans après la fondation de l’Université de Panthéon-Sorbonne (Paris I) et de l’UFR de géographie en 1971. Cette naissance est liée à l’éclatement de la Sorbonne après les événements de mai-juin 1968 puis la loi Edgar Faure. A Paris, la géographie est alors étudiée et enseignée dans les universités de Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris IV (aujourd’hui Sorbonne Université) et Paris VII Paris-Diderot.
Ce livre, dense et copieux (plus de 300 pages, 14 chapitres, 3 index, 65 figures, 25 encadrés, 7 tableaux…), se compose de trois parties : Histoire de l’UFR et de l’Institut de géographie, La géographie à Paris I (à travers ses masters, ses laboratoires…) et Les filières Aménagement et environnement.
Il commémore un jubilé : cinquante ans de fonctionnement de l’UFR de géographie de Paris I permettent de dresser un bilan solide et de dessiner des perspectives d’avenir… d’autant qu’il ne s’agit pas de n’importe quelle UFR, mais de la plus importante de France qui, en outre, n’a cessé de grandir, passant d’un millier d’étudiants en 1971 à plus de 1200 aujourd’hui et d’une cinquantaine d’enseignants en 1971 à plus de trois cent vingt aujourd’hui. Dans nombre d’universités, en raison d’effectifs plus faibles, il n’existe pas d’UFR de géographie ; la discipline est alors noyée dans une UFR de sciences humaines et/ou sociales…
Par ailleurs, l’UFR de Paris I est indissolublement liée à l’Institut de géographie, voulu par Vidal de la Blache (1845-1918), financé par la marquise Arconati-Visconti (grande mécène de l’Université de Paris), construit par l’architecte de la Sorbonne, Nénot, et opérationnel à partir de 1925. Et, comme l’écrit Jean-Marie Théodat (p. 93), « quand on dit “géographie”, tous les regards se tournent vers la rue Saint-Jacques, le 191 exactement, au sommet de la montagne Saint-Geneviève, comme au point symboliquement le plus élevé de la discipline. Là se trouve l’Institut de géographie. » Il est, de toute évidence, le lieu central de la discipline, l’épicentre des manifestations géographiques, à commencer par les congrès internationaux. Certes, les enseignements des premières années ont lieu au centre Pierre Mendès-France (Paris, XIIIe). Par ailleurs, les locaux de l’Institut de géographie (bureaux, salles de cours, amphis…) sont partagés entre trois universités ; mais sa gestion est assurée par Paris I, “gardienne” de l’Institut de géographie, Pénélope en quelque sorte…
La Bibliothèque, emblématique, dépend de la BIS2 (Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne). Constamment enrichie, elle possède d’immenses ressources (livres, périodiques, cartes, documents patrimoniaux…). Un chapitre fort intéressant en révèle l’histoire depuis 1880, heureuse incursion dans le passé.
Selon Christian Grataloup, auteur de la préface, malgré les particularités de cette UFR, « le demi-siècle ici raconté résume (…) plutôt bien le parcours de l’ensemble de la géographie française ces dernières décennies. » Raison supplémentaire pour découvrir cet ouvrage !Notes
(1) Lydie GOELDNER-GIANELLA, Géographies en partage. : L’UFR de géographie, préface de Christian Grataloup. – (Collection Histoire de la France aux XIXe et XXe siècles ; 93). – Paris : Editions de la Sorbonne, 2023. 328 p., 25 €.
(2) Pour une histoire de la BIS, voir Laurence BOBIS, Boris NOGUES, La bibliothèque de la Sorbonne. 250 ans d’histoire au cœur de l’université, Editions de la Sorbonne, 2022, 440 p., 25 €.
Denis Wolff, juillet 2023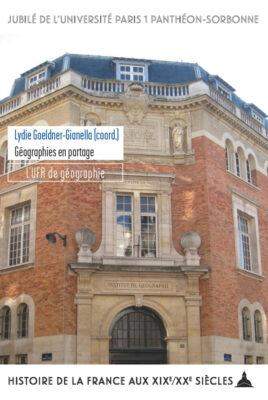
-
 21:15
21:15 La vie du littoral. Définir, protéger, aménager.
sur Les cafés géographiques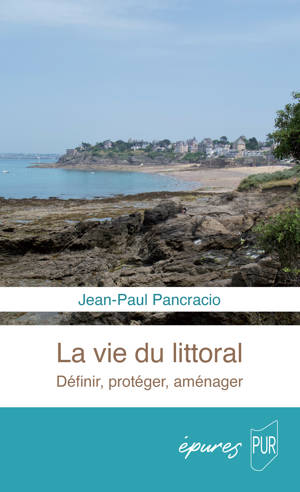
De ce petit ouvrage publié récemment (1), on peut souligner l’actualité. Nombreux sont en effet les reportages et les actualités qui nous inquiètent sur le sort de notre littoral (il faudrait compléter le titre par « littoral de la France métropolitaine »). Villas en équilibre instable sur le bord d’une falaise, plages disparaissant à marée haute, appauvrissement de la biodiversité littorale… L’expression « vivre les pieds dans l’eau » ne fait plus la fortune des agents immobiliers. Les pouvoirs publics doivent faire face à une contradiction majeure : comment ramener le plus possible les espaces littoraux à l’état naturel à une époque où leur attractivité sur la population permanente et touristique n’a jamais été aussi forte.
Les deuxième et troisième parties (« protéger » et « aménager ») constituent un petit manuel de droit. Le rappel de chaque mesure restrictive ou incitative qui porte sur la bande côtière et les eaux territoriales, est appuyé sur un article de loi, un décret, une ordonnance, un arrêt du Conseil d’Etat (2). La première partie (« définir ») est essentiellement descriptive. Puisqu’il n’y a pas de définition juridique du littoral, pourquoi ne pas privilégier une approche sensorielle (bruit des vagues, odeurs des embruns, douceur du sable…) (3). L’auteur s’autorise alors un style imagé : « l’océan, ce vieux lunatique », « les goémons, rois du covoiturage », ce qui ne l’empêche pas de donner des définitions précises du milieu littoral terrestre (estran, laisse de mer, pré-salé…) et marin (avifaune, herbiers marins…).
C’est un arrêt du Conseil d’Etat du 12 août 1973 qui a créé la notion de domaine public maritime dont la délimitation, fixée par une mission d’experts, est évolutive. Les objectifs sont écologiques mais relèvent aussi du service public : assurer à tous un libre passage piétonnier le long de la côte (4). Les pouvoirs de police administrative s’exerçant sur le domaine public maritime et ses eaux surjacentes relèvent du maire, du préfet de département et du préfet maritime.
Depuis cette date la législation est abondante, surtout dans les dix dernières années. Nous retiendrons la loi Littoral de 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, qui n’a permis que de freiner modestement l’urbanisation, la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016, la loi « Climat et résilience » de 2021 qui organise la lutte contre l’artificialisation des sols et la gestion du recul du trait de côte. Inconstructibilité de la bande littorale des 100m, interdiction des prélèvements (sable, galets…), création de zones naturelles protégées (357 en 2022), respect de la visibilité du paysage… Nombreux sont les domaines d’intervention.
La menace la plus urgente à moyen et même à court terme est sans doute le recul du trait de côte (correspondant à la laisse (5) des plus hautes mers) qu’accentue la puissance croissante des tempêtes. Actuellement, il touche 920km de côte (à une vitesse de 50 cm/an sur les côtes basses sablonneuses). L’érosion nationale fait l’objet d’une cartographie obligatoire. La stratégie de gestion du trait de côte comporte des variantes selon la situation du littoral. Là où l’habitat est dense et les enjeux économiques importants, la priorité est donnée à la défense contre la mer. Ailleurs on privilégie le retour à l’état naturel des espaces libérés en recourant à des aménagements anti-érosion (dunes, forêts…). Dans les zones menacées, l’autorité publique peut agir en utilisant une procédure d’expropriation ou son droit de préemption.
Actuellement toute intervention dans l’espace littoral est soumise à une législation abondante et complexe qui suscite parfois les réactions négatives des pouvoirs locaux attachés aux bénéfices amenés par une forte activité humaine. Mais la prise de conscience des nécessaires évolutions à engager semble l’emporter.
Notes
(1) Presses universitaires de Rennes, mars 2023.
(2) L’auteur est agrégé de droit, professeur émérite de l’université de Poitiers.
(3) L’auteur renvoie aux travaux d’Alain Corbin, historien des sensibilités.
(4) L’actuel Sentier du littoral s’étend sur 4577 km. Il manque encore 1200 km pour faire le tour complet du littoral métropolitain.
(5) Les laisses sont les lignes de marée haute et de marée basse, soit les limites entre lesquelles la marée oscille.
Michèle Vignaux, juillet 2023 -
 17:08
17:08 Dessin du géographe n°93. Des leporellos géographiques : E. F. Bossoli dans les Alpes italiennes
sur Les cafés géographiquesEn parcourant les allées du Salon international des Carnets de Voyage d’Aix-en-Provence, j’ai constaté que beaucoup de carnetières et carnetiers dessinent des croquis panoramiques sur des bandes de papiers pliants qu’on appelle des « leporellos », en souvenir du valet de Don Juan chez Mozart et de la liste des femmes conquises par son maître, qu’il déplie en chantant au début du premier acte de l’opéra. Or, il est arrivé à des géographes de dessiner de grands croquis panoramiques en assemblant des feuilles dans le sens de la largeur, selon les besoins de la largeur de l’horizon topographique à prendre en compte. Dans la page web que j’ai consacrée ici à Pierre Deffontaines, j’aurais pu signaler son assemblage panoramique concernant la ville de Barcelone vue du Mont Tibidabo. [https:]]
Lequel était largement battu en dimension par celui qu’il avait réalisé au Brésil concernant la Baie de Rio (plus d’un mètre de large), étudié par Antoine Huerta en 2009 (« Une ascension, une œuvre : la baie de Rio de Janeiro vue du Corcovado par Pierre Deffontaines », Confins, número 5).
[confins.revues.org]Mais il faut reconnaître que sur le plan de la qualité du dessin panoramique, les dessinateurs et peintres professionnels ont produit dans la seconde moitié du 19e siècle des leporellos pour la clientèle touristique des régions de montagne, plus efficaces et imposants. Il s’agissait de procurer aux visiteurs des images permettant de situer et de reconnaître sur le terrain les principaux sommets des grandes chaînes. Les nouveaux voyageurs voulaient pouvoir nommer et mémoriser ces grands sites dans un nouveau « musée imaginaire » des formes de la terre. Lors d’un passage à Turin, une excursion au Monte dei Cappuccini m’a permis d’acquérir un classique de ce genre de leporello : le Panorama delle Alpi (dal Monte dei Cappuccini, Torino, 1874), réalisé par Edoardo Francesco Bossoli, peintre piémontais spécialisé dans les panoramas de montagne et qui fit une grande carrière dans ce type de dessin.
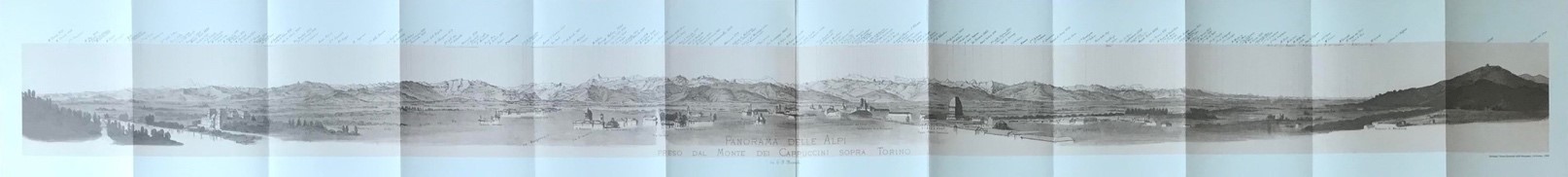
Fig. 1-Panorama des Alpes (depuis le Mont des Capucins, Turin) (E. F. Bossoli, 1874). Source : collection de l’auteur.
Sur un accordéon de papier de 1,93 sur 0,14m (surface de l’image), il a représenté à l’encre (plume et lavis) les Alpes Piémontaises depuis la vallée alpine du Po au SO jusqu’au Monte Generoso au NE, c’est-à-dire le versant italien de la chaîne depuis la haute vallée du Po à gauche du panorama jusqu’à la région des Lacs à droite, en passant par la région du val d’Aoste au centre. Le Mont Blanc n’est pas visible car masqué par le massif du Grand Paradis. Le Mont Rose (4 638m) et le Lyskamm (4 538m) sont donc les 2 plus hauts sommets de la ligne des crêtes figurées par le peintre.
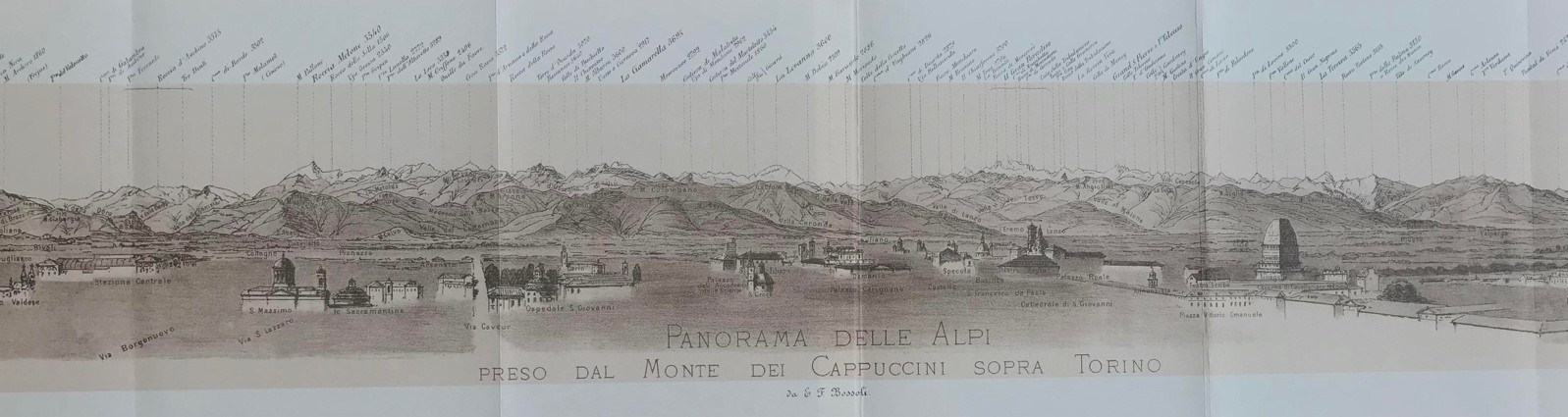
Fig. 2-Panorama des Alpes (depuis le Mont des Capucins, Turin) (E. F. Bossoli, 1874) (détail, partie centrale). Source : collection de l’auteur.
L’essentiel est donc ici de figurer les sommets de la façon la plus « lisible » possible, d’où le dessin au trait (plume) et le lavis d’encre sépia. Mais dans les avant-plans de la ville et de sa campagne un certain nombre de monuments et d’édifices urbains bien connus sont dessinés pour servir de points de repère à la visée des sommets et à leur position sur la ligne des crêtes, le croquis panoramique servant alors pour le touriste de mini-table d’orientation.
Dans ce cas turinois, la faible altitude relative du Mont des Capucins au-dessus de la ville (moins de 70 m au-dessus du Pô) en fait une vue presque horizontale, et l’effet de masque des sommets des premiers plans devant les suivants en devient très important. Un autre leporello emblématique de la production de Bossoli, celui du Panorama preso dal Monte Generoso, réalise une vue quasi aérienne du lac de Lugano et de ses environs, car le sommet en question domine ce lac de ses 1 701 m (soit 1 361m d’altitude relative) et offre des vues spectaculaires vers les grandes Alpes Suisses, Italiennes et Françaises à l’horizon nord et ouest. Le croquis devient franchement panoramique et permet une lecture du paysage qui se rapproche de celle d’une carte. Les lignes de crêtes se succèdent en profondeur sur plus de 60 kilomètres, et la dernière (la plus lointaine) est celle des plus de 4 000 m du Mont Blanc, du Mont Rose, des Alpes du Valais et de l’Oberland bernois, figurée en blanc.
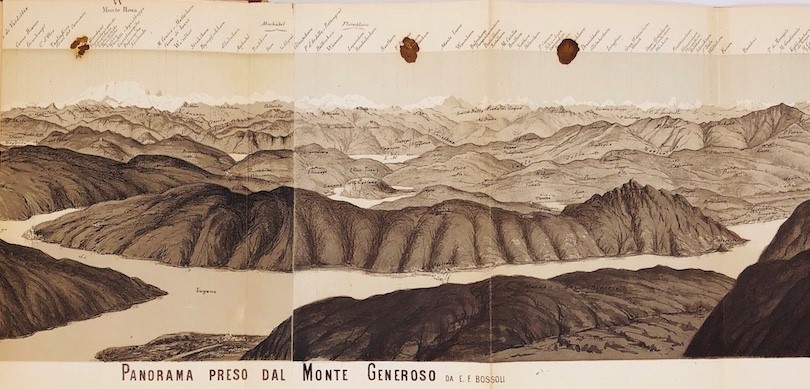
Fig. 3-Panorama pris depuis le Monte Generoso (E. F. Bossoli, 1875). Source : Boletino del Club Alpino Italiano.
Ces deux œuvres sont donc emblématiques de cette production picturale considérable dans la seconde moitié du 19e siècle, destinée à participer de l’invention du paysage de la chaîne des Alpes. Une bibliographie abondante en a repris l’étude dans la géographie contemporaine. Par exemple Cllaudio Ferrata a étudié pour le Tessin La Fabrique du Paysage dans la Région des lacs du Sud des Alpes (Le Globe, tome 147/ GEA, N°23/ 2007, p.29-48). Il cite dans II teatro del paesaggio, (in Ferrata C. (a cura di), //senso dell’ospitalita?, pp. 57-67, 2006)) les travaux graphiques alpestres de Bossoli, dans un paragraphe où il traite de l’« art de voir ». On ne peut être mieux au cœur de la question du dessin géographique.
Roland Courtot, mars 2023
-
 13:04
13:04 Prix du Livre de Géographie des Lycéens et Etudiants 2023
sur Les cafés géographiquesLe prix du Livre de Géographie des Lycéens et Etudiants est une création récente (2020), destinée à faire découvrir et aimer la géographie à travers une sélection annuelle de cinq ouvrages reflétant la diversité de la discipline. Les deux premières éditions avaient récompensé en 2021 Sylvie Lasserre pour Voyage au pays des Ouïghours (Editions Hesse, 2020) et en 2022 Camille Schmoll pour Les damnées de la mer (La Découverte, 2020).
Cette année, le prix a été accordé à Monde enchanté, Chansons et imaginaires géographiques de Raphaël Pieroni et Jean-François Staszak (1). On comprend l’enthousiasme des jeunes gens qui l’ont choisi pour un ouvrage ludique et joyeux dont l’objet d’analyse est constitué de 36 chansons (2) écrites majoritairement en français et en anglais, des années 1930 à nos jours.
Jean-François Staszak a présenté, à la Société de géographie, son travail et celui de son collègue, comme une réalisation de géographie culturelle qui étudie le monde tel qu’on l’appréhende à travers les différents systèmes de représentation. Face aux critiques qui reprochent à cette discipline son caractère trop souvent élitiste et conceptuel, il se réjouit de présenter un travail portant sur des chansons, c’est-à dire des témoignages de la culture populaire empreints d’émotion.
Il a été demandé aux collègues genevois des auteurs de choisir une chanson connue comme enjeu géographique et de produire un texte court à destination du grand public. Ce choix peut être suggéré par le texte même de la chanson ou par les lieux où elle a été entendue. Certaines chansons ont participé à la construction de lieux. Il est ainsi plaisant de savoir qu’un Café Pouchkine a été inauguré en 1999 par Gilbert Bécaud sur la Place Rouge à Moscou, alors que sa chanson Nathalie date de 1964 ! (3)
Michèle Vignaux, juin 2023
1) Georg Editeur, 2021. Cet ouvrage a été suivi de Villes enchantées, en 2022. Il sera à son tour complété par Voyages enchantés en cours de réalisation. 2) Les trois ouvrages évoqueront 121 chansons dont 81 en français. 3) Le 22 septembre 2022, dans Géographie à la carte, France Culture a présenté le sujet des rapports entre la géographie et la chanson, en invitant notamment Jean-François Staszak. Parmi les principales questions abordées lors de l’émission, on retrouve bien sûr celles du livre qui vient d’être récompensé : comment les chansons racontent-elles les villes ? La culture populaire peut-elle matériellement transformer un territoire ? La puissance évocatrice de certaines villes dans les chansons a-t-elle un aspect géopolitique ? [https:]] -
 12:59
12:59 Géopolitique de la Corée du Sud
sur Les cafés géographiques -
 12:16
12:16 L’ère des superpétroliers. Les transports maritimes français au XXe siècle
sur Les cafés géographiques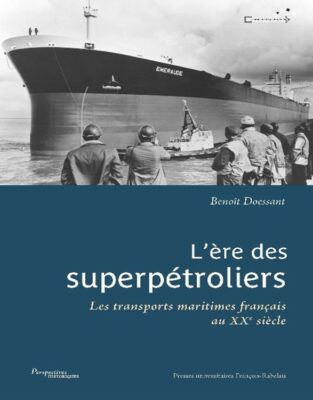
Ce travail d’historien (1) porte sur un court XXe siècle. Le pétrole n’est devenu l’« or noir » qu’entre le moment où la Grande Guerre révéla la dépendance dangereuse de notre pays et celui où il s’est transformé en « mal-aimé » dont il faut se débarrasser le plus possible dans les dernières années du siècle. Entre temps il occupe une place majeure dans les préoccupations des gouvernants, des dirigeants d’entreprise, mais aussi une place non négligeable dans celle des Français de plus en plus attachés à leur voiture. Quant à l ’« ère des superpétroliers » qui donne son titre à l’ouvrage, elle ne dure guère plus de deux décennies car la prouesse technique se révèle vite une catastrophe financière.
Le sujet comprend plusieurs composantes, économique, technique et politique. La première composante comprend la production ou l’achat du pétrole brut, le transport par oléoduc et surtout par bateau et le raffinage sur le sol national. Ces trois activités peuvent être assurées par une même compagnie ou par plusieurs compagnies, parfois filiales d’un maison-mère. Les achats se font suivant des contrats à long ou à court terme ou sur un marché spot (2). Sur le plan technique, les chantiers navals ont produit des pétroliers de plus en plus performants, c’est-à-dire offrant des coûts de transport de plus en plus bas par tpl (tonne de port en lourd) transportée, grâce à leur gros tonnage. Mais la géographie a ses impératifs. Avec un tirant d’eau élevé un superpétrolier ne peut emprunter des détroits comme celui de Malacca, ou le canal de Suez. La composante politique est majeure. Dans une France dont le sous-sol ne contient pas pétrole, le devoir de l’Etat est d’assurer la sécurité de l’approvisionnement, donc d’avoir des relations stables avec les producteurs. Ce n’est pas la même chose d’acheter du pétrole à la Norvège ou dans un des pays du Moyen-Orient ! Ces trois composantes n’évoluent pas selon les mêmes rythmes. Plusieurs années s’écoulent entre la conception et la livraison d’un nouveau type de pétrolier alors qu’une crise politique peut bouleverser les flux pétroliers maritimes en quelques semaines, voire quelques jours. C’est en fonction de ces données que l’auteur a distingué quatre périodes entre 1931 et 1994.
1931-1958 : un programme d’autonomie maritime
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le nouvel Office National des Combustibles Liquides (1925) se donne comme objectifs de constituer une industrie pétrolière française avec la construction de navires-citernes et de rechercher des approvisionnements. Ce dernier but est facilité par les traités qui mettent fin à la domination ottomane au Moyen-Orient. La nouvelle CFP (Compagnie française des pétroles) obtient, au titre de réparations de guerre, 23,7% de la Turkish Petroleum Compagny. Le pétrole, extrait à Kirkouk, est alors transporté par oléoduc jusqu’à Tripoli puis convoyé par la CNP (Compagnie navale des pétroles, filiale de la CFP jusqu’aux ports de Gonfreville (Normandie) et La Mède (Provence).
Entre 1928 et 1938, la consommation de pétrole est multipliée par quatre et la France est le deuxième acheteur européen alors que le transport du brut s’effectue majoritairement sur des tankers étrangers. Par crainte d’une dépendance dangereuse en cas de guerre, le gouvernement fait voter une loi en 1928, renforcée par un décret en 1931, puis par un nouveau décret en 1950 (le premier décret est suspendu en 1939) instaurant l’obligation de pavillon. 50% des importations (en 1931) puis 66% (en 1950) doivent être faites sous pavillon français. Cette particularité – qui a duré jusqu’en 1992- a entraîné la perte de compétitivité de notre flotte, le coût du transport sur des navires à l’équipage uniquement français étant beaucoup plus élevé que sur les bateaux concurrents.
La Deuxième Guerre mondiale conduit à la dévastation de l’industrie pétrolière française qui doit être entièrement reconstruite. Le redressement maritime est achevé au début des années 1950. La France peut alors profiter de nouveaux gisements en Irak et la CNP livre des bateaux qu’on appelle déjà des « supertankers » avec un port en lourd supérieur à 30 000 tpl (norme permettant le passage dans le canal de Suez). Ses 104 navires permettent à la France d’occuper le 7ème rang mondial en 1954.
1956-1973 : l’âge d’or des transports maritimes français
En 1956, le Moyen-Orient (surtout l’Irak) fournit la majeure partie de la consommation pétrolière française. Chaque année, 25 Mt de brut sont exportés par les ports de Méditerranée orientale et 58 Mt empruntent le canal de Suez. La « Crise de Suez » bouleverse ce trafic. En juillet 1956, Nasser nationalise le canal de Suez, ce qui provoque, trois mois plus tard, une intervention militaire franco-britannique. Le canal est alors entièrement bloqué et les oléoducs Irak-Méditerranée détruits. Il faut réorganiser les itinéraires. Une seule solution : le contournement de l’Afrique par la route du cap de Bonne-Espérance (20 900 km entre le golfe Persique et la mer du Nord, au lieu de 12 000km par Suez), ce qui provoque l’explosion des taux d’affrètement. Même après la réouverture du canal, on ne revient pas à la situation antérieure. On combine un aller France-Moyen-Orient par Suez et un retour par Le Cap avec des bateaux chargés, mais surtout on envisage d’utiliser des pétroliers de très gros tonnage.
Les années 1960 sont des années de réorganisation avec l’arrivée du pétrole algérien et le lancement d’un ambitieux programme d’armement par la CNP qui devient le premier armateur français. Pour diminuer les coûts de transport, on construit des Very Large Crude Carrier (VLCC), de 150 000 tpl à 320 000 tpl. Le premier gros tanker de la CNP sort des chantiers navals en 1970. Ces superpétroliers sont le produit d’innovations technologiques de pointe qui doivent permettre de compenser les charges qui grèvent le pavillon français. Nouvelles proportions, aciers spéciaux, automatisation des tâches de chargement/déchargement, augmentation du débit des pompes…, les superpétroliers assurent une augmentation de la vitesse moyenne et une économie de personnel. Ils n’embarquent que des équipages très spécialisés, moins nombreux (les besoins en équipage ne croissent pas avec la taille du navire), aux conditions de travail attractives (avantages financiers et confort). Néanmoins, les dépenses d’équipage restent plus élevées que sous les pavillons étrangers car tous les marins doivent être français.
La course au gigantisme semble justifiée par une nouvelle fermeture du canal de Suez provoquée par la Guerre des 6 jours (1967). Même si on s’approvisionne alors sur des marchés plus diversifiés et plus proches de l’Europe (Algérie, Etats-Unis, Venezuela), le Moyen-Orient reste un fournisseur majeur. Le pétrolier-roi semble alors le 200 000 tpl capable d’emprunter à l’aller, le canal de Suez sur ballast et, au retour, la route du Cap en pleine charge. Le tonnage moyen de la CNP triple en 10 ans (1961-1971). Ces très gros navires posent néanmoins des problèmes de logistique (équipement des ports, taille des raffineries, passages des détroits), ce qui ne décourage pas la commande des Ultra Large Crude Carriers (ULCC) de plus de 350 000 tpl. L’industrie pétrolière française est alors partagée entre CFP-Total et Elf-Erap qui ont des participations dans les sociétés d’armement.
A la fin des années 1960, la consommation continue d’augmenter, mais la demande est flexible alors que l’offre est rigide. Les premiers doutes sur la viabilité du marché des transports apparaissent. Les experts évoquent le risque d’un excédent de tonnage dans les années à venir d’autant que de lourdes charges pèsent sur le pavillon français alors que les pavillons de complaisance se multiplient dans le monde.
1973- 1979 : les transports maritimes pétroliers dans la tourmente
1973 est une année-tournant dans l’histoire des transports pétroliers. A la suite de la guerre du Kippour (octobre 1973), les pays arabes membres de l’OPEP décident d’augmenter unilatéralement le prix du baril de brut (quadruplement du prix en un trimestre) et d’instaurer un embargo sur les exportations destinées aux pays alliés d’Israël. C’est le premier choc pétrolier. Stagnation de la consommation et accès à des ressources plus proches du consommateur (Alaska, mer du Nord) entraînent la surcapacité des transports maritimes et de l’industrie du raffinage. Il faut alors annuler les commandes et réduire les charges au maximum. Pour répondre à ce dernier objectif, plusieurs solutions sont adoptées : ralentissement de la vitesse, utilisation des pétroliers comme stockage flottant ou comme minéraliers ou céréaliers. Mais les armateurs français souffrent toujours d’un handicap supplémentaire par rapport à leurs concurrents, l’obligation de pavillon.
Dans les années 1970, la France est le seul pays à imposer à sa flotte pétrolière de naviguer sous pavillon national (les Etats-Unis ne l’imposent que pour le cabotage le long de leurs côtes). Le surcoût est alors évalué à 1 milliard de francs par an (de plus, l’obligation de pavillon est incompatible avec le Traité de Rome). En 1977 38% du port en lourd mondial naviguent sous un pavillon de complaisance (Panama, Liberia, Bahamas…) qui fait bénéficier les armateurs d’avantages fiscaux, de facilité d’immatriculation et de l’emploi d’équipages étrangers aux charges sociales et salariales réduites. Mais les marées noires provoquées par des navires affrétés sous pavillon de complaisance soulèvent la colère des opinions publiques. Le traumatisme du naufrage de l’Amoco Cadiz (234 000 tpl) au large de Portsall (Bretagne) en est un exemple. Les organisations internationales doivent durcir leur réglementation.
1979-1994 : le crépuscule de la flotte pétrolière française
La Révolution iranienne de 1979 puis la guerre Iran-Irak de 1980-1988 provoquent une nouvelle flambée du prix du brut (augmentation du prix du baril par 5 ou 6 depuis 1978). C’est le deuxième choc pétrolier. Il est rapidement suivi d’un contre-choc (1981) car la demande s’effondre dans les pays consommateurs qui s’approvisionnent de plus en plus ailleurs qu’au Moyen-Orient (mer du Nord, Afrique de l’Ouest, Mexique…). C’est le cas de Total qui n’y achète plus que la moitié de son pétrole (Arabie Saoudite, E.A.U.). Entre 1979 et 1985, le trafic mondial de brut chute de 58%, ce qui provoque un excédent mondial de pétroliers, surtout dans la catégorie des plus grosses unités.
Face à cette baisse des besoins de capacité de transport, les armateurs français sont contraints d’opérer le retrait de navires, voués à la reconversion en vraquiers ou au désarmement et souvent à la démolition dans de grands chantiers où ils sont transformés en ferraille servant à la fabrication de nouveaux aciers.
Le redressement du commerce du pétrole à la fin des années 1980 ne permet pas d’éviter le naufrage des superpétroliers français. Les ULCC (Ultra large crude carrier) de plus de 300 000 tpl qui arrivent alors sur le marché, sont une réussite de la technologie française mais un échec économique. Lorsqu’ils sont mis en chantier au début des années 1970, deux certitudes motivaient le choix de pétroliers de gros tonnage, celle de la primauté croissante du golfe Persique comme fournisseur et celle d’une croissance continue de la demande. On néglige l’obstacle de leur tirant d’eau, trop élevé pour franchir le canal de Suez ou traverser les détroits de Malacca et du Pas de Calais. La CNN, filiale d’Elf, et la Société maritime Shell commandent donc quatre supertankers aux Chantiers de l’Atlantique capables de construire des navires de 500 000tpl. Mais dès leur mise en service, leur intérêt est remis en cause, révélant l’absence d’études sérieuses sur leur coût de fonctionnement. Non seulement leurs charges financières sont trop lourdes, mais il est difficile de trouver des cargaisons suffisantes. La contrainte du tirant d’eau les empêche de passer par Suez où la navigation est rétablie et l’impossibilité de rejoindre Rotterdam est un handicap majeur. Pour les opérateurs pétroliers, Le Havre dont l’arrière-pays est limité ne peut remplacer le port néerlandais ouvert sur le gros marché européen. Les ULCC sont donc condamnés.
La crise des transports pétroliers français est illustrée par le choix d’Elf qui désarme ses navires pour affréter l’équivalent à l’étranger. Plusieurs rapports commandés par l’Etat arrivent à la même conclusion : une surcapacité de la flotte, des navires vieillissants et surtout une absence de compétitivité due à la contrainte du pavillon. Pour continuer à assurer la sécurité des approvisionnements d’un pétrole dont on importe 96% de la consommation, on adopte un nouveau cadre juridique, le pavillon Kerguelen, en 1986. Sous ce pavillon, les équipages ne comprennent plus que 35% de marins français et ce sont les lois sociales et fiscales des TAAF qui s’appliquent. En 1996 c’est l’ensemble de la flotte pétrolière française (14 bateaux) qui arbore le pavillon Kerguelen. Mais le registre TAAF n’est qu’une réponse partielle à la crise car tous les pays européens adoptent des registres internationaux (dits « bis ») qui leur permettent de recruter des équipages entiers à très bas coût.
Après l’abandon d’une flotte en propre par le groupe Total puis la vente de CNN, dernier armateur français, en 1998, tous les tankers transporteurs de brut sont de propriété étrangère. C’est la fin des illusions françaises.
Aujourd’hui l’essentiel de la flotte mondiale circule sous pavillons de complaisance. Elle est répartie entre 350 compagnies qui siègent dans 50 pays. Les Majors ne possèdent plus que 4% du tonnage mondial. Les efforts de l’Etat français pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en pétrole ne portent plus sur le brut mais sur le transport des produits raffinés (3).
Notes :
(1) Benoît Doessant, L’ère des superpétroliers, Editions universitaires François Rabelais, Tours, 2022. (2) Marché spot : appelé aussi « marché au comptant ». Dans ce cas,les actifs négociés font l’objet d’une livraison et d’un règlement instantanés. (3) En dehors de l’évolution de la taille des navires pétroliers, la double coque représente une innovation technologique importante pour limiter le risque des pollutions. L’échouement du pétrolier Exxon Valdez en 1989 a joué un rôle important dans l’essor de cette technologie en suscitant de nouvelles réglementations maritimes.Michèle Vignaux, mai 2023