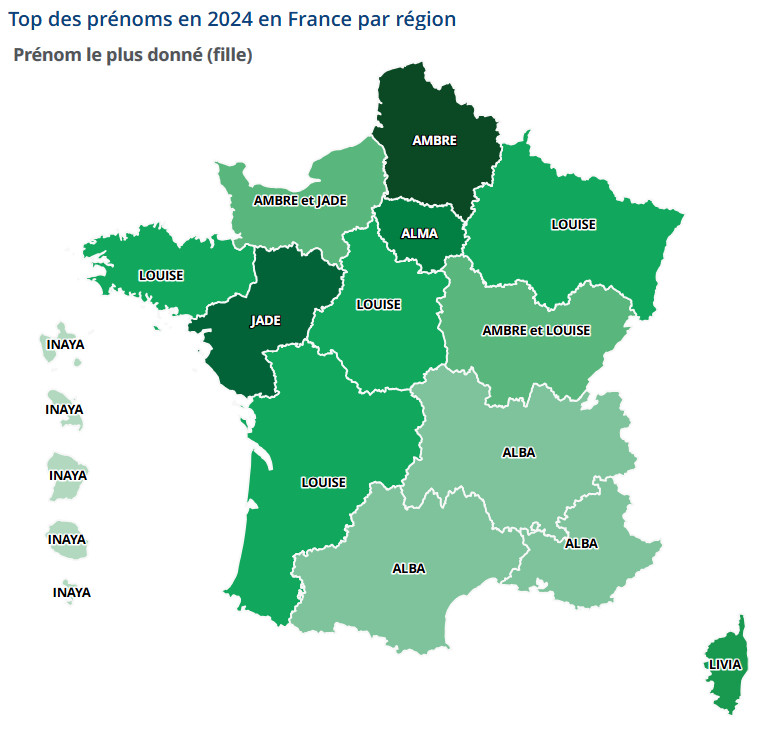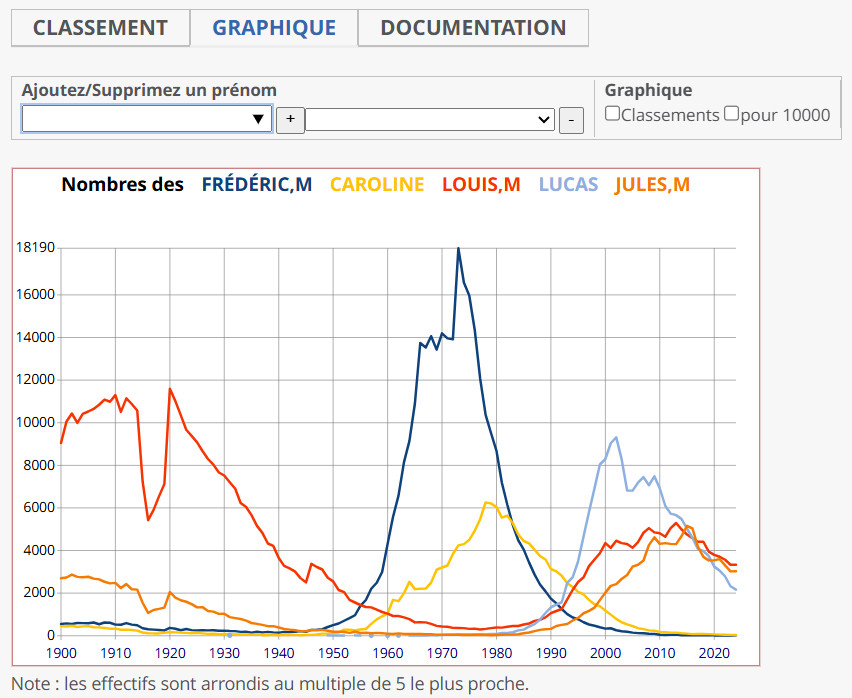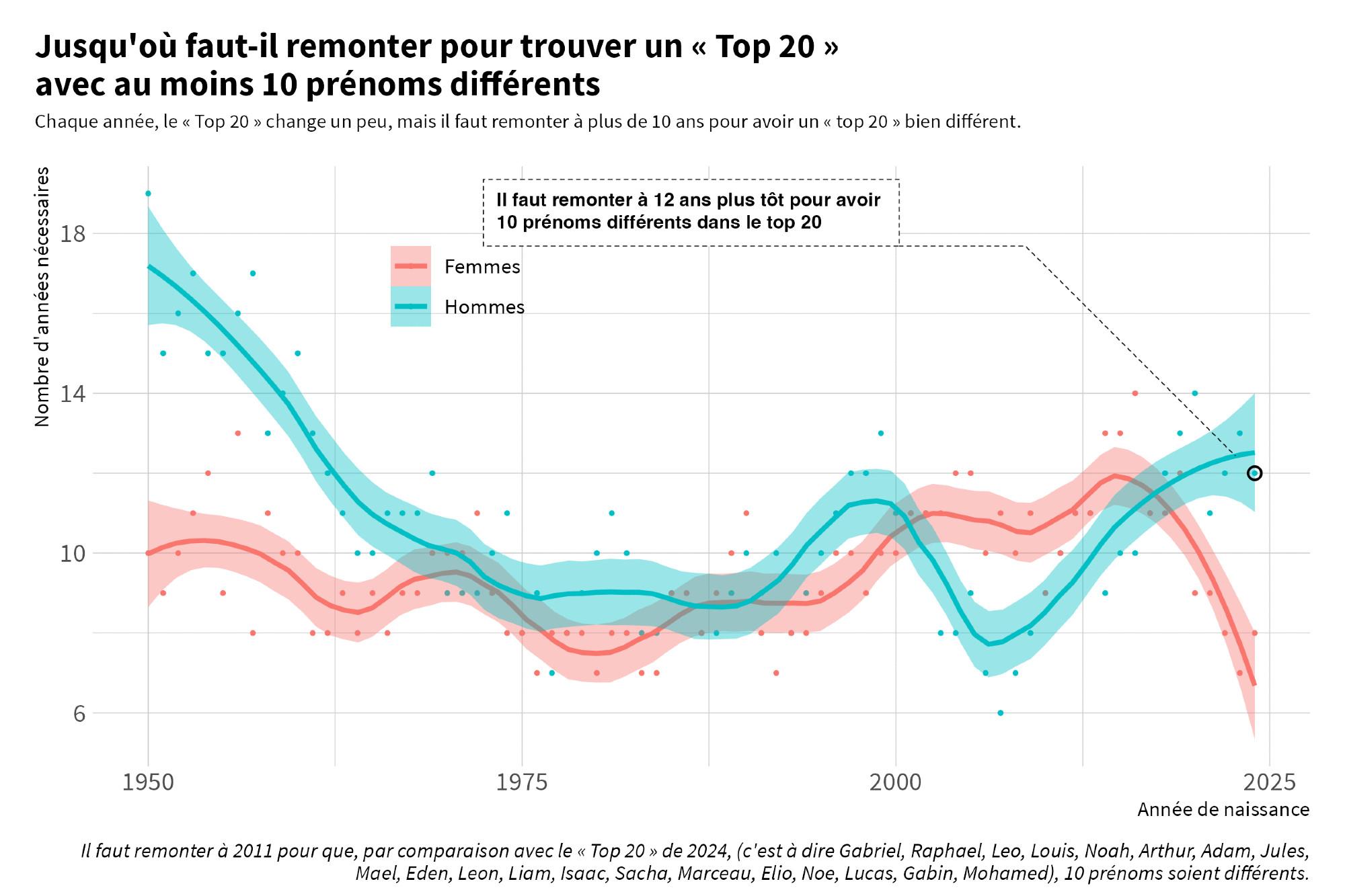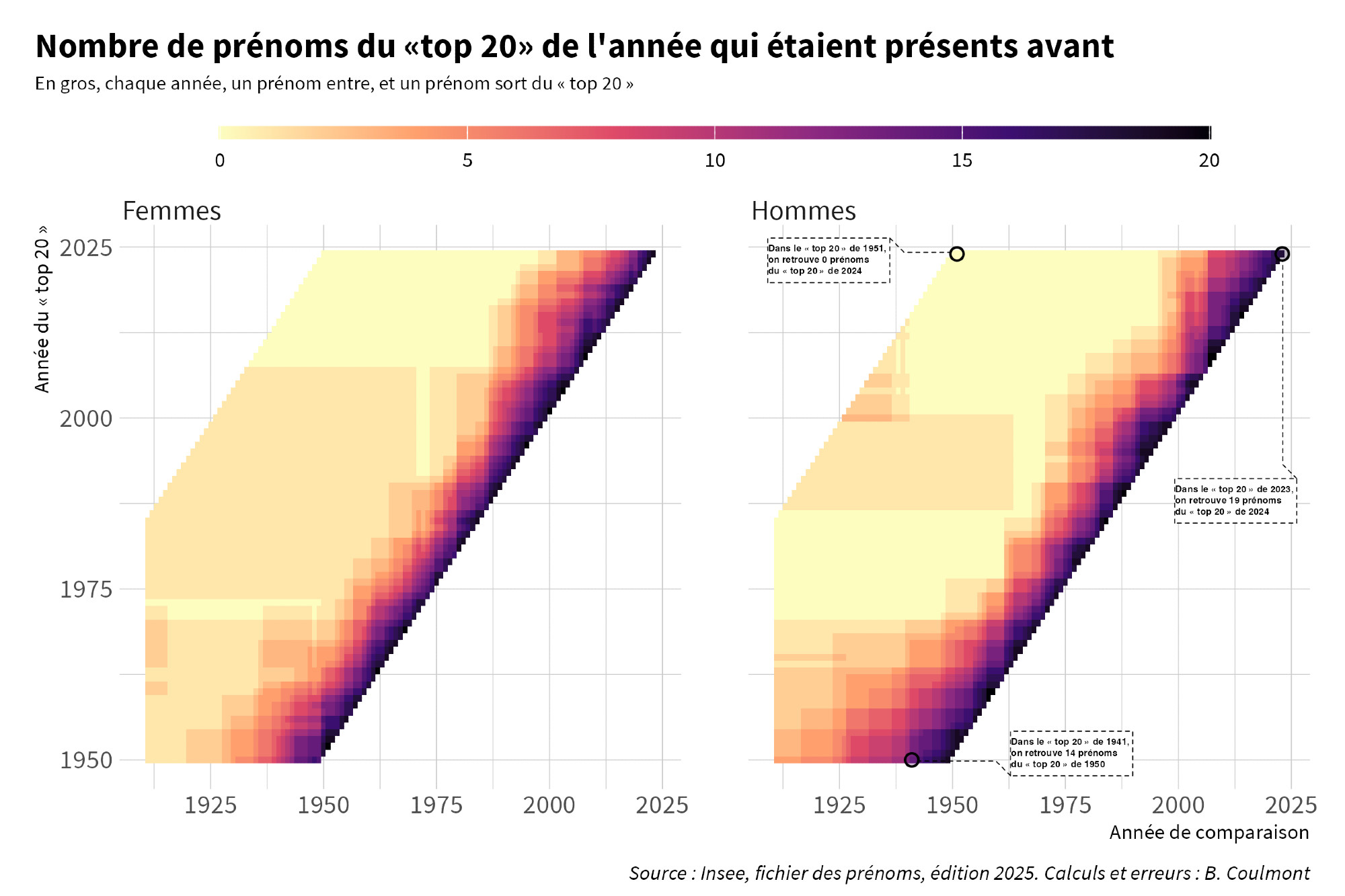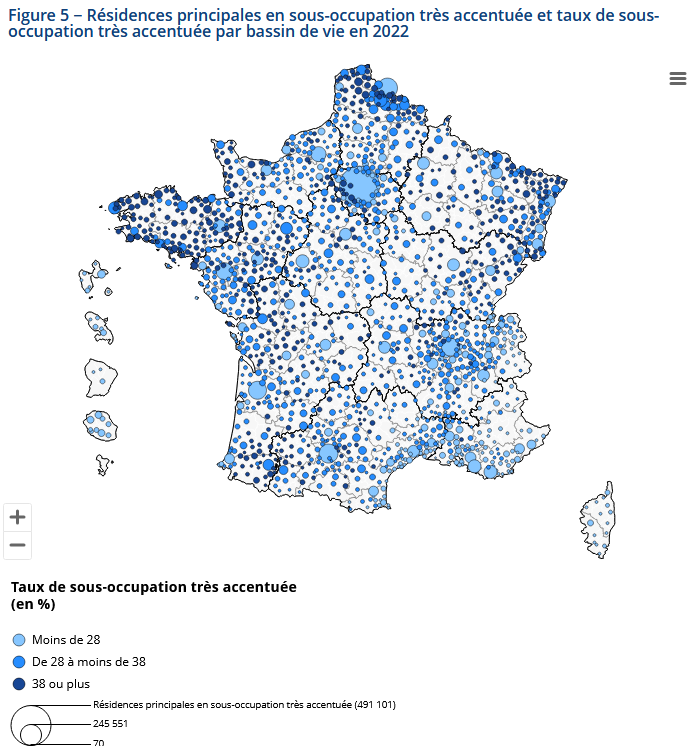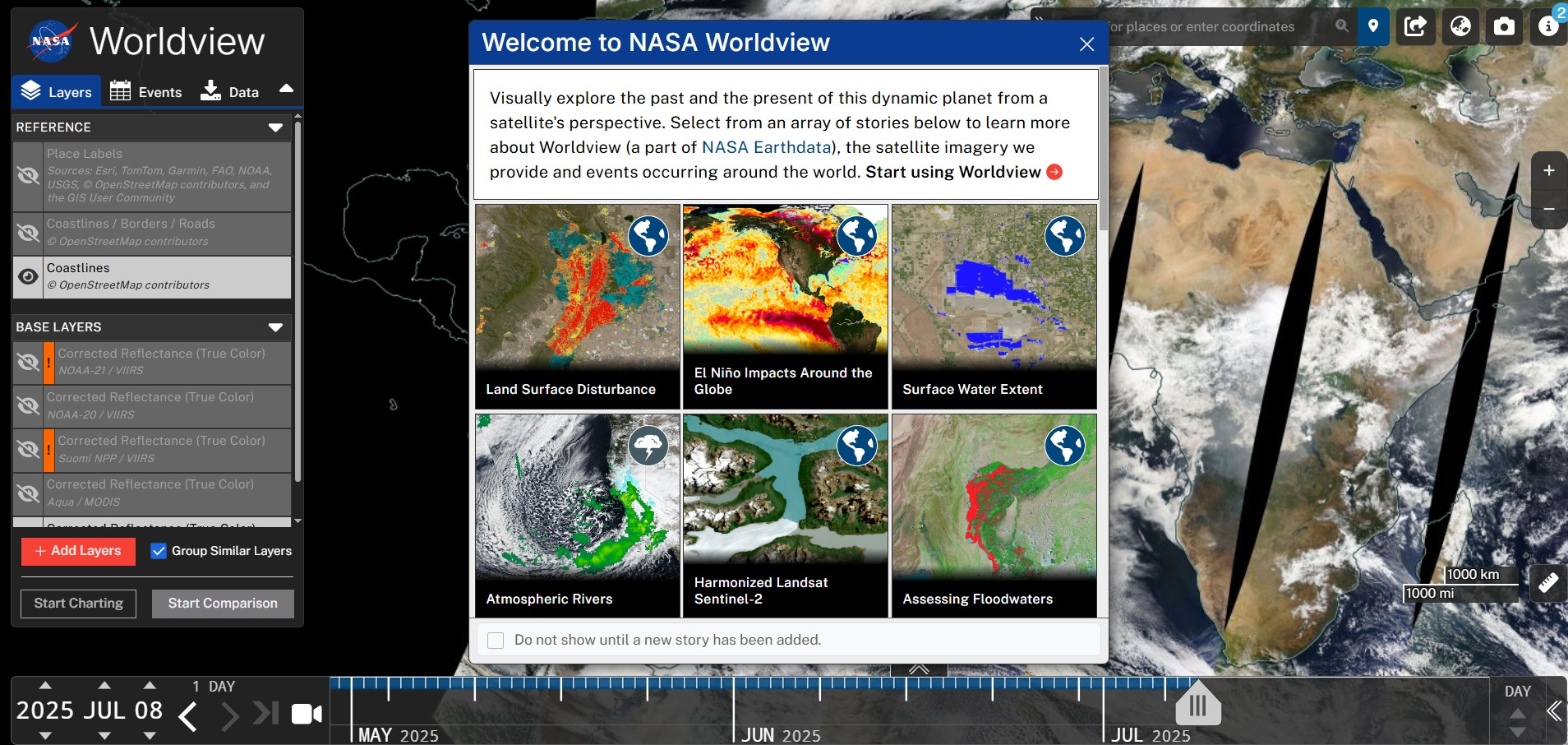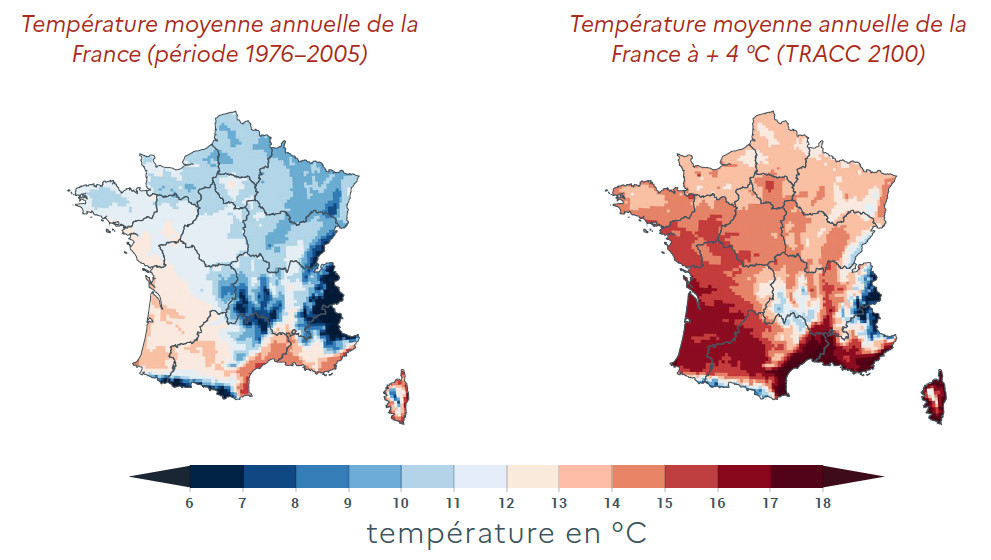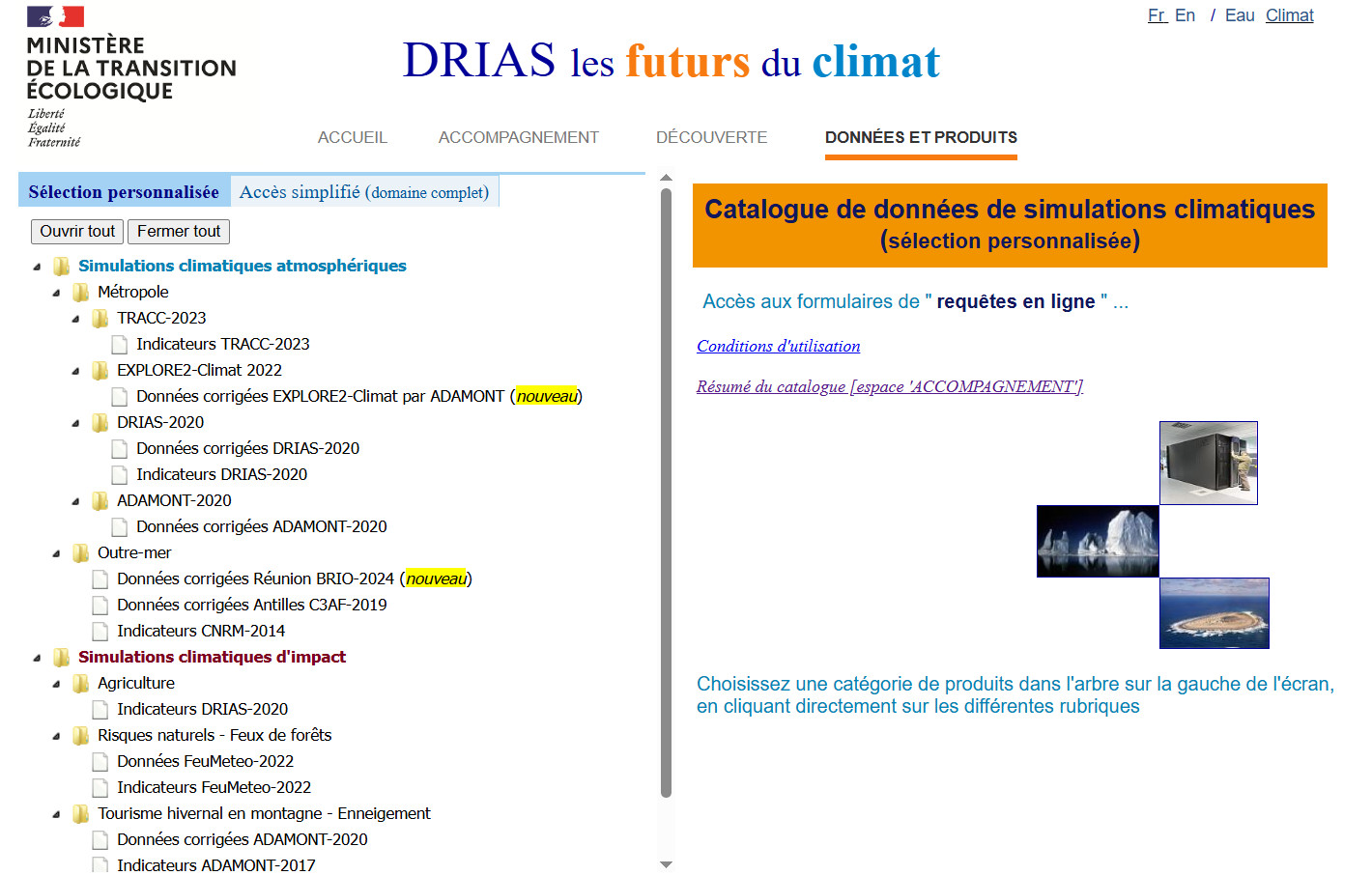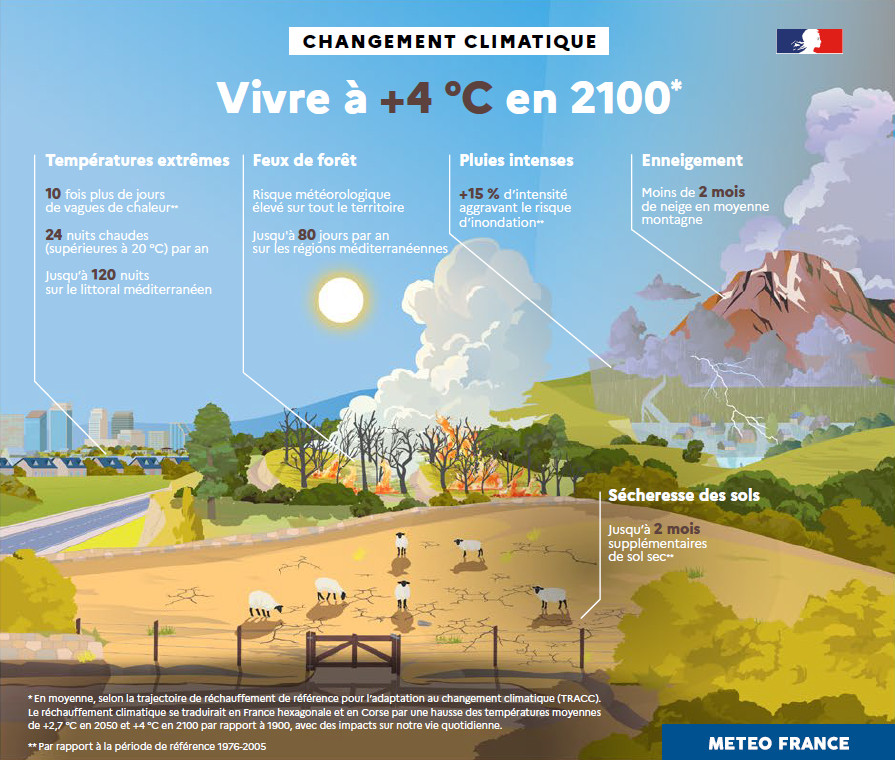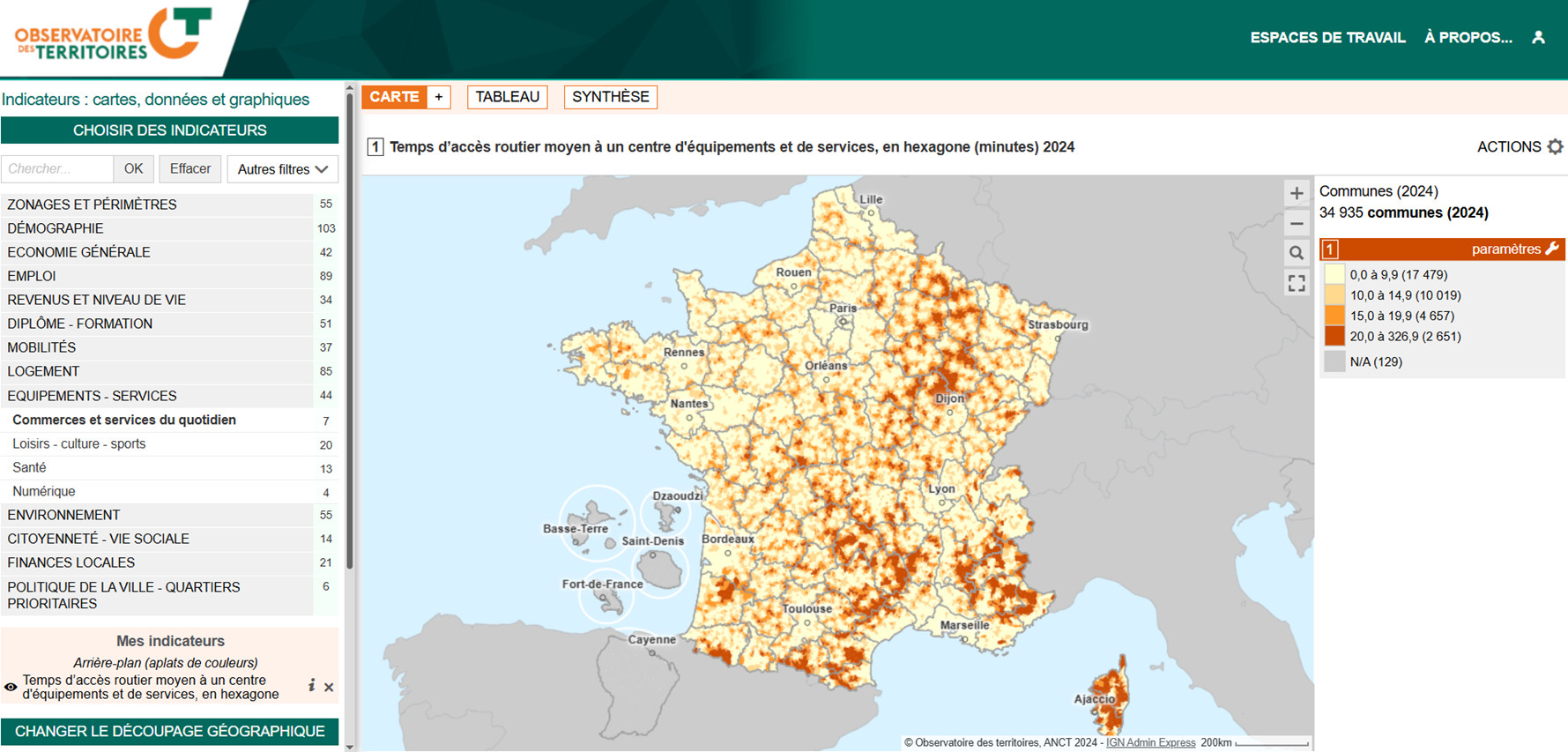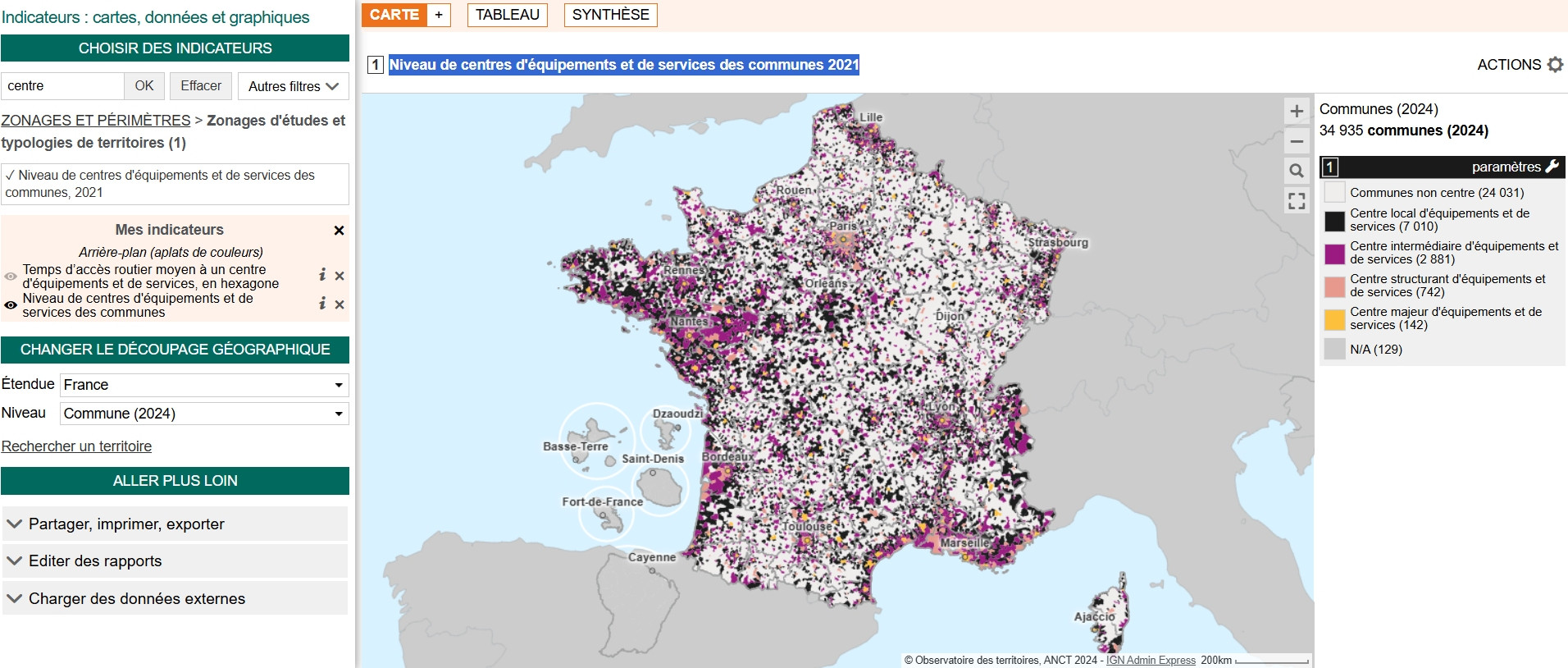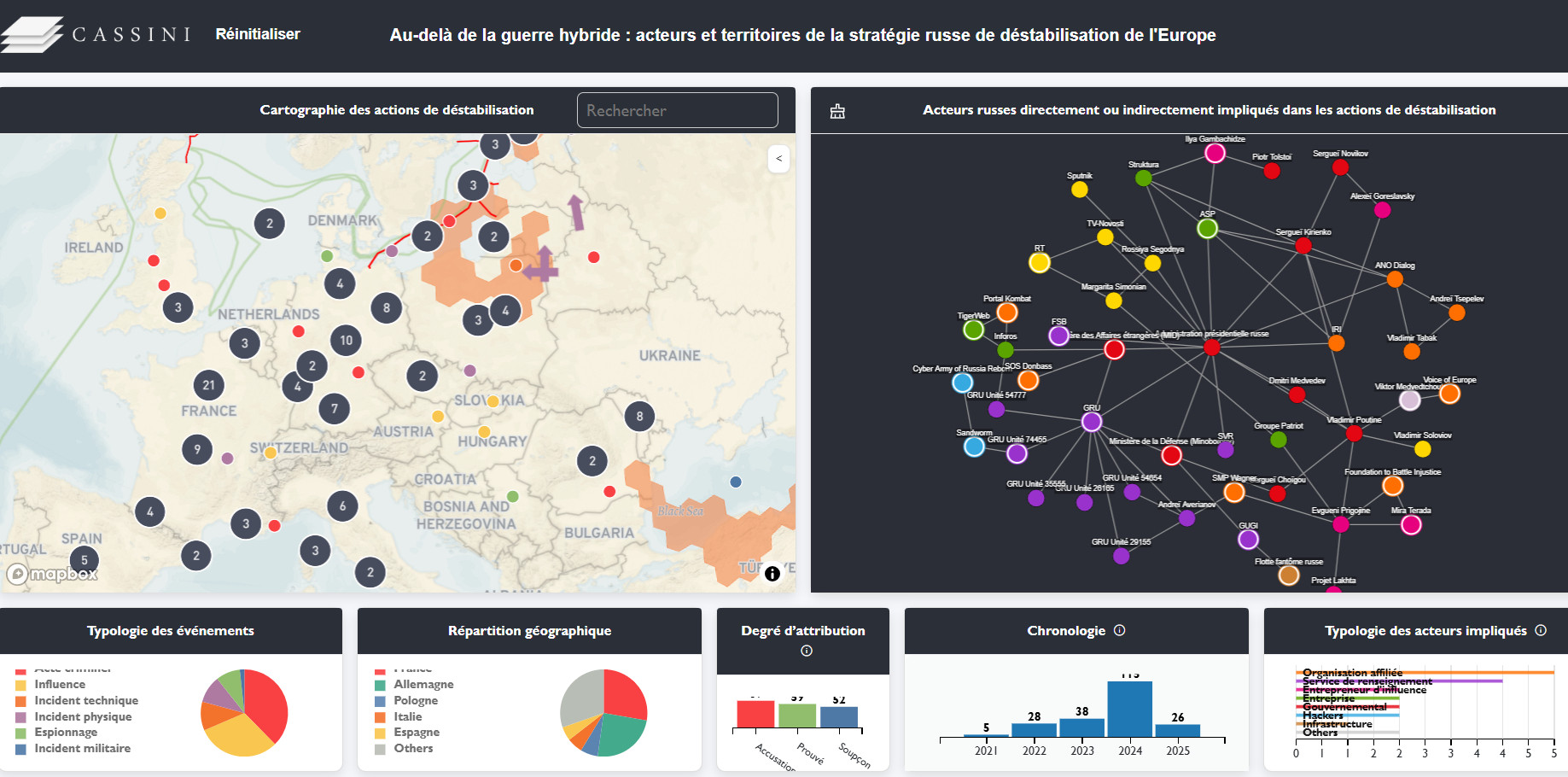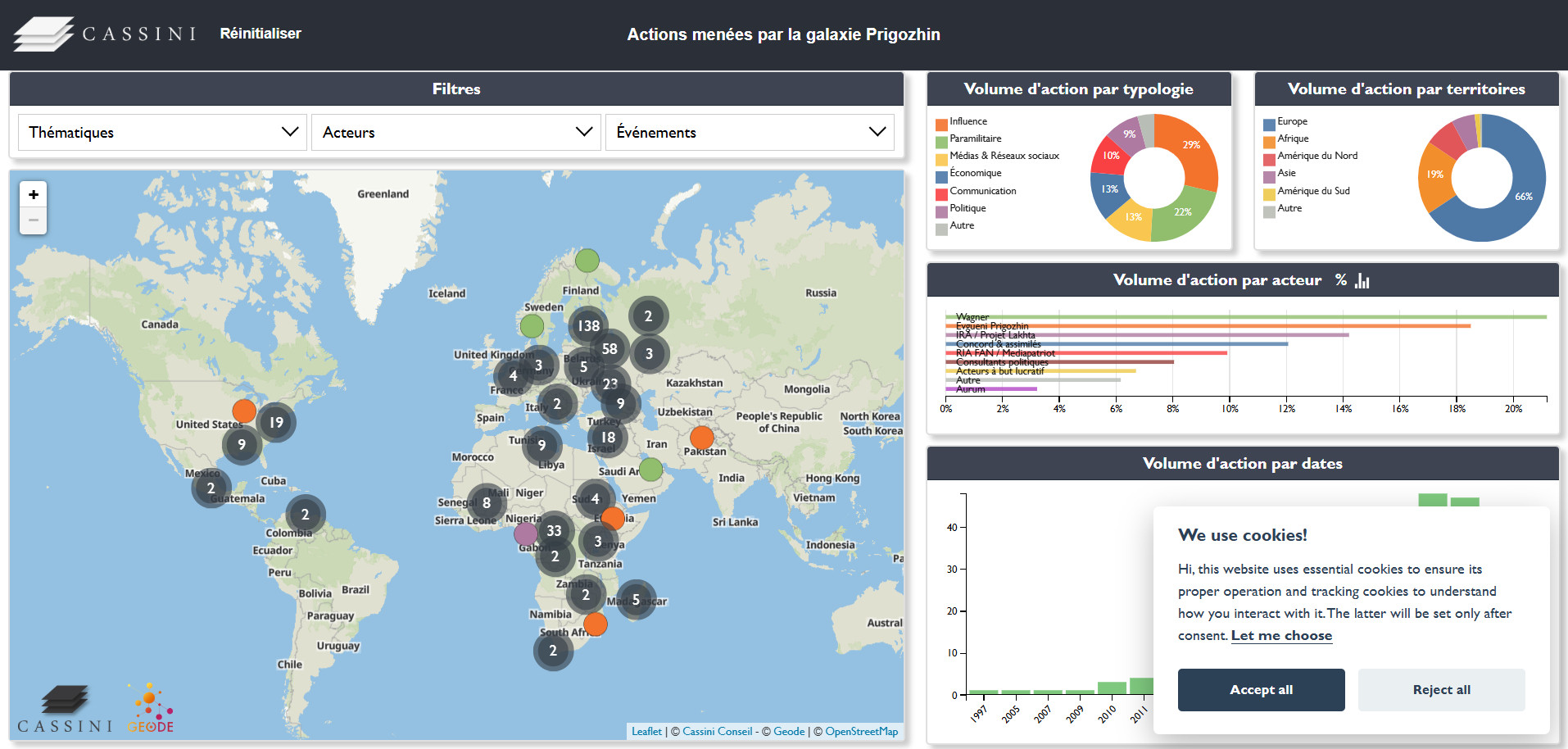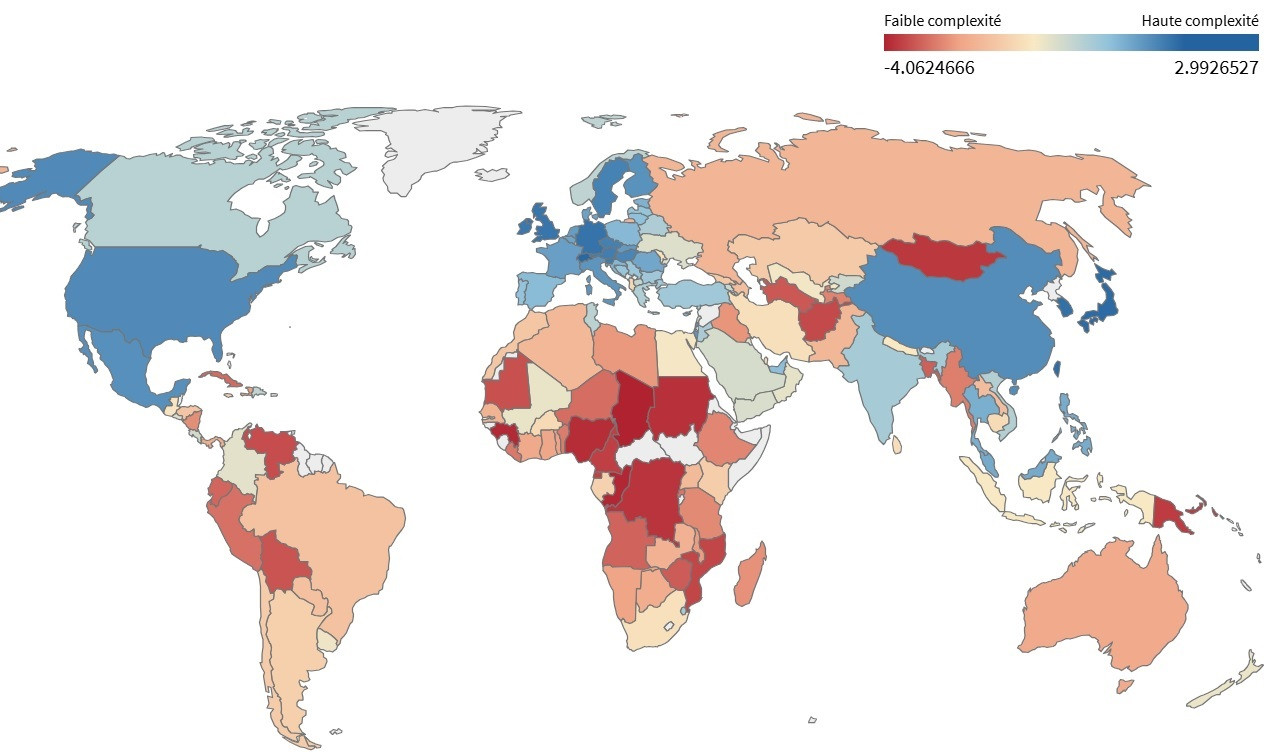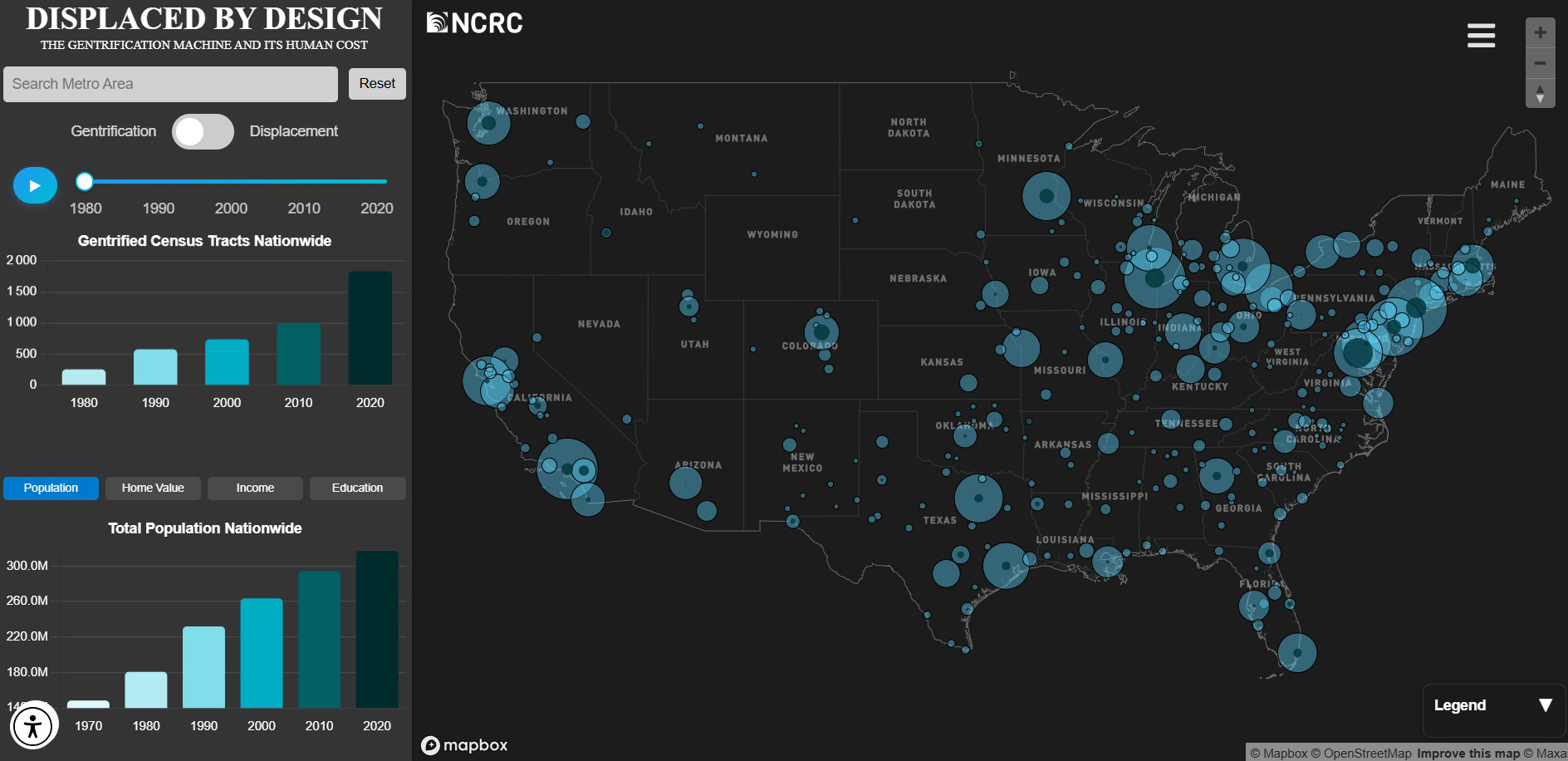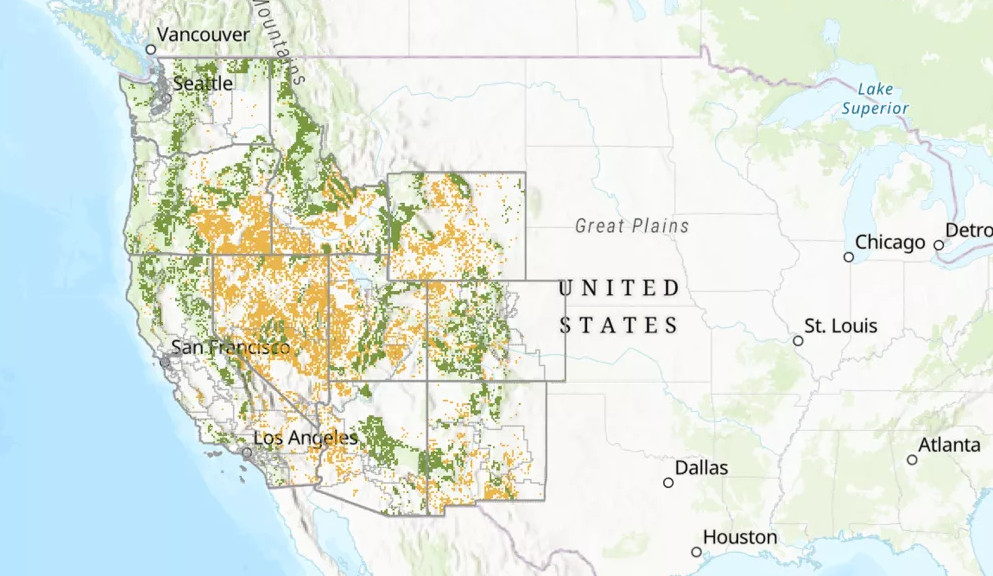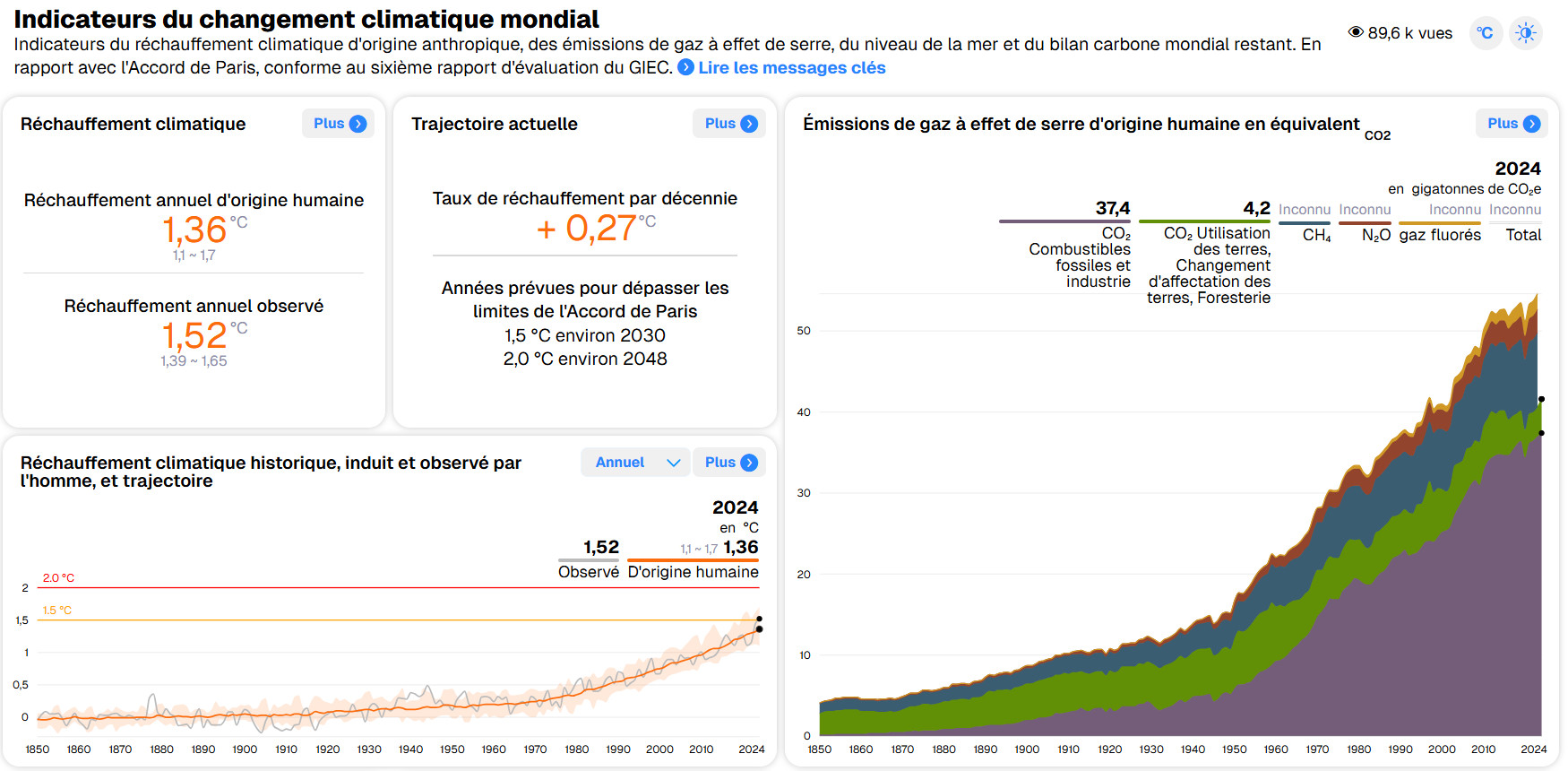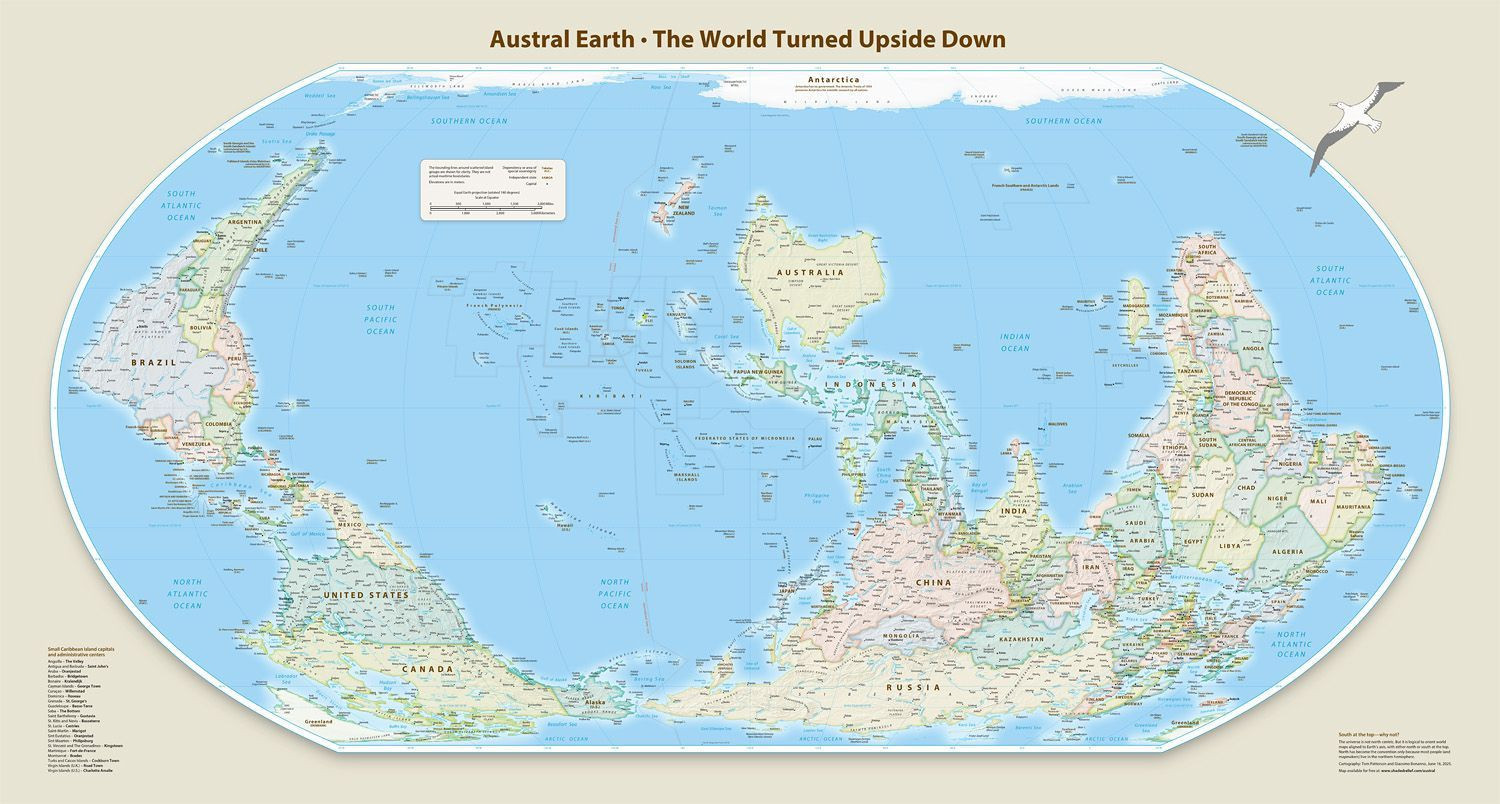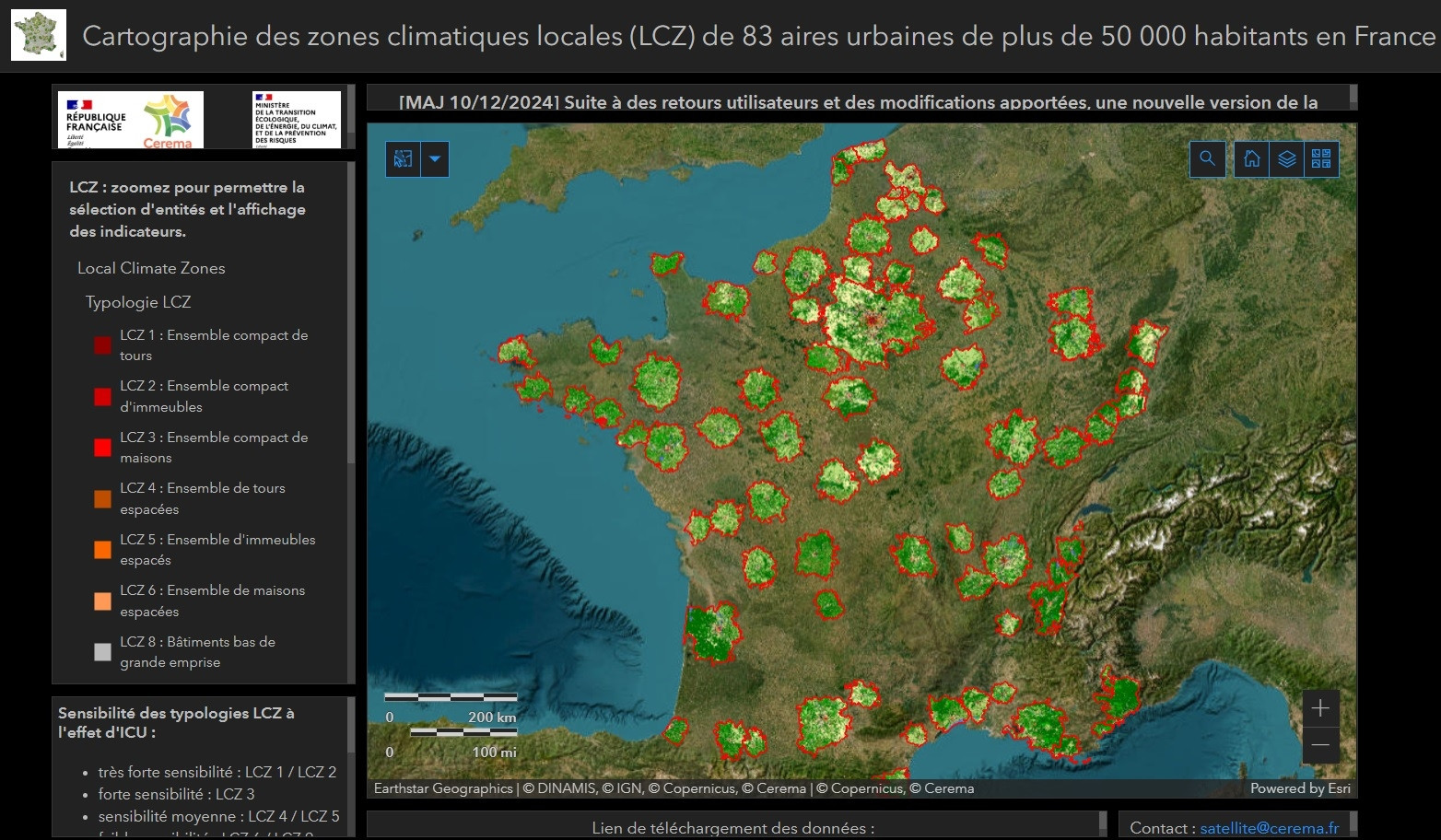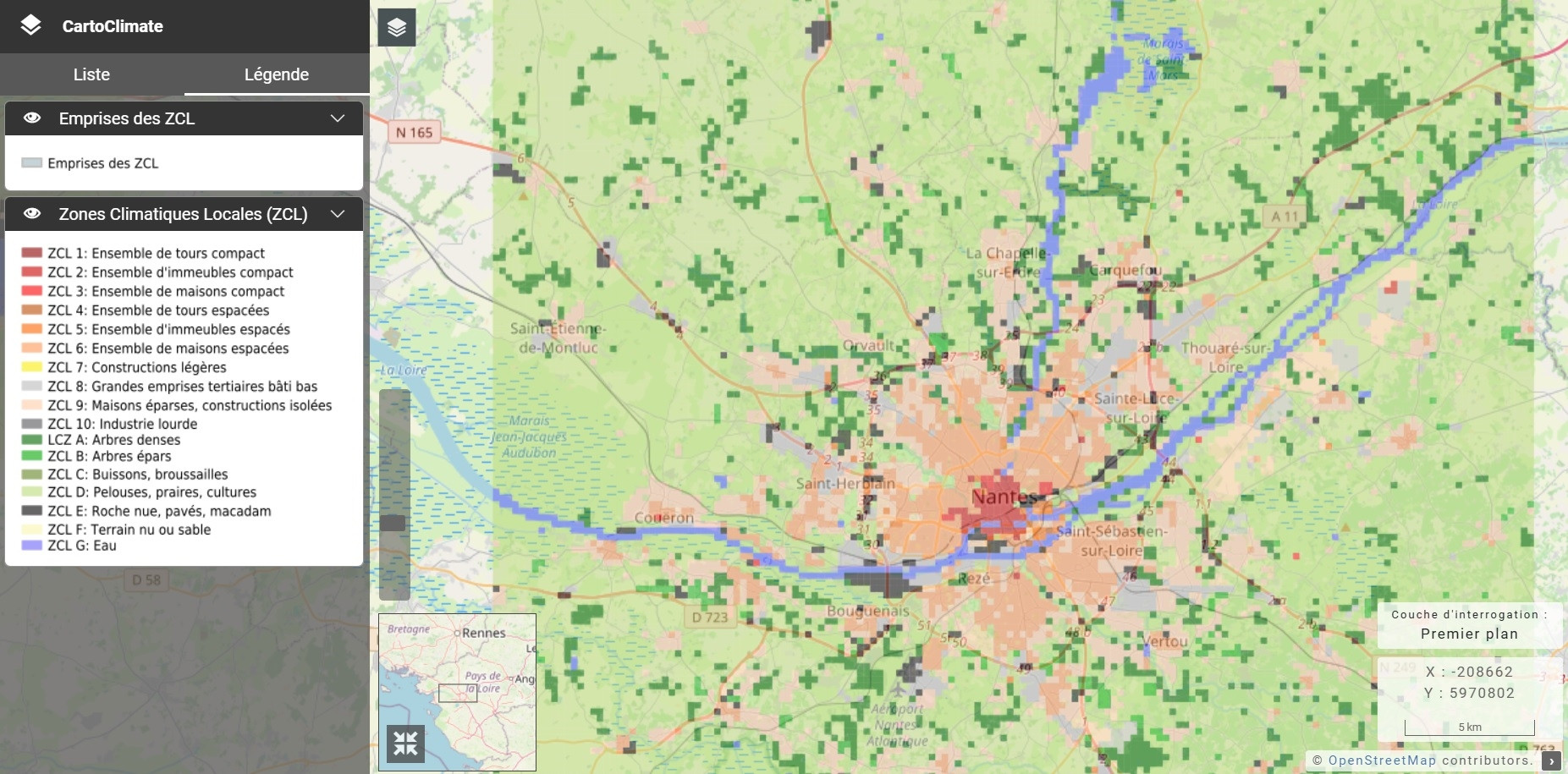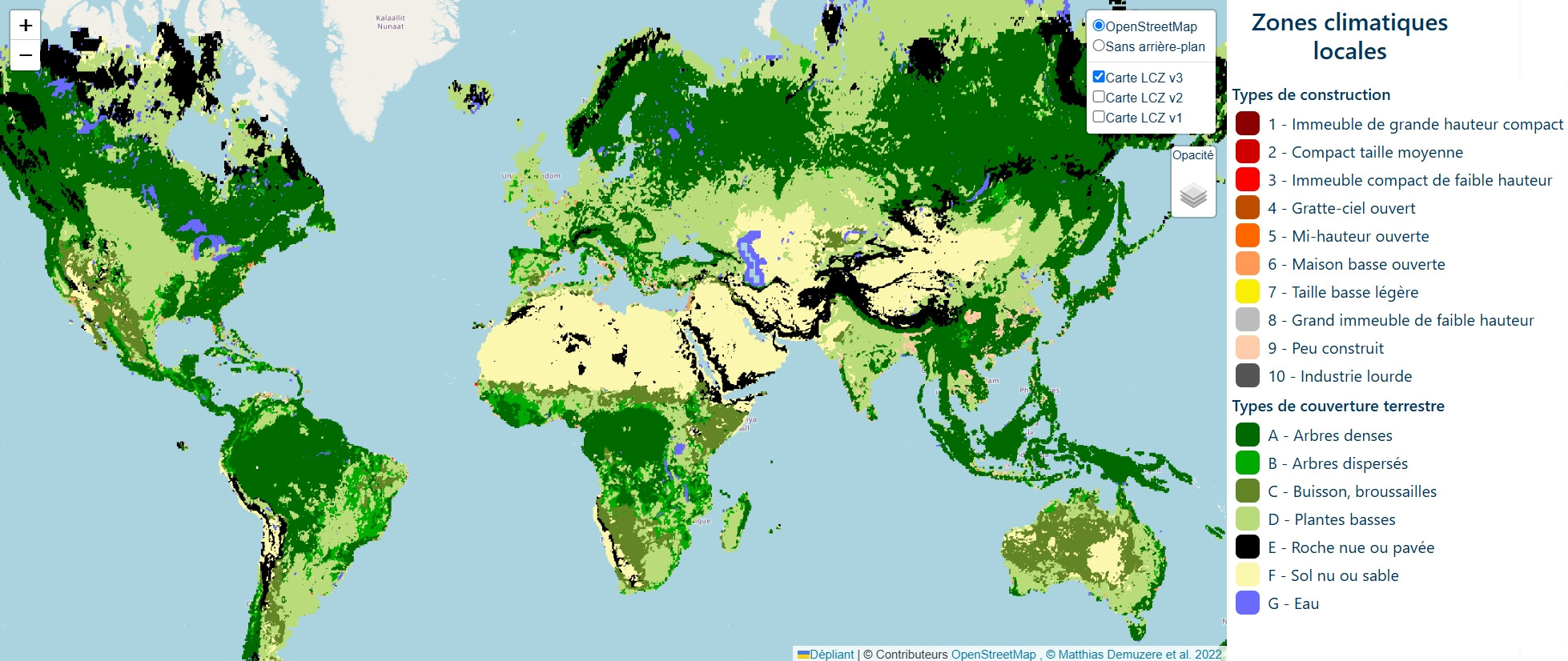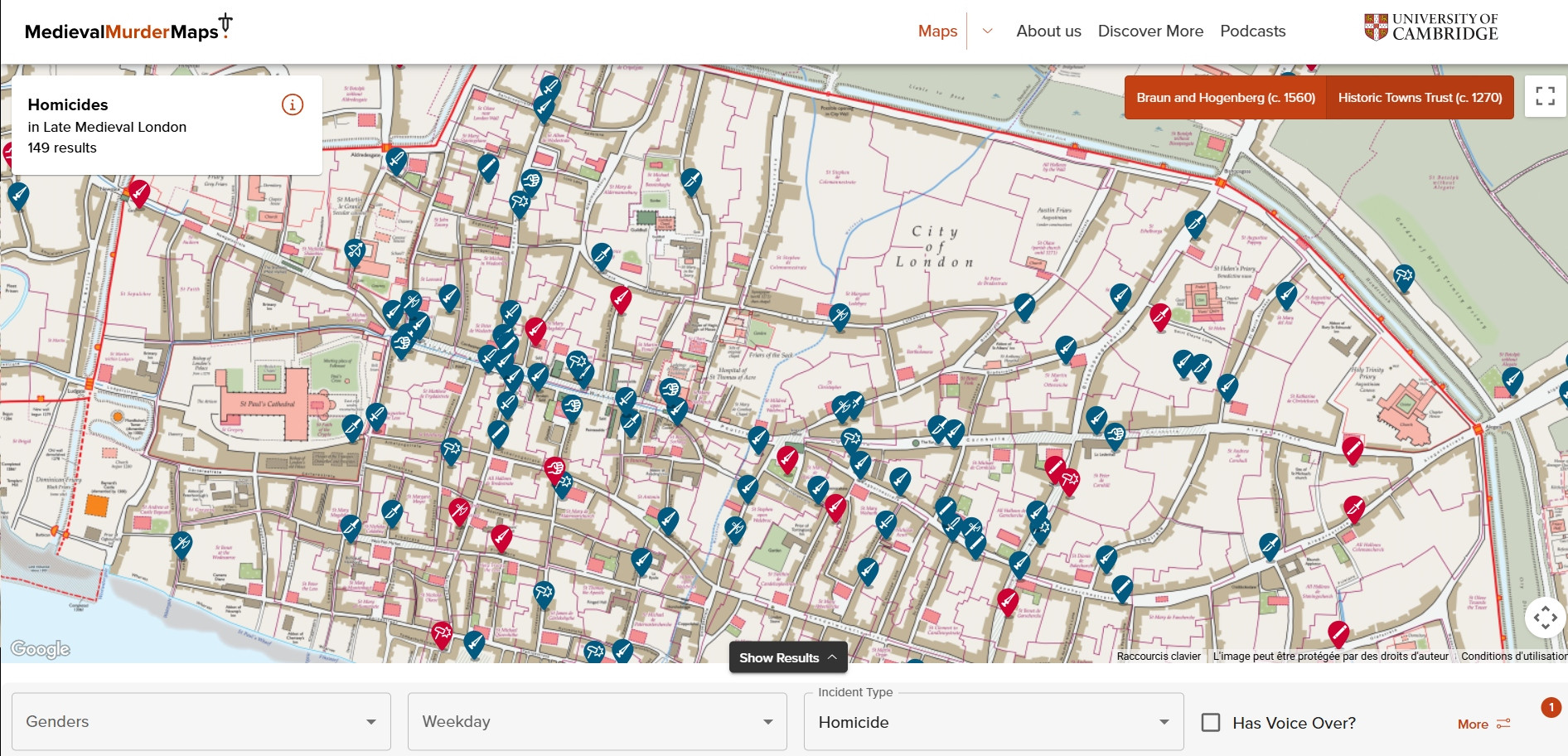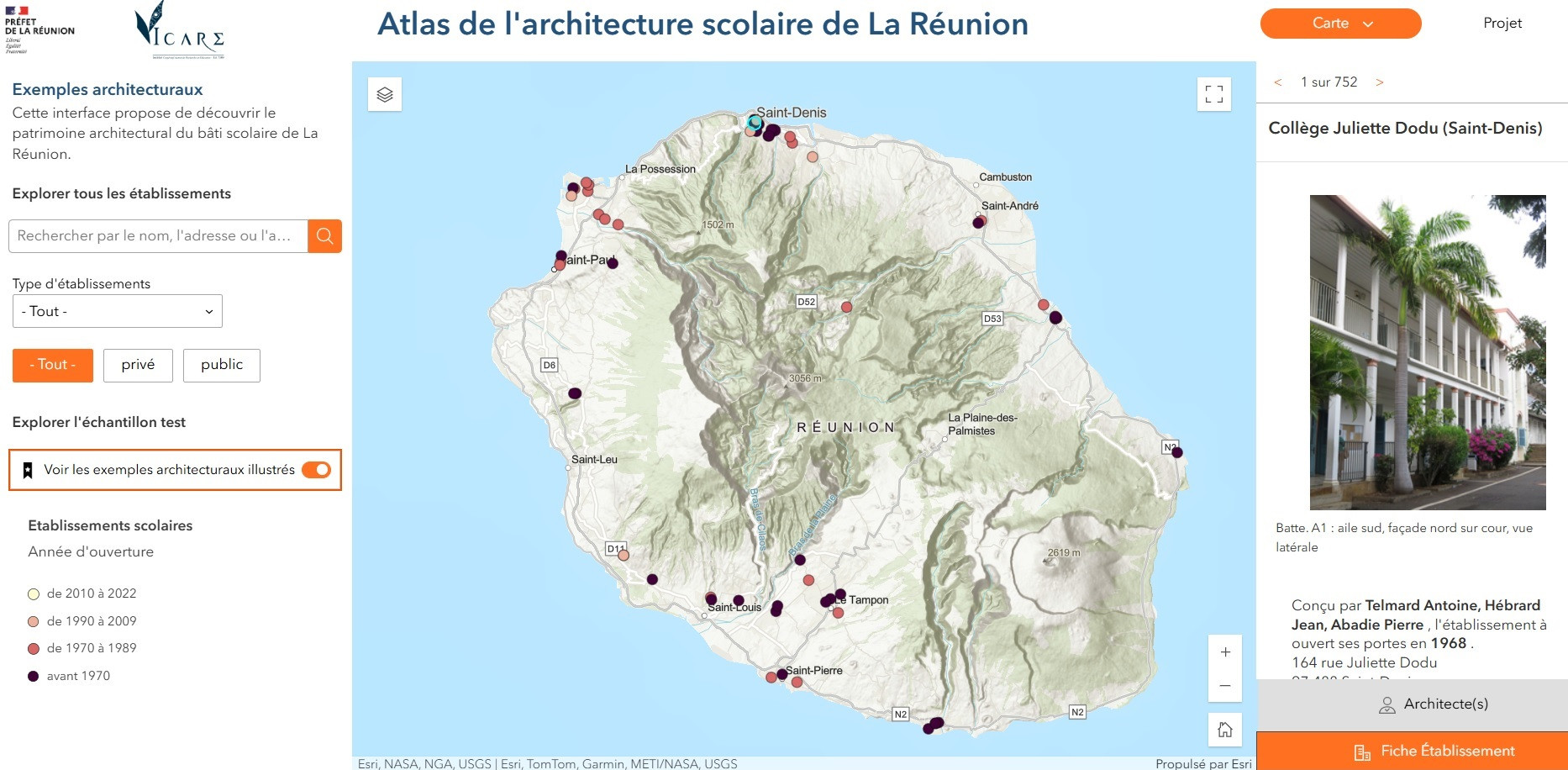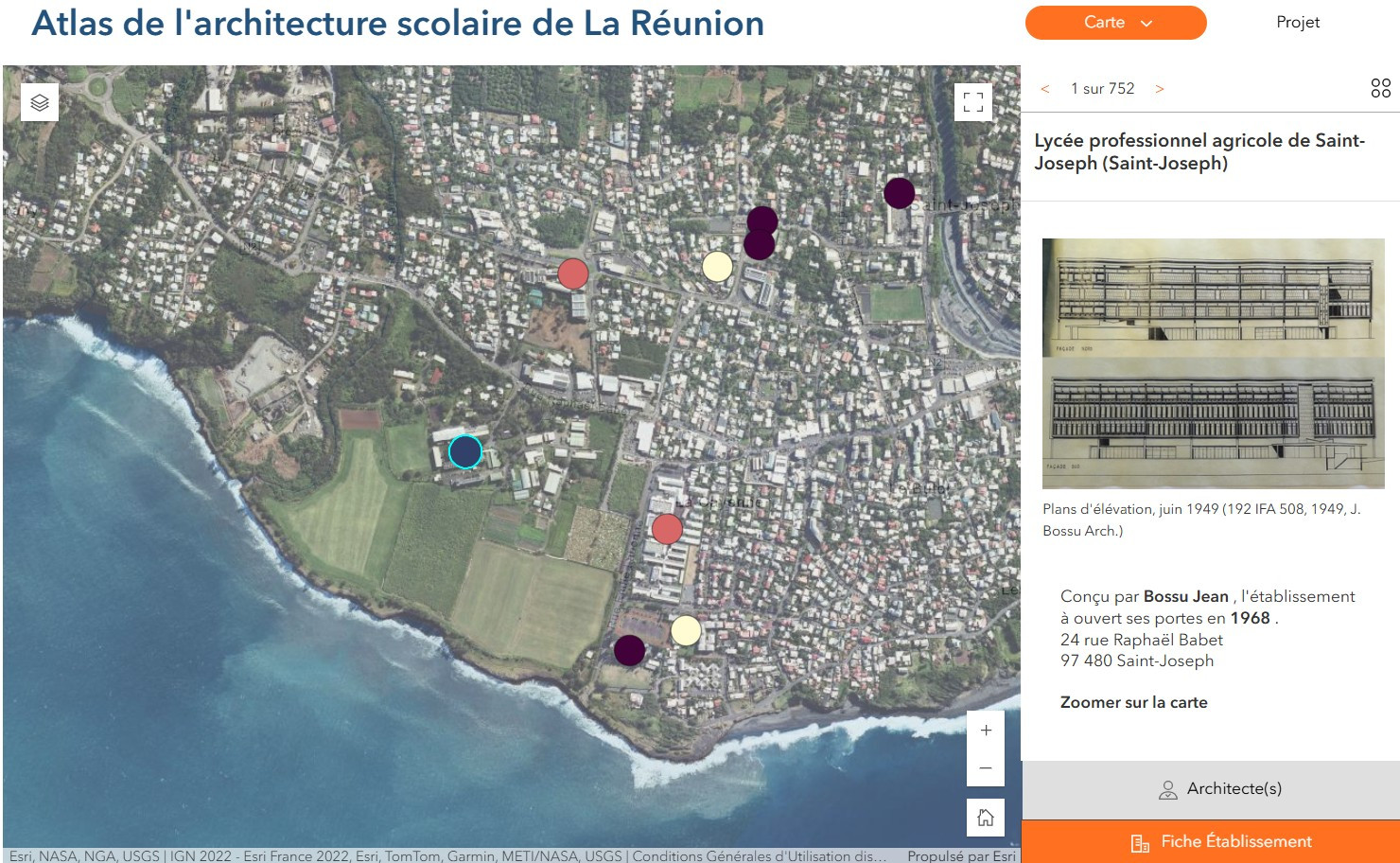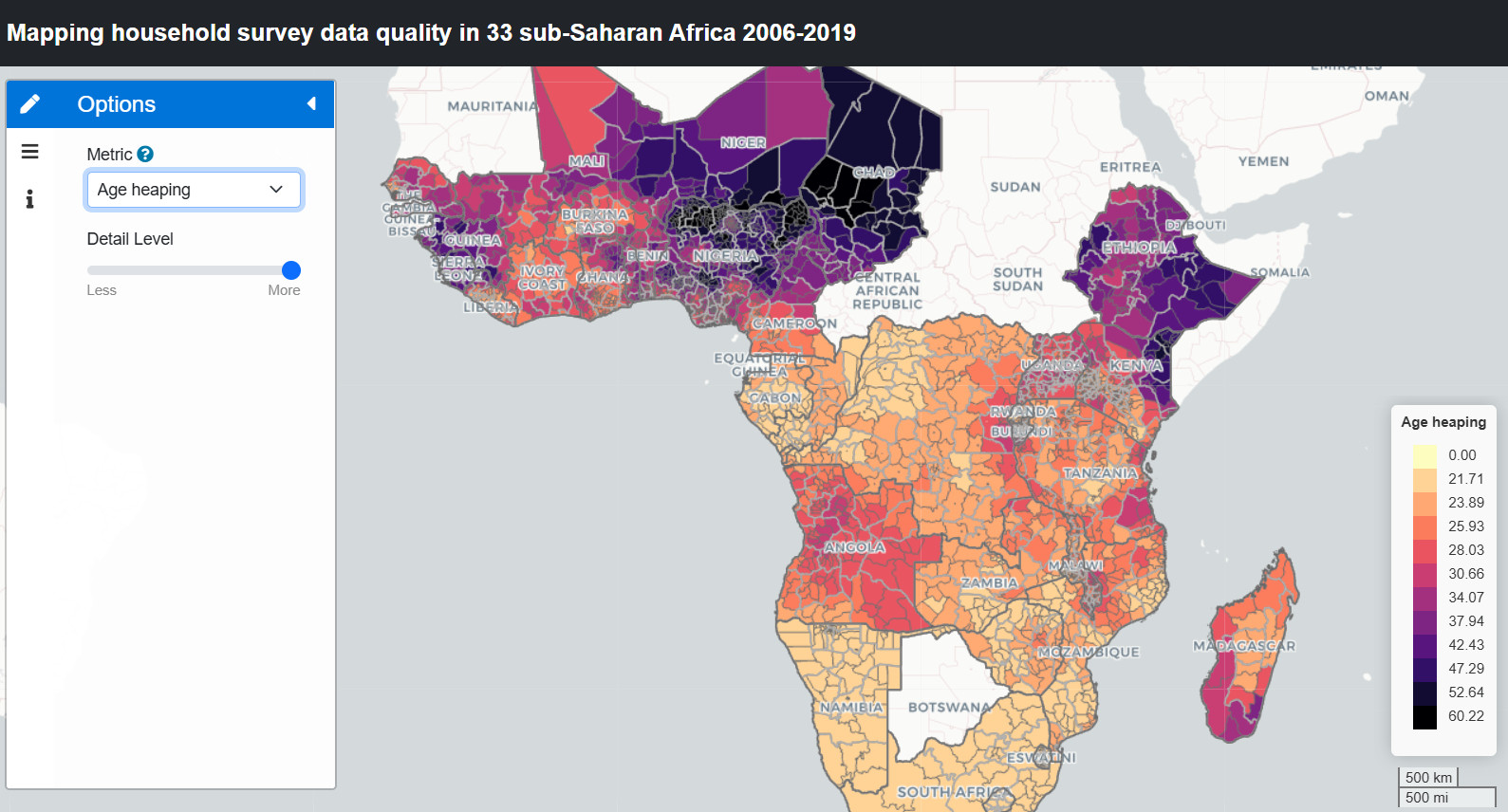Vous pouvez lire le billet sur le blog La Minute pour plus d'informations sur les RSS !
Canaux
6119 éléments (1853 non lus) dans 50 canaux
 Dans la presse
(1672 non lus)
Dans la presse
(1672 non lus)
-
 Cybergeo
(1611 non lus)
Cybergeo
(1611 non lus) -
 Mappemonde
(60 non lus)
Mappemonde
(60 non lus) -
 Dans les algorithmes
(1 non lus)
Dans les algorithmes
(1 non lus)
 Du côté des éditeurs
(24 non lus)
Du côté des éditeurs
(24 non lus)
-
 Toute l’actualité des Geoservices de l'IGN
(15 non lus)
Toute l’actualité des Geoservices de l'IGN
(15 non lus) -
 arcOpole - Actualités du Programme
arcOpole - Actualités du Programme
-
 arcOrama
(9 non lus)
arcOrama
(9 non lus) -
 Neogeo
Neogeo
 Toile géomatique francophone
(110 non lus)
Toile géomatique francophone
(110 non lus)
-
Géoblogs (GeoRezo.net) (5 non lus)
-
 UrbaLine (le blog d'Aline sur l'urba, la géomatique, et l'habitat)
UrbaLine (le blog d'Aline sur l'urba, la géomatique, et l'habitat)
-
 Séries temporelles (CESBIO)
(2 non lus)
Séries temporelles (CESBIO)
(2 non lus) -
 Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)
Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)
-
 Cartes et figures du monde
Cartes et figures du monde
-
 SIGEA: actualités des SIG pour l'enseignement agricole
SIGEA: actualités des SIG pour l'enseignement agricole
-
 Data and GIS tips
Data and GIS tips
-
 ReLucBlog
ReLucBlog
-
 L'Atelier de Cartographie
L'Atelier de Cartographie
-
My Geomatic
-
 archeomatic (le blog d'un archéologue à l’INRAP)
archeomatic (le blog d'un archéologue à l’INRAP)
-
 Cartographies numériques
Cartographies numériques
-
 Carnet (neo)cartographique
Carnet (neo)cartographique
-
 GEOMATIQUE
GEOMATIQUE
-
 Évènements – Afigéo
(12 non lus)
Évènements – Afigéo
(12 non lus) -
 Afigéo
(12 non lus)
Afigéo
(12 non lus) -
 Geotribu
(50 non lus)
Geotribu
(50 non lus) -
 Conseil national de l'information géolocalisée
(9 non lus)
Conseil national de l'information géolocalisée
(9 non lus) -
 Icem7
Icem7
-
Makina Corpus (1 non lus)
-
 Oslandia
(1 non lus)
Oslandia
(1 non lus) -
 CartONG
(2 non lus)
CartONG
(2 non lus) -
 GEOMATICK
(6 non lus)
GEOMATICK
(6 non lus) -
 Geomatys
(3 non lus)
Geomatys
(3 non lus) -
 Les Cafés Géo
(1 non lus)
Les Cafés Géo
(1 non lus) -
 L'Agenda du Libre
(3 non lus)
L'Agenda du Libre
(3 non lus) -
 Conseil national de l'information géolocalisée - Actualités
(3 non lus)
Conseil national de l'information géolocalisée - Actualités
(3 non lus)
 Géomatique anglophone
(35 non lus)
Géomatique anglophone
(35 non lus)
-
 All Points Blog
All Points Blog
-
 Directions Media - Podcasts
Directions Media - Podcasts
-
 Navx
Navx
-
James Fee GIS Blog
-
 Maps Mania
(19 non lus)
Maps Mania
(19 non lus) -
 Open Geospatial Consortium (OGC)
Open Geospatial Consortium (OGC)
-
 Planet OSGeo
(16 non lus)
Planet OSGeo
(16 non lus)
 Toile géomatique francophone (48 non lus)
Toile géomatique francophone (48 non lus)
-
11:30
Lancement de GeoRivière-Public : une plateforme citoyenne pour la préservation des milieux aquatiques
sur Makina CorpusMakina Corpus Territoires annonce le lancement de GeoRivière-Public : une plateforme dédiée à la sensibilisation et à la participation citoyenne pour la protection des cours d’eau.
-
 20:30
20:30 Café géo de Saint-Malo, samedi 4 octobre 2025 : « Géopolitique de l’espace extra-atmosphérique », avec Isabelle Soubès-Verger
sur Les Cafés Géo
-
 6:29
6:29 Webinaire « Sécuriser QGIS : enjeux, solutions et retours d’expérience »
sur Oslandia
IDéO BFC a invité Oslandia à venir s’exprimer sur le sujet de la sécurité dans QGIS à l’occasion d’un webinaire mardi 23 septembre de 11h à 12h.
Vincent Picavet sera au micro pour présenter :
- un panorama des bonnes pratiques de sécurité dans QGIS,
- une analyse des difficultés rencontrées dans les projets géospatiaux,
- et une présentation des travaux menés par Oslandia pour renforcer la cybersécurité au cœur de QGIS.
Inscription : [https:]]
-
 14:35
14:35 Comment notre jumeau numérique de la Terre & Océans change la donne
sur Geomatys Comment le jumeau numérique de la Terre et des océans change la donne
Comment le jumeau numérique de la Terre et des océans change la donne
- 08/09/2025
- Jordan Serviere
La thématique des GeoDataDays 2025 « Agir dans un monde en évolution : indispensables geodata » est ancrée dans un contexte marqué par le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, les transformations rapides de nos territoires et les tensions géopolitiques, les décideurs ont besoin d’outils qui dépassent la simple photographie de la situation. Pour agir efficacement, il faut d’abord observer et comprendre les dynamiques en cours. C’est précisément l’ambition du jumeau numérique multi-milieux développé par Geomatys : plus qu’une carte, il s’agit d’une vision vivante et évolutive de la Terre qui intègre en continu données satellites, capteurs, mesures in situ et modèles pour transformer la donnée en outil visuellement parlant.
La video ci-contre présente les capabilités du jumeau numérique.
Observer : une infrastructure solide et stratégiqueGeomatys a mis en place une architecture complète pour collecter, organiser et visualiser les données. Qu’il s’agisse d’informations géographiques, hydrographiques, océanographiques ou météorologiques (GHOM), la plateforme rend la lecture de ces données accessible en 4D grâce à des capacités avancées de visualisation et de traitements, dans une infrastructure cloud-native.
L’écosystème repose sur le moteur de jeu Unreal Engine 5, ainsi que notre socle logiciel Examind Server, le tout conforme aux standards OGC, garantissant l’interopérabilité et la pérennité de la solution. En résumé, cet outil permet donc disposer d’une base fiable et performante, pour passer au stade de l’analyse.
Comprendre : analyser n’a jamais été aussi simpleCependant, observer ne suffit pas : il faut donner du sens à la masse de données collectées. Grâce à des algorithmes d’IA ou des modèles de prédiction, ces données sont croisées, fusionnées, traduites en scénarios compréhensibles : montée des eaux, submersions, état écologique, pollution marine… Comprendre signifie transformer des données brutes en informations lisibles et exploitables pour les chercheurs comme pour les décideurs.
Par exemple, en croisant l’imagerie satellite avec les modèles de courant, on peut visualiser et anticiper la dérive de bancs de déchets en mer ; on peut faire de même avec les traces AIS et le niveau de houle, pour détecter des transbordements clandestins. Ces cas d’usage montrent comment le croisement et la fusion de données transforme l’observation en analyses immédiatement exploitables.
Agir : transformer la connaissance en décisionLa dernière étape, c’est l’action. Le jumeau numérique devient un levier pour planifier, anticiper et décider. Dans un contexte de crises et d’exigences de durabilité, les collectivités, agences et acteurs institutionnels trouvent dans cette plateforme un environnement immersif pour simuler et planifier. L’intégration de flux en temps réel, la représentation de scénarios tactiques et la possibilité de déployer des IHM directement sur le terrain permettent d’agir sans délai, au plus près des besoins. Un responsable militaire, par exemple, peut intégrer en temps-réel les effets de la météo dans la simulation d’un théâtre d’opérations. Agir, c’est utiliser la connaissance acquise pour guider des choix concrets et coordonnés, partout où les décisions doivent être prises.
Conclusion — Observer, comprendre, agirAvec le jumeau numérique Terre & Océans, Geomatys ne se limite pas à représenter la planète : l’objectif est de la comprendre, pour mieux agir. Dans un monde où chaque décision doit intégrer des données fiables et des perspectives d’avenir, cet outil offre une approche souveraine, interopérable et immersive. Les données deviennent alors des leviers concrets pour prendre les bonnes décisions et anticiper les défis.
Menu Linkedin
Twitter
Youtube
Linkedin
Twitter
Youtube

The post Comment notre jumeau numérique de la Terre & Océans change la donne first appeared on Geomatys.
-
 14:00
14:00 La refonte de QChat
sur Geotribu Raisons et explications techniques de la refonte de QChat, le système pour tchatter avec ses pair/es dans QGIS.
Raisons et explications techniques de la refonte de QChat, le système pour tchatter avec ses pair/es dans QGIS.
-
 14:10
14:10 Saint Romain en Gal: OpenStreetMap, rencontre mensuelle, Le jeudi 18 septembre 2025 de 18h30 à 20h30.
sur L'Agenda du LibreDiscussion entre contributeurs.trices viennois.es du projet OSM et acteurs intéressés.

Toute personne intéressée par OpenStreetMap peut s'intégrer à cette rencontre, tout particulièrement les débutant.e.s qui souhaiteraient des conseils pour se lancer.
Ordre du jour à compléter: [https:]]
Lieu de réunion: Ninkasi, 15, impasse du Rond Point, 69210 Saint-Romain-en-Gal - à partir de 18h30
-
 13:41
13:41 Synthèse d’expert sur l’édition 2025 du geOcom
sur AfigéoSynthèse d’expert sur l’édition 2025 du geOcom Synthèse d’expert sur l’édition 2025 du geOcom AfigéoLa communauté geOrchestra, composée de développeurs et d’utilisateurs (principalement les administrateurs de plateformes de données), s’est réunie en Bretagne du 23 au 25 juin lors de son évènement annuel à Rennes, là où geOrchestra est né une quinzaine d’années plus tôt. Le comité de pilotage geOrchestra a bénéficié de l’accueil de Rennes Métropole. Dans le […]
The post Synthèse d’expert sur l’édition 2025 du geOcom first appeared on Afigéo.
-
 12:52
12:52 Vandoeuvre-lès-Nancy: Réunion OpenStreetMap, Le mercredi 24 septembre 2025 de 18h00 à 20h00.
sur L'Agenda du Libre
Le groupe local Nancy de l’association OpenStreetMap France vous propose de participer aux réunions mensuelles ouvertes à tou·te·s !
Avec OpenStreetMap, participez à la construction d’une carte en ligne libre et gratuite, partagée avec le monde entier!
Participation aux ateliers
Le lieu la Fabrique des possibles nous est librement accessible lors de nos réunions.
Si vous souhaitez participer à distance, cela est possible depuis ce lien. Toutefois merci de nous en avertir pour que nous nous organisions en nous équipant et installant le matériel nécessaire.
-
 15:10
15:10 Collectif CICCLO – Synthèse des réunions et feuille de route 2025/2026
sur AfigéoCollectif CICCLO – Synthèse des réunions et feuille de route 2025/2026 Collectif CICCLO – Synthèse des réunions et feuille de route 2025/2026 AfigéoLe Collectif CICCLO a enchaîné plusieurs réunions stratégiques (6 & 26 juin, 29 août 2025) qui marquent une nouvelle étape pour la valorisation et l’évolution des plateformes de données régionales. Ces échanges, dans la continuité des projets FINDPE 2024, ont permis de dresser un bilan, d’identifier de nouveaux axes de travail et de tracer une […]
The post Collectif CICCLO – Synthèse des réunions et feuille de route 2025/2026 first appeared on Afigéo. -
 10:35
10:35 Retour sur le GT « Défense & Sécurité » de l’Afigéo, 10 juillet 2025
sur AfigéoRetour sur le GT « Défense & Sécurité » de l’Afigéo, 10 juillet 2025 Retour sur le GT « Défense & Sécurité » de l’Afigéo, 10 juillet 2025 AfigéoLe 10 juillet, plus de 30 adhérents du GT « Défense & Sécurité » de l’Afigéo étaient accueillis au Centre National d’Etudes Spatiales sur son site de Toulouse, pour une journée spéciale dédiée aux activités satellitaires dans ce domaine d’application. Le panorama des projets structurants présentés par le CNES s’inscrit dans un contexte géopolitique et environnemental qui […]
The post Retour sur le GT « Défense & Sécurité » de l’Afigéo, 10 juillet 2025 first appeared on Afigéo. -
 10:23
10:23 Découvrez le pré-programme du FIG 2025
sur AfigéoDécouvrez le pré-programme du FIG 2025 Découvrez le pré-programme du FIG 2025 AfigéoLe programme de l’espace Géo-Numérique du Festival de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges se dévoile ! Animé par l’Afigéo, l’espace Géo-Numérique propose aux participants de découvrir nos métiers de l’information géonumérique à travers des ateliers et des conférences et un salon avec plus de 25 exposants ! Découvrez ci-dessous le pré-programme : Exposants : Vendredi 3 octobre : 09h45 à 10h15 : Comment […]
The post Découvrez le pré-programme du FIG 2025 first appeared on Afigéo.
-
 15:48
15:48 3ème édition du concours de datavisualisation, du 13 oct au 5 nov 2025
sur Évènements – Afigéo3ème édition du concours de datavisualisation, du 13 oct au 5 nov 2025 3ème édition du concours de datavisualisation, du 13 oct au 5 nov 2025 AfigéoPour sensibiliser le grand public à l’importance des données et à leur accessibilité, DataGrandEst organise un concours original et créatif, ouvert à toutes et tous. En 2025, on met le cap sur la biodiversité ! À partir de données sur la faune, la flore et les milieux naturels du Grand Est, les participants sont invités à raconter […]
The post 3ème édition du concours de datavisualisation, du 13 oct au 5 nov 2025 first appeared on Afigéo. -
 15:18
15:18 4ème édition des Rencontres Régionales de la Donnée en Grand Est, le 27 novembre à Strasbourg
sur Évènements – Afigéo4ème édition des Rencontres Régionales de la Donnée en Grand Est, le 27 novembre à Strasbourg 4ème édition des Rencontres Régionales de la Donnée en Grand Est, le 27 novembre à Strasbourg AfigéoDonnées pour une transition écologique et un numérique responsable : le défi du Grand Est ! Plus de données pour une transition écologique réussie, moins de données pour une sobriété numérique responsable… Comment concilier ces deux impératifs ? Le Grand Est relève le défi ! Présentations de cas d’usages, nouvelles perspectives de collaboration, venez découvrir […]
The post 4ème édition des Rencontres Régionales de la Donnée en Grand Est, le 27 novembre à Strasbourg first appeared on Afigéo.
-
 13:25
13:25 France – Québec : le géonumérique au service d’Energir
sur AfigéoFrance – Québec : le géonumérique au service d’Energir France – Québec : le géonumérique au service d’Energir AfigéoDans le cadre du partenariat de coopération, l’Afigéo et Géospatial ont organisé une rencontre en visio entre les membres du Club SIG Grands Comptes et Benoît PRONOVOST, directeur de l’équipe solutions Géomatique chez Énergir, le 1er distributeur de Gaz naturel au Québec La présentation s’est déclinée en trois parties : A la suite de cette présentation, […]
The post France – Québec : le géonumérique au service d’Energir first appeared on Afigéo.
-
 12:32
12:32 GéoMTL 2025, les 8 et 9 octobre au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe
sur Évènements – AfigéoGéoMTL 2025, les 8 et 9 octobre au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe GéoMTL 2025, les 8 et 9 octobre au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe AfigéoLe 22e événement organisé par l’ACSG Montréal qui crée des opportunités en géomatique. Dans le cadre du partenariat France-Québec 2025, l’Afigéo sera présente le 7 octobre pour le Forum Géospatial Québec au Centre des Congrès de Saint-Hyacinthe et organise un stand collectif les 8 et 9 octobre au Salon GéoMTL avec l’accueil d’entreprises françaises : […]
The post GéoMTL 2025, les 8 et 9 octobre au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe first appeared on Afigéo.
-
 11:07
11:07 Vers une « Étude en faveur des usages des Infrastructures Géodésiques en France »
sur AfigéoVers une « Étude en faveur des usages des Infrastructures Géodésiques en France » Vers une « Étude en faveur des usages des Infrastructures Géodésiques en France » AfigéoLes infrastructures géodésiques nationales fournissent une référence commune indispensable à la fiabilité des données géolocalisées et à l’interopérabilité des systèmes. Elles sont le socle invisible mais essentiel de nombreuses applications géonumériques, dont l’usage s’est fortement intensifié grâce aux progrès du géopositionnement (urbanisme, génie civil, sécurité civile, agriculture de précision ou encore navigation), au bénéfice d’acteurs publics, […]
The post Vers une « Étude en faveur des usages des Infrastructures Géodésiques en France » first appeared on Afigéo. -
 10:51
10:51 Apéro Géo & Innovation : retour sur l’édition 2025 à Toulouse !
sur AfigéoApéro Géo & Innovation : retour sur l’édition 2025 à Toulouse ! Apéro Géo & Innovation : retour sur l’édition 2025 à Toulouse ! AfigéoL’Apéro Géo & Innovation a fait son grand retour à l’Afigéo ! Cette première édition 2025 s’est déroulée le 9 juillet dernier avec plus de 40 participants à la « Cantine Toulouse », organisé par l’Afigéo, accueilli par la Mêlée et avec le soutien de Magellium et Groupe PARERA. Géonumérique et dataviz : où en est-on ? Par […]
The post Apéro Géo & Innovation : retour sur l’édition 2025 à Toulouse ! first appeared on Afigéo.
-
 7:06
7:06 Lyon: OpenStreetMap, rencontre mensuelle, Le mardi 16 septembre 2025 de 18h30 à 20h00.
sur L'Agenda du LibreDiscussion entre contributeurs lyonnais du projet OSM et acteurs intéressés.

Toute personne intéressée par OpenStreetMap peut s'intégrer à cette rencontre, tout particulièrement les débutants qui souhaiteraient des conseils pour se lancer.
Ordre du jour à compléter: [https:]]
Lieu de réunion: Tubà, 15 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3e.
-
 11:19
11:19 Retour sur la session dédiée à l’ingénierie coopérative dans les geodata aux RNIT
sur AfigéoRetour sur la session dédiée à l’ingénierie coopérative dans les geodata aux RNIT Retour sur la session dédiée à l’ingénierie coopérative dans les geodata aux RNIT AfigéoLes Rencontres Nationales de l’Ingénierie Territoriale (RNIT) de l’AITF (Association des Ingénieur.e.s territoriaux et Ingénieur.e.s en chef territoriaux de France) se sont déroulées du 8 au 9 juillet dernier à Toulouse sur le thème « Construire une ingénierie numérique responsable et coopérative à travers l’intelligence collective ». A cette occasion, l’Afigéo a organisé une conférence […]
The post Retour sur la session dédiée à l’ingénierie coopérative dans les geodata aux RNIT first appeared on Afigéo.
-
 14:00
14:00 Geodatadays à vélo
sur Geotribu Rejoignez le défi : pédalez jusqu’aux Geodatadays.
Rejoignez le défi : pédalez jusqu’aux Geodatadays.
-
 9:27
9:27 Webinaire France-Québec #2 Mutualiser les solutions géonumériques innovantes au service de la transition écologique dans les territoires
sur AfigéoWebinaire France-Québec #2 Mutualiser les solutions géonumériques innovantes au service de la transition écologique dans les territoires Webinaire France-Québec #2 Mutualiser les solutions géonumériques innovantes au service de la transition écologique dans les territoires AfigéoDate : 29 septembre 2025Heure : 9 h à 10 h 15 (heure du Québec) / 15 h à 16 h 15 (heure de France) La collaboration entre Géospatial Québec et l’Afigéo favorise l’échange et le partage de bonnes pratiques entre les deux écosystèmes d’acteurs experts en geodata. Ce second webinaire explorera les dispositifs de coopération autour […]
The post Webinaire France-Québec #2 Mutualiser les solutions géonumériques innovantes au service de la transition écologique dans les territoires first appeared on Afigéo. -
 11:55
11:55 Cycle d’événements autour des données publiques organisé par la DINUM
sur AfigéoCycle d’événements autour des données publiques organisé par la DINUM Cycle d’événements autour des données publiques organisé par la DINUM AfigéoLa Direction interministérielle du numérique (DINUM) lance, à partir de septembre 2025, “la rentrée de datagouv”, un cycle de trois mois de rencontres et d’événements autour des données publiques. L’objectif : se réunir, échanger et réfléchir aux manières de renforcer l’impact des données publiques sur la société, l’économie et les services publics. Pendant la rentrée de […]
The post Cycle d’événements autour des données publiques organisé par la DINUM first appeared on Afigéo.
-
 2:49
2:49 Dates de fauche en France
sur Séries temporelles (CESBIO)
En 2024, des collègues du Cesbio ont publié un article* sur la cartographie de la date de fauche en France en 2022 à partir des données satellitaires Sentinel-2. Leur magnifique figure 10 a attiré mon attention. La version à haute résolution fournie avec l’article (2861 × 2911 pixels) correspond à une image dont les pixels font […]
-
16:30
Geotrek-Mobile, zones sensibles désormais accessibles
sur Makina CorpusUne nouvelle fonctionnalité vient enrichir l’application Geotrek-Mobile : l’affichage des zones sensibles directement sur la carte, le long des itinéraires.
-
 12:00
12:00 Publication du rapport annuel du CNIG 2024
sur Conseil national de l'information géolocaliséeLe rapport annuel du CNIG est sorti : le CNIG au service de la donnée territoriale et souveraine
-
 12:00
12:00 Publication du rapport annuel du CNIG 2024
sur Conseil national de l'information géolocalisée - Actualités -
 10:00
10:00 Info-CNIG n°24 - août-septembre 2025
sur Conseil national de l'information géolocalisée - Actualités Découvrez la nouvelle formule de la lettre d'information du CNIG
Abonnez-vous !
Découvrez la nouvelle formule de la lettre d'information du CNIG
Abonnez-vous !
-
 11:55
11:55 La cartographie comme trace des parcours d’exil
sur Carnet (neo)cartographiqueLe billet ci-dessous est une retranscription de l’entretien réalisé pour le centre Primo Levi. Le Centre Primo Levi a été créé en 1995 par 5 associations engagées dans le domaine de la santé et de la défense des droits humains : Amnesty International France, Médecins du Monde, l’Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-France), Juristes sans frontières et Trêve. C’est une association de référence spécifiquement dédiée au soin et au soutien des personnes victimes de la torture et de la violence politique exilées en France. Cet entretien a été publié dans le numéro 91 de la revue Mémoires.

La cartographie sur la thématique des migrations pourrait-elle faire trace dans les mémoires des lecteurs ? Quelques éléments de réponse par Nicolas Lambert, ingénieur de recherche au CNRS et membre individuel de Migreurop.
Propos recueillis par Marie Daniès, rédactrice en chef
Marie Daniès : Quelle est la fonction d’une carte ?
Nicolas Lambert : La carte est le point de départ et le point d’aboutissement du travail en géographie. Au début du travail, la carte est construite pour soi. Cela permet d’avoir une première vision des données, de regarder comment elles s’organisent, de tester des croisements, de faire émerger des hypothèses, etc. En premier lieu, c’est donc un travail d’investigation, d’exploration. À la fin, la carte joue un autre rôle. Elle sert de vecteur de communication pour donner à voir ce qu’on a trouvé. Le travail commence donc par une carte tournée vers soi à des fins d’exploration, pour parvenir à une carte tournée vers l’extérieur, avec une dimension pédagogique et une volonté de communication d’un message. Insistons sur un point. Le processus de construction cartographique est toujours un acte de création. Car même si elle se modélise à partir de données, de faits étayés scientifiquement, que les règles de constructions graphiques sont respectées, la carte n’est jamais tout à fait neutre. Toute carte porte en elle une forme de discours. Et comme dans tout discours, il existe divers éléments rhétoriques sur lesquels il est possible de jouer : les affects, les couleurs, les ordres de grandeur, etc. Il faut donc faire preuve d’esprit critique. Mon approche, en ce qui concerne les migrations, est de déconstruire les représentations dominantes et proposer des représentations alternatives.
MD : Comme c’est le cas pour représenter les « flux » migratoires par exemple ?
NL : Prenons l’exemple d’une carte traditionnelle réalisée par l’agence Frontex, l’agence européenne des garde-frontières et des garde-côtes. Leurs cartes représentent souvent les migrations avec des grosses flèches rouges, agrégées, unidirectionnelles, qui traversent des territoires, etc., et qui représentent les mouvements de personnes avec une rhétorique d’invasion que l’on peut retrouver dans les cartographies de type « fronts militaires » ou dans les cartes de propagande de l’extrême droite. Pour contrebalancer cette vision, nous avons eu envie, à Migreurop, de représenter le parcours d’une seule personne, décomposer un de ces flux pour montrer qu’il n’est pas homogène. Que derrière ces grosses flèches agrégées, ce sont toujours des histoires individuelles vécues. Individualiser un parcours permet d’humaniser ces vies. Par ailleurs, transmettre une idée, une émotion, passe aussi par la façon dont la carte va être présentée. Proposer des cartes dessinées à la main, essayer de mettre un peu de chaleur en n’étant pas trop abstrait ou trop quantitatif. Déconstruire la manière dont ces cartes sont bâties pour remettre un peu de complexité là où cela est simplifié. Il n’y a jamais une seule représentation possible. Tout comme on peut raconter la même histoire de différentes façons, il n’y a jamais de lien automatique entre la donnée et la façon dont on la représente.
Un autre exemple pourrait être celui réalisé avec une collègue, Françoise Bahoken, sur les réfugiés syriens en 2015. A partir de cartes représentant « l’invasion de l’Europe » par des milliers de Syriens, nous avons cherché à faire varier ces représentations en changeant la taille des cercles, les couleurs, les mots. Mais également l’emprise spatiale de la carte pour montrer que si l’on élargit le cadre, nous pouvons nous rendre compte que les migrants vont majoritairement dans les pays limitrophes de la Syrie et non en Europe, ce qui vient perturber le récit dominant de la fameuse « submersion migratoire ». Ce travail a pris la forme d’une courte vidéo que nous espérons la plus pédagogique possible[1].
MD : Si l’on cherche à sensibiliser sur les personnes mortes en mer Méditerranée, que faudrait-il mobiliser ?
NL : La difficulté, c’est qu’il n’y a eu aucune collecte de données officielles pendant des années. C’est une ONG néerlandaise, United Against Racism, qui a commencé en 1993 à référencer sur un tableur le nombre de morts à partir de revues de presse et de ce que rapportaient des ONG. Le journaliste italien, Gabriele Del Grande, tenait également un blog, Fortress Europe, où il référençait tous les cas de personnes mortes en Méditerranée portés à sa connaissance. Puis il y a eu un travail de référencement et de « fact cheking » réalisé par un collectif de journalistes européens, The Migrants File.
La première carte des morts de la migration, a été réalisée en 2002 par le géographe Olivier Clochard. Pour ce faire, il s’est basé sur le travail d’United Against Racism. Cette carte a été retravaillée en 2006 par le géographe Philippe Rekacewicz pour une publication dans le Monde Diplomatique. Elle a fait grand bruit. Dorénavant, ces cartes sont réactualisées régulièrement par le réseau Migreurop. Elles reposent aujourd’hui sur le travail de collecte de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) qui met à jour une base de données de manière quasi quotidienne. Contrairement à auparavant, ce sont donc cette fois-ci des données officielles et institutionnelles, ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes pour ce type de thématique aux enjeux très politiques.
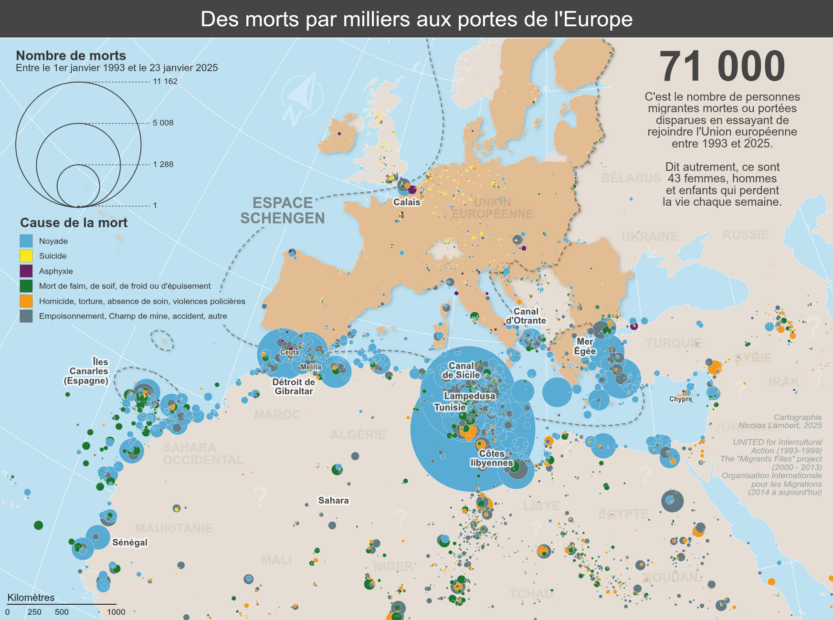
Par ailleurs, il existe de nombreux biais dans ces données et, plus particulièrement, un effet de sonde, c’est-à-dire que certaines informations vont remonter parce qu’on s’intéresse à cette thématique à ce moment-là. Dit autrement, les données dépendent de l’intérêt qu’on y porte. Il peut y avoir des fluctuations temporelles difficiles à évaluer, par exemple, ce qui se passe dans le désert, très en amont. Cette comptabilisation sous-estime la réalité. Mais malgré ses défauts, elle permet tout de même de présenter une géographie. L’intérêt de ces cartes, c’est de passer du fait divers à quelque chose de systémique, structurel, organisé. Avoir ces cartes qui se dessinent au cours du temps, au fur et à mesure des données, permettent de visualiser où se situent les zones létales. Et comment elles varient au cours du temps. Ce que l’on a pu observer à partir de ces cartes, c’est que lorsqu’une frontière est fermée ou militarisée, les flux migratoires ne sont pas stoppés. Leur géographie se déplace et se recompose. Les trajets sont déviés, rendus plus dangereux, et avec une augmentation du nombre de décès. Sur les cartes anciennes, on pouvait observer un point de cristallisation était entre l’Espagne et le Maroc au niveau des enclaves de Ceuta, Melilla, etc. Une fois militarisée, la route s’est déplacée au sud, même au large du Sénégal, vers les Canaries. Et lorsque cela a été à nouveau militarisé, la Libye et la mer Egée sont apparues comme des zones de danger. Une chose est sûre : la « protection » des frontières n’a jamais eu pour but de sauver des vies.
MD : Que vous évoque encore la trace dans votre travail ?
NL : En ce moment, je travaille avec un journaliste, Maël Galisson, membre du réseau Migreurop, qui collecte les données de personnes exilées mortes en essayant de traverser la frontière à Calais. En lien avec les associations sur place, nous maintenons une petite base de données qui alimente une carte en ligne[1]. L’idée de ce travail est de garder une mémoire de ces personnes dont parfois le nom n’est même pas connu. Documenter, pour garder une trace.
Ingénieur de recherche CNRS en sciences de l'information géographique. Membre de l'UMS RIATE et du réseau MIGREUROP / CNRS research engineer in geographical information sciences. Member of UMS RIATE and the MIGREUROP network.
-
10:30
Climadiag Agriculture : nouvelles fonctionnalités
sur Makina CorpusLe projet Climadiag-Agriculure
-
 13:31
13:31 [EDIT : document actualisé] Consultation en vue de la 15ème session du Comité d'experts des Nations Unies sur la gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale (UN-GGIM).
sur Conseil national de l'information géolocalisée - ActualitésPièce jointe: [télécharger]

[EDIT] Nouvelle version du document disponible
La quinzième session du Comité d'experts des Nations Unies sur la gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale (UN-GGIM) se tient à New York du 6 au 8 aout 2025.
L'ordre du jour ainsi que les résumés des rapports préparés par les différents groupes fonctionnels sont d'ores et déjà disponibles sur le site du Comité. Les rapports complets et documents de fond y sont publiés progressivement.
Conformément à une conclusion de la commission Europe et internationale du CNIG en date du 26 novembre 2024, l'IGN propose de coordonner l'élaboration de la position française sur les sujets inscrits à l'ordre du jour.
À cette fin, un document de travail ci-dessous est mis à disposition afin de permettre aux experts intéressés d'y contribuer.
Pour participer à cette démarche collective vous êtes invités à renvoyer vos propositions sur ce document à clement.godin(at)ign.fr avant le 31 juillet 2025.Propositions pour la position française pour la 15ème session de l'UN-GGIM 2025 docx - 346.5 kio
Les thématiques abordées incluent :
- L'avenir de l'écosystème de l'information géospatiale ;
- Le Cadre intégré des Nations Unies pour l'information géospatiale (UN-IGIF) ;
- Le Repère de référence géodésique mondial (GGRF) ;
- Le rôle de l'information géospatiale dans le développement durable, le climat, de l'environnement et de la résilience ;
- L'intégration des informations géospatiales, statistiques et connexes ;
- L'administration foncière et la gestion des biens fonciers ;
- L'information géospatiale marine intégrée ;
- Les principes d'action et le cadre juridique, notamment sur les données faisant autorité et les technologies émergentes ;
- L'adoption et l'application de normes dans le domaine géospatial ;
- La normalisation des noms géographiques et la collaboration avec le Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques (GENUNG) ;
- La contribution des centres d'excellence (GGCE, GGKIC) à la gouvernance de l'information géospatiale.
-
 7:38
7:38 Mégafeux. Le changement climatique augmente les risques d’incendies de forêt extrêmes à l’échelle mondiale
sur Cartographies numériques
Source : Abatzoglou, J.T., Kolden, C.A., Cullen, A.C. et al. (2025). Climate change has increased the odds of extreme regional forest fire years globally. Nature Communications, 16, 6390. [https:]] (article en accès libre)Au cours de la décennie 2014-24, de nombreuses régions ont connu des incendies dévastateurs aux conséquences considérables. L'article examine le rôle de la variabilité climatique dans la survenue d'années d'incendies extrêmes dans les forêts du monde entier. Ces années extrêmes ont généralement coïncidé avec des indices météorologiques extrêmes (1 fois tous les 15 ans) et ont été caractérisées par une multiplication par quatre ou cinq du nombre d'incendies majeurs et des émissions de carbone liées aux incendies par rapport aux années non extrêmes. Des années avec de tels indices extrêmes présentent une probabilité de 88 à 152 % plus élevée sous un climat contemporain (2011-2040) que sous un climat quasi préindustriel (1851-1900), le risque étant plus prononcé dans les forêts tempérées et amazoniennes. Les résultats montrent que le changement climatique d'origine humaine augmente le risque d'années d'incendies extrêmes d'origine climatique dans les régions forestières, ce qui nécessite des mesures proactives pour atténuer les risques et s'adapter aux années d'incendies extrêmes.
Augmentation du potentiel d’années d’incendies extrêmes dues au climat dans les écorégions forestières
(source : Abatzoglou et al., 2025, sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International)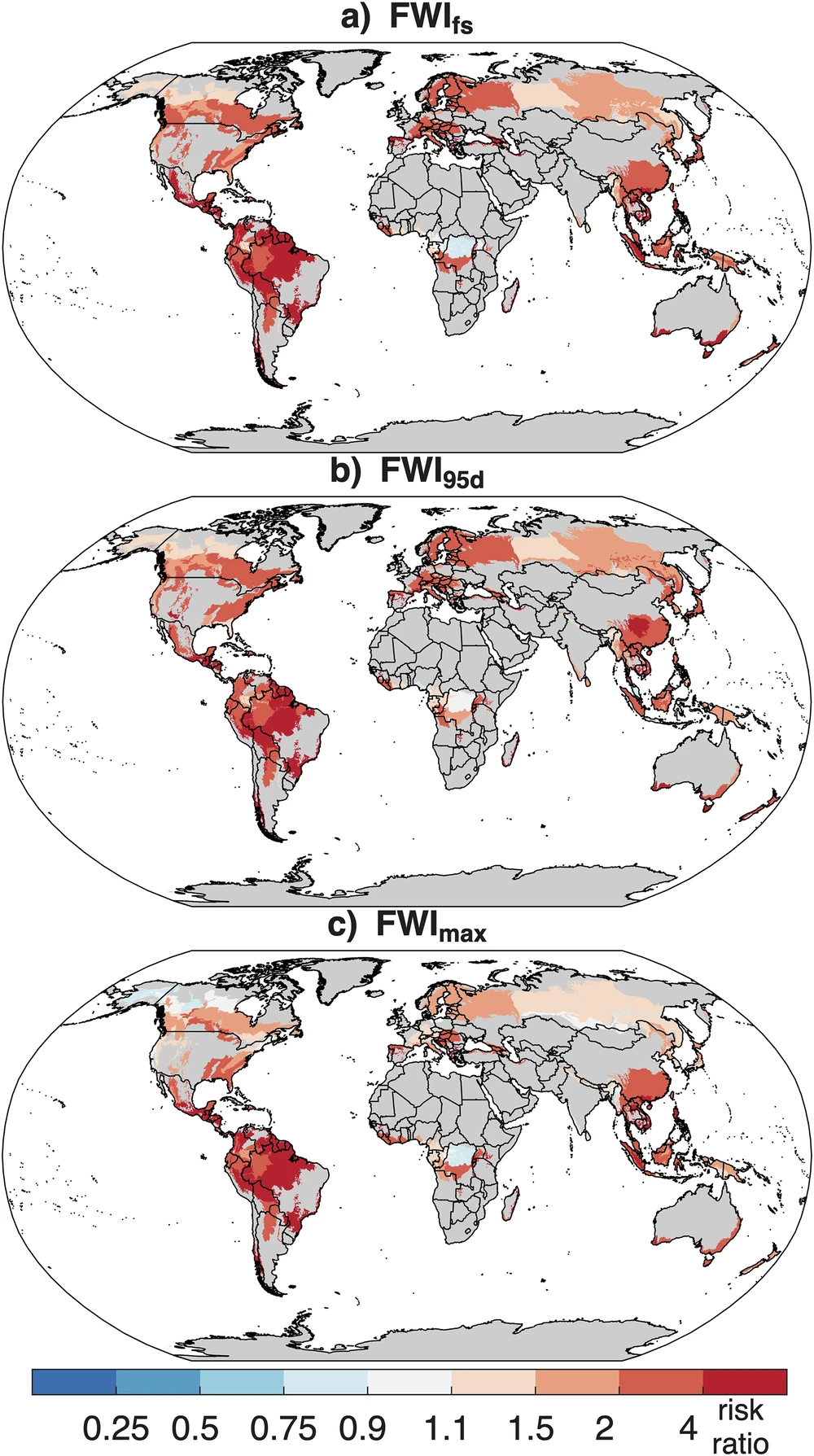
Les données sont disponibles à partir de l'Atlas mondial des incendies. Cet Atlas permet d'étudier la taille, la durée, la vitesse et la direction des incendies dans le monde. Il s'agit d'une version mise à jour et étendue de l'Atlas mondial des incendies présenté par Andela et al. (2019). Les données d'entrée (surfaces brûlées et couverture terrestre) sont issues du spectro-radiomètre imageur à résolution moyenne (MODIS) du satellite Terra de la NASA. Elles ont été mises à jour conformément à la collection MODIS 6.1 (la version précédente était basée respectivement sur les surfaces brûlées de la collection 6.0 et sur la couverture terrestre de la collection 5.1). La série chronologique a été étendue de manière à couvrir la période de 2002 à février 2024.
La méthode employée pour créer l’ensemble de données suit précisément l’approche décrite par Andela et al. (2019). Le produit de surface brûlée d'entrée est le MCD64A1 Collection 6.1. Il est décrit par Giglio et al. (2018). Le produit d'entrée relatif à la couverture terrestre est la collection MCD12Q1 6.1. Il est décrit par Sulla-Menashe et al. (2019). Bien que les méthodes soient restées les mêmes que celles d'Andela et al. (2019), on observe de légères différences entre les produits du Global Fire Atlas, dues aux différences entre les données de superficie brûlée de la collection 6.1 du MCD64A1 utilisées ici et celles de la collection 6 du produit original.
L'ensemble de données original comprenait des séries chronologiques de 2003 à 2016, incluant la saison complète des incendies pour chaque année. Pour chaque tuile MODIS, la saison des incendies est définie comme la période de douze mois centrée sur le mois où la zone de brûlage est la plus importante (voir Andela et al., 2019). La série chronologique a été étendue de manière à inclure la saison des incendies de 2002, prolongée jusqu'en février 2024. Par conséquent, les fichiers de 2023 et 2024 contiennent des enregistrements incomplets. Par exemple, pour une tuile MODIS avec un pic de superficie brûlée en décembre, la saison des incendies de 2023 serait définie comme la période allant de juillet 2023 à juin 2024, l'enregistrement actuel se terminant en février 2024. Aux fins d'analyse des séries chronologiques, on note que le produit 2002 a pu être affecté par des pannes de Terra-MODIS (notamment du 15 juin 2001 au 3 juillet 2001 et du 19 mars 2002 au 28 mars 2002), ce qui affecte les estimations des dates de brûlage et le produit Global Fire Atlas. Depuis le lancement d'Aqua-MODIS en mai 2002, les estimations des dates de brûlage sont plus fiables, telles qu'elles sont estimées par les deux capteurs MODIS embarqués sur Terra et Aqua.
Pour compléter
« Pourquoi les mégafeux embrasent-ils la planète ? » (Museum national d'histoire naturelle).
« Incendies et mégafeux, quand la planète s’embrase » (France Inter).
De l’Australie au Canada, du Chili aux États-Unis, du Congo à l’Indonésie, en passant par l’Europe et la Russie, depuis le début des années 2000, les mégafeux se multiplient et se propagent à travers tous les continents. En cause, le réchauffement climatique et une gestion humaine des milieux souvent inadaptée. Pourtant, le vivant recèle là encore de formidables capacités d’adaptation.
La fréquence des mégafeux, ou feux extrêmes, caractérisés par leur puissance et leur propagation rapide, est en constante augmentation. Les mégafeux représenteraient « seulement » 3 % des incendies, mais seraient responsables de plus de 50 % des surfaces brûlées de la planète. À la différence des incendies, qui surviennent régulièrement au cœur de l’été, ces phénomènes sont plus incontrôlables. Cette catastrophe, amplifiée par le changement climatique, a mis en lumière l'urgence d'agir. Face à l'impuissance relative des moyens de lutte contre les mégafeux, il convient de souligner l'importance cruciale de la préventionArticles connexes
Cartographie des incendies en Californie
Incendies en Amazonie : les cartes et les images auraient-elles le pouvoir d'attiser la polémique ?
Méga-feux en Australie : une conséquence du réchauffement climatique, mais attention aux fausses images !
Le rôle des arbres urbains dans la réduction de la température de surface des villes européennes
Quelles sont les surfaces qui pourraient être reboisées dans le monde ? (Reforestation Hub)
Analyser et discuter les cartes de risques : exemple à partir de l'Indice mondial des risques climatiques
Des sécheresses répétées en France depuis 2018 : analyse en cartes et en images satellitaires
Cartes et données sur la canicule et les incendies de forêt en France et en Europe
La France est-elle préparée aux dérèglements climatiques à l'horizon 2050 ?
Utiliser les données DRIAS sur les futurs du climat
-
 20:23
20:23 La répartition géographique des prénoms en France (INSEE)
sur Cartographies numériques
Chaque année, l'INSEE publie le Top10 des prénoms les plus donnés en France. Il est possible de faire des comparaisons dans le temps et dans l'espace du fait que les données remontent à 1900 et qu'elles sont livrées à différentes échelles (nationale, régionale et départementale).Prénoms attribués aux enfants nés en France depuis 1900
Le fichier des prénoms fournit des données sur les prénoms attribués aux enfants nés en France depuis 1900 aux niveaux national, régional et départemental. Pour le millésime disponible le plus récent, le classement des 10 prénoms masculins et féminins les plus donnés en France ainsi que des cartes présentant les prénoms masculins et féminins les plus donnés dans chaque région sont également proposés.
Évolution de la méthode de diffusion
A partir de 2025, la méthode de diffusion des prénoms évolue afin de fournir davantage d'informations tout en respectant le secret statistique. En complément des produits habituels, de nouvelles données régionales ainsi qu'une liste des prénoms par sexe donnés au moins 3 fois depuis 1900 sont désormais proposées. La méthode de secrétisation est également modifiée, les effectifs étant notamment arrondis au multiple de 5 le plus proche (voir la documentation). Les effectifs arrondis nuls ne sont pas diffusés. Les prénoms ayant les mêmes effectifs arrondis sont classés suivant l'ordre alphabétique.
Fichiers des prénoms à téléchargerLes données disponibles sont regroupées sur cette page. Dans le détail, il est possible de les télécharger à différentes échelles :
- un fichier de données nationales qui contient les prénoms attribués aux enfants nés en France entre 1900 et 2024 (les données avant 2012 ne concernent que France hors Mayotte) et les effectifs par sexe associés à chaque prénom, arrondis au multiple de 5 le plus proche (environ 711 000 lignes).
- un fichier de données régionales qui contient les mêmes informations au niveau régional (environ 1,9 million de lignes).
- un fichier de données départementales qui contient les mêmes informations au niveau départemental, sauf pour la Corse où les départements 2A (Corse-du-Sud) et 2B (Haute-Corse) sont regroupés sous le code DPT=20 (environ 3,9 millions de lignes).
- des fichiers par département qui contiennent les informations pour chaque département de naissance depuis l'année 2000 uniquement.
La base de données permet de faire des animations. Voici par exemple le Top10 des prénoms masculins sur une génération (2000-2024) à partir des données nationales :.gif)
L'outil graphique en ligne de l'INSEE permet de retrouver le classement des prénoms en France depuis 1900 et d'observer des phénomènes de générations, avec des prénoms anciens qui disparaissent et d'autres qui reviennent à la mode :
Il est possible d'utiliser Gallicagram pour effectuer différents types de visualisation. Choisir dans le champ Corpus "Prénoms INSEE 1900-2023", puis saisir des prénoms au choix, générer le type de graphique que l'on souhaite. Les données sont téléchargeables en csv.
Liens ajoutés le 16 juillet 2025
Le Top20 des prénoms se renouvelle-t-il plus vite maintenant qu'avant ? Sur le 20 premiers prénoms de 2024, 10 étaient déjà présents 11 ans avant. Par Baptiste Coulmont.Yovel Dutel a proposé une cartographie détaillée des prénoms les plus donnés de 1900 à 2018 par départements et par régions (Tableau public). De manière générale, les prénoms garçons sont un peu plus diversifiés que pour les filles. Il y a 72 prénoms différents au total pour les garçons, contre 65 pour les filles. A découvrir sous forme de carte animée (Reddit).
Articles connexes
Répartition géographique et sociologie des prénoms en France
Étudier la répartition géographique des noms de famille en France et en Europe
La répartition des noms de famille en Allemagne et dans d'autres pays
Geonames, une base mondiale pour chercher des noms de lieux géographiques
Les nouvelles perspectives offertes par la cartographie des odonoymes et autres toponymes
Une carte des suffixes les plus fréquents par région des noms de villes françaises
Renommer les stations de métro avec des noms de femmes célèbres
Cartographie des noms qui servent à désigner les couleurs en Europe (Mapologies)
-
 14:00
14:00 Revue de presse du 11 juillet 2025
sur Geotribu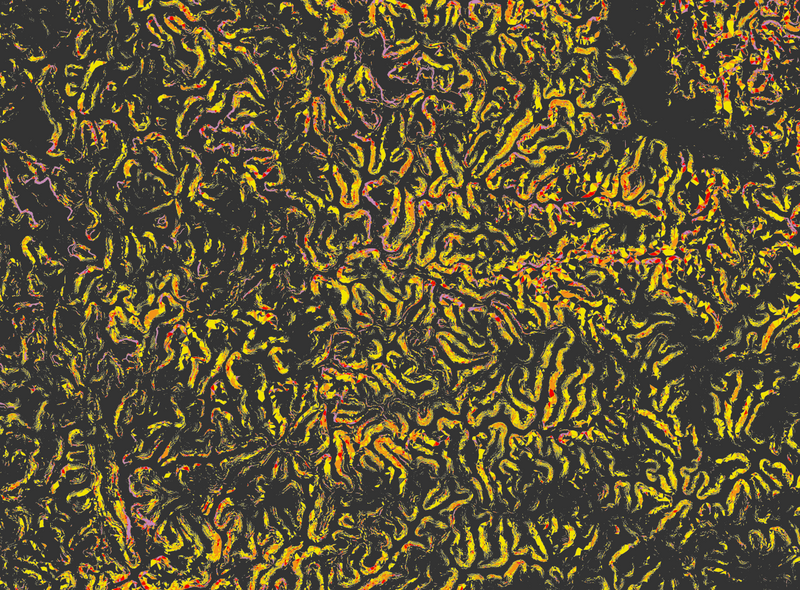 Voici la GeoRDP d'été, servie avec deux géoglaçons. À la recherche du Cartonaute, venez découvrir des tutos et d'autres truqs divers et variés.
Voici la GeoRDP d'été, servie avec deux géoglaçons. À la recherche du Cartonaute, venez découvrir des tutos et d'autres truqs divers et variés.
-
 21:14
21:14 Une belle géovisualisation de la NASA sur les courants océaniques à travers le monde
sur Cartographies numériquesSource : « Going with the Flow: Visualizing Ocean Currents with ECCO » (NASA Science).
Le studio de visualisation scientifique de la NASA propose une très belle géovisualisation des courants océaniques à travers le monde. Celle-ci a été produite à partir du modèle « Estimating the Circulation and Climate of the Ocean » (ECCO) utilisé pour visualiser les courants. Le modèle de circulation océanique ECCO intègre des observations provenant de sondes spatiales, de bouées et d'autres mesures in situ pour garantir sa précision. ECCO est un projet conjoint entre la NASA/JPL, le MIT et l'Université du Texas à Austin. Les données du modèle utilisées pour cette visualisation proviennent d'ECCO-2 et couvrent les années 2021-2023. Les tourbillons formés par ces courants océaniques revêtent une dimension esthétique, presque picturale. On dirait une toile bleue de Van Gogh !
Un océan en mouvement : une visualisation fascinante de la NASA sur les autoroutes sous-marines (crédit : NASA Goddard)
En 2011, la NASA a utilisé ECCO2 pour créer une visualisation appelée « Perpetual Ocean ». Océan Perpétuel continue d'être extrêmement populaire, mais il ne montre que les courants océaniques en surface. Dans cette nouvelle visualisation, la NASA a utilisé la 3D pour visualiser certains des courants océaniques les plus forts. Le procédé repose sur la libération de particules virtuelles dans l'océan de manière à leur permettre de se déplacer avec le champ de vitesse tridimensionnel de l'océan. Chaque particule possède une trace permettant de mieux visualiser sa direction . Les particules initialisées à plus de 600 mètres de profondeur ont une traînée de 3 jours, celles initialisées à plus de 600 mètres ont une traînée de 6 jours. Les traînées de particules permettent d'identifier les courants les plus forts, resserrés dans d'étroites ceintures à l'ouest de chaque bassin océanique. On les appelle courants de bordure occidentale. Les méandres en boucle des courants de bordure forment parfois des anneaux turbulents (tourbillons) qui peuvent piéger des eaux froides ou chaudes en leur centre, puis se séparer du courant principal. En général, les courants de bordure occidentale sont chauds et salés.
La visualisation commence par une vue en rotation globale avant de ralentir pour observer le courant de bordure occidentale le long de la côte ouest de l'océan Pacifique, le long des côtes australiennes et asiatiques. Un zoom avant montre le courant de Kuroshio au large du Japon. Le long de la côte japonaise, le courant présente de larges méandres qui peuvent persister plusieurs mois plus ou moins au même endroit. La température du courant de Kuroshio varie de 20 à 25 °C. Sa salinité peut varier selon les saisons, avec une valeur moyenne de 34,5.
L'animation zoome ensuite pour se déplacer au niveau de l'océan Indien. Celui-ci présente de grandes variations de salinité. Sa partie occidentale est assez salé (> 36) en raison des apports de débordement des mers marginales (par exemple, le golfe Persique et la mer Rouge), tandis que sa partie orientale est plus douce (~ 35) en raison des apports fluviaux en provenance de l'Inde. Le courant indonésien (33-34) et transporte de l'eau douce du Pacifique. Nous zoomons ensuite sur la pointe sud de l'Afrique. L'échange d'eau de l'océan Indien vers l'Atlantique Sud se produit ici. Le courant des Aiguilles est un autre courant de frontière occidentale qui suit de près la pente du plateau continental. Le plateau continental le long de la côte est de l'Afrique australe est assez étroit et abrupt. Cette topographie en pente stabilise le courant des Aiguilles de sorte qu'il ne présente pas de larges méandres que l'on peut trouver dans d'autres courants de bordiure tel le Kuroshio. Le courant des Aiguilles dépasse le continent africain, se déplaçant dans l'Atlantique Sud, puis rétrofléchit vers l'océan Indien. Lors de cetterétroflexion, des anneaux chauds (20 à 25 °C) et salés (~35,5 °C) se détachent. Les tourbillons détachés du courant ont une durée de vie de plus de deux ans et traversent l'océan Atlantique Sud. Ces tourbillons sont appelés anneaux des Aiguilles.
Un autre courant de bordure occidentale, le Gulf Stream, apparaît le long de la côte est de l'Amérique du Nord. Le Gulf Stream se forme dans le détroit de Floride. C'est l'un des courants les plus rapides de la planète, avec une vitesse de surface pouvant atteindre 2,5 mètres par seconde. Dans le Gulf Stream, des noyaux froids (principalement anticycloniques) se forment lorsque le courant serpente vers l'est en quittant la côte nord-américaine (au large du cap Hatteras, en Caroline du Nord). Le diamètre des tourbillons peut atteindre 1 000 km. En zoomant sur le Gulf Stream, on observe que l'eau de surface chaude (> 25 °C) se déplace vers les pôles (tracés de particules blanches). Le Gulf Stream est généralement le courant de bordure occidentale le plus chaud et le plus salé. Un courant de retour se déplace vers le sud, à moins de 500 m de profondeur (tracés de particules bleues), transportant les eaux froides du pôle. Les courants en boucle du golfe du Mexique forment de très grands tourbillons persistants. Ils transportent les eaux chaudes et très salées des Caraïbes dans le golfe. En s'éloignant du Gulf Stream, on s'aperçoit que l'Atlantique est généralement beaucoup plus salé que le Pacifique.
Pour accéder aux différentes géovisualisations :
- Perpetual Ocean (2011)
- Perpetual Ocean 2 : équirectangulaire (2024) avec images en haute résolution
- Perpetual Ocean 2 : projections équirectangulaires (2024) avec globes à manipuler en 3D
- Perpetual Ocean 2 : courants de bordure occidentale (2025)
- Perpetual Ocean 2 : vues polaires (2025)
- Autres géovisualisations utilisant le modèle ECCO-2
NASA Worldview lance un nouvel outil de cartographie
La NASA met à disposition plus de 11 000 vues satellitaires prises ces 20 dernières années
La NASA publie un nouveau modèle numérique d'élévation (février 2020)
CLIWOC. Une base de données climatologiques des océans à partir des journaux de bord des navires (1750-1850)
Les frontières maritimes des pays : vers un pavage politique des océans ?
La cartographie des déchets plastiques dans les fleuves et les océans
Le rapport du GIEC sur l'océan et la cryosphère (septembre 2019)Le site Marine Traffic permet de visualiser la densité des routes maritimes
Shipmap, une visualisation dynamique du trafic maritime à l’échelle mondiale
-
 16:16
16:16 Appel à participants - GT données géolocalisées de l'éducation
sur Conseil national de l'information géolocaliséeAppel à participants - GT données géolocalisées de l'éducation
-
 15:17
15:17 Un quart des ménages en France vivent dans un logement en sous occupation très accentuée
sur Cartographies numériques
Source : Catherine Lavaud, Romuald Le Lan (2025). « Un quart des ménages vivent dans un logement en sous?occupation très accentuée », INSEE Première n° 2064, 8 juillet 2025.Un quart des ménages vivent dans une résidence principale considérée en sous?occupation très accentuée. Il s’agit le plus souvent de maisons individuelles occupées depuis longtemps par des propriétaires âgés n’ayant plus d’enfants à leur domicile. Le taux de sous?occupation très accentuée atteint 41 % pour les maisons individuelles.
Il varie beaucoup au sein du territoire national, en lien en particulier avec la part plus ou moins élevée de grands logements. La Bretagne est la région la plus concernée par la sous?occupation ; cette dernière est moins fréquente en Île-de-France, en PACA, en Corse et dans les départements d’outre-mer. Le phénomène est plus prégnant dans les couronnes des aires d’attraction des villes que dans les pôles.
La sous?occupation très accentuée augmente depuis vingt ans avec le vieillissement de la population. Les habitants des logements sous-occupés sont le plus souvent satisfaits de leurs conditions de logement et seulement une minorité d’entre eux considère son logement comme trop grand. Ils souhaitent très rarement déménager.
Les données de cette carte sont disponibles dans le fichier de données en téléchargement.
Les maisons individuelles sont dix fois plus souvent largement sous-occupées que les appartements (41% contre 4%). Les appartements comportent en général moins de pièces que les maisons. Or, le nombre de pièces est déterminant : 54% des résidences principales de cinq pièces sont en sous occupation très accentuée, et 86% de celles d’au moins six pièces. Les propriétaires vivent fréquemment dans une résidence principale largement sous occupée (39%), les locataires rarement (7%). Or, les maisons individuelles sont plus souvent occupées par leurs propriétaires que les appartements. Cela contribue donc également à l’écart de sous occupation entre maisons et appartements.
Autres études de l'INSEE sur le sujet- Durieux S., Fabre B., Sanzeri O., « Plus de 100 000 résidences principales en sous-occupation très accentuée dans la métropole d’Aix?Marseille?Provence », Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 147, juillet 2025.
- Daguet F., « En 2021, une personne de 65 ans ou plus sur trois vit seule dans son logement », Insee Première no 2040, février 2025.
- Bertrand P., « Des prix immobiliers plus élevés dans les zones denses et touristiques », Insee Première n°2025, novembre 2024.
- Fiche « Logement », in France, portrait social, coll. « Insee Références », édition 2024.
- « Les conditions de logement des ménages résidant en France en 2020 », Datalab Essentiel, Sdes, décembre 2022.
L'article publié par l'INSEE suscite un large débat en France concernant les actions à conduire pour limiter ces logements inoccupés. A partir de quels critères est-on en droit d'estimer qu'un logement est trop grand ? Le droit de jouir à sa guise de son logement repose sur le droit de propriété qui est un droit inaliénable. Les logements inoccupés font d'ailleurs l'objet d'une taxation fiscale. A l'opposé, des voix s'élèvent pour mettre en avant le veillissement de la population qui pourrait encore accroître le phénomène, le coût financier et environnemental que cela représente ou encore la nécessité de repenser les modes d'habiter. Les types de logements construits il y a plusieurs décennies ne correspondent plus aux modèles familiaux d’aujourd’hui, à la pyramide des âges, au nombre insuffisant de logements…
Quelques ressources pour nourrir le débat :- « Ces Français qui vivent dans des logements bien trop grands… et ne veulent surtout pas en partir » (Capital)
- « Limiter les mètres carrés par personne pour réduire l’empreinte carbone des logements » (Euractiv)
- « Densifier les zones résidentielles en s'appuyant sur le Bimby » (Ministère du développement durable). Voir les initiatives proposées par Villes vivantes.
- « Le grand partage. Bande annonce du film » (Youtube). Et si les français "bien logés" étaient forcés d'héberger les plus pauvres pendant l'hiver ?
Quelle évolution de la ségrégation résidentielle en France ? (France Stratégie)
France Pixel Bâti. Naviguer dans la structure du patrimoine bâti français en haute définition
Les données sur le logement social en France disponibles en open data
Publication de nouveaux inventaires de données sur Data.gouv.fr (logement, emploi, santé)
Mise à disposition de la base Demandes de valeurs foncières (DVF) en open data
L’inégale abordabilité du logement dans les villes européennes (Cybergéo)
Etudier la structure et l'évolution des logements dans 50 métropoles des Etats-Unis
Étudier les mobilités résidentielles des jeunes Américains à partir du site Migration Patterns
Étudier les mobilités résidentielles des élèves à partir des statistiques de la DEPP
- Durieux S., Fabre B., Sanzeri O., « Plus de 100 000 résidences principales en sous-occupation très accentuée dans la métropole d’Aix?Marseille?Provence », Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 147, juillet 2025.
-
13:00
Geotrek-Mobile évolue avec les contenus outdoor
sur Makina CorpusLe Département du Doubs a financé une évolution majeure de son application mobile Explore Doubs en y intégrant l’affichage des pratiques outdoor issues de Geotrek-Admin.
-
 21:44
21:44 NASA Worldview lance un nouvel outil de cartographie
sur Cartographies numériques
Source : « NASA Worldview Releases New Charting Tool » (NASA Earthdata)
NASA Worldview permet aux utilisateurs de parcourir, comparer et animer plus de 1200 couches d'images satellites en haute résolution, fournies par les services GIBS (Global Imagery Browse Services) de la NASA, puis de télécharger les données sous-jacentes. Nombre de ces produits sont disponibles quelques heures après leur acquisition, illustrant ainsi la Terre entière telle qu'elle apparaît « à l'instant T ». Worldview propose actuellement 461 couches matricielles cartographiables.
NASA Worldview, un outil en pleine évolution
Depuis son lancement initial en décembre 2011, les ingénieurs et développeurs de NASA Worldview ont constamment ajouté de nouvelles fonctionnalités permettant aux utilisateurs de créer des animations personnalisées, de rechercher par lieu, de mesurer des distances et des superficies, et de comparer des images satellites à différentes dates. Worldview propose désormais une nouvelle fonctionnalité graphique permettant de créer un graphique linéaire présentant des statistiques (médiane, moyenne, minimum, maximum et écart type, par exemple) pour une variable unique, à une date donnée ou sur une plage de dates à partir dune zone d'intérêt définie par l'utilisateur.
« Les utilisateurs nous demandent depuis un certain temps d'ajouter une fonctionnalité de cartographie à Worldview, et bien qu'elle ne soit disponible que pour les tests bêta et l'évaluation à l'heure actuelle, nous sommes heureux de pouvoir fournir à nos utilisateurs une fonctionnalité qui leur permet de visualiser les tendances statistiques importantes pour une variable au fil du temps », a déclaré Minnie Wong, ingénieur système pour NASA Worldview avec le projet Earth Science Data and Information System (ESDIS) de la NASA. Lorsque la fonction de création de graphiques sera entièrement terminée, cette fonction permettra aux utilisateurs de représenter graphiquement plusieurs variables à la fois et d'augmenter le nombre de points tracés.
Interface de l'application (crédit : NASA Worldview)
La fonctionnalité de cartographie étant actuellement disponible en version bêta et en évaluation, toute analyse numérique réalisée sur les images ne doit être utilisée qu'à des fins d'exploration initiale et non pour une étude scientifique formelle. En effet, les images disponibles dans Worldview sont généralement moins précises que les données d'origine et ont souvent fait l'objet d'étapes de traitement supplémentaires (par exemple, projection dans un système de coordonnées différent).
Les utilisateurs qui sont à la recherche d'une analyse statistique plus rigoureuse sur le plan scientifique doivent télécharger les données et les analyser avec une application plus robuste, telle que NASA Giovanni. Pour accéder à des images d'archive déjà traitées, voir les images de la semaine sélectionnées à partir d'exemples d'actualité.
Pour essayer l'outil cartographique
Suivez ce lien pour accéder à une carte Worldview présentant les données de température de surface de la mer pour le lac Huron, issues du système d'imagerie radiométrique infrarouge visible (VIIRS) du satellite Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi NPP). Les données portent sur une période de deux ans, du 12 avril 2023 au 12 avril 2025.
Les utilisateurs peuvent créer leur propre graphique de séries chronologiques en suivant ces étapes :- Accéder à NASA Worldview.
- Cliquez sur le bouton rouge « Ajouter des calques » dans le menu principal de Worldview (sur le côté gauche de l’écran).
- Sélectionnez la couche à cartographier en cliquant sur le bouton radio à gauche du nom de la couche, puis fermez la fenêtre de sélection de couche.
- Dans la fenêtre principale de Worldview, cliquez sur le bouton « Démarrer la cartographie », puis déplacez et redimensionnez le cadre de sélection selon votre zone d'intérêt. (NB : les utilisateurs peuvent également modifier les coordonnées du cadre de sélection dans « Modifier les coordonnées » en cochant la case « Écran entier ».)
- Pour sélectionner une plage de dates, cliquez sur les dates dans la case « Sélection de date en mode graphique ». Pour sélectionner une seule date, sélectionnez « Une date ».
- Pour générer un graphique d'évolution temporelle, cliquez sur le bouton rouge « Générer un graphique ». (Dans le cadre de cette version bêta, le nombre de points de données tracés peut être réduit s'il dépasse 31 points.)
- Pour générer des statistiques, cliquez sur le bouton rouge « Générer des statistiques » pour calculer la médiane, la moyenne, le minimum, le maximum et l’écart type.
Articles connexes
La NASA met à disposition plus de 11 000 vues satellitaires prises ces 20 dernières années
La NASA publie un nouveau modèle numérique d'élévation (février 2020)
La carte de la hauteur de la canopée dans le monde (NASA Earth Observatory)
Greenpeace dresse une carte mondiale de la pollution au SO? à partir d'images de la NASA
Quand la NASA fait encore mieux que le zoom googolien
Images satellites Landsat 9 mises à disposition par l'USGS
Le programme Landsat, lancé en 1972, fête ses 50 ans d'observation de la Terre
Les images satellites Spot du CNES (1986-2015) mises à disposition du public
Animer des images satellites Landsat avec Google Earth Engine et l'application Geemap
Rubrique Images satellitaires
-
 13:28
13:28 Meet’Up Greentech 2025, les 21 et 22 octobre à Paris
sur Évènements – AfigéoMeet’Up Greentech 2025, les 21 et 22 octobre à Paris Meet’Up Greentech 2025, les 21 et 22 octobre à Paris AfigéoMeet’Up Greentech 2025, le rendez-vous annuel de la Greentech porté par les Ministères de l’Aménagement du Territoire et de la Transition Ecologique Le Meet’Up Greentech, évènement GRATUIT pour l’ensemble de l’écosystème de la greentech revient cette année. Les 21 & 22 octobre 2025 à Station F. Cette édition sera placée sous le double signe de […]
The post Meet’Up Greentech 2025, les 21 et 22 octobre à Paris first appeared on Afigéo. -
 12:57
12:57 PCRS : le prochain webinaire startup d’État PCRS / Afigéo se déroulera le 26 septembre
sur Évènements – AfigéoPCRS : le prochain webinaire startup d’État PCRS / Afigéo se déroulera le 26 septembre PCRS : le prochain webinaire startup d’État PCRS / Afigéo se déroulera le 26 septembre AfigéoLe 26 septembre prochain, en partenariat avec l’Afigéo, la startup d’État PCRS propose un webinaire à destination des territoires qui envisagent l’acquisition de données PCRS et se posent des questions relatives aux coûts, aux financements et à la valorisation des usages de la donnée PCRS.
The post PCRS : le prochain webinaire startup d’État PCRS / Afigéo se déroulera le 26 septembre first appeared on Afigéo.
-
 12:49
12:49 PCRS : le prochain webinaire startup d’État PCRS / Afigéo se déroulera le 26 septembre
sur AfigéoPCRS : le prochain webinaire startup d’État PCRS / Afigéo se déroulera le 26 septembre PCRS : le prochain webinaire startup d’État PCRS / Afigéo se déroulera le 26 septembre AfigéoLe 26 septembre prochain, en partenariat avec l’Afigéo, la startup d’État PCRS propose un webinaire à destination des territoires qui envisagent l’acquisition de données PCRS et se posent des questions relatives aux coûts, aux financements et à la valorisation des usages de la donnée PCRS.
The post PCRS : le prochain webinaire startup d’État PCRS / Afigéo se déroulera le 26 septembre first appeared on Afigéo.
-
 1:42
1:42 Évolution du jour de déneigement dans les Alpes françaises et les Pyrénées
sur Séries temporelles (CESBIO)
Les socio-écosystèmes des Alpes et des Pyrénées dépendent étroitement des fluctuations annuelles du manteau neigeux. En particulier, le moment de l’année où la neige disparait détermine le début de la saison de croissance de la végétation de montagne et donc la période des estives. Le changement climatique est en train de bouleverser ce rythme saisonnier. […]
-
 8:43
8:43 Utiliser les données DRIAS sur les futurs du climat
sur Cartographies numériques
L'urgence climatique est là. Pour agir, il est indispensable de connaître aussi précisément que possible les évolutions climatiques en vue de s'y adapter. Le portail Drias les futurs du climat, mis en œuvre par Météo-France en lien avec la communauté scientifique nationale du climat (IPSL, CERFACS, CNRM) a pour vocation de mettre à disposition les projections climatiques régionalisées de référence pour l'adaptation en France.
Initié en 2009 et inscrit au Plan National d'Adaptation au Changement Climatique, le projet DRIAS ("Donner accès aux scénarios climatiques Régionalisés français pour l'Impact et l'Adaptation de nos Sociétés et environnement") a bénéficié d'un important soutien du ministère du Développement durable. Les informations climatiques sont délivrées sous différentes formes graphiques ou numériques et intègrent notamment la représentation selon la Trajectoire de Réchauffement de Référence pour l'Adaptation au Changement Climatique (TRACC).
Le site "Drias les futurs du climat" propose une démarche d'appropriation en trois étapes :- l'espace Accompagnement présente un guide d'utilisation et de bonnes pratiques pour les projections climatiques.
- l'espace Découverte permet de visualiser et géolocaliser les projections climatiques au plus près de chez vous, dans l'hexagone comme outre-mer.
- l'espace Données et Produits permet de télécharger les données numériques ces variables et indicateurs climatiques.
Le portail "Drias les futurs du climat" est mis en œuvre par Météo-France et bénéficie d'une aide de l'État au titre de France 2030 au travers du programme de recherche sur le climat. Un catalogue de données de simulations climatiques est proposé sur une page dédiée (inscription préalable mais gratuite pour pouvoir télécharger les données).
Pour accéder aux diagnostics climatiques :- Climat passé et futur : Climat-HD
- A quel climat s'adapter en France selon la Trajectoire de Réchauffement de référence pour l’Adaptation au Changement Climatique (TRACC) ?
- Le climat futur de la France selon la TRACC
- Evolution des vagues de chaleur en France dans le cadre de la TRACC
- Le jeu EXPLORE2-Climat
- Les nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020
- La France au XXIe siècle
- Changements climatiques à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Extrêmes et changement climatique
- Evolution des types de climat en France
- Evolution des sécheresses météorologiques
- Impact du changement climatique dans le domaine des feux de forêt et végétation
Analyser les opportunités des données DRIAS (scénarios climatiques Régionalisés) par une entrée géomatique, c'est la mission qui a été confiée aux étudiants du Master 2 eSIGAT Association par Siradel (voir le diaporama).
Une synthèse graphique résume les principaux risques liés au changement climatique pour un scénario à +4 °C en 2100 par rapport à la période 1900-2005, avec des impacts sur notre vie quotidienne :- 10 fois plus de jours de vagues de chaleur
- 24 nuits chaudes (supérieures à 20 °C) par an (jusqu’à 120 nuits sur le littoral méditerranéen)
- Pluies intenses +15 % d’intensité aggravant le risque d’inondation
- Enneigement. Moins de 2 mois de neige en moyenne montagne
- Sécheresse des sols. Jusqu’à 2 mois supplémentaires de sol sec
Vivre à + 4°C en 2100. Source : À quel climat s’adapter en France selon la TRACC ? 2e partie (rapport de juin 2025)
Articles connexes
Données météorologiques sur la France disponibles en open data
Rapport annuel 2023 du Haut conseil pour le climat « Acter l’urgence, engager les moyens »
Impact du changement climatique sur le niveau des nappes d'eau souterraines en 2100
Aborder la question de l'inégalité des pays face au changement climatique
Comment la cartographie animée et l'infographie donne à voir le réchauffement climatique
Analyser et discuter les cartes de risques : exemple à partir de l'Indice mondial des risques climatiques
Quels sont les États qui ont le plus contribué au réchauffement climatique dans l’histoire ?
Un globe 3D pour explorer le climat et ses évolutions vus de l'espace (site de l'ESA)
Tchernobyl : la météo nationale a-t-elle truqué des cartes en 1986 ? Retour sur une polémique sur fond de complotisme
-
 21:52
21:52 Datavisualisation sur les distances parcourues en France de 1800 à 2023
sur Cartographies numériquesSource : Mise à disposition des animations sur les distances parcourues en France de 1800 à 2023 (Visual Data Flow)
Depuis 200 ans, nous nous déplaçons toujours une heure par jour en moyenne. Mais là où cette heure se faisait à pied, et nous emmenait donc peu loin au début du XIXe siècle, nous faisons désormais 50 kilomètres par jour et par personne en moyenne.
Sur les 52 km parcourus par une personne sur une journée :
- 34 km le sont en voiture. C’est le principal moteur de l’augmentation des distances.
- 9 km le sont en avion (effet de moyenne, les distances étant beaucoup plus longues).
- 5 km via des modes de transport ferroviaires.
- 2,2 km en transport collectif routier.
- 0,9 km en marchant.
- 0,7 km en deux-roues (vélo, moto, scooter).
- 0,1 km en bateau.
La mobilité en France par mode et par énergie 1800-2023 (source : Visual Data Flow)
Distances parcourues en France de 1800 à 2023 par mode de transport
(animation à visualiser et télécharger sur Visual Data Flow)
Ces animations sont issues de la collaboration d'Aurélien Bigo, chercheur sur la transition énergétique des mobilités à l'Institut Louis Bachelier et Daniel Breton, expert en visualisation de données au sein de Visual Data Flow.
L'intérêt de cette animation est de montrer à la fois l'évolution historique des modes de transport et la répartition des types d’énergies de propulsion utilisées pour chacun. Il s'agit de la version simple de l'animation, seuls les modes de transports sont représentés. Trois versions sont disponibles en fonction de 3 palettes de couleurs différentes :
- une palette de type Office.
- une palette de type D3.
- une palette de type monochrome bleue.
La vidéo se termine par un écran de crédits reprenant sous forme d'un graphique les distances parcourues par mode de transport dans le temps. Ce qui permet de saisir facilement quelques enseignements clés :
- Les années 1950 : un tournant majeur. La voiture supplante train et marche. Cette montée en puissance s’accompagne d’une explosion de la consommation d’essence, puis de diesel.
- 1990 – 2000 : l’essor de l’aérien. Résultat, aujourd’hui, 80% des distances que nous parcourons en France en 2023 reposent sur 3 carburants fossiles : diesel, essence et kérosène.
- Décarbonation : un frémissement. Malgré l’arrivée des biocarburants introduits dans les années 2000, et la montée timide de l’électrique pour la voiture, les bus ou les deux roues, la transition reste modeste. Ce double axe d’analyse (mode de transport et énergies de propulsion) permet de bien saisir certaines tendances historiques.
- Ce double regard met en lumière des dynamiques fortes :
- La montée en puissance du transport ferroviaire à partir les années 1860 grâce au charbon, une électrification qui démarre dès 1900, une transition par le diesel au courant du 20eme pour arriver aujourd’hui à un mode de propulsion principalement électrique.
- Lors de la montée en puissance de la voiture, sous l’impulsion des différentes politiques de soutien au diesel en France : la transition forte de l’essence au diesel entre 1970 et 2015.
- Au niveau des 2 roues, la forte utilisation du vélo à propulsion humaine au sortir de la seconde guerre pour basculer ensuite vers la moto principalement à essence.
Chronologie d'une accélération de la mobilité (source : Bigo et al., 2022, graphique sous licence CC-BY-NC 4.0)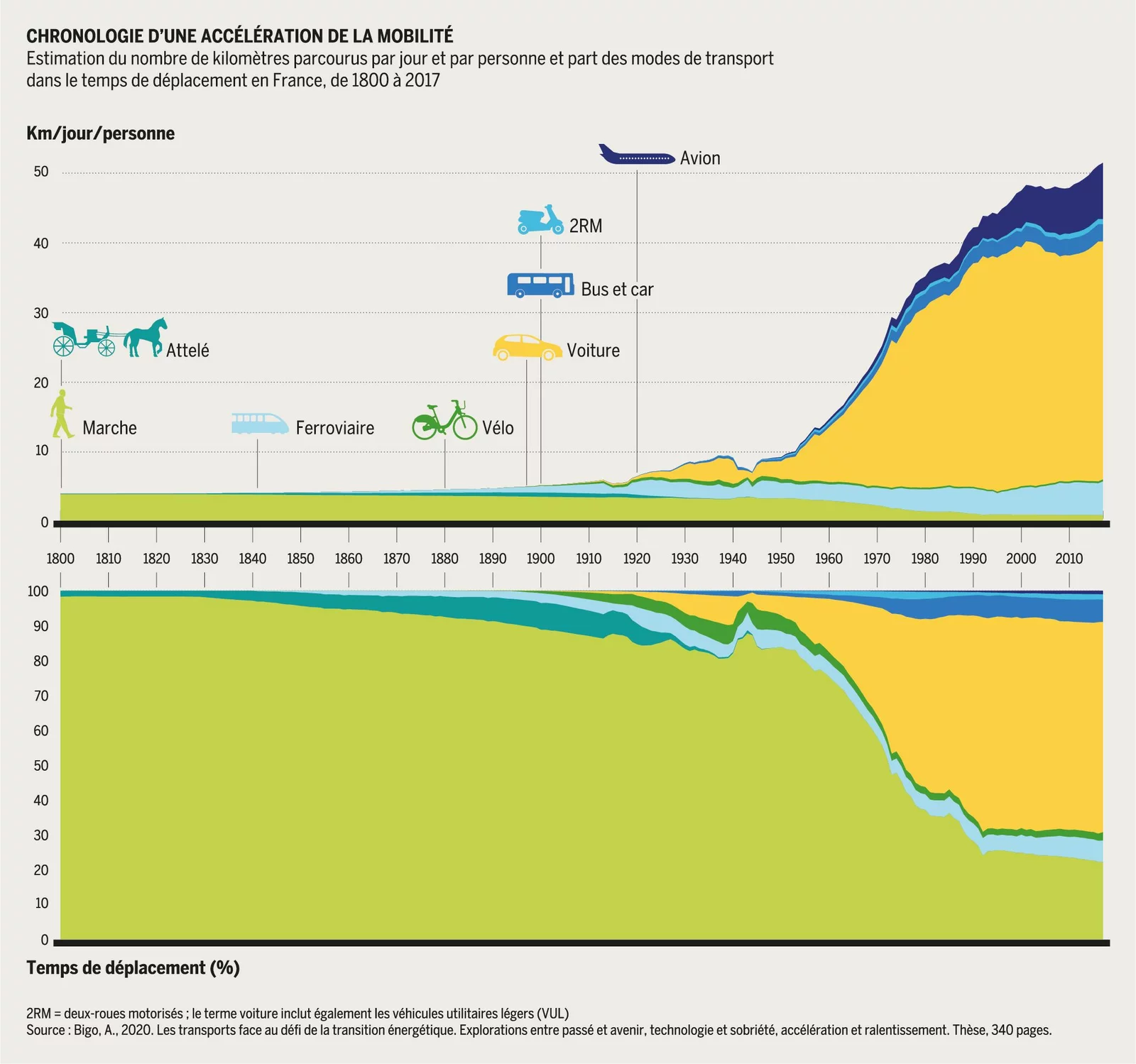
Pour compléter
Bigo, A. (2020). Les transports face au défi de la transition énergétique. Explorations entre passé et avenir, technologie et sobriété, accélération et ralentissement, Institut Polytechnique de Paris, Thèse de doctorat en économies et finances, 340 pages, [https:]]
Bigo, A. et al. (2022). Atlas des mobilités. Faits et chiffres sur les mobilités en France et en Europe, [https:]]
« En 200 ans, le temps dans les transports est resté le même pour les Français (1 heure par jour), mais les distances ont été multipliées par 12 (BFM-TV).
« De 4 à 52 km/jour parcourus, de la marche à la voiture toute-puissante... Un expert a visualisé l'évolution de la mobilité des Français en deux siècles » (France-Info).
« Évolution des distances parcourues (en km) par personne et par jour depuis 1880 aux États-Unis » (Alternatives économiques).
Rapport de l'Observatoire des territoires sur l'impact des mobilités en France
Articles connexes
Le Mobiliscope, un outil de géovisualisation pour explorer les mobilités urbaines heure par heure
CAPAMOB, un guide du Cerema pour réaliser des diagnostics de mobilités en territoire rural ou péri-urbain
The arrogance of space : un outil cartographique pour montrer la place allouée à l'automobile en milieu urbain
Vers une loi universelle des mobilités urbaines ? (Senseable City Lab - MIT)
De villes en villes. Atlas des déplacements domicile-travail interurbains
Portail des mobilités dans le Grand Paris (APUR)
Quels apports du Géoweb et de la géolocalisation pour représenter les mobilités touristiques ?
-
 14:24
14:24 Retour sur le 11ème congrès de l’AFNEG à Metz
sur AfigéoRetour sur le 11ème congrès de l’AFNEG à Metz Retour sur le 11ème congrès de l’AFNEG à Metz AfigéoLe 11ème congrès de l’AFNEG s’est déroulé le week-end du 6 et 7 juin à Metz. Cet évènement a pour objectif de réunir l’ensemble des associations et étudiants du réseau AFNEG autour de temps d’échanges, de débats, et la tenue de leur Assemblée Générale. L’Afigéo en tant que partenaire était invitée au salon des initiatives : […]
The post Retour sur le 11ème congrès de l’AFNEG à Metz first appeared on Afigéo.
-
 13:37
13:37 Cahiers de l'ANCT sur le thème "Territoires et transitions"
sur Cartographies numériques
L'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) aide les collectivités à réaliser leurs projets. Elle coordonne également des programmes et dispositifs nationaux qui soutiennent les territoires les plus fragilisés. Elle propose tous les 15 jours un bulletin Veille et territoires, une sélection d’analyses d’experts et de publications pour mieux comprendre les enjeux des territoires. En lien avec l'Observatoire des territoires, elle édite des cahiers thématiques sur les enjeux de transitions territoriales :
Cahier n°1 - Territoires et transitions : enjeux démographiques
Ce premier cahier du 9e rapport de l’Observatoire des territoires (2021-2022) « Territoires et transitions » analyse les dynamiques démographiques dans le temps long à différentes échelles géographiques, éclairant les transitions à l’oeuvre et les trajectoires diverses des territoires. Illustré de cartes et de graphiques, il vise à apporter un éclairage aux acteurs publics sur les enjeux démographiques passés, actuels et à venir des territoires.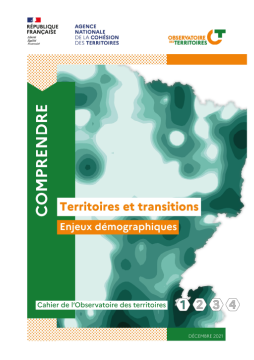
Cahier n°2 - Territoires et transitions : Enjeux économiques
Ce deuxième cahier (octobre 2022) donne les clés de lecture qui croisent territoires et activités, montre la différence des trajectoires passées, illustre la diversité des situations aujourd’hui constatées, socle des transformations à venir. Les équilibres économiques infra-nationaux se sont en effet substantiellement transformés en 50 ans, influant profondément sur les dynamiques locales et régionales. Un même phénomène, la désindustrialisation par exemple, cache des réalités très diverses, opposant des espaces qui ont essentiellement souffert du déclin, d’autres où elle a été en quelque sorte absorbée par la croissance du tertiaire, d’autres encore où la spécialisation sectorielle ou la disponibilité foncière ont préservé un potentiel productif fort.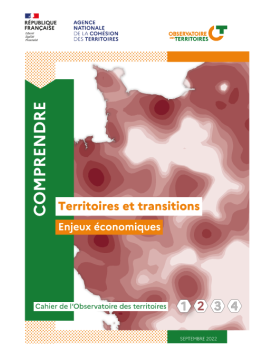
Cahier n°3 - Territoires et transitions : enjeux environnementaux
Après les cahiers sur les transitions démographiques et économiques, cette publication de l'Observatoire des territoires (juillet 2024) vise à offrir une perspective territorialisée, en examinant les problématiques environnementales déterminantes à différentes échelles, de l'intercommunalité à l'échelle nationale :- Axe 1 : Etat des lieux des défis dans des domaines clés tels que l'eau, l'énergie, la biodiversité et la gestion des déchets.
- Axe 2 : Mise en œuvre de politiques publiques écologiques à différentes échelles territoriales et outils de suivi et d'observation.
- Axe 3 : Impacts différenciés selon les territoires, en termes de sobriété foncière et de risques (exposition des populations aux pollutions, catastrophes naturelles, …).
- Axe 4 : Impact sur l’emploi et transformation économique des transitions environnementales.

Cahier n°4 - Territoires et transitions : enjeux numériques
Après les cahiers sur les transitions démographiques, économiques et environnementales, cette publication (janvier 2025) vise à offrir une perspective territorialisée, en examinant les problématiques numériques déterminantes à différentes échelles, de l'intercommunalité à l'échelle nationale :- Axe 1 : Aménagement numérique des territoires ;
- Axe 2 : Usages, opportunités et défis du numérique pour la société ;
- Axe 3 : Transformation de l’économie et de l’emploi au regard du numérique ;
- Axe 4 : De la gouvernance des données à la transition environnementale.
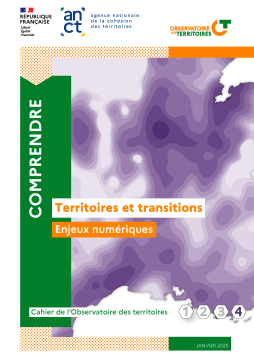
La cartothèque de l'ANCT propose par ailleurs de nombreuses cartes et infographies, issues des travaux de l'Observatoire des territoires, sur des thématiques aussi diverses que l’emploi, les services au public, l’industrie, les ruralités, le cadre de vie, les mobilités, etc. La recherche se fait par mot clé, ou à partir des quatre filtres proposés (par thème, par échelle de territoire, par série et par année). Les cartes sont toutes téléchargeables en haute définition.
C'est l'occasion d'aller découvrir un nouvel indicateur : le temps d’accès routier moyen à un centre d'équipements et de services proposé en avril 2025. Cet indicateur est calculé à partir des polarités intermédiaires, structurantes et majeures (centres de niveau 2 et plus).
Temps d’accès routier moyen à un centre d'équipements et de services en 2024 (source : Observatoire des territoires)
La carte ainsi que les données concernant les niveaux de centralité en fonction des équipements et services par commune sont à retrouver également sur le site de cartographie de l'Observatoire des territoires.
Niveau de centres d'équipements et de services des communes 2021 (source : Observatoire des territoires)
Pour compléter
Lydia Coudroy de Lille, Anne Rivière-Honegger, Lisa Rolland et Anaïs Volin, « Notion en débat : transition », Géoconfluences, février 2017. URL : [https:]]
Vincent Banos, Sabine Girard, Marie Houdart et Salma Loudiyi (2024). Territoires & Transitions socio-écologiques : dialogue fécond, parcours inachevé ou voie sans issue ? Géocarrefour, 98/3-4 | 2024. URL : [https:]]
Dimitris Stevis et Romain Felli, « Une transition planétaire juste ? Comment la rendre inclusive et juste ? », Développement durable et territoires, Vol. 15, n°2 | Septembre 2024. URL : [journals.openedition.org]
Sylvie Clarimont, Émeline Hatt et Steve Hagimont, « Introduction. Tourismes et transitions écologiques », Mondes du Tourisme, 25 | 2024. URL : [journals.openedition.org]
Articles connexes
La cartographie interactive de l'Observatoire des territoires s'enrichit de nouveaux zonages et indicateurs
Comparaison entre l'INSEE Statistiques locales et l'Observatoire des Territoires : deux sites de cartographie en ligne complémentaires
Cartographie nationale des lieux d'inclusion numérique (ANCT - Mednum)
Étude sur la diversité des ruralités (ANCT - Observatoire des territoires)
La France en 12 portraits : cartes et analyses dans le rapport de l'Observatoire des territoires (avril 2021)
La cartographie interactive de l'Observatoire des territoires s'enrichit de nouveaux zonages et indicateurs
Rapport de l'Observatoire des territoires sur l'impact des mobilités en France
Atlas IGN des cartes de l'anthropocène
Les territoires de l'anthropocène (cartes thématiques proposées par le CGET)
Paul Crutzen et la cartographie de l'Anthropocène
-
 11:24
11:24 La majorité de la planète reconnaît déjà l’État palestinien
sur Carnet (neo)cartographiqueEn 2025, 158 pays dans le monde ont d’ores et déjà officiellement reconnu l’État de Palestine. Il s’agit principalement de pays du Sud, mais également d’États européens d’Europe de l’Est, rejoints récemment par l’Espagne, l’Irlande et la Norvège. Cette reconnaissance massive reflète une dynamique mondiale irrépressible en faveur du droit du peuple palestinien à l’autodétermination.
 https://observablehq.com/embed/@neocartocnrs/palestine@289?cells=viewof+year%2Cmap
https://observablehq.com/embed/@neocartocnrs/palestine@289?cells=viewof+year%2CmapCe mouvement est irrésistible. Il s’inscrit dans une histoire longue de luttes contre la domination coloniale et pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

La France ne peut plus rester à l’écart de ce mouvement, sauf à s’isoler sur la scène internationale et à trahir les valeurs qu’elle prétend incarner.
Ingénieur de recherche CNRS en sciences de l'information géographique. Membre de l'UMS RIATE et du réseau MIGREUROP / CNRS research engineer in geographical information sciences. Member of UMS RIATE and the MIGREUROP network.
-
 16:50
16:50 1ère édition du Forum de la donnée territoriale, le 7 octobre à Paris
sur Évènements – Afigéo1ère édition du Forum de la donnée territoriale, le 7 octobre à Paris 1ère édition du Forum de la donnée territoriale, le 7 octobre à Paris AfigéoLa 1ère édition du Forum de la donnée territoriale aura lieu mardi 7 octobre 2025 de 9h30 à 16h30 à Paris (Auditorium Marceau Long – 20 avenue de Ségur, 75007 Paris). Le site de l’événement et le programme de la journée (tables-rondes, keynotes et ateliers) seront bientôt disponibles. Un « Save the date » sera publié cette semaine et le site […]
The post 1ère édition du Forum de la donnée territoriale, le 7 octobre à Paris first appeared on Afigéo.
-
 10:48
10:48 Manuel de cartographie, 2e édition
sur Carnet (neo)cartographique
Camarades cartographes, j’ai le plaisir de vous annoncer la parution de la seconde édition du Manuel de cartographie, coécrit avec Christine Zanin. Entièrement revue, corrigée et enrichie, cette nouvelle édition s’ouvre sur une préface de Georg Gartner, président de l’Association cartographique internationale (ACI). Depuis sa première publication en 2016, le manuel a été actualisé pour intégrer les évolutions majeures de la discipline. Il comprend désormais plus de 160 figures en couleurs — contre 120 dans l’édition précédente. Toutes les illustrations ont été mises à jour, améliorées, et complétées par de nouvelles cartes et schémas. Cette richesse graphique — 160 figures réparties sur 250 pages — fait vraiment la force de cet ouvrage.

Pour répondre aux usages contemporains de la cartographie, un nouveau chapitre consacré à la cartographie numérique et à la géovisualisation a été ajouté. On y aborde les formes cartographiques récentes, comme les story maps, les clusters, les swipe maps, les web SIG, les heatmaps ou encore les dashboards. Autant d’outils devenus incontournables dans l’univers de la cartographie aujourd’hui.

Au final, nous espérons que cette nouvelle édition sera une ressource précieuse, aussi bien pour les enseignants, qui y trouveront des contenus clairs pour transmettre les enjeux de la cartographie contemporaine, que pour les étudiants, qui pourront s’appuyer sur des textes concis et des figures en couleur pour apprendre à maîtriser l’art de construire des cartes.
Bonne lecture…

Ingénieur de recherche CNRS en sciences de l'information géographique. Membre de l'UMS RIATE et du réseau MIGREUROP / CNRS research engineer in geographical information sciences. Member of UMS RIATE and the MIGREUROP network.
-
 9:36
9:36 Appel à participants - GT dépôt légal des cartes et données géographiques
sur Conseil national de l'information géolocaliséeAppel à participants - GT dépôt légal des cartes et données géographiques
-
 21:58
21:58 Spatialisation avec Arabesque d’un réseau de collaborations scientifiques sur les îlots de chaleur urbains
sur Carnet (neo)cartographiqueJe dédie ce court billet à Anne RUAS, en mémoire de ses superbes conférences énoncées lors de la semaine de l’information géographique qui s’est tenue en mai 2025 à Avignon, et qui m’ont fait prendre la mesure de ce phénomène d’îlot de chaleur urbain.
Vous qui êtes actuellement en ville, comme moi, n’avez-vous pas trop chaud depuis quelques jours ?
Comment faire pour avancer dans la connaissance et la compréhension de cette élévation des températures en ville, de ce phénomène d’îlots de chaleur urbains qui nous terrasse actuellement ? Saviez-vous que c’est l’objectif de nombreuses collaborations scientifiques ?Dans le cadre de l’AMI #RETICULAR, une action de recherche sur la spatialisation des réseaux de relations et d’interactions financée par l’Université Gustave Eiffel, que je porte avec mes deux collègues Étienne Côme & Lionel Villard, nous avons récemment investigué sur le 3eme Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC3). Ce plan publié en mars dernier, a été longuement évoqué pas plus tard qu’hier, par le premier ministre François Bayrou, à propos de la canicule qui nous terrassent actuellement (fin juin-début juillet 2025).
Nous avons examiné quelques sujets en lien avec la notion d’adaptation au changement climatique, dont celui de ces îlots de chaleur urbains et de température. Procédé à des géovisualisations menées à titre exploratoire pour tester Arabesque 2 version de développement (poursuivie par Tony Hauck) ces derniers temps, et son interopérabilité avec la plateforme CorText (portée par Lionel Villard). Les données issues du Web of Sciences (WOS) pour 2021 ont ainsi fait l’objet d’un traitement avec CortText, un peu de R (quand même) et une géovisualisation avec Arabesque.
Cluster sémantique sur les îlots de chaleur urbains et de température
a- Réseau de collaborations scientifiques supérieures à cinq contributionsa- Réseau mondial de collaborations scientifiques supérieures à cinq contributions (détail)
Le cluster sémantique cartographié ici révèle un réseau de collaborations scientifiques sur les îlots de chaleur urbains formant un motif en quadrilatère centré sur l’Océan Atlantique, pour relier des chapelets de villes (les lieux d’affiliations des chercheurs sur le sujet) situées sur la façade orientale des États-Unis d’Amérique à d’autres situées en Europe Occidentale (du Nord et au Portugal), de l’Afrique Centrale (Gabon et Cameroun) et de l’Amérique du Sud (Brésil).
b- Réseau mondial de collaborations scientifiques supérieures à 10 contributions
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve particulièrement saisissant le motif spatial de ces collaborations scientifiques, permettant de voir qui dans le monde s’intéresse à ce sujet.
Références :
Arabesque 2 documentation :
– Temperature topic scientific collaborations
– Arabesque interoperabilty with CorTextGéographe et cartographe, Chargée de recherches à l'IFSTTAR et membre-associée de l'UMR 8504 Géographie-Cités.
-
 21:46
21:46 Spatialisation des trajets de covoiturage avec Arabesque
sur Carnet (neo)cartographique

 C’est déjà l’été, vos grandes vacances sont surement déjà programmées. Si vous prenez la route, vous avez probablement déjà envisagé.es de covoiturer pour économiser votre bilan carbone
C’est déjà l’été, vos grandes vacances sont surement déjà programmées. Si vous prenez la route, vous avez probablement déjà envisagé.es de covoiturer pour économiser votre bilan carbone 

 .
.
En tous les cas, il semblerait que de multiples voyageurs covoiturent régulièrement, ce qui génère des centaines de milliers de trajets parcourus qui sont mis à disposition dans le registre de preuve du covoiturage.
Quelques 450 000 d’entre eux, observés en août 2022 entre 7800 localités de France, avaient d’ailleurs pu être cartographiés lors de la Journée d’études de l’action de recherches (carto)graphies et (géo)visualisation (ar9MAGIS) organisée à Rennes en janvier 2023, en utilisant … Arabesque.
Trajets de covoiturage effectués en France en août 2022 Ah mais oui, Arabesque, ça vous dit quelque chose ?
Ah mais oui, Arabesque, ça vous dit quelque chose ?
Vous vous en souvenez ? Voir ici.
Au cas ou vous l’auriez complètement oubliée, je rappelle que Arabesque est une application du GeoWeb dédiée à la géovisualisation et cartographie contemporaine de données de réseaux origine-destination. Elle eut bien des déboires ces dernières années, mais nous avons essayé de remonter la pente avec les moyens du bord, au point d’aboutir aujourd’hui à une version à peu près stable, complétée d’une documentation mise à jour récemment. Accéder à la documentation de la v2 … (en anglais seulement, pour le moment). Alors, n’hésitez pas à tester vos propres données – sur l‘importation des données – ou à jouer avec les exemples fournis sur la page d’accueil.
Alors, n’hésitez pas à tester vos propres données – sur l‘importation des données – ou à jouer avec les exemples fournis sur la page d’accueil.
 Accédez à la version de développement et faites-nous vos retours !
Accédez à la version de développement et faites-nous vos retours !

 Vos plus belles cartes pourront être intégrées à la galerie d’Arabesque
Note : ce billet est issu d’un post précédemment publié sur Linkedln (voir)
Vos plus belles cartes pourront être intégrées à la galerie d’Arabesque
Note : ce billet est issu d’un post précédemment publié sur Linkedln (voir)
Géographe et cartographe, Chargée de recherches à l'IFSTTAR et membre-associée de l'UMR 8504 Géographie-Cités.
-
 14:35
14:35 Cartographie de la guerre hybride et des tentatives de déstabilisation de l'Europe
sur Cartographies numériquesSource : « Au-delà de la guerre hybride : acteurs et territoires de la stratégie russe de déstabilisation de l'Europe » (Cassini Maps).
Alors que l’on parle plus que jamais des actions « hybrides » conduites par la Russie dans l’Union Européenne, nous avons souvent du mal à connecter entre eux des événements qui, pris séparément, paraissent souvent anodins. Pourtant, si l’on commence à les relier entre eux en utilisant les sources ouvertes disponibles, on entrevoit rapidement une stratégie territoriale d’ensemble, dont l’objectif est la déstabilisation du continent européen.
L’objectif de cette cartographie interactive est de mettre en lumière une partie de cette toile invisible, en utilisant les outils méthodologiques de la géopolitique. L’interface est une expérimentation scientifique menée conjointement par CASSINI, le laboratoire GEODE, l’Institut Français de Géopolitique et le collectif CORUSCANT. Le tableau de bord proposé croise un graphe de relations montrant les réseaux invisibles entre acteurs russes et une carte de l'Europe montrant les lieux de leurs actions. Le tableau de bord combine cartographie dynamique, schémas d’acteurs et statistiques interconnectées dans un outil d’OSINT remarquable.
Tableau de bord mettant en relation acteurs et territoires de la stratégie russe de déstabilisation de l'Europe
(source : Cassini Maps)Une autre plateforme cartographique a été développée par les équipes du centre de recherche cyber de l’Université Paris 8, GEODE et la société CASSINI, spécialisée en cartographie. Son objectif est de cartographier et hiérarchiser toutes les actions menées par Prigozhin ou ses réseaux dans le monde, à partir des données collectées en source ouverte depuis plusieurs années par les chercheurs du centre GEODE et les analystes de CASSINI.
Actions menées par la galaxie Prigozhin (source : Cassini Maps)
Pour compléter
« La Russie de Poutine est déjà en train d’attaquer l’Europe : cartographier les 60 opérations de guerre hybride menées depuis 2022 » (Le Grand Continent).
« Les guerres hybrides de la Russie contre l’Europe, avec Kévin Limonier » (Geopolitique.net).
« A partir de quand la guerre hybride devient-elle la guerre tout court ? » (Le Monde).
« La guerre hybride à l'épreuve du feu » (IFRI).
« J'ai été piraté parce que je travaille sur la Russie. Mais la même nouvelle attaque intelligente pourrait être utilisée contre presque n’importe qui » (Foreign Policy).
« Penser le renseignement. Le retour du terrorisme d’État?? » (Magazine DSI)
« L’Europe en première ligne des ingérences informationnelles russes » (Alternatives économiques).
« La cyberguerre Russie-Ukraine, caractère de la guerre hybride » (Carto-Lycée).
Articles connexes
Comment cartographier la guerre à distance ?
La carte, objet éminemment politique : la guerre en Ukraine
Les enjeux du projet de gazoduc Nord Stream 2 à partir de ressources disponibles sur Internet
La géographie et les cartes : des outils pour faire la guerre ? (France Culture)Le brouillage et l'usurpation de signaux GPS participent de nouvelles formes de guerre électronique
OSINT, enquêtes et terrains numériques (revue Hérodote, 2022/3)
Les dépenses militaires dans le monde à partir des données du SIPRI
-
9:26
[Le blog SIG & URBA] “GeoPhotos”
sur Géoblogs (GeoRezo.net)Je commence cet article en m'amusant à imaginer un nouveau nom à l'initiative Panoramax, dénommée provisoirement "France 360" par Christian Quest. Moi, j'y ai (presque) cru à "France 360". Un tout petit doute m'a évité de rediffuser cette information à tout mon réseau le 1er avril ... Panoramax se présente comme "L'alternative libre pour photo-cartographier les territoires". C'est une banque de photos, très utile pour décrire le territoire :
- des clichés pris depuis la voie publique,
- sous forme de traces, de séquences de photos, à 360°, ou pas !
- ou sous forme de photos plus ponctuelles,
- et mises à disposition de tous.
Pour aller plus loin : [https:]] [https:]] [https:]] [https:]] [https:]]
Merci à Christian et Sophie pour leur aide à la rédaction de cet article.
-
 17:35
17:35 Impacts du changement climatique sur l'agriculture mondiale et prise en compte de l'adaptation
sur Cartographies numériques
Source : Hultgren, A., Carleton, T., Delgado, M. et al. (2025). Impacts of climate change on global agriculture accounting for adaptation. Nature 642, p. 644–652. [https:]] (article en accès libre).Le changement climatique menace les systèmes alimentaires mondiaux, sans que l'on sache dans quelle mesure l'adaptation peut contribuer à réduire ces pertes. Dans le contexte bien documenté de l'agriculture américaine, certaines analyses soutiennent que l'adaptation sera généralisée et que les dommages climatiques seront faibles, tandis que d'autres concluent que l'adaptation sera limitée et les pertes assez lourdes. Les analyses basées sur des scénarios indiquent que l'adaptation devrait avoir des conséquences notables sur la productivité agricole mondiale, mais il n'existe pas d'étude systématique sur l'ampleur de l'adaptation réelle des productions à l'échelle mondiale. Dans cet article, les auteurs ont cherché à estimer empiriquement l'impact des adaptations en utilisant des données longitudinales concernant six cultures de base (maïs, soja, riz, blé, manioc et sorgho) et couvrant 12 658 régions dans 54 pays (soit les deux tiers des calories fournies par les cultures à l'échelle mondiale).
Ils estiment que la production mondiale diminue en moyenne de 5,5 × 10¹? ?kcal par an pour chaque augmentation de 1 °C de la température moyenne à la surface du globe (TMGS), soit 120 kcal par personne et par jour. Cela représente 4,4 % de la consommation alimentaire quotidienne. Ils prévoient que l'adaptation et la croissance des revenus atténueront 23 % des pertes mondiales en 2050 et 34 % à la fin du siècle (6 % et 12 %, respectivement selon un scénario d'émissions modérées), mais des pertes résiduelles substantielles subsistent pour tous les aliments de base, à l'exception du riz. Contrairement aux analyses d'autres résultats qui prévoient les dommages les plus importants pour les pauvres, ils constatent que les pertes concernent aussi les greniers à blé modernes dotés de climats favorables et d'une adaptation actuelle limitée, bien que les pertes dans les régions à faible revenu puissent être également substantielles. Les scientifiques recommandent de mettre en place des stratégies d’adaptation ambitieuses pour garantir la sécurité alimentaire et atténuer les effets du changement climatique.
Projections de l’évolution des productions de maïs, soja, riz, blé, manioc et sorgho d’ici à la fin du siècle (source : © Nature)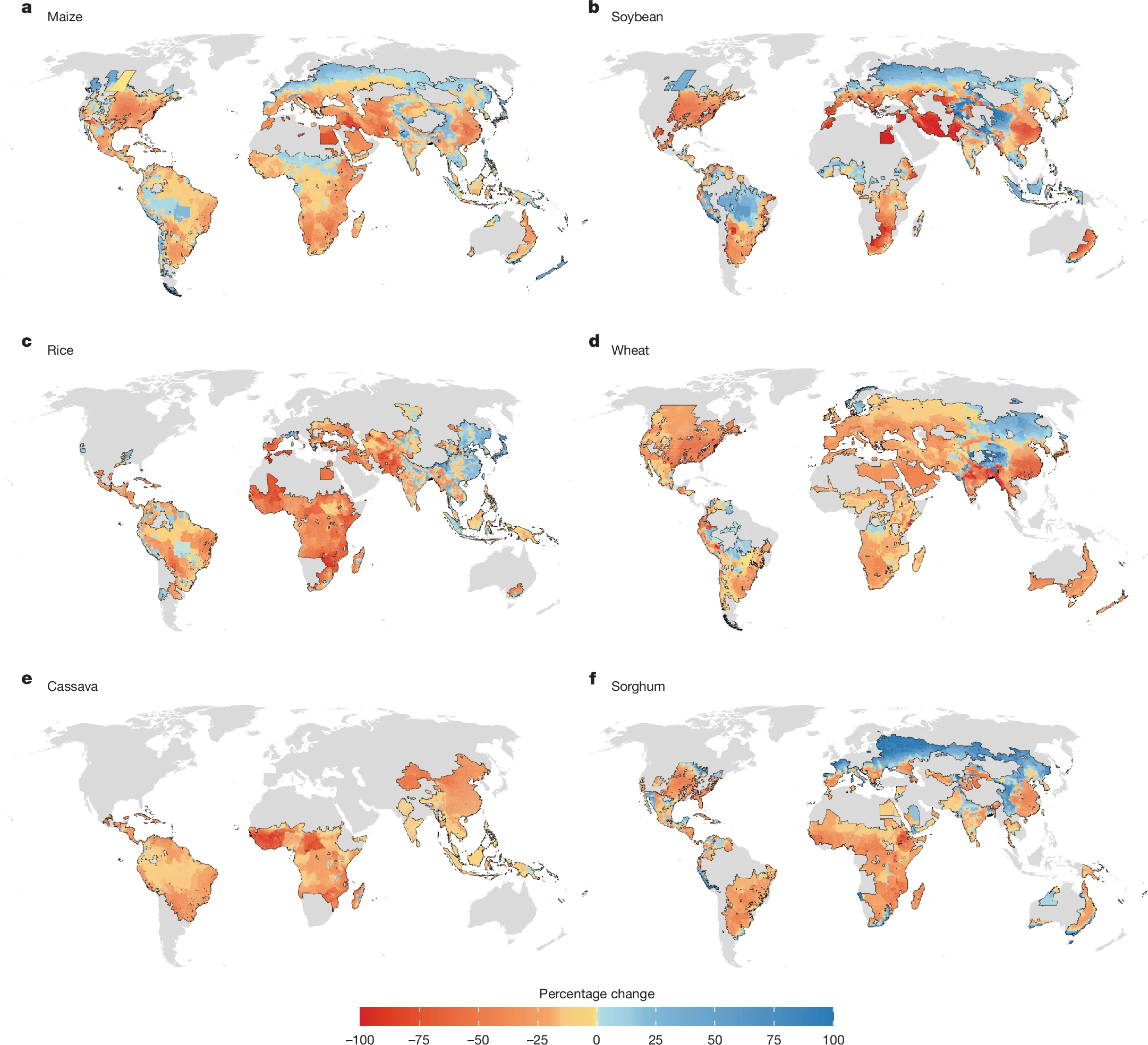
MaïsDans un scénario d'émissions élevées, les pertes de rendement du maïs projetées à la fin du siècle sont sévères (environ ?40 %) dans la ceinture céréalière des États-Unis, en Chine orientale, en Asie centrale, en Afrique australe et au Moyen-Orient. Les pertes en Amérique du Sud et en Afrique centrale sont plus modérées (environ ?15 %), atténuées en partie par des niveaux élevés de précipitations et une augmentation des précipitations à long terme. Les impacts en Europe varient selon la latitude, de +10 % de gains dans le nord à ?40 % de pertes le long de la Méditerranée. Des gains dans les potentiels de rendement théoriques se produisent dans de nombreuses régions du nord dans lesquelles le maïs n'est pas largement cultivé.
SojaLa distribution spatiale des impacts sur le rendement du soja est similaire en structure à celle du maïs, bien que les ampleurs soient accentuées ; par exemple, environ ?50 % aux États-Unis et environ +20 % dans les régions humides du Brésil dans un scénario d'émissions élevées.
RizLes impacts sur le rendement du riz à fortes émissions sont mitigés en Inde et en Asie du Sud-Est, qui dominent la production mondiale de riz, avec de faibles gains et pertes dans ces régions. Ce résultat régional est globalement cohérent avec les travaux antérieurs. Dans les autres régions rizicoles, les estimations centrales sont généralement négatives, avec des reculs en Afrique subsaharienne, en Europe et en Asie centrale dépassant ?50 %.
BléLes pertes sont particulièrement constantes dans les principales régions productrices de blé, avec des pertes de rendement dues à de fortes émissions de ?15 % à ?25 % en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, en Afrique et en Amérique du Sud et de ?30 % à ?40 % en Chine, en Russie, aux États-Unis et au Canada. Il existe des exceptions notables à ces tendances mondiales : les régions productrices de blé de l'ouest de la Chine affichent à la fois des gains et des pertes, tandis que les régions productrices de blé du nord de l'Inde affichent certaines des pertes projetées les plus sévères à l'échelle mondiale.
ManiocLe manioc devrait avoir des impacts négatifs uniformes dans presque toutes les régions où il est cultivé actuellement, les pertes les plus importantes se situant en Afrique subsaharienne (-40 % en moyenne dans un scénario d'émissions élevées). Bien que le manioc ne représente pas une part importante des revenus agricoles mondiaux, il constitue une culture de subsistance importante dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ainsi, ces pertes de rendement pourraient constituer une menace future substantielle pour l'apport nutritionnel des populations pauvres dans le monde.
SorghoLes pertes de sorgho sont généralisées dans presque toutes les régions principales où il est cultivé actuellement : Amérique du Nord (?40 %), Asie du Sud (y compris l'Inde) (?10 %) et Afrique subsaharienne (?25 %). Des gains projetés apparaissent en Europe occidentale (+28 %) et en Chine du Nord (+3 %).
Articles connexes
Estimation du PIB agricole à l'échelle mondiale sur une trame de 10x10km²
Agroclimat2050, un outil pour prévoir l'impact des événements météorologiques sur la production agricole
OneSoil, la carte interactive des parcelles et des cultures en Europe et aux Etats-Unis
Un Atlas de la PAC pour une autre politique agricole commune
L'insécurité alimentaire dans le monde (rapport du FSIN)
L'autosuffisance alimentaire est-elle possible pour La Réunion ?
-
 10:49
10:49 Atlas de la complexité économique
sur Cartographies numériques
L'Atlas de la complexité économique est un outil de visualisation de données qui permet d'explorer les flux commerciaux mondiaux sur les différents marchés, de suivre leur dynamique au fil du temps et de découvrir de nouvelles opportunités de croissance pour chaque pays. Développé par la Harvard Kennedy School of Government, l'Atlas s'appuie sur les recherches du Growth Lab de Harvard et constitue l'outil phare de The Viz Hub, la plateforme d'outils de visualisation du Growth Lab.
L'Atlas place les capacités industrielles et le savoir-faire d'un pays au cœur de ses perspectives de croissance, la diversité et la complexité des capacités existantes influant fortement sur la croissance. L'outil combine des données commerciales avec des synthèses issues des recherches du Growth Lab.
L'Atlas original en ligne a été lancé en 2013 pour accompagner l'ouvrage L'Atlas de la complexité économique : cartographier les voies de la prospérité. Aujourd'hui, il est utilisé dans le monde entier par les décideurs politiques, les investisseurs, les entrepreneurs et les universitaires comme une ressource précieuse pour comprendre la structure économique d'un pays.
L'Atlas de la complexité économique fournit des données complètes sur le commerce international couvrant plus de 6 000 produits dans 250 pays et territoires. La page téléchargement des données donne accès aux jeux de données de l'Atlas.
Le classement des pays du Harvard Growth Lab évalue l'état actuel des connaissances productives d'un pays grâce à l'indice de complexité économique (ICE). Les pays améliorent leur ICE en augmentant le nombre et la complexité des produits qu'ils parviennent à exporter. Une carte permet de comparer les pays en fonction de leur classement ICE avec possibilité de mesurer des évolutions depuis 1995.
Comparaison des pays en fonction de leur classement ICE (source : Harvard Growth Lab)
Articles connexes
Cartographie des pays ayant les États-Unis ou la Chine comme principal partenaire commercial (2001-2023)
Carte des tarifs douaniers imposés par les États-Unis : vers une guerre commerciale ?
Country T-SNE, une solution de data visualisation originale pour comparer des pays entre eux
AllThePlaces : géodonnées et vision du monde commercial à travers Internet
Calculer l'indice de richesse relative à une échelle infra-nationale pour les pays pauvres ou intermédiaires
Le calcul de l'IDH prend désormais en compte les pressions exercées sur la planète (IDHP)
Rapport de la Commission européenne sur la cohésion économique, sociale et territoriale
Rapport du Forum économique mondial sur la perception des risques globaux
-
 11:16
11:16 Évolution de la plateforme de données ouvertes Data.gouv.fr
sur Cartographies numériques
La mission de la plateforme Data.gouv.fr est de simplifier l’accès aux données publiques françaises. L’ouverture et la circulation des données publiques renforcent la transparence, améliorent l’action publique et permettent la création de nouveaux services. Lancée en 2011 par la mission Etalab, la plateforme est développée et opérée par le département Opérateur des Produits Interministériels de la Direction interministérielle du numérique (DINUM). Les rubriques du site se sont considérablement enrichies et sont de mieux en mieux structurées.
1) Data.gouv.fr, un site de mieux en mieux structuré
Accès aux données par thématique :- Données relative aux élections
- Données relative à la santé
- Données relative à l'emploi
- Données liées aux actualités
- Données relatives à la météo
- Données relatives aux transports
- Données relatives à l'écologie
- Trouver des données (où rechercher des jeux de données)
- Evaluer la qualité des données (comment s'informer sur un jeu de données)
- Récupérer des données (comment télécharger des données ou utiliser une API)
- Manipuler des données (comment ouvrir, filtrer, nettoyer ou croiser des données)
- Analyser des données (comment utiliser un tableur, python ou R pour l'analyse)
- Visualiser des données (comment créer des visualisations de données)
2) Les principales nouveautés
Au cours de la démo publique qui a eu lieu le 18 juin 2025 (enregistrement disponible ici), l'équipe de data.gouv.fr a présenté les dernières évolutions de la plateforme, parmi lesquelles la prévisualisation cartographique.
Après avoir travaillé sur la prévisualisation des fichiers tabulaires, data.gouv.fr permet désormais de visualiser directement sur la plateforme des données géographiques (PMTiles et GeoJSON).

Un exemple de visualisation cartographique
Voici deux exemples :
Liste des édifices labellisés « Architecture contemporaine remarquable »
Liste des bornes de Recharge pour Véhicules Électriques
D’autres formats seront prochainement pris en charge, en s’appuyant sur les communs numériques développés par l’Institut de l’information géographique et forestière (IGN) via cartes.gouv.fr. Il y aura par exemple des flux WMS et WFS, ainsi que des CSV contenant des coordonnées géographiques comme des latitudes et des longitudes.
Pour aller plus loin et découvrir davantage de données à composante géographique, nous vous invitons à consulter l’inventaire thématique dédié.
Voir la feuille de route avec la liste des nouveautés (déjà réalisées ou à venir).
Pour s'abonner à l'infolettre de Data.gouv.fr.
Articles connexes
Les données à composante géographique référencées sur le site Data.gouv.fr
Nouvelle version simplifiée du fond de carte communal Admin Express (IGN)
La grille communale de densité : un nouveau zonage d'étude proposé par l'INSEE
Code officiel géographique et découpage administratif de la France (INSEE)
Depuis le 1er janvier 2021, l'IGN rend ses données libres et gratuites
Bascule des géoservices de l'IGN vers une Géoplateforme
Travailler en équipe avec l'outil Ma carte de l'IGN
Lidar HD : vers une nouvelle cartographie 3D du territoire français (IGN)
Les anciens millésimes de la BD Topo disponibles en téléchargement sur le site de l'IGN
Cartes IGN, une application mobile pour comprendre le territoire et découvrir la France autrement
Fonds de cartes pour réaliser des croquis ou des cartes
Fonds de cartes pour utiliser dans un SIG
-
 9:34
9:34 Display by Design. La machine à gentrifier et son coût humain aux États-Unis
sur Cartographies numériques
La National Community Reinvestment Coalition (NCRC) a publié une carte interactive qui illustre la gentrification des villes américaines au cours des 50 dernières années. « Displaced by Design » est un outil qui permet de comprendre le processus complexe et multiforme de la gentrification. La carte interactive permet de visualiser l'évolution des quartiers dans les zones urbaines américaines, de 1970 à 2020. Les changements socio-économiques et démographiques ont remodelé les communautés, souvent au détriment de populations marginalisées de longue date.Visualisation de la gentrification au sein des villes des Etats-Unis sur la période 1970-2020
(source : Displaced by Design)L'application permet d'étudier les changements au niveau de chaque quartier urbain selon plusieurs critères :
- Race et origine ethnique des résidents
- Revenu médian
- Valeurs immobilières
- Niveau d'instruction
L'un des principaux enseignements de cette carte est que les changements induits par la gentrification vont au-delà des tendances démographiques et de la valeur des propriétés. Ils peuvent également transformer le tissu culturel des communautés. Cette transformation est souvent plus marquée au sein de la population noire.
Entre 1980 et 2020, 523 quartiers à majorité noire ont connu une gentrification. Un tiers d'entre eux ont connu un renouvellement racial complet et près d'un quart sont devenus mixtes. Cette tendance représente une perte de 261 000 résidents noirs dans les quartiers autrefois majoritairement noirs. Le NCRC rapporte que « les taux de déplacement pourraient être plus élevés, avec une diminution d'un demi-million de personnes noires dans l'ensemble des quartiers en cours de gentrification ».
A partir de la carte, vous pouvez zoomer sur les villes des États-Unis pour explorer les données historiques et les évolutions démographiques. Les boutons de la barre latérale permettent de visualiser l'évolution des revenus, des prix de l'immobilier ou de la composition raciale de la ville sélectionnée. Les graphiques permettent de croiser les évolutions avec la répartition géographique. Il est ainsi possible d'étudier l'extension du phénomène de gentrification dans certains quartiers que l'on peut cibler pour une étude plus approfondie.
Exemple d'extension de la gentrification dans la métropole d'Atlanta avec les déplacements de population
(source : Displaced by Design)La carte a été publiée pour compléter le rapport de la National Community Reinvestment Coalition (NCRC) « Displaced by Design: Fifty years of gentrification and Black cultural displacement in US cities » .
Présentation du rapport :
Ce rapport aborde les principaux défis liés à la mesure de la gentrification en introduisant une nouvelle méthode de validation permettant d'identifier plus précisément quand et où la gentrification s'est produite dans les villes américaines entre 1980 et 2022. L'analyse comprend également une estimation du déplacement culturel des Noirs, offrant un aperçu des bouleversements sociaux que la gentrification peut entraîner pour les résidents des quartiers à faibles revenus et à majorité noire. Bien que Glass ait défini la gentrification il y a soixante ans, il manque une méthodologie universellement reconnue pour la déterminer. Cette étude utilise des indicateurs de gentrification largement reconnus et l'évalue en examinant les niveaux de revenus, l'augmentation ultérieure de la valeur des logements et la proportion de résidents diplômés de l'enseignement supérieur. Les auteurs ont également développé une méthode permettant de valider si les quartiers présentent des signes de gentrification en analysant l'évolution des classes sociales, mesurée par la croissance des emplois professionnels, techniques et de direction, ainsi que l'évolution de la composition raciale et ethnique des quartiers, notamment entre les populations blanches non hispaniques et les minorités. Pour la gentrification survenue au cours des deux dernières décennies, un indicateur supplémentaire est utilisé pour évaluer l'évolution de l'activité de prêt hypothécaire. Enfin, les chercheurs ont évalué le déplacement culturel dans les quartiers qui ont montré des signes de gentrification et qui sont passés d'une population majoritairement noire entre 1980 et 2020. Cela fournira, espérons-le, une mesure approximative mais plus complète de l'impact de la gentrification sur les quartiers du centre-ville.
Points-clés à retenir :
- Au cours des cinquante dernières années, 15 % des quartiers urbains présentent des signes de gentrification aux Etats-Unis.
- Bien que la gentrification soit rare, elle est en augmentation. Le nombre de quartiers urbains en cours de gentrification a augmenté au cours des cinquante dernières années, passant de 246 dans les années 1970 à 1 807 dans les années 2010.
- Dans les années 2010, les cinq villes les plus gentrifiées étaient : Nashville, Tennessee, Washington, DC, la région de la baie de San Francisco, Denver et Austin, Texas.
- La gentrification a touché 523 quartiers à majorité noire entre 1980 et 2020. Un tiers (155) de ces quartiers ont subi un renouvellement racial complet, tandis que près d'un quart (121) sont désormais des quartiers diversifiés et racialement mixtes.
- Il y a 261 000 Noirs de moins vivant dans les quartiers en voie de gentrification qui étaient majoritairement noirs, ce qui indique un déplacement considérable depuis 1980. Les estimations des taux de déplacement pourraient être plus élevées, avec une diminution d'un demi-million de Noirs dans tous les quartiers en voie de gentrification.
- Les villes les plus touchées par le renouvellement racial et le déplacement des quartiers comprennent : Washington, DC, New York, Philadelphie, La Nouvelle-Orléans, Atlanta et la région de la baie de San Francisco.
Zones métropolitaines comptant plus de 10 quartiers présentant des signes de gentrificationRANG
1970s
1980s
1990s
2000s
2010s
1
Washington DC
Tucson, AZ
Portland, OR
Atlanta, GA
Nashville, TN
2
Denver, CO
Boston, MA
Denver, CO
Washington DC
Washington DC
3
Boston, MA
Seattle, WA
Riverside, CA
Portland, OR
San Francisco Bay Area
4
Chicago, IL
Cincinnati, OH
Atlanta, GA
St, Louis, MO
Denver, CO
5
New York City Area
Buffalo, NY
Tampa Bay Area
Austin, TX
Austin, TX
6
Houston, TX
Chicago, IL
Minneapolis, MN
Boston, MA
7
Denver, CO
Miami, FL
Denver, CO
Los Angeles, CA
8
Phoenix, AZ
Seattle, WA
New York City Area
Raleigh, NC
9
Chicago, IL
New York City Area
Pittsburgh, PA
Miami, FL
10
Dallas Metro Area
Charlotte, NC
New Orleans, LA
El Paso, TX
Graphiques et données fournies par le rapport de la NCRC :- Estimations du nombre de zones présentant des indications de gentrification à l’échelle nationale de 1970 à 2020
- Classement de l’intensité de la gentrification des villes des années 1970 à 2010
- Évolution de la population dans des quartiers non gentrifiés des années 1980 à 2020
- Évolution de la population dans des quartiers gentrifiés des années 1980 à 2020
- Variation de la population par origine ethnique à l'échelle nationale
- Changements dans la majorité raciale/ethnique des quartiers en cours de gentrification
- Zones métropolitaines ayant connu les plus grands changements dans les quartiers à majorité noire
- Changements démographiques dans les quartiers gentrifiés
- Changements démographiques dans les quartiers non gentrifiés
- Tendance globale de la population des quartiers présentant des indications de gentrification avant 2010
- Transition démographique des Noirs vers les Blancs dans les quartiers en voie de gentrifications
- Transition démographique des Hispaniques vers les Blancs dans les quartiers en voie de gentrification
- Transition démographique des Noirs vers les Hispaniques dans les quartiers en voie de gentrification
- Évolution démographique par décennie dans les quartiers à majorité noire en voie de gentrification
- Évolution démographique au niveau métropolitain dans les quartiers à majorité noire
- Changement de population dans les quartiers non gentrifiés de Saint Louis
- Changement de population dans les quartiers gentrifiés de Saint Louis
- Évolution de la population dans la zone entourant Lafayette Square à St. Louis
- Changement de population dans les quartiers non gentrifiés de Washington DC
- Changement de population dans les quartiers gentrifiés de Washington DC
- Changement de population dans le quartier autour de U Street depuis les années 1970
Les données sont disponibles en téléchargement sur le site Diversity and Disparities (Université Brown). Voir également cette page qui permet de trier les régions métropolitaines selon un certain nombre de critères de composition raciale/ethnique et de ségrégation (US2020).
Articles connexes
Étudier la structure et l'évolution des logements dans 50 métropoles des États-Unis
Le « redlining » : retour sur une pratique cartographique discriminatoire qui a laissé des traces aux Etats-Unis
Les ségrégations raciales aux Etats-Unis appréhendées en visualisation 3D et par la différence entre lieu de travail et lieu d'habitat
La Black Elevation Map : une carte en 3D pour rendre visible la présence de la culture noire aux Etats-Unis
Une carte de 330 millions de points pour représenter la répartition ethnique aux Etats-Unis
La suppression de la Racial Dot Map et la question sensible de la cartographie des données ethniques aux Etats-Unis
La cartographie des opportunités dans les quartiers des grandes métropoles : un outil au service de la justice spatiale ?
Mapping Prejudice, un projet pour cartographier les préjugés raciaux à Minneapolis
Etats-Unis : les États qui gagnent de la population ou qui en perdent au recensement de 2020
Une erreur de recensement révèle des détails surprenants sur les hispaniques et les latinos américains
Étudier les mobilités résidentielles des jeunes Américains à partir du site Migration Patterns
Les shrinking cities, des villes toutes en déclin économique ?
-
 16:36
16:36 La Plateforme Digitale Collaborative (PDC) : un outil numérique au service de la gouvernance urbaine au Cameroun
sur CartONGCette plateforme vise à renforcer la gouvernance urbaine au Cameroun en facilitant la mise en réseau, le partage d’informations et la transparence entre les multiples acteurs du développement des villes. La PDC représente la brique numérique du projet PUC, et constitue une avancée majeure dans la structuration des données et la collaboration entre institutions, collectivités…
-
 15:57
15:57 Séminaire OneGeo Suite, le 9 septembre à Marseille
sur Évènements – AfigéoSéminaire OneGeo Suite, le 9 septembre à Marseille Séminaire OneGeo Suite, le 9 septembre à Marseille AfigéoNeogeo vous convie à la seconde édition du séminaire OneGeo Suite qui aura lieu le mardi 9 septembre 2025 à Marseille au Palais des Arts (Parc Chanot), de 14h à 18h, veille des GeoDataDays 2025. Ce séminaire s’adresse à tous les membres de la communauté ainsi qu’à toutes les structures intéressées par la solution OGS avec pour objectif […]
The post Séminaire OneGeo Suite, le 9 septembre à Marseille first appeared on Afigéo.
-
 7:54
7:54 Nouvelle version simplifiée 2025 d'Admin Express (IGN)
sur Cartographies numériques
Source : « De nombreuses nouveautés arrivent avec la nouvelle version d’Admin Express » (IGN)Depuis mi-2024, l’IGN œuvre en interne à une refonte du contenu autour de ses référentiels administratifs en réponse aux demandes d’évolution remontées par les utilisateurs. Ce travail de refonte arrive à son terme et se traduit par une nouvelle version 4 d'Admin Express. Cette nouvelle version s’accompagne d’un grand nombre d’améliorations : un enrichissement de l’offre existante, une meilleure cohérence entre les référentiels administratifs, et une mise à jour importante sur le littoral.
- Un référentiel administratif complet et cohérent
- Ajout de trois collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy (977), Saint-Martin (978) et Saint-Pierre et Miquelon (975)
- Ajout systématique du code SIREN dans toutes les classes
- Le remplacement des géométries des pseudos-cantons par des vrais cantons (y compris infra-communaux)
- Des classes de chef-lieu (ponctuel) sur l’ensemble des niveaux administratifs
- L’ajout de la superficie cadastrale de l’INSEE sur la classe commune
- Mise à jour de la limite littorale suite à l’intégration de la limite terre-mer
- Deux nouveaux produits « petite échelle » :
- Admin Express COG CARTO_PLUS PE (à télécharger)
C’est la déclinaison CARTO_PLUS de sa grande sœur Admin Express COG CARTO PE arrivée en 2024. CARTO_PLUS est la version petite échelle millésimée COG offrant un rapprochement fictif des DROM autour de la métropole, plus adaptée à des besoins de datavisualisation. Elle s’inspire du travail réalisé par l’ICEM7 avec un dernier millésime publié en 2022. La géométrie « Carto Plus » ne possèdera pas de géoréférencement légal et sera proposée sur l’ensemble des couches administratives (commune, département, etc…). - Contour IRIS PE
Ce nouveau produit est la déclinaison petite échelle de IRIS GE (Contour IRIS étant la version moyenne échelle). L’objectif est d'offrir sur la thématique IRIS les 3 niveaux d’échelle (grande, moyenne et petite échelles).
Pour obtenir les régions, départements ou cantons dans la même précision, il est possible de télécharger le fichier gpkg de l'IGN pour faire les découpages administratifs ou bien d'utiliser l'outil en ligne Mapshaper. A partir de la couche communale, saisir dans la console la requête suivante, puis faire les exports dans le format choisi :
- "dissolve reg" = pour faire apparaître les limites de régions
- "dissolve dept" = pour faire apparaître les limites de départements
- "dissolve can" = pour faire apparaître les limites de cantonsLes données Admin Express peuvent être visualisées aussi sur le site cartes.gouv.fr.
Mapshaper est un outil en ligne qui permet, sans avoir à installer un logiciel SIG, de lire et de convertir des fichiers au format Shp, GeoJson, TopoJson, Kml ou Svg. Voir le tutoriel de prise en main proposé par Eric Mauvière.
Découpage administratif à partir du fond simplifié d'Admin Express (source : IGN)
A titre de comparaison, le fond de carte des communes françaises proposé par l'Observatoire des territoires respecte davantage la taille des départements d'outre-mer. L'application Philcarto propose quant à elle des fonds à différentes échelles.
Articles connexes
La grille communale de densité : un nouveau zonage d'étude proposé par l'INSEE
Code officiel géographique et découpage administratif de la France (INSEE)
Depuis le 1er janvier 2021, l'IGN rend ses données libres et gratuites
Bascule des géoservices de l'IGN vers une Géoplateforme
Travailler en équipe avec l'outil Ma carte de l'IGN
Lidar HD : vers une nouvelle cartographie 3D du territoire français (IGN)
Les anciens millésimes de la BD Topo disponibles en téléchargement sur le site de l'IGN
Cartes IGN, une application mobile pour comprendre le territoire et découvrir la France autrement
Fonds de cartes pour réaliser des croquis ou des cartes
Fonds de cartes pour utiliser dans un SIG
- Un référentiel administratif complet et cohérent
-
 10:06
10:06 Le CNIG fête ses 40 ans d'existence
sur Conseil national de l'information géolocaliséeLe CNIG fête ses 40 ans d'existence
-
10:00
Où en est Geotrek-Rando en 2025 ?
sur Makina CorpusGeotrek-Rando v3, vitrine publique des territoires pour la valorisation des activités de pleine nature, a connu de nombreuses évolutions depuis 2023.
-
 8:18
8:18 Le CNIG est renouvelé pour cinq ans
sur Conseil national de l'information géolocaliséeLe CNIG est renouvelé pour cinq ans
-
 8:31
8:31 Le globe de Coronelli et les cultures géographiques dans la France de Louis XIV
sur Cartographies numériques
Martin Vailly. Le monde au bout des doigts : François Le Large, le globe de Coronelli et les cultures géographiques dans la France de Louis XIV. Thèse soumise au jury pour approbation en vue de l’obtention du grade de Docteur en Histoire et Civilisation de l’European University Institute, 2020. [https:]] (mise en accès libre sur Hal en juin 2025).Cette thèse explore la constitution de cultures géographiques parmi les courtisans et les élites du royaume de France à la fin du règne de Louis XIV, entre 1680 et 1720 environ. L'analyse est principalement menée à partir de l’étude des globes terrestres de Vincenzo Coronelli, de leur circulation dans les cabinets curieux, ainsi qu’à partir des travaux de François Le Large, garde du globe du roi à Marly. Martin Vailly interroge deux espaces différents, mais pourtant complémentaires, de la pratique géographique : la cour de Louis XIV, où une paire de grands globes cosmographiques est exposé, et les différents lieux du travail savant que sont les bibliothèques, les cabinets ou encore les jardins. En analysant à la fois la constitution de savoirs géographiques, leur exposition sur les globes, leur acquisition et leur discussion par les curieux de géographie, il montre la place de ces connaissances dans la vie sociale, politique et culturelle du royaume de France.
À partir de l’étude de la persona savante et des travaux de François Le Large, il met en évidence le lien entre la constitution d’une culture géographique, et les jeux de positionnement et d’ascension sociale, dans une démarche qui s’inscrit dans l’histoire sociale des sciences et dans l’anthropologie historique des pratiques savantes. En reconstruisant les sociabilités curiales qui s’articulent tant autour du grand globe de Coronelli que de l’acquisition d’une culture géographique, il montre que le goût pour ces savoirs est un enjeu tant politique que mondain, qui caractérise le roi savant, le bon courtisan ou le gentilhomme éduqué. Cette thèse révèle ainsi l’importance de ces objets de distinction sociale que sont les globes en général, et les globes terrestres de Coronelli en particulier. Ils sont au cœur d’un tissu de sociabilités savantes, mondaines et politiques, et forgent les imaginaires géographiques de leurs possesseurs. L’étude détaillée de la surface du grand globe terrestre de Louis XIV, et de son analyse par François Le Large, montre en outre la place des savoirs géographiques dans la symbolique du règne louis-quatorzien. La surface du globe participe à sa manière aux « guerres de plume » qui opposent Louis XIV et ses rivaux. Elle met en scène et légitime les ambitions impériales d’un souverain présenté comme protecteur des arts et sciences, dans ce lieu privilégié de son pouvoir absolu qu’est le palais de Marly.
Pour compléter
Cartes et globes de Coronelli sur Gallica
Les globes qu'il a créé ont fait la renommée de Vincenzo Coronelli (1650-1718). Mais le moine franciscain a des centaines de cartes à son actif. La Bibliothèque nationale de France en conserve de nombreuses, notamment cette carte en deux plans-hémisphères assez originale assortie de diverses autres projections. Les sources de ces cartes et plans sont référencées à la page 447 de la thèse de Martin Vailly.Le Globe terrestre représenté en deux plans-hémisphères et en diverses autres figures par P. Coronelli (source : Gallica)

Offerts par le cardinal d’Estrées à Louis XIV, les globes réalisés en 1683 par le cosmographe vénitien Vincenzo Coronelli offrent une représentation synthétique de la Terre et du ciel. Objets de science et emblèmes du pouvoir, ces globes de 4 m de diamètre, exceptionnels par leur dimension, sont les deux pièces les plus monumentales conservées par la Bibliothèque nationale de France.
Les globes de Coronelli (source : Bibliothèque nationale de France)
A découvrir : « Les globes de Coronelli. Exposition virtuelle sur les globes du Roi soleil » (BNF). Aujourd'hui les Globes de Louis XIV sont installés à la BNF dans l'aile ouest de la bibliothèque François-Mitterrand. Il existe aussi des copies miniatures de ces globes à la Bibliothèque nationale de Vienne. Comme le montre Martin Vally dans sa thèse, il y a un parallèle à faire entre les bibliothèques et les globes qui sont des sources majeures de savoirs. Coronelli lui-même a consigné les principales informations dans un « Recueil des inscriptions des remarques historiques et géographiques qui sont sur le globe terrestre de Marly ». François Le Large, qui était le garde du globe de Coronelli, a transcrit les connaissances géographiques à travers ses « Explications pour les figures qui accompagnent la dédicace du globe terrestre de Louis XIV » que l'on peut considérer comme un véritable guide d'éducation géographique.
« Le garde du globe terrestre, François Le Large, entreprit la transcription de toutes les légendes et son travail, nécessaire déjà en 1710, a préservé certains textes qui allaient par la suite s’effacer. Il se lança dans l’explication des figures, dont certaines étaient traitées avec "la fantaisie du peintre" et rechercha les sources. Mais, plus qu’à une simple transcription, François Le Large se livre à une sévère analyse des éléments inscrits par Coronelli et lui reproche de ne pas mettre à jour sa cartographie. En effet, les travaux de l’Académie des sciences ont permis de multiplier les observations sur le terrain et de corriger beaucoup de positions géographiques. » (Exposition virtuelle sur les globes du Roi soleil, BNF).
Articles connexes
Un jeu de l'oie pour apprendre la géographie du royaume de France
Le monde en sphères. Une exposition virtuelle de la BnF
De la supériorité du globe sur la carte pour enseigner la géographie. Un vieux débat
Un outil immersif pour explorer les globes de la collection David RumseyL'histoire par les cartes : 18 globes interactifs ajoutés à la collection David Rumsey
Des cadres qui parlent : les cartouches sur les premières cartes modernes
Globes virtuels et applicatifs
-
 21:20
21:20 La carte, objet éminemment politique. Mobilisation contre la vente de terres publiques dans l'Ouest des États-Unis
sur Cartographies numériques
Source : 250+ million acres of public lands eligible for sale in SENR bill [Plus de 250 millions d'acres de terres publiques éligibles à la vente dans le projet de loi de réconciliation budgétaire SENR], The Wilderness Society, 13 juin 2025.Depuis 1935, la Wilderness Society mène des efforts pour protéger les étendues sauvages de l'Ouest américain. Cette société a été à l’avant-garde de presque tous les combats en matière de défense des terres publiques. Aujourd'hui elle tire la sonnette d'alarme face au projet de loi de réconciliation budgétaire du Comité sénatorial de l'énergie et des ressources naturelles, publié le 14 juin 2025. Ce texte comprend une série de mesures extraordinaires visant à privatiser les terres fédérales et à promouvoir la domination énergétique au détriment des terres et des ressources publiques.
Le projet de loi impose la vente arbitraire d'au moins 2 millions d'acres de terres du Service des forêts et du Bureau de gestion des terres dans 11 États de l'Ouest au cours des cinq prochaines années, et il donne aux secrétaires de l'Intérieur et de l'Agriculture une large latitude pour choisir les endroits qui doivent être vendus.
Terres publiques susceptibles d'être cédées dans l'Ouest des États-Unis (source : The Wilderness Society)
Plus de 250 millions d'acres de terres publiques sont éligibles à la vente dans le cadre de ce projet de loi, y compris des zones de loisirs, des zones d'étude de la nature sauvage et des zones sans routes inventoriées, des habitats fauniques essentiels et des couloirs de migration de gros gibier. Ce projet de loi prévoit ce qui est probablement la plus grande vente de terres publiques nationales de l'histoire moderne afin de réduire les impôts des plus riches du pays. Il troque l'accès des Américains ordinaires aux loisirs de plein air contre un avantage à court terme qui profite de manière disproportionnée aux privilégiés et aux personnes bien connectées. La version mise à jour du projet de loi du 14 juin autorise la vente des terres bénéficiant de permis de pâturage. Bien que les terres, dont les « droits existants valides » ne sont pas définis, soient toujours exclues, cette expression englobe désormais les droits fonciers tels que les baux pétroliers et gaziers, les droits de passage ou les concessions minières perfectionnées.
Ce projet de loi expose les États et les collectivités locales, relativement démunis, à des conflits d'enchères ouverts face à des intérêts commerciaux fortunés. Il ne confère pas non plus aux nations tribales souveraines le droit de préemption pour les appels d'offres sur des terres, même pour des zones faisant partie de leurs territoires traditionnels ou contenant des sites sacrés. Les terres des monuments nationaux pourraient également être menacées par cette proposition. Dans un avis du ministère de la Justice publié la semaine dernière, l'administration Trump s'est arrogé le pouvoir juridique sans précédent de révoquer la protection des monuments nationaux. Si elle tentait d'appliquer cette décision, 5,5 millions d'hectares supplémentaires de terres publiques les plus précieuses pourraient être menacés de vente.
La disposition relative à la vente de terrains publics se présente comme un moyen de créer davantage de logements, mais elle manque de garanties pour garantir l'utilisation des terrains à cette fin, sans mécanisme de contrôle de l'application des clauses restrictives et avec un large pouvoir discrétionnaire du Secrétaire pour déterminer ce qui constitue un logement ou une « infrastructure destinée à répondre aux besoins locaux en matière de logement ». Les recherches suggèrent que très peu de terrains gérés par le BLM et l'USFS sont réellement adaptés à l'habitat.
Les agences foncières disposent déjà de moyens pour identifier les terres publiques destinées à des usages tels que le logement, si cela répond aux besoins de la communauté. L'élaboration d'une nouvelle méthode pour forcer une telle « cession » dans le cadre du processus de réconciliation budgétaire crée un précédent susceptible de liquider rapidement d'importantes portions de terres américaines précieuses à l'avenir, dès que les politiciens auront un projet à financer. Le site invite à contacter des sénateurs afin de s’opposer au projet de loi de réconciliation. La mobilisation est relayée par d'autres organisations de conservation à but non lucratif telles que le Western Watersheds Project (WWP), qui œuvre pour la protection et la restauration de la faune et des bassins versants dans tout l'Ouest américain.- Consulter la carte interactive (à voir aussi par ici)
- Les terres publiques menacées de vente (pdf)
- Données cartographiques et méthodologie
- Texte du projet de loi du SENR
- Principales dispositions du texte du projet de loi SENR (résumé)
Articles connexes
Cartes et données sur les parcs nationaux aux Etats-Unis
Quand l'Administration Trump fait disparaître des données sur les sites gouvernementaux
La carte, objet éminemment politique : quand Trump dessine sa carte du monde
La carte, objet éminemment politique : quand Trump arrange à sa façon la trajectoire prévue du cyclone Dorian
La carte, objet éminemment politique : le monde vu à travers les tweets de Donald Trump
-
 9:23
9:23 Climate Change Tracker, un tableau de bord pour étudier le changement climatique global
sur Cartographies numériques
La plateforme Climate Change Tracker vise à fournir des tableaux de bord interactifs, des visualisations, des données et des informations fiables et facilement accessibles sur le changement climatique à l'échelle mondiale.
1) Un tableau de bord pour sensibiliser un large public
L'objectif est de fournir des informations en temps réel pour une action coordonnée et une éducation du public. Il s'agit également de sensibilier les décideurs politiques impliqués dans les négociations de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et les acteurs de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique. Climate Change Tracker prévoit de mettre à jour les indicateurs clés plusieurs fois par an, offrant ainsi une vision actualisée des indicateurs du changement climatique.
Indicateurs du changement climatique mondial (source : Climate Change Tracker)
Les différents tableaux de bord mis à disposition sont les suivants :- Indicateurs du changement climatique mondial
- Réchauffement climatique
- CO2 Dioxyde de carbone
- CH4 Méthane
- N2O Protoxyde d'azote
Anomalie de la température moyenne annuelle observée (source : Climate Change Tracker)
Élévation annuelle moyenne du niveau de la mer à l'échelle mondiale (source : Climate Change Tracker)
2) Référence scientifique
Un groupe international de 61 scientifiques issus de 17 pays a produit une troisième mise à jour des indicateurs clés de l’état du système climatique tels que définis dans l’évaluation du 6e rapport de synthèse sur le changement climatique du GIEC (AR6), en s’appuyant sur les éditions précédentes de 2023 et 2024 :Forster et al. (2025). Indicators of Global Climate Change 2024: annual update of key indicators of the state of the climate system and human influence [Indicateurs du changement climatique mondial 2024 : mise à jour annuelle des indicateurs clés de l'état du système climatique et de l'influence humaine]. Earth System Science Data, vol. 17, 6, 2641–2680, [https:]] (article en libre accès)
Les auteurs de l'article évaluent les émissions, les concentrations, les températures, les transferts d’énergie, les bilans radiatifs et le rôle de l’activité humaine. Bien que la variabilité naturelle du climat ait également joué un rôle, ils concluent que les températures record observées en 2024 ont été dominées par l’activité humaine et le budget carbone qui reste par rapport au seuil de 1,5° C n'a jamais été aussi réduit. La mise à jour 2024 comprend deux indicateurs supplémentaires : l’élévation du niveau moyen mondial de la mer et les précipitations terrestres mondiales. Entre 2019 et 2024, le niveau moyen mondial de la mer a également augmenté d’environ 26 mm, soit plus du double du taux à long terme de 1,8 mm par an observé depuis le début du XXe siècle. Les précipitations terrestres mondiales ont quant à elles affiché une grande variabilité interannuelle en raison d’El Niño.
Parmi les autres conclusions clés, on peut citer :
- Les émissions de gaz à effet de serre, provenant principalement de la combustion de combustibles fossiles, mais également liées à la déforestation, restent à un niveau élevé et persistant.
- Les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère mondiale continuent d’augmenter.
- L’amélioration de la qualité de l’air réduit simultanément la force du refroidissement par aérosol.
- Le déséquilibre énergétique de la Terre continue de s’accroître, avec des flux de chaleur sans précédent dans les océans de la Terre.
- Les températures moyennes observées à la surface de la planète continuent d’augmenter.
- Le réchauffement climatique d’origine humaine continue d’augmenter à un rythme sans précédent dans les données instrumentales.
(source : Forster et al., 2025, licence Creative Common)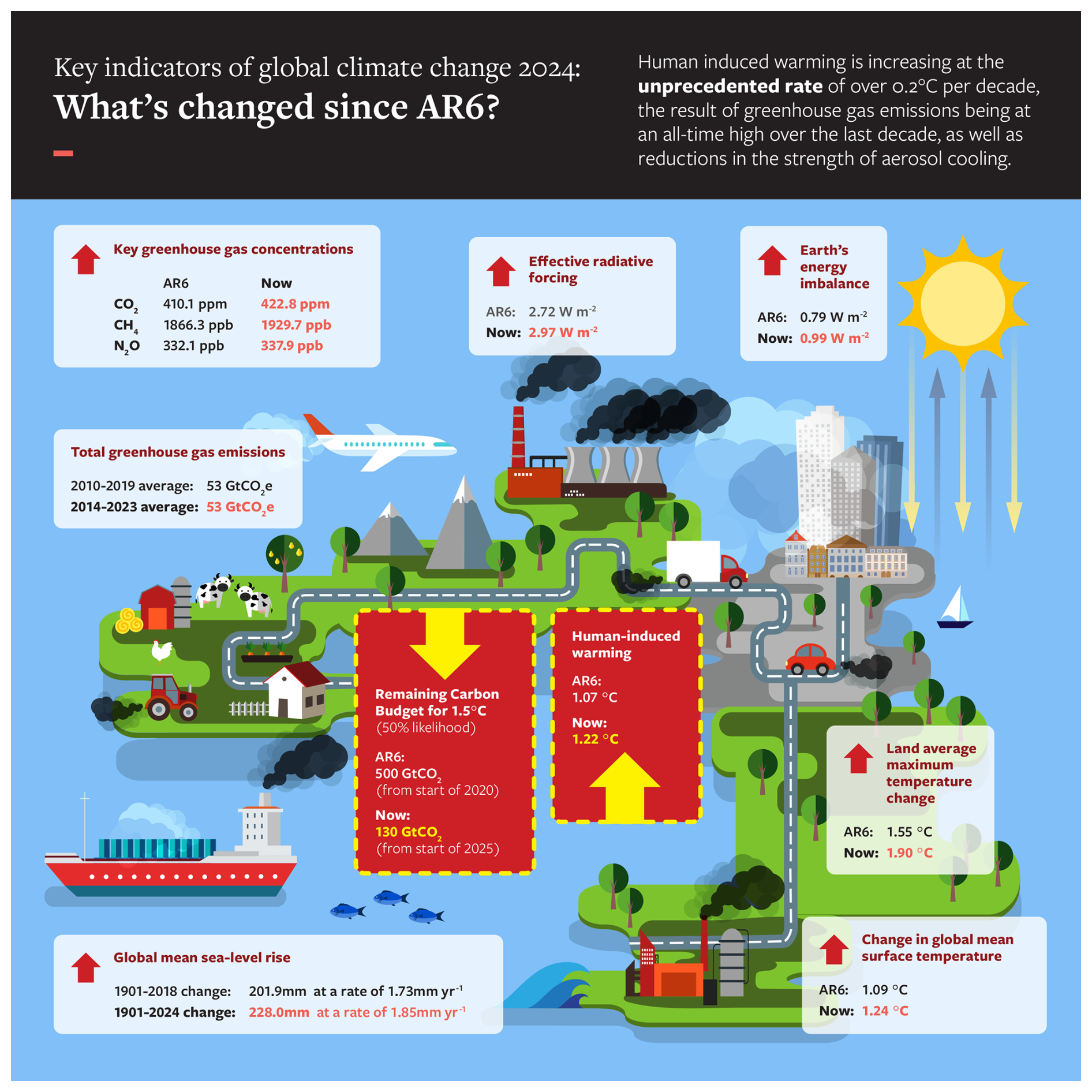
3) Sources des données et téléchargement
La publication de ces données actualisées et librement accessibles, qui se fondent sur les méthodologies du GIEC, offre un moyen de suivre et de surveiller l’influence humaine sur le climat entre la publication des rapports du GIEC. Dans les tableaux de bord, toutes les données sont traçables jusqu'à leurs sources.
Le calcul du budget carbone est disponible sur Github (Lamboll et Rogelj, 2025). Le code et les données utilisés pour produire les autres indicateurs sont disponibles dans les référentiels (Smith et al., 2025b). Toutes les données sont disponibles sur Zenodo (Smith et al., 2025a). Les données sont fournies sous licence CC-BY 4.0.
Les villes du Sud à croissance rapide sont « remarquablement sous-représentées » dans la recherche sur le climat (CarbonBrief). Selon une analyse de plus de 50 000 études, les recherches sur le changement climatique dans les zones urbaines sont orientées vers les grandes villes bien établies du Nord. La recherche, publiée dans Nature Cities, utilise la recherche par mots-clés et des méthodes d’apprentissage automatique pour produire une base de données d’études sur le changement climatique et les villes publiées entre 1990 et 2022.
Pour compléter« Limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C est désormais impossible » (Le Monde). Selon un collectif de scientifiques, l’objectif fixé par l’accord de Paris en 2015 ne pourra pas être atteint en raison de l’incapacité des pays à diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
« Niveau des mers, émissions… Plusieurs indicateurs climatiques dans le rouge, alerte une étude » (La Croix)
« L'administration Trump déclare qu'elle ne publiera pas les principaux rapports sur le changement climatique sur le site Web de la NASA comme promis » (APNews).
Articles connexes
Climate Change Explorer, un outil cartographique pour visualiser les projections climatiques
Climate Trace, une plateforme pour visualiser et télécharger des données sur les émissions de gaz à effet de serre (GES)
Data visualisation sur la responsabilité et la vulnérabilité par rapport au changement climatique
La France est-elle préparée aux dérèglements climatiques à l'horizon 2050 ?
Les plus gros émetteurs directs de CO? en France
Qualité de l'air et centrales thermiques au charbon en Europe : quelle transition énergétique vraiment possible ?
Quand la lutte contre les émissions de CO? passe par la dénonciation des entreprises les plus concernées
Cartographie des projets de combustibles fossiles : comment réduire le risque des "bombes à carbone" ?
Calculer le bilan carbone de nos déplacements aériens
-
 11:16
11:16 Quelles sont les surfaces qui pourraient être reboisées dans le monde ? (Reforestation Hub)
sur Cartographies numériquesL'organisation Nature Conservancy a publié une nouvelle carte interactive identifiant 195 millions d'hectares dans le monde où la couverture forestière pourrait être restaurée. Le reboisement de ces zones pourrait permettre de capter 2,2 milliards de tonnes de CO? par an, soit l’équivalent de la suppression de 481 millions de véhicules de tourisme circulant pendant un an.
La carte interactive du reboisement
La carte du Reforestation Hub permet de découvrir pour chaque pays quelle quantité de terres pourrait être reboisée, combien de tonnes de CO? cela permettrait de capturer chaque année et combien cela représente en émissions annuelles de véhicules de tourisme.
Carte du reboisement global avec les estimations (Reforestation Hub)La carte montre les estimations au niveau juridictionnel de la zone présentant une opportunité potentielle de reboisement (en unités d’hectares) et la quantité de carbone que ces zones pourraient capturer (en unités de tonnes métriques, ou mégagrammes, de dioxyde de carbone par an). La carte s'appuie sur de nouvelles recherches menées par le programme Futur Ecosystems for Africa de l'Université du Witwatersrand. L'étude a identifié les zones où la restauration des arbres pourrait apporter un maximum de bénéfices climatiques sans nuire aux communautés ni aux écosystèmes. Toutes les terres sélectionnées pour le reboisement devaient répondre à trois critères clés :
- Potentiel de couverture arborée élevé : seules les zones capables de supporter une couverture arborée de 60 % ou plus ont été prises en compte.
- Utilisation actuelle des terres : les zones déjà boisées ou couvertes en permanence par l'eau (en 2020) ont été exclues.
- Mesures de précaution : les terres agricoles ont été exclues pour éviter les impacts sur la sécurité alimentaire.
En sélectionnant le bouton « Voir le site américain » , vous pouvez explorer le potentiel de reforestation aux Etats-Unis à l'échelle des comtés. Cette carte est basée sur des études menées par The Nature Conservancy.
Références et données scientifiques
Fesenmyer et al. (2025). Addressing critiques refines global estimates of reforestation potential for climate change mitigation [La réponse aux critiques permet d'affiner les estimations mondiales du potentiel de reforestation pour l'atténuation du changement climatique]. Nature Communications. [https:]]
L'article montre que la reforestation est une solution rentable, évolutive et éprouvée face au changement climatique. Les solutions climatiques naturelles, comme la reforestation, représentent des moyens de collaborer avec la nature pour contribuer à limiter la crise climatique. Globalement, elles correspondent à des mesures de protection, de restauration et d'amélioration de la gestion des terres. À l'échelle mondiale, les solutions climatiques naturelles peuvent fournir jusqu'à 11,3 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an, soit un tiers des réductions d'émissions de gaz à effet de serre nécessaires à la stabilisation du climat.
Il est important de comprendre l'ampleur globale des opportunités de reboisement, ainsi que leurs concentrations, pour soutenir l'élaboration des politiques et mobiliser les ressources vers les zones présentant les plus grandes opportunités. De nouvelles recherches menées par des scientifiques de The Nature Conservancy et d'autres institutions de premier plan fournissent des estimations « à la juste mesure » des zones où le reboisement est le plus réalisable, compte tenu des limites écologiques, des compromis entre biodiversité et disponibilité de l'eau, de la concurrence pour l'utilisation des terres, ainsi que des besoins et des droits des communautés locales. Ces nouvelles recherches identifient jusqu'à 195 millions d'hectares de terres présentant des opportunités de reboisement. La restauration des forêts sur l'ensemble de cette zone permettrait de séquestrer 2,2 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an.
Les auteurs identifient neuf scénarios d'opportunités de reboisement avec des objectifs variés. Tous les scénarios commencent par une carte d'opportunités de reboisement de base qui applique plusieurs mesures de protection afin de fournir une estimation prudente des zones où le reboisement est à la fois réalisable et susceptible de nécessiter peu de compromis. Il s'agit de la carte globale d'opportunités de reboisement sous contrainte. Les autres scénarios appliquent des contraintes supplémentaires pour vous aider à évaluer différentes motivations ou facteurs d'intérêt.
La carte des opportunités de reboisement sous contrainte totale diffère des autres cartes mondiales de reboisement sur trois points principaux. Premièrement, elle définit la forêt de manière beaucoup plus conservatrice, comme des zones pouvant accueillir 60 % ou plus de couvert forestier. De ce fait, les cartes présentées ici n'identifient pas les opportunités de reboisement dans les prairies, les savanes, les forêts ou autres écosystèmes où le potentiel de couvert forestier est limité par les précipitations, les incendies ou d'autres facteurs. Deuxièmement, elle utilise des cartes d'occupation et d'utilisation des terres datant de 2020 pour représenter les zones où le reboisement pourrait être concrètement mis en œuvre. Par exemple, les cartes n'identifient pas les opportunités de reboisement dans les zones déjà boisées ou présentant des points d'eau permanents en 2020. Enfin, la carte des opportunités de reboisement sous contrainte est prudente et applique des mesures de protection pour minimiser les effets pervers potentiels du reboisement. Par exemple, les cartes n’identifient pas les terres agricoles comme des opportunités de reboisement en raison des préoccupations concernant les impacts sur l’approvisionnement alimentaire et n’identifient pas les opportunités de reboisement dans les zones où la couverture forestière peut exacerber, plutôt que réduire, le réchauffement climatique en raison des changements d’albédo.
En quoi cette carte est-elle différente des cartes précédentes ? Les cartes mondiales de reforestation précédemment élaborées ont été critiquées pour plusieurs raisons liées à la manière dont elles définissaient la notion de forêt, aux données utilisées pour la cartographie et à l'absence de garanties que les zones cartographiées pour le reboisement aient un impact positif réel sur le climat. L'analyse a cherché à répondre à ces critiques et à présenter des estimations plus prudentes de la superficie mondiale où le reboisement pourrait être pertinent.
Les ensembles de données SIG de tous les scénarios à une résolution de 1 km sont disponibles en téléchargement sur FigShare (1,43 Go).
Pour compléter
« Face aux défis posés par le réchauffement climatique, nous pouvons trouver de la force dans la nature – et les uns dans les autres – pour développer des communautés résilientes au climat » (The Nature Conservancy)
Future Ecosystems for Africa permet aux scientifiques africains d’utiliser leurs données et leurs connaissances pour éclairer les décisions de développement importantes sur le continent.
« Climat. L’Afrique émet dorénavant plus de dioxyde de carbone qu’elle n’en absorbe » (Courrier international).
Articles connexes
Cartes et données sur les forêts en France et dans le monde
La carte de la hauteur de la canopée dans le monde (NASA Earth Observatory)
Comment la canopée urbaine de Los Angeles rend les inégalités visibles
Le rôle des arbres urbains dans la réduction de la température de surface des villes européennes
Cartographie des arbres dans les zones arides et semi-arides de l'Afrique de l'ouest
Cartes et données sur la canicule et les incendies de forêt en France et en Europe
Le rôle des arbres urbains dans la réduction de la température de surface des villes européennes
Incendies en Amazonie : les cartes et les images auraient-elles le pouvoir d'attiser la polémique ?
Méga feux en Australie : une conséquence du réchauffement climatique, mais attention aux fausses images !
Cartographier les arbres. Entre visions esthétiques et enjeux environnementaux
-
11:00
Makina Corpus : conférence sur le DbToolsBundle au BreizhCamp 2025
sur Makina CorpusNotre expert Symfony anime une conférence sur le DbToolsBundle au BreizhCamp 2025, du 25 au 27 juin à Rennes.
-
 8:33
8:33 Map Myths, un blog à découvrir sur les mythes cartographiques
sur Cartographies numériquesLe blog Map Myths, créé par Henry Patton, s'intéresse aux histoires et légendes associées à des lieux figurant sur des cartes historiques aujourd'hui disparus. Pourquoi ont-ils disparu et comment les cartographes ont-ils imaginé ces espaces vides au-delà du monde connu ? Une carte interactive donne accès à l'ensemble des mythes cartographiques commentés sur le site.
Map Myths a débuté sous la forme d'une carte interactive, mêlant une géographie fantomatique à une vision du monde moderne. Le blog a été lancé fin 2024 pour approfondir l'histoire et les personnages de ces mythes.
Carte interactive donnant accès aux différentes histoires et légendes (source : Map Myths)
Henry Patton (@mapmyths.com), créateur et auteur de ce site web, est titulaire d'un doctorat en glaciologie. Il a toujours été passionné par les cartes et leur histoire. « J'adore passer des heures à fouiller dans les archives et les sources originales des cartographes, explorateurs, pirates, baleiniers du passé, pour vous livrer ces récits fascinants des profondeurs de l'histoire ».
Articles disponibles (juin 2025) :
- Les 5 erreurs de cartographie les plus notoires de l'ère moderne
- Meurtre au pôle Nord ?
- Ce qui était faux (et étonnamment vrai) dans la carte de l'Arctique de Mercator de 1595
- Benjamin Morrell, « le plus grand menteur du Pacifique »
- Les Chinois ont-ils découvert l’Amérique 1 000 ans avant Colomb ?
- La rivalité autour du Groenland un siècle avant Trump
- L'homme derrière le mythe qui préfigurait l'Antarctique
- La ruée vers l'or du XVIe siècle qui a divisé le Groenland en deux
- Comment une île perdue a paniqué les astronomes
- La double vie de Giles Land
La Lémurie : le mythe d'un continent englouti. La cartographie entre science et imaginaire
Articles connexes
Le voyage d'Ulysse. Comment cartographier un mythe ?
Derrière chaque carte, une histoire. La cartographie du détroit de Magellan entre science et imaginaire
L'histoire par les cartes : entre faits et légendes, la cartographie du fleuve Amazone du XVIe au XVIIIe siècle (Gallica)
L'histoire par les cartes : les créatures marines monstrueuses d'Olaus Magnus
Les monts de Kong en Afrique : une légende cartographique qui a duré près d'un siècle !
Le Blanc des cartes. Quand le vide s'éclaire (Atlas Autrement)
Cartes et atlas historiques
Cartes et atlas imaginaires
-
11:00
Où en est Geotrek-Admin en 2025 ?
sur Makina CorpusDepuis 2023, Goetrek-Admin connait de nombreuses évolutions tant du côté fonctionnel que technique et son écosystème continue de se structurer, de s’enrichir grâce aux contributions de la communauté, et de s’ouvrir à d’autres outils.
-
 8:12
8:12 Terre Australe, projection d'un monde à l'envers vu depuis l'hémisphère sud
sur Cartographies numériques
Les cartes du monde ne sont pas forcément orientées avec le nord en haut. Tom Patterson propose une nouvelle carte du monde à l'envers, vu depuis l'hémisphère sud. Il s'agit d'une version spéciale de la projection Equal Earth, centrée sur l'Océanie (150° Est), qui a été inversée.
« Tout ce qui était autrefois familier semble désormais inconnu. L'eau domine l'hémisphère sud reculé, encerclant la planète sans interruption près de l'Antarctique. Je n'ai pas pu résister à l'envie d'y ajouter un albatros. »
Austral Earth, une vision du monde depuis l'hémisphère sud (source : Shaderelief, T. Patterson)
Choisissez la version qui vous convient le mieux :- Image JPEG de qualité moyenne, 200 DPI, 21 Mo (avec plus de 4 000 étiquettes)
- Fichier Adobe Illustrator en couches avec géoréférencement MAPublisher et art du terrain (193 Mo)
- Terrain géoréférencé avec hydrographie (GeoTIFF, 350 DPI, 187 Mo)
Visitez également le site web principal d'Equal Earth pour des versions de cette carte avec le Nord en haut, disponible en plusieurs langues.
Le site Shaderelief de Tom Patterson fournit de nombreuses autres cartes physiques à télécharger en haute résolution ainsi que des tutoriels pour les réaliser.
Articles connexes
La projection Equal Earth, un bon compromis ?
Le nord en haut de la carte : une convention qu'il faut parfois savoir dépasser
Désaxer la carte pour porter un autre regard, mais lequel ?
Andrew Rhodes et ses projections originales pour décentrer le regard sur l'Indopacifique
La projection cartographique Liquid Earth : une nouvelle projection à surfaces presque égales
Des usages de la projection Spilhaus et de notre vision du monde
Compare Map Projections. Un site pour comparer des projections cartographiques entre elles
La projection Peters, toujours aussi mal aimée ?
Projections vues de l'hémisphère sud
-
 14:06
14:06 Cartographie des Zones Climatiques Locales (LCZ) dans les aires urbaines françaises
sur Cartographies numériques
Source : « Cartographie des zones climatiques locales (LCZ) de 83 aires urbaines de plus de 50 000 habitants en France » (Cerema)
Le Cerema met à disposition l’outil Zones climatiques locales (LCZ), qui permet d’accéder aux données et cartes indiquant le degré d’exposition au phénomène d’îlot de chaleur des quartiers de 12 000 communes de France : 88 aires urbaines les plus densément peuplées sont ainsi couvertes, soit 44 millions d’habitants. Ce service est unique car il donne pour tous les territoires un accès gratuit et compréhensible à des données uniformisées, permettant de classer les zones urbaines en fonction de leur exposition potentielle au phénomène d’îlot de chaleur.
Visualisateur cartographique des Zones climatiques locales (Cerema)
Le Cerema répond ainsi à un besoin essentiel des territoires et une priorité du Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC3). L’évolution du climat en cours (+1,7°C en moyenne en France hexagonale depuis 1900) s’accompagne d’épisodes de forte chaleur plus fréquents et plus intenses. Le 3e Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC3) rendu public le 10 mars 2025 par le Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, retient l’un des scénarios de référence du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), pour préparer la France : une hausse des températures moyennes de 4 °C en 2100 par rapport à l’ère préindustrielle. L’outil « LCZ » du Cerema répond à la mesure 13 du PNACC3 : « Renaturer les villes pour améliorer leur résilience face au changement climatique ».
État des lieux de la sensibilité des 88 plus grandes aires urbaines de l’Hexagone aux fortes chaleurs
L’outil dit « LCZ » couvre 88 plus grandes aires urbaines de l’Hexagone, soit 44 millions d’habitants (Outre-mer à l’étude en 2025). Il est disponible pour 12 000 communes (sur 34 826 en Hexagone) dont 248 communes de 20 000 à 50 000 habitants, 79 communes de 50 à 100 000 habitants et les 40 communes de plus de 100 000 habitants.- Plus de 5 millions d’habitants vivent dans des quartiers à forte sensibilité aux fortes chaleurs
- Plus de 20 000 hectares (200 km2, soit 2 fois la surface de la ville de Paris) de zones bâties sont à forte ou très forte sensibilité à l’effet d’îlot de chaleur et demanderaient des actions d’adaptation importantes.
- Dans les plus grandes villes (> 400 000 habitants), ces zones représentent près de 20 % des tissus urbanisés.
- Sur l’ensemble des villes de plus de 20 000 habitants, 4,2 millions de personnes vivent dans des quartiers à forte ou très forte sensibilité, soit 20 % de la population totale de ces communes
- Sur les villes de plus de 400 000 habitants, 2 millions de personnes vivent dans des secteurs à forte ou très forte sensibilité, soit 50 % de la population
- Sur les villes de 200 à 400 000 habitants, 350 000 personnes sont dans des secteurs à forte ou très forte sensibilité, soit 18 % de la population
- Ce taux est de 16 % pour les villes de 100 000 à 200 000 habitants, et il est plus faible (7 %) pour les villes de 20 000 à 50 000 habitants
L'outil LCZ. Un pré-diagnostic simple pour agir face aux fortes chaleurs
Une Zone Climatique Locale (ou LCZ pour "Local Climate Zone" en anglais), concept adopté par la communauté scientifique internationale du climat urbain depuis les travaux de Stewart et Oke [2012], est une unité de surface urbaine, de la taille de quelques îlots ou d’un quartier, avec une homogénéité de composition urbaine entraînant un comportement climatique homogène. 17 classes de LCZ différentes, réparties en deux grandes catégories selon qu’il s’agit d’une zone artificialisée ou non, permettent de qualifier l’exposition de chaque zone à la surchauffe urbaine.Ce concept se fonde sur une classification géo-climatique des territoires urbanisés ; une classification éprouvée et internationalement reconnue, issue de travaux de recherche. Il consiste à découper un territoire en zones uniformes du point de vue de l’occupation du sol (artificialisée ou naturelle), de la structure urbaine, des matériaux, et des activités humaines en supposant que ces zones ont un comportement climatique homogène. Ces zones peuvent s’étendre de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres de large. 17 classes de LCZ permettant de caractériser les territoires ont été définies par des travaux de recherche : 10 classes LCZ « bâties » et 7 classes LCZ « naturelles ».
Le pôle satellitaire du Cerema a développé une méthode originale basée sur des images satellite à très haute résolution spatiale ainsi que des bases de données ouvertes pour cartographier les LCZ et identifier ainsi les quartiers particulièrement exposés à la surchauffe urbaine et susceptibles de contribuer à l’effet d’îlot de chaleur urbain.
Accès aux ressources- Visualiseur cartographique
- Données téléchargeables sur Data.gouv.fr
- Guide méthodologique
- Guide utilisateurs
- Webinaire de présentation
Cette donnée LCZ peut être utilisée comme diagnostic à grande échelle du phénomène d'Îlot de Chaleur Urbain (ICU) sur votre territoire. Elle constitue un pré-diagnostic climatique tenant compte de la morphologie urbaine et de l'occupation du sol : le but est de localiser les îlots/quartiers à enjeux sur lesquels affiner les analyses et prioriser les actions.
La plateforme CartoClimate de la Fondation CNRS Geomanum permet également d'accéder à une cartographie des Zones Climatiques Locales (LCZ). La cartographie des LCZ permet d'appréhender la réponse d’un territoire aux vagues de chaleur estivale (comportement thermique, potentiel de rafraîchissement d’une zone) et de connaître in fine les secteurs potentiellement propices à l’effet d'Îlot de Chaleur Urbain (ICU). Il convient de noter cependant que la cartographie des LCZ n'est pas une modélisation de l'Îlot de Chaleur Urbain.
En cliquant sur un îlot de la carte, vous accédez au détail de celui-ci (CartoClimate)
Références scientifiques
La typologie LCZ (Stewart et Oke, 2012) est une typologie urbaine universelle qui permet de distinguer les zones urbaines, en tenant compte de la combinaison des couvertures terrestres à micro-échelle et des propriétés physiques associées. Le schéma LCZ se distingue des autres schémas d'utilisation et d'occupation du sol par l'accent mis sur les types de paysages urbains et ruraux, qui peuvent être décrits par l'une des 17 classes qu'il contient. Sa forte valeur ajoutée réside dans la diversité des classes urbaines, facilement interprétables et globalement cohérentes, qui capturent la variabilité intra-urbaine des formes de surface et des fonctions du sol.
Stewart, I. D., and T. R. Oke, 2012: Local Climate Zones for Urban Temperature Studies [Zones climatiques locales pour les études de température urbaine]. Bull. Amer. Meteor. Soc., 93, 1879–1900, https://doi.org/10.1175/BAMS-D-11-00019.1
Demuzere, M., Kittner, J., Martilli, A., Mills, G., Moede, C., Stewart, ID, van Vliet, J., et Bechtel, B. (2022). A global map of local climate zones to support earth system modelling and urban-scale environmental science [Une carte mondiale des zones climatiques locales pour soutenir la modélisation du système terrestre et la science environnementale à l'échelle urbaine]. Earth Syst. Sci. Data, 14, 3835-3873, [https:]]
Le site LCZ-generator fournit une cartographie mondiale des zones climatiques locales à une résolution spatiale de 100 m, dérivée de plusieurs ensembles de données d'observation de la Terre et d'étiquettes de classe LCZ expertes.
Carte des zones climatiques locales à l'échelle mondiale (source : LCZ-generator)
Sur les 17 classes de ZCL, 10 reflètent l'environnement bâti, et chaque type de ZCL est associé à des descriptions numériques génériques des principaux paramètres de la canopée urbaine, essentiels à la modélisation des réponses atmosphériques à l'urbanisation. De plus, les ZCL ayant été initialement conçues comme un nouveau cadre pour les études sur les îlots de chaleur urbains , elles contiennent également un ensemble limité (7) de classes d'occupation du sol « naturelles » pouvant servir de zones de « témoin » ou de « référence naturelle ». Ces sept classes naturelles du schéma ZCL ne permettant pas de saisir l'hétérogénéité des écosystèmes naturels existants, il est conseillé, si nécessaire, de combiner les classes de ZCL construites avec tout autre produit d'occupation du sol offrant un éventail plus large de classes d'occupation du sol naturelles.
Ensemble des données disponibles à l'échelle mondiale en téléchargement sur Zenodo.
Pour compléter
Iungman et al. (2024). Impact des configurations urbaines sur les îlots de chaleur urbains, la pollution atmosphérique, les émissions de CO2 et la mortalité en Europe : une approche fondée sur la science des données. The Lancet Planetary Health 8(7), p. 489-505. [https:]]
Articles connexes
Ilots de chaleur et inégalités urbaines en France
Adapt’Canicules. Identifier les vulnérabilités des quartiers populaires face aux canicules
CAPAMOB, un guide du Cerema pour réaliser des diagnostics de mobilités en territoire rural ou péri-urbain
La France est-elle préparée aux dérèglements climatiques à l'horizon 2050 ?
Renforcer l'atténuation, engager l'adaptation (3e rapport du Haut Conseil pour le climat - 2021)
Rapport du Giec 2021 : le changement climatique actuel est « sans précédent »
Les villes face au changement climatique et à la croissance démographique
Le choc climatique frappe déjà les villes les plus peuplées du monde (rapport WaterAid)
Surmortalité attribuée à la chaleur et au froid : étude d'impact sur la santé dans 854 villes européennes
R4RE, une plateforme cartographique d'analyse de résilience pour les bâtiments (Observatoire de l'immobilier durable)
-
 10:58
10:58 Cartes et complotisme. Quand les cartes de pieuvres déploient leurs nombreuses tentacules
sur Cartographies numériquesSource : Puerta, E., Spivak, S. C., Correll, M. (2025). « The Many Tendrils of the Octopus Map ». CHI '25: Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, n° 970, 1-20, [https:]] (article en accès libre).

Dans cet article, des chercheurs américains explorent le fonctionnement des cartes de pieuvres comme arguments visuels à travers l'analyse d'exemples historiques et une étude participative sur la façon dont les données sous-jacentes et l'utilisation de métaphores visuelles peuvent contribuer à des interprétations négatives ou conspirationnistes. Ils montrent que certaines caractéristiques de données ou de styles visuels peuvent conduire à une pensée « de type pieuvre » dans les visualisations, même sans l'utilisation explicite d'un motif de pieuvre. Ils concluent en appelant à une analyse plus approfondie de la rhétorique visuelle de ces cartes, en soulignant le potentiel des datavisualisations à contribuer à une pensée néfaste ou conspirationniste.
En représentant une entité centrale aux multiples bras tentaculaires, ces cartes-pieuvre suggèrent un contrôle diffus, hostile et souvent dissimulé. L'un des premiers exemples connus de carte de pieuvre a été publié par Fred W. Rose en 1877 pendant la guerre russo-ottomane. La carte représente les pays européens par des figures humaines, tandis que la Russie est représentée par une pieuvre déployant ses tentacules sur les pays voisins. Ce type de cartes est à rattacher au courant de la cartographie persuasive qui s'intéresse au pouvoir rhétorique des cartes. L'une des fonctions de ces cartes sensationnalistes est de présenter l'ennemi comme une menace, ce qui peut être également réalisé à travers l'utilisation de lignes ou de flèches, de la couleur, de l'ombrage ou encore de la projection. On peut retrouver la métaphore visuelle de la pieuvre dans la visualisation des graphes ayant émergé au XIXe siècle avec les organigrammes, et au XXe siècle avec les sociogrammes. Ces sociogrammes ont établi de nombreuses conventions de conception dans les diagrammes de nœuds-liens modernes, telles que l'utilisation de la couleur et de la forme pour désigner les attributs des nœuds et des arêtes.
Les métaphores aident à la compréhension d'un domaine en l'ancrant dans un autre, ce qui est particulièrement le cas avec l'utilisation d'images anthropomorphes et zoomorphes. L'utilisation de monstres ou d'autres animaux en cartographie a une longue histoire, par exemple pour désigner (ou peupler) des régions inconnues du monde sur les cartes européennes depuis au moins la Renaissance. Dans d'autres cas, l'entité elle-même est utilisée comme métonymie pour un pays dans son ensemble, avec des exemples bien connus comme l'Europa Regina du XVIe siècle (où le continent européen est représenté sous la forme d'une reine avec divers pays dessinant ses parties constitutives) ou encore Leo Belgicus (où les Pays-Bas sont représentés sous la forme d'un lion, avec des informations géographiques représentées à l'intérieur de son « corps »). Bien que de nombreux animaux aient été utilisés pour symboliser des empires, des pays, des religions et des entités sociales et politiques, la pieuvre est unique par son utilisation répandue et cohérente à travers les époques, les régions et les cultures. Elle a été utilisée pour susciter la peur, l’indignation, la sympathie, le dégoût et le nationalisme, généralement dans le cadre d’un appel à l’action.
Les cartes de pieuvres peuvent être réparties en différentes sous-catégories. Bien qu'il puisse exister des pieuvres bienveillantes, ces cartes présentent généralement le même argument visuel implicite : un organisme centralisé et néfaste utilise de multiples leviers de contrôle pour envahir ou affaiblir de larges pans d'une région ou d'un système. Il existe occasionnellement des variations ou des exceptions à cette forme générale, par exemple, en établissant un lien entre la pieuvre et la gorgone ou l'hydre, sémiotiquement similaires. L'étude participative qui a été conduite auprès de 256 participants avait pour objectif d'évaluer l'impact rhétorique des composantes visuelles et structurelles d'une carte-pieuvre d'un territoire fictif le Huskiland, à partir de 6 composantes :- Centralité : Huskiland est une puissance militaire centrale dans la région.
- Tentacularité : Huskiland étend sa portée militaire.
- Portée : Huskiland est déjà présent dans de nombreux pays de la région.
- Intentionnalité : le placement des bases de Huskiland fait partie d'une stratégie militaire intentionnelle.
- Saisie : Huskiland utilise ces bases pour exercer un contrôle militaire ou politique sur ses voisins.
- Menace : Huskiland constitue une menace pour la paix et la stabilité de la région.
Les concepteurs de visualisations (notamment académiques) sont tentés de considérer (à tort) leur travail comme « le simple compte rendu ou la structuration de faits objectifs », la persuasion ou les appels rhétoriques étant considérés comme l'apanage exclusif d'acteurs malveillants ou manipulateurs. Les résultats suggèrent cependant que la cartographie et la visualisation ne peuvent être clairement distinguées entre cartes et graphiques sensationnalistes et « persuasifs » et graphiques plus « neutres » sans intention rhétorique manifeste. Les lecteurs, eux aussi, apportent leurs propres attentes et contextes aux cartes et aux graphiques, ce qui rend impossible une dichotomie claire entre visions neutres ou sensationnalistes des données. La bonne intention des concepteurs de visualisations ne suffit pas à éviter la culpabilité morale quant à la manière dont les visualisations peuvent être mal interprétées ou détournées à des fins conspirationnistes. Un exemple est l'utilisation rhétorique des visualisations de données sur la COVID-19, où des activités de littératie des données apparemment bien conduites, comme le questionnement des sources, l'évaluation du positionnement et la réalisation d'analyses alternatives, ont été utilisées pour étayer la pensée conspirationniste.
Articles connexes
Cartes et caricatures. Recension de cartes satiriques et de cartes de propagande
La rhétorique derrière les cartes de propagande sur le coronavirus
Étudier l'expansion de la Chine en Asie du Sud-Est à travers des cartes-caricatures
La carte, objet éminemment politique. Carte-caricature et dispositif narratif
Les nouvelles façons de « faire mentir les cartes » à l'ère numérique
Bouger les lignes de la carte. Une exposition du Leventhal Map & Education Center de Boston
L'histoire par les cartes : les créatures marines monstrueuses d'Olaus Magnus
Les animaux sur les cartes géographiques anciennes (1500-1800)
Utiliser le lion pour politiser la géographie (blog de la Bibliothèque du Congrès)
La carte, objet éminemment politique
-
 14:18
14:18 Quelles seraient les conséquences d'un effondrement de l'AMOC ?
sur Cartographies numériques
Que se passerait-il si la principale circulation océanique de l’Atlantique, qui régule le climat mondial et européen, venait à s’effondrer ? C'est ce qu'analyse une étude néerlandaise parue en juin 2025 dans la revue Geophysical Research Letters en proposant plusieurs scénarios :René M. van Westen, Michiel L. J. Baatsen (2025). European Temperature Extremes Under Different AMOC Scenarios in the Community Earth System Model, Geophysical Research Letters, vol. 52, 12, 11 June 2025.
La circulation méridienne de retournement Atlantique (en anglais AMOC) est le principal système de courants océaniques de l'Atlantique. Une grande partie du transfert de chaleur dans l'Atlantique est due au Gulf Stream, un courant de surface qui transporte l'eau chaude vers le nord depuis les Caraïbes. Alors que le Gulf Stream dans son ensemble est uniquement entraîné par les vents, son segment le plus septentrional, le courant nord-atlantique tire une grande partie de sa chaleur des échanges thermohalins dans l'AMOC. Ainsi, l'AMOC transporte jusqu'à 25 % de la chaleur totale vers l'hémisphère nord, jouant un rôle majeur dans le climat de l'Europe du nord-ouest.
La circulation méridionale de retournement de l'Atlantique (AMOC) modère le climat européen. Un affaiblissement substantiel de l'AMOC sous l'effet du changement climatique pourrait entraîner une Europe plus froide dans un monde plus chaud. L'objectif dans cet article scientifique est de quantifier l'évolution des températures européennes selon différents scénarios d'AMOC et de changement climatique à l'aide du Modèle Communautaire du Système Terrestre (CESM).
Températures extrêmes en Europe selon différents scénarios d'AMOC à partir du Modèle communautaire du système terrestre (source : van Westen & Baatsen, 2025)

Lorsque l'AMOC s'effondre complètement sans les effets du changement climatique, les extrêmes de température hivernale en Europe du Nord-Ouest s'intensifient (avec une chute pouvant atteindre 15 °C par endroits). L'intensification des extrêmes de froid est liée à la présence de glace de mer près de l'Europe du Nord-Ouest. Si l'on considère un AMOC réduit sous des conditions intermédiaires de réchauffement climatique : la limite de la banquise recule vers le nord et les impacts sur la température sont moindres, mais restent considérables. Outre les variations de température, les tempêtes hivernales devraient s'intensifier et entraîner d'importantes fluctuations de températures quotidiennes dans le cadre d'un AMOC nettement plus faible. Les températures européennes du futur seront déterminées par la force de l'AMOC et l'ampleur du réchauffement climatique.
L'article est accompagné d’une carte interactive qui permet de visualiser les changements avec +2° de réchauffement climatique et un AMOC effondré. Les données de cet outil en ligne sont issues du Modèle Communautaire du Système Terrestre. Les simulations climatiques ont été réalisées sur le supercalculateur national néerlandais Snellius dans le cadre du projet NWO-SURF 2024.013. Les données complètes sont disponibles sur Zenodo.Articles connexes
Vers un affaiblissement du Gulf Stream dans l'Atlantique nord
Rapport du Giec 2021 : le changement climatique actuel est « sans précédent »
Densité du trafic maritime mondial et effets sur le réchauffement climatique
Comment la cartographie animée et l'infographie donne à voir le réchauffement climatique
CLIWOC. Une base de données climatologiques des océans à partir des journaux de bord des navires (1750-1850)
Faut-il relancer les Zones marines d'importance écologique ou biologique (ZIEB) ?
-
 14:00
14:00 Revue de presse du 13 juin 2025
sur Geotribu Une GeoRDP rédigée à 100% par des plumes humaines, comme d'habitude. Au menu : une enquête sur la qualité de vos données géo, de la géo en Romandie, des nouvelles de la galaxie QGIS locale et globale, des tuiles, de l'art, et des vaches.
Une GeoRDP rédigée à 100% par des plumes humaines, comme d'habitude. Au menu : une enquête sur la qualité de vos données géo, de la géo en Romandie, des nouvelles de la galaxie QGIS locale et globale, des tuiles, de l'art, et des vaches.
-
 11:41
11:41 Atlas conjoncturel de la France en crise
sur Cartographies numériques
L’Atlas conjoncturel de la France en crise, proposé par le géographe Arnaud Brennetot, est disponible sous la forme d’un site Internet en accès libre. L'Atlas propose une analyse critique des transformations géographiques de la France métropolitaine depuis le début du XXIe siècle.Cet atlas conjoncturel a la particularité d’être évolutif car il est appelé à s’enrichir au gré des capacités de l'auteur à l’alimenter, mais aussi du déploiement de la crise elle-même et des retours, critiques et suggestions que les lecteurs intéressés souhaiteraient éventuellement lui adresser. Conçu et lancé dans le cadre d’une démarche itérative sur les réseaux sociaux en juillet 2024, cet atlas assume une position engagée, combinant analyse cartographique et géographie critique, ouverte au dialogue et à la controverse.

Contexte
Face à la polycrise mondiale, dont les ressorts sont autant écologiques, géoéconomiques que géopolitiques, la France, comme la plupart des démocraties libérales, se trouve confrontée à des défis immenses. Or, après plusieurs décennies de néolibéralisation, les instruments de l’action publique ne sont pas nécessairement adaptés à ce nouveau contexte. L'émergence d’une gouvernance multiniveau mobilisant une pluralité d’institutions territoriales s’est traduite par une focalisation collective sur les questions locales et par le délaissement concomitant des enjeux nationaux. Face à l’abandon par l’État d’une véritable stratégie pour le territoire national, les fantasmes et les diagnostics catastrophistes se sont multipliés sans frein dans le débat public, alimentant la crise politique nationale et la délégitimation du régime et des institutions, sans pour autant dégager d'alternatives crédibles.
Objectifs de l'Atlas
Face à la double dérive du laisser-aller de l’État et de l’outrance des débats, cet Atlas de la France en crise vise à proposer une géoscopie des mutations du territoire de la France métropolitaine à travers :- L’analyse des transformations induites par les marchés les plus influents (l’emploi, l’activité productive, le parc immobilier)
- Les moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics pour réguler ces mutations spatiales et promouvoir leurs valeurs et leurs objectifs.
Fonctionnement
L’Atlas de la France en crise est construit à partir de données publiques (INSEE, URSSAF, CEREMA, etc.) et mobilise la plateforme Magrit ( [https:]] ) mise à disposition par l’UMR Géographie-Cités. Les cartes et leur commentaire sont enrichis et actualisés de façon progressive.
Les analyses menées pour aboutir à cet Atlas résultent d’une initiative personnelle et n’engagent que leur auteur, lequel reste disponible pour recevoir tous commentaires et questions.
Présentation de l'Atlas
Auteur : Arnaud Brennetot
Introduction
1. La mise en marché du territoire1.1 Le PIB
2. Une régulation publique en crise
1.2 L'évolution de l'emploi
1.3 Une réindustrialisation fragile
1.4 L'ouverture internationale
1.5 Les revenus d'activité
1.6 Le marché immobilier
1.7 La consommation foncière2.1 Les revenus disponibles
Publications associées
2.2 Les ressources des collectivités territoriales
2.3 La présence publique dans les territoires
2.4 La recherche publique
2.5 Le problème de la santé
Articles connexes
Les inégalités femmes-hommes en matière d'emploi en France
La carte de la pauvreté en France en trois dimensions (Observatoire des inégalités)
Atlas de l'Anthropocène : un ensemble de données sur la crise écologique de notre temps
PopFlux, une application pour visualiser les déménagements des Français avant et après la crise Covid-19
Avec la crise du Covid19, les villes moyennes ont-elles bénéficié d’un regain d’attractivité ?
Cartographie de la crise de l'assurance habitation aux États-Unis
-
 19:00
19:00 [Expo] Les cartes du Monde de Malala Andrialavidrazana
sur Carnet (neo)cartographiqueJ’ai découvert récemment le travail de Malala Andrialavidrazana autour et avec les cartes géographiques, au détour de l’exposition FEMMES, organisée par Louise Thurin dans la somptueuse galerie Perrotin, à Paris, en mars 2025. Cette exposition collective présenta 39 œuvres sélectionnées par le célèbre musicien africain-américain, Pharell Williams, pour célébrer les femmes, la féminité, leur nécessaire émancipation ; des femmes de tous âges, mais essentiellement noires, issues d’une diaspora africaine.
Centrée sur des artistes, ces ” – Soldiers of Love – qui transforment le monde par le pouvoir de leurs mains“, l’exposition mit à l’honneur plusieurs artistes pour leurs œuvres remarquables, des installations grandioses, des sculptures telles une revisite de la Venus hottentote, des photographies et des tableaux, parmi lesquels l’un de Malala Andrialavidrazana intitulé Figures 1856. Geological structures 2018. Celui qui m’intéresse aujourd’hui est cependant tout autre. Lisez plutôt.Malala Andrialavidrazana est architecte de formation (formée à l’ENSA de Paris la Villette), artiste peintre et photographe malgache. Née en 1971 à Madagascar, elle réside à Paris depuis 1983 d’où elle sillonne le Monde pour nourrir son intérêt pour l’altérité, les mouvements globaux notamment de la période coloniale et ses conséquences sur les signes et les représentations sociales des différentes populations humaines qui découlent de l’esclavage.
Malala A. s’attache en effet à changer le regard que les Nords portent sur les Suds, en particulier sur l’océan Indien, l’une des premières économies globales du monde. Elle s’intéresse pour cela à l’exploration du Monde de la période impériale et coloniale du XIXe siècle, aux grandes conquêtes qui ont en relation différents mondes, pour montrer leur ancienneté, la pérennité de ces relations et les représentations que nous en avons aujourd’hui. L’un de ses matériaux de prédilection est la carte papier, (apparemment) issue des grands atlas tels ceux de la fin du XIXe-début du XXe siècle qu’elle combine avec d’autres objets.
Dans le projet Figures (qu’elle initie en 2015 et présenta au Palais de Tokyo à Paris en 2024), Malala A. examine les “nombreuses permutations de la mondialisation du XIXe siècle” en usant de cartes géographiques qui superposent différentes réalités historiques et géographiques, parfois contradictoires, pour représenter des relations issues de la colonisation, souvent de domination. Sont ainsi combinées et superposées des cartes, des photographies, des dessins (de dieux ou de temples occidentaux, des toises, par exemple) mais aussi des pagnes à de la peinture mise en scène.
Le tableau ci-dessous est une véritable planche cartographique, repérable par son cadre et sa grille (il s’agit de la Plate III, comme dans les grands atlas de la période coloniale allemande) repérable par ses graticules et ses coordonnées géographiques apparentes. Des motifs évoquant des morceaux de carte choroplèthe sont visibles sur les bords et en arrière-plan, comme pour contextualiser l’ensemble.
Cette planche représente “les principaux pays du monde”, sous la forme d’une mappemonde qui évoque directement (en même temps), un billet de banque. Elle met en scène deux protagonistes : une femme noire, d’apparence ordinaire, et, un homme, sobre, mais il ne s’agit pas de n’importe qui : c’est un homme politique, c’est Nelson Rolihlahla Mandela.
Figures 1867, Principal countries of the World
Les deux cercles de cette mappemonde-billet symbolisent, comme toutes les mappemondes, ses deux hémisphères continentaux : les Amériques, sur la gauche, servent de cadre à la femme et le reste du monde sur la droite, abrite l’homme politique.
La femme est présentée de dos à l’inverse de l’homme, à sa gauche, qui apparaît quasiment de face. Le buste tourné de trois-quart, le regard filant sur la gauche, elle regarde droit devant elle en arborant un grand sourire aux lèvres tandis qu’il esquisse à peine un rictus, le regard comme tourné sur l’avenir. Elle arbore les apparats de beauté de la femme noire africaine authentique, que l’on devine antillaise (ou créole ?) : de larges anneaux dorés aux oreilles (des créoles ?), que l’on suppose en or ; plusieurs rangées de perles, que l’on suppose aussi en verre (ou en plastique recyclé ?), surplombent des vêtements en wax, blouse en pagne et foulard. Le tissu symbole de l’Afrique subsaharienne, héritage flamboyant de la colonisation et de l’esclavage est rehaussé ici par la carte du monde, plus précisément celle du continent américain, placé comme une partie décorative du foulard.
L’homme apparaît au second plan, en mode portrait dans un cadre resserré, en noir et blanc derrière la carte du reste du monde qui lui fait de l’ombre plus qu’elle ne l’abrite. Placé devant la case, il apparaît comme effacé ou en retrait et pour cause, la dite case m’évoque son long emprisonnement à Robben Island. Son revêtement en terre battue décrit les motifs d’un tissu traditionnel, de type Shweshwe, également hérité de la colonisation allemande.
Cette présence monétaire, en référence au capitalisme évoquerait-t’elle le symbole d’une réussite ? Je pose cette question car la partie gauche du tableau m’évoqua en première intention un autre symbole, celui celui des Nana Benz à la réussite éclatante grâce au commerce de ces pagnes, dans les pays du Golfe de Guinée, dès les années 1950. A la réflexion, ce tableau est bien en lien avec la colonisation, l’un des thèmes privilégié d’étude de Malala Andrialavidrazana.
Nombre d’autres œuvres de l’artiste de ce projet Figures articulent en effet les attraits des colonies, les “principales découvertes” (au titre original en français) des premiers explorateurs, comme ci-dessous.
Figures 1862, Le Monde Principales découvertes
Ce qui intéressant dans le travail de Malala Andrialavidrazana réside dans l’usage de la carte du Monde, pour ce qu’elle, le théâtre de l’impérialisme à l’époque des grandes ouvertes, mais aussi son traitement à la fois en tant que support du récit et élément de ce dernier. Architecte et artiste-plasticienne, l’artiste use de représentations cartographiques variées du monde : sur le globe ou sur le plan – voir le tableau intitulé Figures 1876, Planisphère Elémentaire (2018) sur le site du Fonds d’art contemporain, jouant alors avec différents projections cartographiques et centrages des cartes – ci-dessus, sur l’océan Indien dont elle est originaire.
Au final, une belle découverte des travaux de Malala Andrialavidrazana qui reçu par ailleurs le prix HSBC de la Photographie pour sa série “d’Outres-Monde” (1983), focalisant l’attention sur les villes contemporaine.
En savoir plus, sur le site de l’artiste : andrialavidrazana.com
Géographe et cartographe, Chargée de recherches à l'IFSTTAR et membre-associée de l'UMR 8504 Géographie-Cités.
-
11:30
Portail Hautes-Alpes rando : nouvelle page d’accueil
sur Makina CorpusInterface revisitée pour valoriser les activités de pleine natureLe site Hautes-Alpes Rando, le portail départemental des sports de nature dans les Hautes-Alpes, bénéficie d’une nouvelle page d’accueil.
-
 23:08
23:08 Faut-il relancer les Zones marines d'importance écologique ou biologique (ZIEB) ?
sur Cartographies numériquesSource : Dunn, D.C., Cleary, J., DeLand, S. et al. (2025). What is an ecologically or biologically significant area ? npj Ocean Sustain 4, 28. [https:]] (article en accès libre)
1) Qu'est-ce qu'une Zone marine d'importance écologique ou biologique (ZIEB) ?Les zones d'importance écologique et biologique (ZIEB, en anglais EBSA) sont des zones au sein des eaux océaniques que des évaluations scientifiques officielles ont désignées comme ayant une importance écologique et biologique particulière par rapport à l'écosystème marin environnant. Créées en 2011 par la Convention sur la diversité biologique, ces zones regroupent des milieux variés?: zones côtières (55%), océaniques (17%) et grands fonds (28%). Certains sites abritent des espèces clés comme des tortues, des oiseaux ou des mammifères marins, d'autres des habitats critiques (mangroves, monts sous-marins, zones d’upwelling). Amorcée en 2011, la première vague du processus des ZIEB touche à sa fin. Pendant plus d'une décennie, 15 ateliers régionaux ont été organisés, impliquant plus de 400 participants, couvrant 75,7 % de l'océan et identifiant 338 ZIEB.
Les 336 ZIEB délimitées spatialement (sur 338) décrites dans 15 ateliers régionaux (source : Dunn et al., 2025)
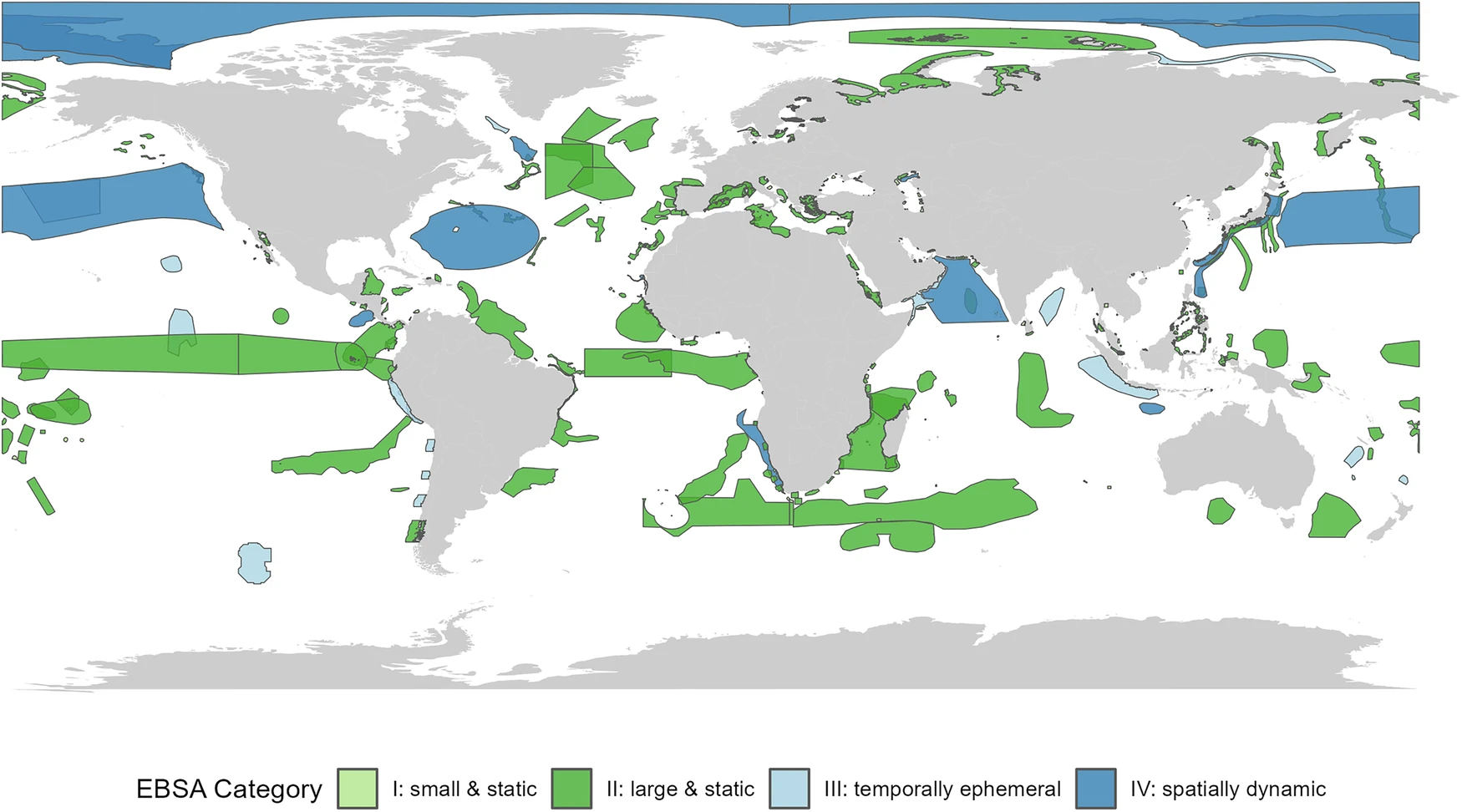
2) Quelles sont les lacunes de ce dispositif ?
La majorité des ZIEB ne bénéficient d’aucune mesure de gestion renforcée. Dans les eaux internationales, seuls 7% d'entre elles incluent une aire protégée. Plus la zone est vaste, dynamique et en haute mer, plus elle échappe à une régulation efficace. Les systèmes côtiers fréquemment regroupés dans les descriptions des ZIEB, présentent différents niveaux de vulnérabilité à divers facteurs de stress. Une différenciation et une délimitation plus poussées sur ces zones côtières seraient probablement nécessaires afin que des mesures de gestion puissent être envisagées. De nombreuses lacunes subsistent : peu de données sur les grands fonds, faible représentation des herbiers ou macroalgues, participation limitée de certains États. Des régions très riches comme les mers de Chine ou les archipels indonésiens restent peu couvertes. Les États-Unis et le Canada ont choisi de ne pas inclure leurs ZEE dans le processus des ZIEB, indiquant qu'ils avaient des processus internes en cours.
3) Pistes pour permettre une gestion améliorée
Attribuer une valeur à un lieu et attirer l'attention sur ce point est une chose, convaincre les autorités réglementaires de mettre en œuvre des mesures significatives pour assurer la pérennité de cette valeur et de prévoir un budget pour financer sa gestion, y compris un suivi de base permettant de comprendre la valeur existante ou perdue, en est une autre. Une reconnaissance internationale est importante pour stimuler et soutenir les initiatives nationales de gestion, en particulier dans les pays aux capacités scientifiques limitées. L'adoption du Traité international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine (BBNJ), signé par 115 États en 2023, a ouvert la voie à une nouvelle approche pour attribuer une valeur écologique afin d'orienter et de hiérarchiser l'élaboration de mesures de surveillance et de gestion. La société a déployé des efforts considérables pour mieux comprendre (à savoir collecter, analyser et synthétiser les données scientifiques et autres sources de connaissances) et ainsi pouvoir attribuer une valeur à ces lieux en tant que zones d'importance écologique et biologique . « Nous avons accumulé un océan de connaissances grâce au processus ZIEB, mais, comme pour notre océan mondial, la grande majorité reste à comprendre et à protéger adéquatement.
4) Disponibilité des données
Le référentiel ainsi que les informations sur les ZIEB sont disponibles sur le site officiel de la Convention sur la biodiversité biologique (CBD). Leurs périmètres sont à télécharger au format geojson dans la partie description des ZIEB examinées par la Conférence des Parties à la CDB (voir la carte interactive des dépôts).
Les critères scientifiques adopté en 2008 par la 9e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP9) pour définir les zones d'importance écologique ou biologique (ZIEB) étaient les suivants. Ils peuvent être vus comme un peu larges, mais ils ont le mérite d'exister :
- Unicité ou rareté de la zone
- Importance particulière pour les stades du cycle biologique des espèces
- Importance pour les espèces et/ou les habitats menacés, en voie de disparition ou en déclin
- Vulnérabilité, fragilité, sensibilité ou rétablissement lent
- Productivité biologique
- Diversité biologique
- Dimension naturelle
Pour aller plus loin
Un indispensable sommet sur l’océan (Le Monde). La troisième Conférence des Nations unies sur l’océan (UNOC-3) se tient à Nice, du 9 au 13 juin, en présence de 60 chefs d’Etat ou de gouvernement, sans les Etats-Unis. Même si les objectifs paraissent modestes, cette conférence doit permettre d’entretenir la mobilisation en faveur d’une cause qui concerne l’humanité tout entière.
Sommet sur les océans à Nice : on vous résume le débat sur les aires marines protégées (TF1). En amont de l'UNOC-3, Emmanuel Macron a annoncé vouloir "limiter l'activité" des chaluts de fond dans certaines zones des aires marines protégées françaises. Le sujet est central pour la protection des océans. Mais l'efficacité de ces zones conçues pour assurer une conservation pérenne des écosystèmes marins fait débat.
Obtenir des aires marines réellement protégées (Bloom). Selon cette association "entièrement dévouée à l’océan et à ceux qui en vivent", la France s’illustre par sa médiocrité en matière de protection de la biodiversité océanique. L'association Bloom préconise 11 règles d'or pour une pêche sociale et écologique. Ce rapport présente les travaux scientifiques d’une trentaine des plus grands spécialistes de l’océan à l’échelle mondiale. L’article scientifique "Repenser la durabilité des pêcheries marines pour une planète en évolution rapide" qui relate leurs travaux a été publié en septembre 2024 dans la revue npj Ocean Sustainability du journal Nature.
Protection des océans : des ONG portent plainte à Bruxelles pour l’arrêt du chalutage de fond dans les aires marines « protégées » (Libération). Cinq collectifs ont saisi la Commission européenne. Elles accusent la France, l’Italie et l’Allemagne de manquer à leur devoir de sauvegarder quinze écosystèmes marins, en violation d’une directive européenne datant de 1992.
Le sommet de l’ONU sur l’océan s’achève à Nice, avec un cap clair sur la haute mer (Le Temps). La ratification du traité sur la haute mer par une cinquantaine de pays, actée lundi à Nice, permet d’espérer une entrée en vigueur rapide de cet accord. Une COP dédiée est prévue dès 2026. Plusieurs pays, de la Colombie aux Samoa, annoncent de nouvelles aires marines protégées (AMP) ou renforcent celles existantes. L’océan passe ainsi de 8,34% à plus de 10% d’AMP. En France, seuls 4% des eaux sont mieux protégés, décevant les ONG. Le sommet pointe les « effets néfastes » du climat sur l’océan mais la déclaration finale ne parle pas d’une sortie des énergies fossiles, principale cause de l’acidification.
Programmes de l’UNESCO pour l’océan (2025). L’UNESCO propose plusieurs programmes pour mieux connaître, préserver et valoriser durablement les milieux océaniques.La mer, un objet hautement politique. La privatisation des territoires et ressources maritimes en acte (VertigO)
Comment l'océan est-il construit socialement ? Cela a été appréhendé à travers les méthodes des sciences sociales par la géographie, le droit, l'économie et l'histoire, mais peu par la sociologie, l'anthropologie ou encore la science politique. Les articles de ce numéro spécial de [VertigO] – La revue électronique en science de l'environnement contribue à combler cette lacune en partant de différentes approches et en mobilisant l'anthropologie, la sociologie politique, le droit et la géopolitique dans l'analyse de l'objet « gouvernance des mers et des océans ».Course à l’exploitation minière des fonds marins : l’impuissance du droit international ? (The Conversation)
Laisa Branco Coelho De Almeida doctorante à l’IHEID analyse l’impasse juridique autour de l’exploitation minière des grands fonds marins. Face aux ambitions d’acteurs comme Metals Company et aux manœuvres de Washington, l’autorité internationale est fragilisée. L’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), créée en 1982 par la Convention sur le droit de la mer, peine à imposer son Code minier. Les entreprises dénoncent les lenteurs, tandis que l’environnement exige des garanties strictes.Articles connexes
La carte de protection des océans proposée par Greenpeace pour 2030 : utopie ou réalisme ?
MPAtlas, un atlas de la protection marine pour évaluer les aires marines réellement protégées
Blanchissement des coraux et suivi satellitaire par la NOAA
Global Fishing Watch, un site pour visualiser l'activité des navires de pêche à l'échelle mondiale
Une évaluation mondiale des zones d'accès préférentiel pour la pêche artisanale
Vers de possibles variations dans la répartition des stocks de poissons (dans et hors ZEE) en raison du changement climatique
Une carte réactive de toutes les ZEE et des zones maritimes disputées dans le monde
Données cartographiques sur les énergies marines renouvelables consultables sur le Géoportail
Progression de la cartographie haute résolution des fonds marins (programme Seabed 2030 et GEBCO)
DeltaDTM : un modèle numérique de terrain côtier à l'échelle mondiale
Cartes et données pour alimenter le débat sur les attaques de requins dans le monde
-
 19:43
19:43 Medieval Murder Maps. Un site de cartographie interactive sur les meurtres en Angleterre à la fin du Moyen Âge
sur Cartographies numériquesLe site Medieval Murder Maps offre un aperçu unique de la violence et de la justice à la fin du Moyen Âge en Angleterre. Son fondateur, Manuel Eisner a repéré des centaines de meurtres à cette époque. En utilisant des registres du XIVe siècle et d'autres sources d'archives, l'historien directeur de l'Institut de criminologie de l'Université de Cambridge, a passé 15 ans à travailler sur des outils interactifs qu'il appelle « cartes de meurtres » avec l'aide d'une équipe. Réunis et analysés dans un article à comité de lecture, leurs résultats offrent un aperçu des dessous sombres de la vie médiévale à Londres, Oxford et York. Ils révèlent également des tendances qui pourraient surprendre les lecteurs d'aujourd'hui : certains des foyers les plus meurtriers se trouvaient dans les quartiers les plus aisés, et les étudiants universitaires figuraient parmi les tueurs les plus fréquents. Les auteurs ont également constaté que les meurtres avaient tendance à se concentrer dans les zones extérieures très fréquentées et que la majorité des tueurs bénéficiaient de l'impunité.
Référence scientifique
Eisner, M., Brown, S.E., Eisner, N. et al. (2025). Spatial dynamics of homicide in medieval English cities: the Medieval Murder Map project [Dynamique spatiale des homicides dans les villes médiévales anglaises : le projet Medieval Murder Map], Criminal Law Forum, [https:]] (article en accès libre).
Cette étude examine les schémas spatiaux des homicides dans trois villes anglaises du XIVe siècle – Londres, York et Oxford – à travers le projet Medieval Murder Map, qui visualise 355 cas d'homicides issus d'enquêtes judiciaires. En intégrant la criminologie historique aux théories contemporaines de la criminalité spatiale, les auteurs esquissent une nouvelle criminologie historique de l'espace, montrant la manière dont les environnements urbains ont façonné les schémas de violence meurtrière du passé. Les résultats révèlent des similitudes entre les trois villes. Les homicides étaient fortement concentrés dans des lieux clés de la vie urbaine tels que les marchés, les places et les voies publiques. Les schémas temporels indiquent que la plupart des homicides se produisaient le soir et le week-end, ce qui concorde avec la théorie des activités routinières. Oxford présentait des taux d'homicides bien plus élevés que Londres et York, ainsi qu'une proportion plus élevée de violences collectives organisées, suggérant des niveaux élevés de désorganisation sociale et d'impunité. Les analyses spatiales révèlent des zones distinctes liées aux conflits entre la ville et l'université et à la violence alimentée par les factions étudiantes. À Londres, les résultats suggèrent des groupes distincts d'homicides reflétant des différences de fonctions économiques et sociales. Dans les trois villes, certains homicides ont été commis dans des espaces à forte visibilité et à forte signification symbolique. Ces résultats mettent en évidence l'influence historique de l'espace public sur la violence urbaine. L'étude soulève également des questions plus larges sur le déclin à long terme des homicides, suggérant que les changements dans la gouvernance urbaine et l'organisation spatiale pourraient avoir joué un rôle crucial dans la réduction de la violence meurtrière.
Le site Medieval Murder Map
Le site Medieval Murder Maps ( [www.medievalmurdermap.co.uk] ) comprend trois villes : Londres, York et Oxford. Les sites ont été sélectionnés selon plusieurs critères : leur importance en tant que centres urbains dans l'Angleterre médiévale ; la disponibilité d'enquêtes de coroners s'étalant sur plusieurs années ; l'accès à des cartes historiques numériques de haute qualité ; et des considérations pratiques telles que l'expertise et les contraintes de temps. Les coroners étaient des fonctionnaires locaux représentant les intérêts de la Couronne, chargés principalement de mener des enquêtes sur les morts violentes ou suspectes. Leur rôle garantissait la protection des intérêts financiers royaux et la présentation des informations pertinentes aux tribunaux pour la mise en accusation lors des procès.Les cartes montrent les lieux d'homicides recensés au XIVe siècle. Le bleu indique les meurtres impliquant des hommes ; le rouge indique une victime ou un agresseur de sexe féminin. Les symboles indiquent les armes utilisées. Il est possible de sélectionner les données en fonction du genre de l'agresseur ou de la victime (homme ou femme), du jour et de l'heure de la semaine, du type d'arme utilisé, du lieu de l'événement.
Interface du site Medieval Murder Maps
L'auteur Manuel Eisner et son équipe
Manuel Eisner a étudié l'histoire à l'Université de Zurich et est titulaire d'un doctorat en sociologie. Il aa publié plusieurs ouvrages, comme auteur ou directeur de publication, ainsi que plus d'une 100e d'articles et chapitres de livres en anglais, allemand, espagnol et français. Ses travaux universitaires portent sur l'explication des causes, des conséquences et de la prévention de la violence interpersonnelle dans les sociétés humaines. ses recherches visent à répondre aux questions suivantes : comment décrire et expliquer les variations des niveaux de violence entre les sociétés et au cours de l'histoire humaine ? Quels mécanismes psychologiques et sociaux expliquent l'évolution et la stabilité des comportements violents au cours de la vie ? Quelle combinaison de prévention, d'intervention et de contrôle est la plus adaptée pour réduire la violence interpersonnelle dans différentes sociétés du monde ?
L'équipe de Murder Maps : Manuel Eisner, Sam Barnes, Dr Stéphanie Emma Brown, Birgitte Bruun, Simone Castello, Dr Nora Eisner, Charlie Inman, Jeremy Ries, Michael Rice, Ruth Schmid, Liam Kelly, Steve Hankey.
Pour aller plus loin
- « Just how bloody was medieval England ? A ‘murder map’ holds some surprises » (The Washington Post)
- « Who Killed the Innkeeper With a Sword in 1315 ? » (The New York Times)
- « Noblewoman may have ordered brazen murder of priest outside St Paul’s in 1337 » (The Guardian)
Numérisée en haute résolution, la carte médiévale de Fra Mauro peut être explorée en détail
La carte médiévale d'Ebstorf en version interactive et en téléchargement
Mapping Narrations, un ouvrage sur la cartographie au Moyen Âge et à l’époque moderne
Cartographie des fusillades de masse aux Etats-Unis : comment étudier et objectiver le phénomène ?
Cartes et données sur les conflits et violences dans le monde
Cartes et atlas historiques
-
 9:48
9:48 Cartes des taux d'application des pesticides dans l'Union européenne à une résolution spatiale de 250 m
sur Cartographies numériquesSource : Porta, G.M., Casse, L., Manzoni, A. et al. (2025). Pesticides application rate maps in the European Union at a 250?m spatial resolution. Science Data 12, 725 (article en open access), [https:]]
Les auteurs proposent une cartographie des taux d'application de pesticides dans l'Union européenne à une résolution spatiale de 250 mètres pour 53 ingrédients actifs en 2018. Les données sources comprennent des estimations mondiales des apports de pesticides, des cartes de cultures à haute résolution et l'utilisation de pesticides rapportée par les chiffres officiels d'EUROSTAT. Les taux d'application mondiaux de pesticides précédemment publiés dans PEST-CHEMGRIDS sont utilisés comme premières estimations. Ceux-ci sont ensuite ajustés à l'aide d'un ensemble de données d'étalonnage recueillies à partir de l'utilisation des pesticides en agriculture. L'estimation de la masse appliquée par pays et par type de culture est ensuite combinée à des cartes de cultures à haute résolution. La procédure prend explicitement en compte la qualité et l'incertitude des données grâce à une procédure d'estimation du maximum de vraisemblance. Ce produit de données présente des distributions spatiales détaillées des apports de pesticides, facilitant l'évaluation du devenir et du transport des pesticides, des transformations biogéochimiques ainsi que de l'évaluation des risques environnementaux.
Cartes des taux d'application des pesticides dans l'Union européenne à une résolution spatiale de 250 m (source : Porta, Casse, Manzoni et al., 2025).
Les cartes sont fournies au format géoréférencé (geotiff) utilisant les coordonnées projetées EPSG:3035. Pour chaque ingrédient actif les auteurs fournissent une carte d'estimation haute (H), médiane (M) et basse (L). Les données comprennent également une distribution d'indice de précision spatiale, qui indique la fidélité des cartes produites par rapport à l'ensemble de données d'étalonnage. La carte des cultures EUCM-CORINE-250 est également fournie, ainsi que les données sur les taux d'application. Toutes les données sont disponibles sur Figshare (7,8 Go de données à télécharger).Articles connexes
Carte de l'utilisation des pesticides en France et outre-mer
Cartographie des rejets de PFAS par les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
La moitié des pays du monde ont des systèmes d'eau douce dégradés (ONU-PNUE)
Connaître l'état des eaux souterraines de l'Union européenne (projet Under the Surface)
Impact de l’exposition à la pollution de l’air ambiant sur la survenue de maladies chroniques
Pollution de l'air et zones urbaines dans le monde
Agroclimat2050, un outil pour prévoir l'impact des événements météorologiques sur la production agricole
Un Atlas de la PAC pour une autre politique agricole commune
-
 14:00
14:00 Transformation des features Mapillary avec dbt
sur Geotribu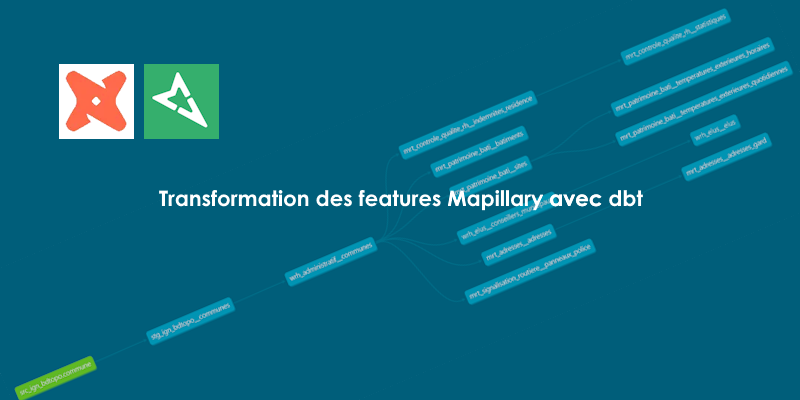 Transformation avec dbt des features extraites via les API de Mapillary au sein de la Modern Data Stack du Gard.
Transformation avec dbt des features extraites via les API de Mapillary au sein de la Modern Data Stack du Gard.
-
11:00
Makina Corpus participe et sponsorise State of the Map 2025
sur Makina CorpusDu 13 au 15 juin 2025 à Tours, Makina Corpus a le plaisir d’annoncer sa participation à State of the Map 2025 et d’apporter son soutien à l’événement de la communauté OpenStreetMap en le sponsorisant.
-
 13:33
13:33 « Reaching the Unreached » : comment la cartographie des routes a permis à des enfants en Afrique d’accéder à des vaccins vitaux
sur CartONGAu point A, dans un pays donné, se trouvent un groupe d’enfants dans un village isolé, pratiquement absent des cartes, et donc déconnecté du centre de santé situé au point C, à seulement quelques dizaines de kilomètres, et pourtant capable de leur sauver la vie. Il suffirait d’une ligne, une route, pour relier les points : ces enfants pourraient alors accéder à des vaccins vitaux.
-
20:34
[Le blog SIG & URBA] Outils carto à dispo
sur Géoblogs (GeoRezo.net)Il n'a jamais été si facile de produire des cartes. La palette des outils accessibles est large mais je fais ici le choix de zoomer sur deux solutions : Ma carte IGN, et uMap, pour vous donner envie d'aller plus loin. Dans le contexte actuel, je suis ravie de disposer de solutions que l'on peut qualifier de souveraines en particulier avec Ma carte IGN, libres et opensource. Les codes de ces 2 applications sont disponibles. Ma carte IGN
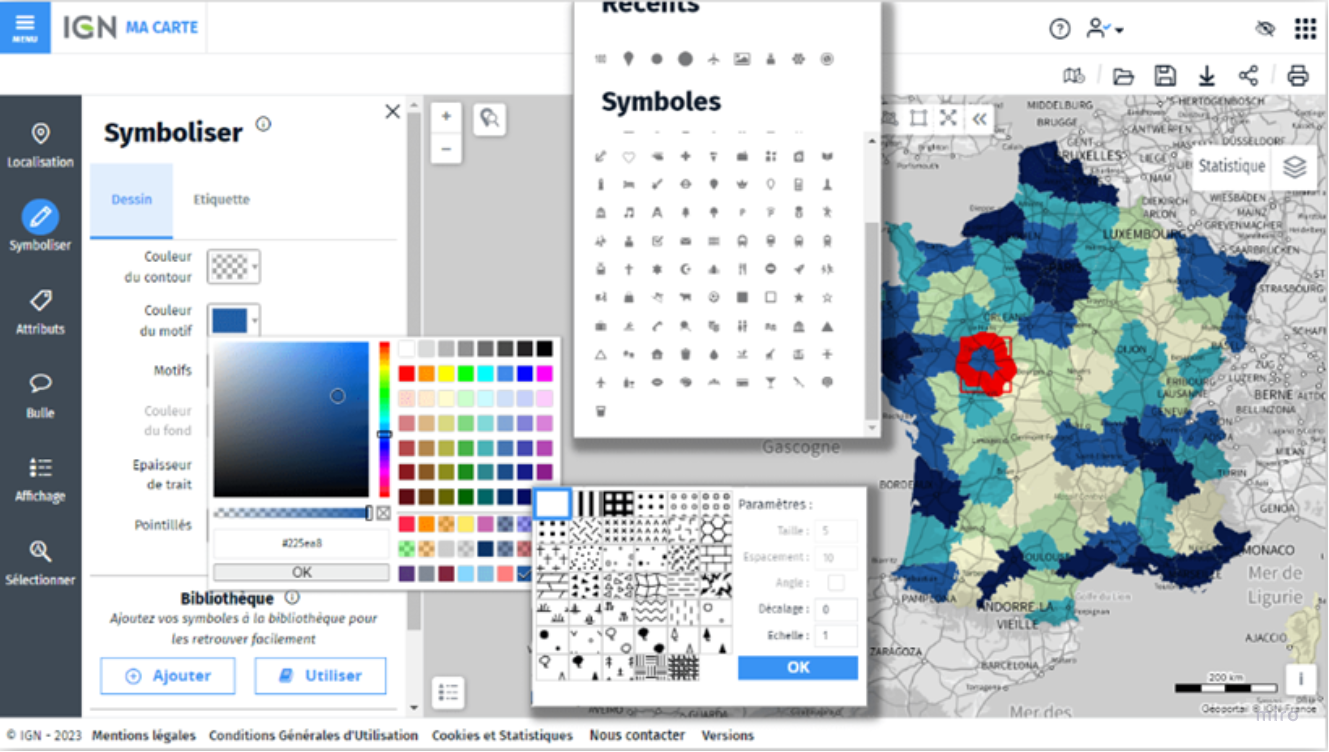 Ma carte IGN permet de créer des cartes personnalisées à partir de la formidable " bibliothèque de plans " de notre vénérable Institut National de l'Information Géographique et Forestière, qui a su se renouveler pour offrir des outils en sus de toutes les données qu'elle tient à jour. Cette solution est parfaite pour créer des cartes, des représentations statistiques, pour mettre tout ça sous forme d'atlas ou d'histoire (story map avec textes et illustrations), pour travailler en équipe ou pour les mettre à disposition. On est là dans la catégorie des outils que l'on peut qualifier de grand public. On peut rapidement réaliser la carte que l'on souhaite et la partager. Il existe des exemples de cartes dans l'atlas proposé sur le site : [https:]] . Pour en admirer une série particulièrement élaborée, réalisée par Jean-Marc Viglino, chef de projet à l'IGN, dans le cadre des #30DayMapChallenge, c'est ici : [https:] . Côté urbanisme, l'exemple du CAUE du Nord est particulièrement abouti et on retrouve nombre de leurs réalisations dans l'Atlas. A terme, Ma carte IGN doit intégrer cartes.gouv.fr, le service public des cartes et données du territoire. uMap uMap est un outil carto en ligne, qui permet d'intégrer des données dynamiques sur les fonds de plan d'OpenStreetMap, vue aérienne et fond IGN ou ses propres fonds de cartes. Ce n'est pas un outil spécifiquement français. Il s'appuie sur une organisation décentralisée avec des " instances " qui permettent au plus grand nombre d'utiliser cette solution. En France, il existe deux instances en particulier uMap OSMFr et FramaCarte. Depuis mai 2023, est développée également une instance plus spécifique pour les collectivités, portée par L'Incubateur des Territoires de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et la DIrection du NUMérique. Comme il est de mise dans ce type de projet, toute une animation accompagne la démarche. C'est une solution à la fois simple à mettre en place et riche en fonctionnalités pour ceux qui veulent aller plus loin, jusqu'à la gestion des droits utilisateurs. Il est possible de rajouter des calques ou même de se connecter avec son compte OSM pour faire des modifications de carte. J'aime bien cet article qui explique comment créer une carte uMap rédigé par Hortense Chevalier sur son site : [capnum.io] .
Ma carte IGN permet de créer des cartes personnalisées à partir de la formidable " bibliothèque de plans " de notre vénérable Institut National de l'Information Géographique et Forestière, qui a su se renouveler pour offrir des outils en sus de toutes les données qu'elle tient à jour. Cette solution est parfaite pour créer des cartes, des représentations statistiques, pour mettre tout ça sous forme d'atlas ou d'histoire (story map avec textes et illustrations), pour travailler en équipe ou pour les mettre à disposition. On est là dans la catégorie des outils que l'on peut qualifier de grand public. On peut rapidement réaliser la carte que l'on souhaite et la partager. Il existe des exemples de cartes dans l'atlas proposé sur le site : [https:]] . Pour en admirer une série particulièrement élaborée, réalisée par Jean-Marc Viglino, chef de projet à l'IGN, dans le cadre des #30DayMapChallenge, c'est ici : [https:] . Côté urbanisme, l'exemple du CAUE du Nord est particulièrement abouti et on retrouve nombre de leurs réalisations dans l'Atlas. A terme, Ma carte IGN doit intégrer cartes.gouv.fr, le service public des cartes et données du territoire. uMap uMap est un outil carto en ligne, qui permet d'intégrer des données dynamiques sur les fonds de plan d'OpenStreetMap, vue aérienne et fond IGN ou ses propres fonds de cartes. Ce n'est pas un outil spécifiquement français. Il s'appuie sur une organisation décentralisée avec des " instances " qui permettent au plus grand nombre d'utiliser cette solution. En France, il existe deux instances en particulier uMap OSMFr et FramaCarte. Depuis mai 2023, est développée également une instance plus spécifique pour les collectivités, portée par L'Incubateur des Territoires de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et la DIrection du NUMérique. Comme il est de mise dans ce type de projet, toute une animation accompagne la démarche. C'est une solution à la fois simple à mettre en place et riche en fonctionnalités pour ceux qui veulent aller plus loin, jusqu'à la gestion des droits utilisateurs. Il est possible de rajouter des calques ou même de se connecter avec son compte OSM pour faire des modifications de carte. J'aime bien cet article qui explique comment créer une carte uMap rédigé par Hortense Chevalier sur son site : [capnum.io] . Pour aller plus loin :
Merci à Sophie et Jean-Marc pour leur relecture.
-
 11:00
11:00 La situation financière des communes selon le revenu moyen par habitant
sur Cartographies numériques
Source : Guillaume Leforestier (2025). La situation des communes en 2023 selon les revenus de leurs habitants, Bulletin d'Information Statistique de la Direction générale des collectivités locales, n°194, avril 2025.La Direction générale des collectivités locales publie la situation des communes en 2023 selon les revenus de leurs habitants. Les communes dont les habitants disposent d'un revenu moyen élevé sont situées principalement sur le littoral, les régions frontalières avec la Suisse, l'Allemagne et le Luxembourg, ainsi que dans les zones périphériques des grands centres urbains. Cette géographie diffère de celle des communes analysées selon leurs recettes de fonctionnement par habitant, en raison notamment de leur modèle de financement, qui ne repose que partiellement sur les revenus des habitants. Pour autant, la situation financière des communes ayant des habitants à hauts revenus présente certains traits communs. Leurs recettes et des dépenses de fonctionnement par habitant sont un peu plus importantes. Au regard des différents indicateurs financiers, leur situation financière se révèle glo-balement plus favorable, surtout pour les communes de moins de 50 000 habitants. Pour ces der-nières, les différents ratios financiers sont sensibles au revenu des habitants, contrairement aux communes plus peuplées, hormis l'effort d'investissement. Les communes aux habitants les plus aisés consacrent une part plus importante de leurs dépenses dans certains domaines: culture, sport et jeunesse, santé et action sociale, ou encore transports, routes et voirie.
Le revenu moyen par habitant est appréhendé ici à travers le revenu fiscal de référence. Le modèle économétrique utilisé répartit les communes selon leur quartile de revenu moyen par habitant en 2022 et leur quartile de recettes de fonctionnement en 2023. Plus le revenu de leurs habitants est élevé, plus les communes appartiennent à des aires d'attraction des villes de grande taille. La situation est plus favorable pour les communes de moins de 50 000 habitants aux habitants à hauts revenus. Les efforts d'investissement et d'équipement sont globalement plus soutenus dans les communes aux habitants aisés. Les cartes et données peuvent être consultées sur le site de l'Observatoire des territoires.

La Direction générale des collectivités locales publie régulièrement des analyses statistiques. Pour accéder aux différents numéros du Bulletin d'Information Statistique (BIS) de la DGCL, cliquez sur ce lien. Voir notamment le numéro concernant les structures territoriales au 1er janvier 2025.
Pour compléter
L'INSEE fournit chaque année des données sur la structure et la distribution des revenus ainsi que l'inégalité des niveaux de vie en France. Ces données sont issues du dispositif Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) et sont disponibles à différents niveaux géographiques (régions, départements, arrondissements, EPCI, EPT, CTCD, communes, aires d'attraction des villes, unités urbaines, zones d’emploi).
L'Observatoire des inégalités a publié en février 2025 un palmarès des villes françaises les plus inégalitaires.
Articles connexes
Cartographier les inégalités en France à partir des données carroyées de l'INSEE
Données sur la localisation et l’accès de la population aux équipements (BPE) en France
L'INSEE propose une nouvelle typologie des aires urbaines en fonction de leur niveau d’attraction
L'Insee propose un nouveau gradient de la ruralité
Cartes et données sur les « déserts médicaux » en France
La carte de la pauvreté en France en trois dimensions (Observatoire des inégalités)
Étudier les inégalités entre établissements scolaires à partir de l'Indice de position sociale (IPS)
Etudier la métropolisation et les dynamiques urbaines en France avec les données INSEE
-
 14:00
14:00 Extraction et chargement des features Mapillary avec Apache Airflow
sur Geotribu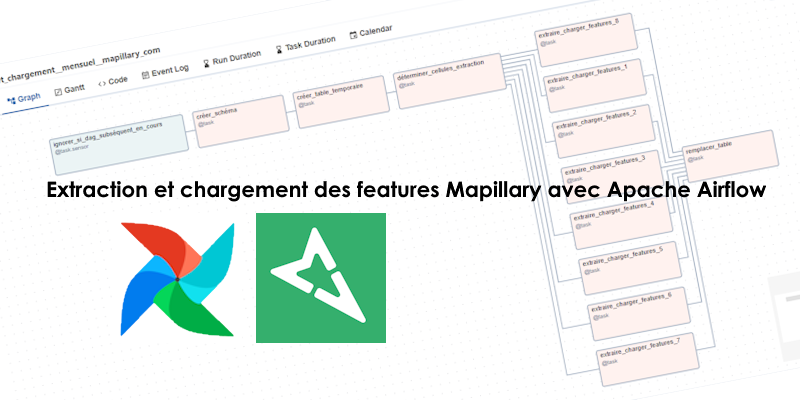 Utilisation des API de Mapillary au sein de la Modern Data Stack du Gard pour extraire et charger des objets détectés (features) sur les images.
Utilisation des API de Mapillary au sein de la Modern Data Stack du Gard pour extraire et charger des objets détectés (features) sur les images.
-
13:49
Nantes Métropole lance son Observatoire de la Biodiversité Métropolitaine
sur Makina CorpusNouvel outil pour suivre la biodiversité à Nantes MétropoleAccessible en ligne à l’adresse observatoire-b
-
 8:06
8:06 Les Géodata Days les 10 et 11 septembre 2025 à Marseille
sur Conseil national de l'information géolocaliséeLes Géodata Days les 10 et 11 septembre 2025 à Marseille
-
11:00
Mise en place d'une passerelle API entre Geotrek et Cirkwi
sur Makina CorpusCet article présente le développement de la passerelle bidirectionnelle permettant l’échange de données entre Cirkwi et Geotrek, ainsi que la configuration nécessaire à sa mise en service sur une instance Geotrek.
-
 19:07
19:07 2e séminaire du progamme CartAsia de la BnF, 27 juin 2025
sur Cartes et figures du mondeLa cartographie d’Asie de l’Est à la BnF :
construction et composition d’une collection nationale (XVIIe-XXe siècle)BnF- site Richelieu, salle des conférences
27 juin 2025Entrée libre dans la limite des places disponibles
https://www.bnf.fr/fr/agenda/lasie-de-lest-en-cartes

Le programme CartAsia, lancé en 2024 dans le cadre du plan quadriennal de la recherche de la Bibliothèque nationale de France, étudie un important corpus cartographique en provenance d’Asie de l’Est conservé dans les collections de la Bibliothèque. Mené par le département des Cartes et plans, avec l’appui de nombreux partenaires scientifiques et institutionnels en France et dans le monde, il a pour objectif de faire connaître et donner accès à cet ensemble dispersé et jusqu’ici difficile à identifier.
Cette seconde journée d’étude se penche sur le corpus coréen et sur les grandes collections de cartographie d’Asie de l’Est conservées dans les institutions parisiennes.
9:00 Accueil
9:15 Eve Netchine, BNF
Le programme de recherche CartAsia : résultats et perspectives
9:30 Haengri Cho, OKCHF- Eve Netchine, BNF
Décrire les cartes coréennes : un partenariat OKCHF-BNF
9:45 Professor Kihyuk Kim, Pusan National University
Les cartes coréennes anciennes de la BNF et leurs liens avec les cartes des collections coréennes
10:30 Jungki Cho, EHESS-OKCHF-BNF, Catherine Hofmann, BNF
Provenances et circulation des cartes du fonds coréen de la BnF
Pause
11:15 Pierre-Emmanuel Roux, CCJ – EHESS
Les cartes hybrides, support du transfert de connaissance
12:00 Romain Lefebvre, BNF, département des Manuscrits, Julie Garel-Grislin, BNF, département des Cartes et plans
Présentation des cartes coréennes de la BNF
Déjeuner libre
14:30 Les collections de cartes d’Asie de l’Est à Paris, table ronde animée par Eve Netchine
Benjamin Guichard, Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations
Cristina Cramerotti, bibliothèque du Musée National des Arts Asiatiques-Guimet
Delphine Spicq, bibliothèque d’études chinoises, Collège de France
Katia Juhel, bibliothèques de l’École française d’Extrême OrientPause
16:00 Vera Dorofeeva-Lichtmann , CCJ, EHESS
Les atlas coréens comportant des cartes circulaires du monde: origines et histoire de leur étude
16:45 Echanges et conclusionsAccès
5, rue Vivienne ou 58 rue Richelieu 75002 Paris
[https:]
-
11:00
RODolPh : un écho médiatique révélateur d’un enjeu national
sur Makina CorpusDepuis son lancement, RODolPh suscite un vif intérêt auprès des collectivités et des médias spécialisés. Découvrez les retombées presse liées à la plateforme pour optimiser la gestion de la Redevance d’Occupation du Domaine Public.
-
10:13
[La Minute GeoRezo] State of the map (SOTM) France - 13 au 15 juin 2025 à Tours
sur Géoblogs (GeoRezo.net) La onzième édition des Rencontres Nationales OpenStreetMap (SOTM pour les initiés) arrivent à Tours. Les 13-14-15 juin 2025, durant 3 jours, contributeurs, utilisateurs, représentants de collectivités et d'entreprises gravitant autour du Web et de l'information géographique, chercheurs, mais aussi personnes curieuses de découvrir cette " base de données libre du monde " que représente OSM, se retrouveront pour partager leurs expériences, se tenir informé, se former, découvrir l'écosystème et les multiples applications - existantes ou à imaginer - autour d'OpenStreetMap.
La onzième édition des Rencontres Nationales OpenStreetMap (SOTM pour les initiés) arrivent à Tours. Les 13-14-15 juin 2025, durant 3 jours, contributeurs, utilisateurs, représentants de collectivités et d'entreprises gravitant autour du Web et de l'information géographique, chercheurs, mais aussi personnes curieuses de découvrir cette " base de données libre du monde " que représente OSM, se retrouveront pour partager leurs expériences, se tenir informé, se former, découvrir l'écosystème et les multiples applications - existantes ou à imaginer - autour d'OpenStreetMap.
-
 11:30
11:30 Calendrier des prochaines formations sur les Données Foncières
sur Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)Publié le 20 août 2023Retrouvez le calendrier des formations sur les données foncières Sessions sur les Fichiers fonciersFormation certifiée Qualiopi Sessions sur DV3FFormation certifiée Qualiopi Sessions sur les Données Foncières (Fichiers fonciers + DV3F)Formation certifiée (…)
Lire la suite
-
 20:27
20:27 Flux de migrants en zone endémique paludéenne (2010)
sur Carnet (neo)cartographiqueLe site du World Population Project propose depuis quelques années au téléchargement, un jeu de données intéressant sur les flux de migrants internes à la zone endémique paludéenne africaine. Je me suis souvent dit qu’il fallait que je réalise une carte à partir de ces données rendues accessibles librement et gratuitement par un collectif de collègues rassemblé autour de Alessandro Sorichetta, Tom J. Bird et Nick W. Ruktanonchai. C’est chose faite aujourd’hui.
Les cartes ont été réalisées avec la version 2 de Arabesque en cours de test, dans le cadre de sa consolidation – j’en parlerai plus tard. Pour celles et ceux intéressées, la version de développement est toujours accessible ici.
Cette première carte décrit l’ensemble des données de ces données de mobilités liées à la malaria, qui concernent plus de 22 millions de migrants circulant entre différentes localités de l’Afrique subsaharienne.
L’attention est attirée sur le fait que ces valeurs ne sont pas des données réelles, c’est-à-dire observées sur le terrain, mais des valeurs théoriques. Elles ont été estimées à partir d’un modèle d’interactions spatiales de type gravitaire [voir] à partir de données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la prévalence du paludisme (malaria) dans les zones endémiques. Les données ont été modélisées en 2010 et publiées en 2016 pour chacun des pays, d’où cette apparente limitation des mobilités à l’intérieur des États – il n’en est rien, ou, plutôt, ce n’est pas le sujet ici : les flux internationaux n’étant pas mobilisés.
Pour aller un peu plus loin que cet effet spaghetti, il est possible de ne représenter que les flux les plus importants en volume. La carte ci-dessous décrit les 40% des plus importants (ceux qui supérieurs à 2678 personnes) et qui concernent 8 millions de personnes qui ont migré entre 55% des localités.
Au-delà de la partition des pays (non représentée ici, car peu pertinente), il est intéressant de visualiser la concentration spatiale des flux les plus importants dans les zones humides ou en eau affectionnées par les anophèles. D’abord dans la région des grands lacs de l’Est : celle du lac Victoria et autour du Tanganyka jusqu’au lac Malawi. Aussi le long de la côtière, du Cap-Vert au sud du fleuve Congo, en passant par le Cap des Palmes et le Cap de la Baie des îles Bonny au large de Malabo, en Guinée Équatoriale ; la prévalence du paludisme étant visible sur de larges zones marquées par un réseau de mobilités qui s’étend depuis l’embouchure des grands fleuves (Bandama, Volta, Niger, Sanaga et Congo) jusqu’à leurs arrière-pays. Observez sa densité sur quasiment tout le parcours du fleuve Niger ou de la Sanaga par exemple. Les capitales et grandes villes ne sont pas en reste, avec des effectifs notables qu’elle polarise à Yaoundé et Douala, Porto-Novo, Kaduna et Kano, Ouagadougou, mais aussi et plus à l’ouest : Abidjan, Bamako, Djourbel et Dakar.
Références :
Sorichetta, A., Bird, T., Ruktanonchai, N. et al. Mapping internal connectivity through human migration in malaria endemic countries. Sci Data 3, 160066 (2016). [https:]
Sorichetta A. et al. Data Descriptor Mapping internal connectivity through human migration in malaria endemic countries. Sci Data 3, 160066 (2016). [https:]
World Population data Hub : Migration flows Africa
Notes : Ces deux cartes ont été éditées en sortie d’Arabesque avec un logiciel de retouche d’images, pour le seul ajout des textes. Elles ne présentent pas de légende ni des nœuds et ni des liens, j’en suis consciente. Arabesque ne sait pas encore dessiner correctement à mon sens les légendes. Un verrou technique que nous essaierons de dénouer prochainement.
Géographe et cartographe, Chargée de recherches à l'IFSTTAR et membre-associée de l'UMR 8504 Géographie-Cités.
-
 12:54
12:54 Agroclimat2050, un outil pour prévoir l'impact des événements météorologiques sur la production agricole
sur Cartographies numériquesSerge Zaka (sergezaka.bsky.social), qui est ingénieur agronome et docteur en agroclimatologie, s'est fait connaître en tant que lanceur d'alerte sur les impacts du changement climatique sur la production agricole. Il a créé le site Agroclimat2050 (agroclimatologie.com) qui entend devenir le premier service cartographique agroclimatique de France.
L'outil « gratuit, sans compte et ouvert à tous » vise à cartographier les risques agroclimatiques. Il propose actuellement les pertes de fleurs dues au gel, à une résolution de 1,3 km² sur toute la France, et de 5 à 12 km² sur l’ensemble de l’Europe. La pomme et la mirabelle ont également été ajoutés. A terme, d'autres cultures et arbres fruitiers vont rejoindre la danse. Les données sont issues du modèle ARPEGE (Météo-France) et de l'opendata du gouvernement français. Les prévisions s'appuient également sur les données des modèles de prévisions numériques Global Forecast System (GFS/NOAA) et AROME (Météo-France).
À terme, le site proposera :
- L’accessibilité des parcelles agricoles
- Des indices de stress thermique pour une dizaine d’animaux d’élevage
- Des indices de développement pour plusieurs maladies et ravageurs
- L’échaudage des céréales et le stress thermique et hydriques pour toutes les grandes cultures.
- La vitesse de croissance des légumes potagers, en irrigué ou non ou des grandes cultures.
- Les cumuls de degrés-jours pour toutes les espèces agricoles en France
Il s’agit encore d’un prototype. « Soyez indulgents : ce projet est entièrement autofinancé, développé avec mes propres moyens, au service du monde agricole ». Ces prévisions ne doivent pas être utilisées pour la protection des biens et des personnes. En aucun cas la responsabilité de leur auteur ou d'Agroclimat2050 ne pourrait être engagée. Ainsi, Agroclimat2050 souligne que ses prévisions sont informatives et ne remplacent pas les informations officielles des services météorologiques nationaux.
[Surprise] Une révolution dans le paysage agricole : voici le 1er service cartographique agroclimatique de France ! agroclimatologie.com Cela fait un an que je travaille, en toute discrétion, sur un outil GRATUIT, SANS COMPTE, OUVERT A TOUS, pour cartographier les risques agroclimatiques. 1/6
— Dr. Serge Zaka (@sergezaka.bsky.social) 6 avril 2025 à 23:51
[image or embed]Pour compléter
Interview de Serge Zaka pour la Chambre d'agriculture de l'Ain.
« Il se consacre à l’étude de l’impact du changement climatique sur l’agriculture, qu’il s’agisse des grandes cultures, du maraîchage, de l'arboriculture, de la viticulture, de l’élevage. Son mot d’ordre : anticiper. Grâce à une approche scientifique rigoureuse, il s’efforce de mieux comprendre et prévoir ces transformations afin d’identifier des stratégies d’adaptation et d’atténuation. L’objectif est clair : préserver une production agricole durable, résiliente et de qualité afin que la France garde son indépendance agricole d’ici 2050. Serge ZAKA répond à nos questions. »Il faut sortir de la politique pansement, court-termiste : pour révolutionner l'agriculture, les pistes de l'agroclimatologue Serge Zaka (FranceInfo).
« Nouvelles cultures, gestion de l'eau, travail du sol : face aux pertes de plus en plus importantes des agriculteurs, l'agroclimatologue Serge Zaka nous présente ses solutions pour faire face au changement climatique dans la région. »Benjamin Nowak, maître de conférences en agronomie, propose des cartes pour le suivi des cultures, les sciences du sol et les cycles biogéochimiques (principalement du carbone, de l'azote et du phosphore).
Lien ajouté le 26 juin 2025
Le Système canadien de surveillance des terres agricoles (SCSTA) fournit des données sur les anomalies hebdomadaires de l'indice de végétation naturelle (NDVI) ainsi que des cartes hebdomadaires sur l'état des cultures tout au long de la saison de croissance. Les données (de 2000 à aujourd'hui) sont à télécharger gratuitement sur le site ouvert.canada.ca.Lien ajouté le 29 juin 2025
« Les prévisionnistes manipulent-ils les cartes météo pour nous affoler sur le déclin du climat ? » (France-Info). Des climatosceptiques accusent les prévisionnistes d'orienter les couleurs des cartes météo pour dramatiser les épisodes de chaleur. Les spécialistes démentent et prouvent le contraire.
Articles connexesClimate Change Tracker, un tableau de bord pour étudier le changement climatique global
Climate Change Explorer, un outil cartographique pour visualiser les projections climatiques
Atlas climatique interactif Copernicus
Aborder la question de l'inégalité des pays face au changement climatique
Quels sont les États qui ont le plus contribué au réchauffement climatique dans l’histoire ?
Carte mondiale d'exposition aux risques climatiques, de conflit et à la vulnérabilité
Carte de l'utilisation des pesticides en France et outre-mer
Data visualisation sur la responsabilité et la vulnérabilité par rapport au changement climatique
Les stations de montagne face au changement climatique (rapport de la Cour des comptes)
Impact du changement climatique sur le niveau des nappes d'eau souterraines en 2100
Rapport annuel 2023 du Haut conseil pour le climat « Acter l’urgence, engager les moyens »
-
 9:10
9:10 Résultats d'enquête dans 125 pays concernant le soutien réel et perçu à l’action climatique
sur Cartographies numériques
Source : Andre, P., Boneva, T., Chopra, F. et al. (2024). Globally representative evidence on the actual and perceived support for climate action. Nature Climate Change, 14, p. 253–259 (article disponible en open access), [https:]]Des chercheurs ont interrogé environ 130 000 personnes dans 125 pays à travers le monde sur le changement et le réchauffement climatique. Ils ont constaté que 89 % des personnes souhaitaient davantage d’action politique pour lutter contre le changement climatique. Comme il s'agit de données déclaratives, l'enquête reflète plus des perceptions que des pratiques. Cette enquête mondiale sur le changement climatique permet malgré tout de remettre en cause la représentation commune selon laquelle l'opinion serait frileuse par rapport à l'action climatique.
Résumé
L'atténuation du changement climatique nécessite une coopération mondiale, mais les données mondiales sur la volonté d'agir des individus restent rares. Dans cette étude, les chercheurs ont conduit une enquête représentative dans 125 pays, auprès d'environ 130 000 personnes. Les résultats révèlent un large soutien à l'action climatique : 69 % de la population mondiale se déclare prête à contribuer à hauteur de 1 % de son revenu personnel, 86 % adhère aux normes sociales pro-climat et 89 % exige une action politique renforcée. Les pays confrontés à une vulnérabilité accrue au changement climatique affichent une volonté de contribuer particulièrement élevée. Malgré ces statistiques encourageantes, on constate que le monde est plongé dans une forme d'ignorance généralisée, où les individus sous-estiment systématiquement la volonté d'agir de leurs concitoyens. Ce décalage de perception, combiné à un comportement individuel coopératif conditionnel, pose des défis pour la poursuite de l'action climatique. Par conséquent, sensibiliser au large soutien mondial à l'action climatique devient crucial pour promouvoir une réponse unifiée au changement climatique.
Un soutien mondial généralisé à l'action climatique (source : Andre et al., 2024).
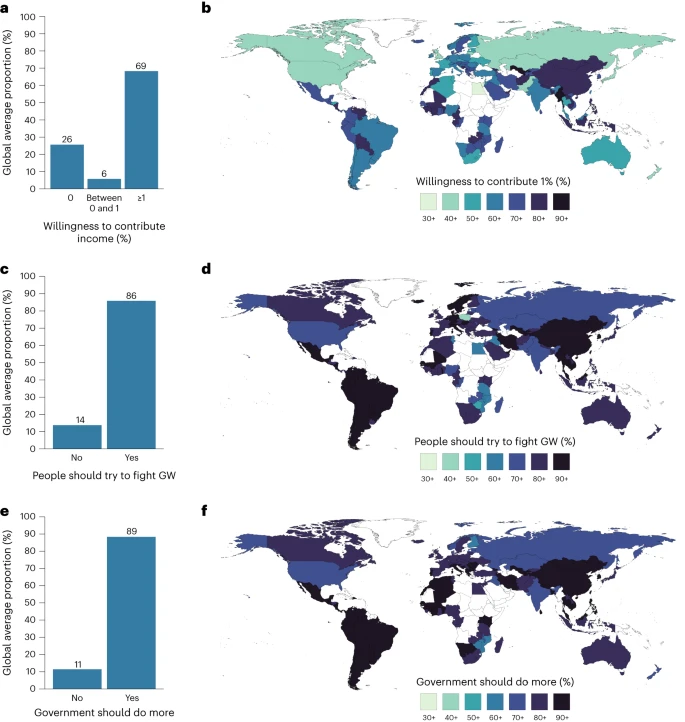
a, c, e Proportions moyennes mondiales de répondants disposés à contribuer à hauteur de 1 % de leur revenu (a), approuvant les normes sociales pro-climatiques (c) et exigeant une action politique (e). Des pondérations ajustées en fonction de la population sont utilisées pour garantir la représentativité au niveau mondial.
b, d, f Cartes du monde dans lesquelles chaque pays est coloré en fonction de sa proportion de répondants disposés à contribuer à hauteur de 1 % de leur revenu (b), approuvant les normes sociales pro-climatiques (d) et exigeant une action politique (f). Des pondérations ont été effectuées pour tenir compte de la procédure d'échantillonnage stratifié.
Les chercheurs ont conçu cette enquête mondiale sur le changement climatique afin d'obtenir des données représentatives à l'échelle mondiale sur la volonté d'agir contre le changement climatique. L'enquête a été menée dans le cadre du sondage mondial Gallup 2021/2022 auprès d'un ensemble vaste et diversifié de pays (N =125) en utilisant une méthodologie d'échantillonnage et d'enquête commune (voir la méthodologie). Les pays inclus dans cette étude représentent 96 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), 96 % du produit intérieur brut (PIB) mondial et 92 % de la population mondiale. Afin de garantir la représentativité nationale, chaque échantillon de pays a été sélectionné aléatoirement parmi la population résidente âgée de 15 ans et plus. Les entretiens ont été menés par téléphone (courant dans les pays à revenu élevé) ou en face à face (courant dans les pays à faible revenu), avec des numéros de téléphone ou des adresses tirés au sort. La plupart des échantillons nationaux comprennent environ 1 000 répondants, et l'échantillon mondial comprend un total de 129 902 personnes.
Les données de l'Enquête mondiale sur le changement climatique sont disponibles à l'adresse [https:]] . Les références et la documentation des données externes et propriétaires, telles que celles du sondage mondial Gallup, sont disponibles dans les Informations supplémentaires.
Articles connexes
Aborder la question de l'inégalité des pays face au changement climatique
Quels sont les États qui ont le plus contribué au réchauffement climatique dans l’histoire ?
Carte mondiale d'exposition aux risques climatiques, de conflit et à la vulnérabilité
Le choc climatique frappe déjà les villes les plus peuplées du monde (rapport WaterAid)
Data visualisation sur la responsabilité et la vulnérabilité par rapport au changement climatique
Densité du trafic maritime mondial et effets sur le réchauffement climatique
Climate Trace, une plateforme pour visualiser et télécharger des données sur les émissions de gaz à effet de serre (GES)
Climate Change Explorer, un outil cartographique pour visualiser les projections climatiques
Atlas climatique interactif Copernicus
Les stations de montagne face au changement climatique (rapport de la Cour des comptes)
Impact du changement climatique sur le niveau des nappes d'eau souterraines en 2100
Rapport annuel 2023 du Haut conseil pour le climat « Acter l’urgence, engager les moyens »
-
 10:51
10:51 Atlas de l'architecture scolaire de La Réunion
sur Cartographies numériques
En partenariat avec la DAC-Réunion et le laboratoire ICARE (Université de La Réunion), nous avons le plaisir de mettre en ligne un Atlas de l'architecture scolaire de La Réunion.
1) Histoire du bâti scolaire à La RéunionLa démocratisation de la fréquentation scolaire à La Réunion s'inscrit dans un processus au long terme qui débute avec les premiers effets de la départementalisation de mars 1946 et les politiques de « rattrapage » menées à partir des années 1960. L'augmentation massive de la population scolaire s'accompagne de la nécessité de favoriser l'accueil des élèves et donc de prévoir la construction de bâtiments spécifiquement dédiés à l'enseignement. L'île étant très largement sous-équipée en infrastructures scolaires au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les autorités utilisent le plus souvent des expédients, comme la construction de classes « semi-provisoires » à coût réduit de type « Éclair », avant de pouvoir envisager leur mise aux normes, d'abord de manière timide, puis plus exclusivement à partir des années 1970-1980. Divers fonds et crédits sont alors mobilisés pour stimuler une expansion rapide du système éducatif de l'île. Comme en métropole, cette mise aux normes des bâtiments scolaires a été pensée pour mieux contrôler les coûts grâce à l'industrialisation de la production d'éléments de construction. Pour répondre à ce besoin pressant, des instructions sont établies afin de mettre en œuvre des programmes de construction répondant à des normes précises conçues sous la forme de plans d'écoles et de modèles de constructions destinés à en faciliter l'exécution.
Les choix architecturaux résolument novateurs adoptés à partir des années 1950-1960 sont à mettre en lien avec l'influence de quelques cabinets d'architectes métropolitains qui s'adaptent par l'intermédiaire d'architectes réunionnais des normes architecturales pensées pour l'hexagone. La construction à partir des années 1960 de deux importantes cités scolaires à Saint-Benoît et à Saint-Denis entérine l'adoption de principes architecturaux uniformes, mettant l'accent sur une utilisation maximale de la préfabrication, tout en jouant avec les motifs des façades, la superposition de galeries ouvertes et de salles de cours traversantes, la fonctionnalité étant recherchée pour les divers espaces.
Ces évolutions illustrent l'influence des mouvements architecturaux résolument modernes. Les bâtiments sont conçus en fonction de leur utilité et de leur destination, avec une attention particulière accordée à l'efficacité. La simplicité est envisagée comme une esthétique moderne. L'utilisation de nouveaux matériaux tels que le béton ou l'acier est privilégiée. Une attention particulière est accordée à la luminosité naturelle et à la connexion visuelle avec l'environnement. Les espaces intérieurs sont conçus selon des plans libres, souvent dépourvus de murs porteurs, offrant une flexibilité dans l'organisation de l'espace. Enfin, les toits plats ou terrasses sont exploités.
Malgré les difficultés d'approvisionnement en matériaux modernes, l'inadéquation de certaines modalités des structures au foncier et des ouvrants aux conditions climatiques, ces nouvelles normes architecturales ont été largement dominantes à La Réunion jusqu'aux années quatre-vingt où les projets moins génériques s'ouvrent quelque peu à la diversité des styles en vue d'une adaptation plus poussée au contexte. Les questions liées à l'hygiène et à la santé des élèves ont pu guider un certain nombre de choix. De même, la question des enseignements est parfois évoquée pour expliquer la présence d'espaces dédiés à certaines disciplines ou encore l'intégration de nouvelles normes technologiques dans les apprentissages. Pourtant, il semble bien que le moteur de cette inflation normative soit purement financier et économique. Un autre constat montre que la normalisation reste par bien des points identiques à celle exploitée pour les établissements en métropole mais s'inscrivent dans une temporalité bien spécifique. Pensées pour des établissements dans des contextes territoriaux et politiques bien différents, les normes architecturales appliquées à La Réunion ont nécessité de nombreuses adaptations de la part des responsables locaux et certaines adaptations de la part du législateur.
Sources des données (dont images) : Étude d'identification d'édifices scolaires et universitaires remarquables construits à La Réunion entre les années 1920 et 1990, commandée par la DAC-Réunion et réalisée par l'agence Bruno Decrock.
2) Mode d'emploi de l'Atlas en ligne
Depuis la page d'accueil du site, vous pouvez filtrer les données par "type d'établissement" puis "voir l'échantillon des exemples architecturaux illustrés". Il est possible de cliquer directement sur un établissement de votre choix sur la carte interactive.

L'Atlas permet de zoomer sur l'environnement de l'établissement à l'échelle du quartier et de faire apparaître sa fiche (notice historique et description détaillée des bâtiments). Des vues au sol ainsi que des plans d'établissements sont présentés dans les différentes notices.L'Atlas de l'architecture scolaire de La Réunion s'inscrit dans le cadre du projet GEORUN - Matériaux pour une géographie de l’école réunionnaise, porté par l'Institut coopératif austral de recherches en éducation (Icare, EA 7389) au sein de l'université de La Réunion. Il fait partie de l'Atlas des territoires éducatifs à La Réunion.
Articles connexes
Atlas des territoires éducatifs à La Réunion
Atlas des paysages de La Réunion
L'histoire de La Réunion par les cartes
L’autosuffisance alimentaire est-elle possible pour La Réunion ?
La carte, objet éminemment politique : la Réunion au coeur de l'espace Indo-Pacifique ?
-
 22:17
22:17 Cartographie de la qualité des données d'enquêtes dans 33 pays d'Afrique subsaharienne
sur Cartographies numériquesSource : Seidler, V., Utazi, E.C., Finaret, A.B. et al. (2025). Subnational variations in the quality of household survey data in sub-Saharan Africa. Nature Communications, 16, 3771, [https:]]
On suppose souvent que les enquêtes nationales auprès des ménages sont uniformes et de bonne qualité. Une nouvelle étude révèle d’énormes différences infranationales dans la qualité des données dans 35 pays d'Afrique. L'étude, publiée dans Nature Communications, analyse les données géocodées à une résolution de 5 km. Elle met en lumière des défis pour l'élaboration des politiques de santé et de développement. Les chercheurs se concentrent sur trois types d’erreurs de données : l'âge incomplet (mois ou année de naissance manquant), l'âge cumulé (âges se terminant par 0 ou 5), les données manquantes ou invraisemblables sur la taille des enfants. Ce sont des indicateurs largement utilisés qui garantissent la qualité des données. À l'aide de modèles géostatistiques, ils ont cartographié ces indicateurs à haute résolution spatiale. Ils ont ensuite agrégé les résultats aux niveaux régional et national, pondérés par la population. Les résultats montrent une variation extrême au sein d'un même pays. Par exemple, au Nigéria, la répartition par âge entre 2006 et 2019 variait de 25 % à plus de 60 % selon les districts. Au Tchad, les données manquantes sur l'âge variaient de 8 % à plus de 90 % selon les régions. Une découverte majeure : la qualité des données se dégrade à mesure que l’on s’éloigne des zones habitées. Dans les zones rurales et reculées, les données manquantes, les mesures imprécises et autres erreurs deviennent beaucoup plus fréquentes.
Des données de mauvaise qualité peuvent induire en erreur les décideurs politiques, entraîner une mauvaise allocation des ressources et ne pas permettre de saisir les véritables besoins des populations isolées. À défaut d'identifier ces problèmes, les interventions risquent de manquer leurs objectifs. Les chercheurs proposent un outil de visualisation en ligne pour analyser la qualité des données en Afrique. Cet outil aidera les utilisateurs à évaluer les risques et à ajuster leurs analyses en conséquence.
Lien vers l'application cartographique :
Articles connexes
Les évolutions de l'Indice de Développement Humain (IDH) : vers un indicateur infranational ?
Calculer l'indice de richesse relative à une échelle infra-nationale pour les pays pauvres ou intermédiaires
Une cartographie très précise des densités à l'échelle mondiale pour améliorer l'aide humanitaire
Étudier les migrations à l'échelle infranationale pour l'ensemble des pays du monde
Cartographier les bâtiments en Afrique à partir d'images satellites
Africartes : toute l’Afrique en cartes et en accès libre sur le site de l'AFD
Africapolis, un projet pour cartographier au plus près l’Afrique urbaine
Frontières et conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest
Cartographie des arbres dans les zones arides et semi-arides de l'Afrique de l'ouest

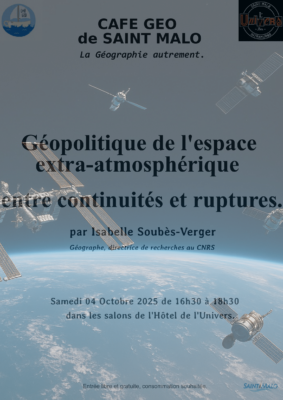
 EN
EN